De qui vient « l’apport créatif » dans la production des séries télévisées ? – David BUXTON
La question de l’apport créatif ou artistique a toujours posé problème dans l’analyse des séries télévisées, tant leur production est industrielle, et tant elles résistent à la notion d’auteur, qui a permis aux études du cinéma d’intégrer la culture humaniste. À cet égard, le statut artistique de la série télévisée reste incertain, et même les productions jouissant d’un succès d’estime tendent à disparaître dans un trou noir, une fois sorties de l’antenne.
Article interdit à la reproduction payante
Contenu
Qui est « l’auteur » d’une série ?
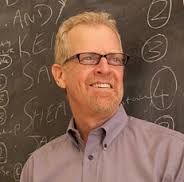
La question de l’apport créatif ou artistique a toujours posé problème dans l’analyse des séries télévisées, tant leur production est industrielle, et tant elles résistent à la notion d’auteur, qui a permis aux études du cinéma d’intégrer la culture humaniste. À cet égard, le statut artistique de la série télévisée reste incertain, et même les productions jouissant d’un succès d’estime tendent à disparaître dans un trou noir, une fois sorties de l’antenne. Il est difficile de voir un auteur dans le réalisateur d’un épisode de série pour deux raisons : la durée standard de tournage en sept jours l’oblige à « rendre » un scénario déjà validé par le producteur, sans prendre des libertés artistiques ; la production enchaînée, qui impose un changement de réalisateur à chaque épisode, force celui-ci à se fondre dans un moule homogène. Émerge alors un autre candidat pour jouer le rôle d’auteur, condition sine qua non pour que l’étude des séries puisse intégrer le canon universitaire : le producteur. Dans un livre d’entretiens avec une sélection de producteurs publié en 1983, Horace Newcombe et Robert Alley affirment que la vraie force créative derrière une série, c’est justement le producteur, allié au scénariste, et non pas au réalisateur, au mieux un « compagnon » [1]. Cet argument a été influent depuis, au point d’avoir été largement adopté par la presse spécialisée, et aussi par le courant « sériephile » de plus en plus présent à l’université [2]. Dans un livre révisionniste publié en 1995, l’universitaire et documentariste John T. Caldwell (ancien professionnel de la télévision) a souligné que la direction créative est plus complexe et plus collective, impliquant, selon la série, producteurs, réalisateurs, scénaristes, et comédiens à des degrés divers [3].

En dessus et en dessous de la ligne
Dans la production de films et de séries, pour des raisons de comptabilité, on distingue aux États-Unis entre coûts above the line et below the line, ce qui correspond aux dépenses variables (honoraires, intéressements, droits) et fixes (salaires). Mais les termes ont aussi un usage moins technique, plus sociologique : il s’agit de démarquer ceux qui sont en mesure de négocier individuellement leur apport créatif (producteurs, réalisateurs, scénaristes) des ouvriers plus ou moins qualifiés dont les compétences sont communes à un corps de métiers, ce qui les rend remplaçables. Caldwell donne la définition suivante :
Secteur en dessus de la ligne : les créateurs « dirigeants » et les professionnels de haut niveau qui négocient de manière indépendante, et par contrat pour chaque production. Les postes dans ce secteur comprennent les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes, les chefs opérateurs, les décorateurs, et les monteurs.
Secteur en dessous de la ligne : les métiers « techniques » et la main d’œuvre impliqués dans la production, normalement les salariés payés à l’heure dont la rémunération et le classement sont fixés et contrôlés par des conventions collectives avec les syndicats. Les postes dans ce secteur comprennent les réalisateurs-assistants, les producteurs associés, les opérateurs de caméra, les preneurs de son, les opérateurs assistants, les monteurs assistants, les décorateurs assistants, les menuisiers, les chefs électriciens, les machinistes, les assistants de production, les infographistes, les artistes-animateurs, les techniciens coloristes, les techniciens vidéo, etc. [6].
Pour Caldwell, cette distinction, opérante dans la production de télévision jusqu’aux années 1990 comme prolongement du système « studio » du cinéma, est trop simpliste pour tenir compte de la situation aujourd’hui :
Ce qui complique en partie cette distinction actuellement, c’est le fait que beaucoup de fonctions traditionnellement perçues comme étant en dehors du processus de production ont intégré les rangs des cadres, à la fois en dessus et en dessous de la ligne. Les employés de bureau, les fournisseurs d’équipements, les assistants personnels, par exemple, ont réussi à figurer dans le générique de la fin dans pas mal de films, alors que l’enjeu d’une mention est souvent une foire d’empoigne, où participent tous ceux occupant une position stratégique dans les négociations autour du projet. Le recours croissant aux travailleurs non syndiqués ou étrangers a atténué encore plus la distinction [7].
La distinction traditionnelle entre les deux secteurs garde alors un côté heuristique, à condition d’être fortement nuancée. Ainsi, le secteur en dessus de la ligne devrait être lui-même divisé entre une sphère commerciale et une sphère créative, et celui en dessous de la ligne entre les sphères de la production et de la postproduction, où dans les deux cas les intérêts ne sont pas les mêmes. La division du travail n’est donc pas statique, et les positions par rapport à « la ligne » sont loin d’être acquises. Ce qui complique encore plus la distinction, c’est que certaines fonctions comme celle de scénariste par exemple, de plus en plus collective depuis les années 1980, sont elles-mêmes situées des deux côtés de la ligne, selon les statuts des uns et des autres : le « showrunner » ou un scénariste « dirigeant » a droit à une mention dans le générique et éventuellement à l’intéressement, alors qu’un simple membre de l’équipe peut être remplacé sans ménagement si l’on juge qu’il est insuffisamment productif.
La définition d’apport « créatif » dépend des changements dans les méthodes de production, ce qui valide l’argument de Caldwell que la ligne entre secteurs créatifs et techniques est instable et mobile. Ainsi, la forme d’une série comme 24 heures chrono n’est pas sans incidence sur l’organisation du travail. Afin d’assurer une stricte continuité de 24 heures s’étirant sur six mois de travail, la scripte, normalement subordonnée, devient une quasi-réalisatrice adjointe ; de même, il est rare que les producteurs reviennent sur la prouesse des monteurs qui arrivent à fabriquer une première version en quelques jours à partir de trois caméras [8]. Le moindre changement dans l’organisation du travail peut faire basculer une fonction relevant d’une compétence technique en apport hautement « créatif », indispensable et donc sujet à des gains salariaux négociés individuellement ; ou vice versa.
Subsomption formelle et subsomption réelle (Marx)

Une telle distinction postule une évolution qualitative dans l’organisation de la production capitaliste ; il ne s’agit pas d’un état arrêté entre deux formes d’intégration dans une économie marchande, mais d’un processus de rationalisation propre au capitalisme. La subsomption formelle demeure extérieure au procès de production. Ainsi, l’écrivain « indépendant » qui propose le produit terminé de son travail au capitaliste ; à ce dernier, monopolisant les réseaux de distribution, la charge de réaliser (ou non) sa valeur. Cet exemple implique que le degré de subsomption au capital peut être différent selon les divers métiers impliqués dans la production d’une marchandise culturelle, et que la subsomption réelle absolue est un horizon qui ne pourra en toute probabilité jamais être atteint.
La différence entre les deux formes de subsomption (ou mieux, de soumission) intervenait chez Marx dans le contexte du problème dit « de transition », entre le féodalisme et un capitalisme naissant. On pourrait également voir en la transition entre ces deux formes un processus sans fin, qui s’approfondit au fur et à mesure que le capitalisme se développe, même dans son stade « tardif ». Une même logique est à l’œuvre dans ce processus d’industrialisation : le remplacement des formes de travail « artisanales » ou « intellectuelles » par la machine et, surtout depuis les vingt dernières années, le logiciel. Autrement dit, il s’agit du glissement progressif des activités en dessus de la ligne vers le dessous : les pratiques « créatives », sursalariées, commandant même une part des bénéfices, tendraient à être rationalisées. Mais ce processus historique n’est ni linéaire, ni homogène.
Les coûts de production des séries

L’enjeu pour Des Agents très spéciaux était de se rapprocher d’un style cinématographique (en étant moins théâtral) avec des budgets réduits par rapport au cinéma. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les séries pionnières en la matière aient été imprégnées d’un style parodique, qui couvrait mieux les inévitables approximations engendrées par un rythme de production inouï, exigeant des journées de douze heures sur cinq jours, avec une moyenne de 45 à 50 plans de tournage par jour (contre une dizaine pour un film, et contre 30 pour une série plus « théâtrale » comme Star Trek). Le producteur assurait le lien entre épisodes en conception, en préparation, en tournage et en postproduction [13]. Ce qui restait relativement artisanal, c’était le travail d’écriture. Alors qu’aujourd’hui une série retient une équipe d’une dizaine de scénaristes, Des Agents très spéciaux n’avaient que deux scénaristes travaillant à plein temps pour la deuxième saison (aucun pour la première), assistés par des écrivains indépendants
L’introduction progressive dans les années 2000 de technologies de montage numérique a sensiblement dérangé l’organisation linéaire de travail, standardisée par les studios. Traditionnellement, tout le processus de production et de postproduction concourait à produire une copie master (duplicate negative), bien après la fin du travail de montage. Cela laissait au directeur de la photo la maîtrise absolue des paramètres esthétiques (couleur, lumière) du produit final, aussi bien lors du tournage que lors de l’impression. Le recours aux caméras numériques déplace le contrôle artistique dans la production d’une copie zéro numérique vers les « techniciens numériques intermédiaires », des travailleurs de la postproduction situés en dessous de la ligne, au détriment des opérateurs et même des réalisateurs. Ces derniers sont déjà mis à mal par l’adoption des techniques de speed shooting (tournage en vitesse), où les mises en place (avec pré-éclairage) sont réduites au maximum, et où tout est filmé par au moins deux caméras. Cela facilite le travail de montage en compensant des ruptures de continuité, et donne aux séquences en studio un côté plus dynamique.

Les spécificités de la série comme forme marchande


Revenons au poids financier des secteurs en dessus et en dessous de la ligne. On se souvient que pour Des Agents très spéciaux (1966), le secteur « créatif » revenait à 38 000 $ par épisode et le secteur « technique », 95 000 $, soit deux fois et demi de plus. Aujourd’hui, les frais matériaux de production seraient relativement standards pour toutes les séries : entre 100 000 $ et 150, 000 $ par jour de tournage (chiffres 2009) [18], soit une fourchette de 700 000 $ à 1,05 million $ par épisode, si l’on prend en compte une durée de tournage normale de 7 jours. Les coûts par épisode de série diffusée sur les networks se situant entre 3 et 4 millions $, on pourrait parler ici d’un retour du bâton dans l’autre sens, les coûts en dessous de la ligne représentant un pourcentage apparemment moins important qu’auparavant. Des chiffres plus précis nous viennent du producteur Robert Del Valle [19]. Les frais « au-dessus de la ligne » comptent pour 30-40% du budget, et les frais « au-dessous de la ligne » pour 32-43%, le restant étant divisé entre coûts de postproduction (12-18%) et divers (frais juridiques, maintenance, assurances, etc.) (8%). Au-delà de la première saison, le pourcentage « au-dessus de la ligne » augmente sensiblement. Pour un budget assez typique d’un épisode de série en 2008 cité par Del Valle (2, 746 703 $), cela donne 818 176 $ en frais « au-dessus de la ligne », et 1, 183 005 $ en frais « au-dessous de la ligne », plus 745 482 $ en postproduction et en frais divers. Il n’est pas certain où se situait cette troisième catégorie dans les pratiques de comptabilité en vigueur dans les années 1960 (voir aussi note 24). Mais quoi qu’il en soit, la théorie d’une évolution vers une plus grande soumission réelle à la logique du capital, esquissée ci-dessus, ne semble pas opérante dans ce schéma.
Comment expliquer cette contradiction apparente ? D’abord par la nature du produit culturel, dont la valeur d’usage est hautement aléatoire et reste donc dépendante du « marquage » apporté par les principaux créateurs identifiables que sont les comédiens, en mesure de monnayer fortement leur participation, et même de faire chanter les producteurs pour le maintien de celle-ci. Dérivé de l’ancien star-system hollywoodien qui, dans une économie de surproduction, distinguait entre comédiens « remplaçables », et comédiens apportant une identité singulière au produit, ce genre de marquage personnel (personal branding) va directement à l’encontre de la tendance historique à remplacer la « créativité » par la « compétence ». On pourrait voir en le produit culturel (cinéma, série, musique) une exception à la tendance vers la soumission réelle en ce sens précis : la valeur d’usage, en l’occurrence la capacité à « divertir » le consommateur, est encore due en grande partie aux mécanismes d’identification psychologique entre artistes et consommateurs, même si la production audiovisuelle s’éloigne progressivement du modèle théâtral. Autrement dit, la naissance des industries culturelles (ou la marchandisation de la culture) était dépendante de l’établissement correspondant d’un star-system afin d’imposer un minimum de rationalité économique dans un marché trop hétérogène et trop hétéroclite.
Au cinéma et à la télévision, deux tendances contradictoires existent dans un état de tension, l’une ancienne, l’autre émergente. Dans de nouvelles industries culturelles comme le jeu vidéo, les « personnages » sont « joués » par des avatars, ou des images de synthèse. Si l’on parvient à généraliser cette avancée technique, non seulement les limites biologiques à la productivité pourraient être dépassées, mais les quasi-rentes dont disposent certains comédiens essentiels au succès d’une série perdraient leur raison d’être, la gestion des avatars rejoignant les coûts de production fixes, intégrés dans le système salarial. Les comédiens seraient alors comme les maîtres-artisans indépendants de jadis, progressivement éliminés par la mécanisation.
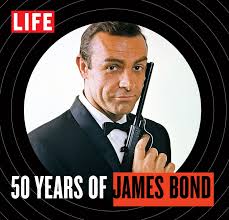
« Tout scénario est aussi un plan d’affaires »
Revenons maintenant à une question importante, en déplaçant le cadre théorique. Peut-on infirmer la tendance vers un approfondissement de la soumission réelle à la logique du capital en dépendant de catégories qui relèvent de la comptabilité, ou pire, d’une conceptualisation idéologique ? Les prétentions « créatives » de ceux se situant « en dessus de la ligne » servent à justifier une surrémunération par rapport à d’autres qui revendiquent, eux aussi, un statut professionnel. Il est vrai que l’éclatement du studio system a contribué au déclin des corporations professionnelles et des syndicats, rendant ainsi le clivage traditionnel entre « créatifs » et « non-créatifs » moins pertinent. L’adage hollywoodien prétend que « tout scénario est aussi un plan d’affaires » (business plan). Caldwell ajoute que tout scénario est aussi une occasion pour promouvoir une image de marque (branding opportunity) :
Un scénario n’est pas composé simplement de personnages et d’arcs narratifs. En raison de la forte intensité en capital des industries de film et de télévision, un scénario fonctionne aussi comme prospectus financier, occasion d’investissement, ou proposition d’affaires. Reconnaître que tous les scénarios sont en même temps des plans d’affaires pourrait rebuter des écrivains avec des idéaux intellectuels ou des prétentions littéraires. Mais cette affirmation souligne aussi une caractéristique fondamentale, voire déterminante du cinéma et de la télévision : le mariage forcé de l’art et du commerce. N’importe quel scénario ou projet élaboré pour la télévision aux heures de grande écoute ou pour le cinéma grand public de nos jours mobilise fortement, dès les premières réunions de scénaristes et de producteurs, des managers rattachés aux départements de gestion, de marketing, de contrats internationaux, de distribution, de commercialisation (« merchandising ») et de nouveaux médias. Ces discussions visent à s’assurer qu’un nouveau film ou une nouvelle série ait des capacités créatrices de plus-value sous la forme de déclinaisons d’un concept original, susceptibles d’être consommées par autant de canaux sensoriels que possible. En d’autres termes, lors des étapes de proposition (« pitch ») et d’écriture, les idées de scénario seront développées comme des qualités divertissantes variées, destinées à être vues (cinéma, télévision, vidéo sur demande), entendues (bandes sonores, CD, téléchargements), jouées (jeux vidéo), consultées (sites en ligne), expérimentées physiquement (parcs d’attractions thématiques), manipulées (phones et appareils mobiles, etc.) et portées (vêtements « marqués »). Rien ne reçoit une lumière verte s’il n’y a pas de perspectives convaincantes de plus-value dans plusieurs de ces marchés, désormais intégrés [23].
L’économie de production mobilise donc, en même temps, le « front end » (préproduction et production) et le « back end » (gestion) d’une entreprise, elle-même appartenant depuis 1995 à une grande société de diffusion [24]. Chaque scénario implique dès le départ des besoins financiers et logistiques spécifiques. Le producteur intervient pour ventiler le scénario en journées de tournage selon le meilleur rapport coût/efficacité (cost effectiveness). Les gestionnaires calculent la ligne budgétaire (line item budget) pour la main d’œuvre, le matériel, et les locations pour chaque séquence. Du coup, les scénarios sont réduits à l’essentiel, sans fioritures « artistiques ». Des logiciels dédiés ont transformé l’analyse budgétaire des scénarios en procédure de routine. Dans cette perspective, l’apport décisif appartient plutôt aux managers du back end, construisant des stratégies de marketing pour des publics divers, régionaux, nationaux, internationaux à partir d’une idée de base, avant que le tournage ne commence. Le scénariste qui veut réussir dans ce milieu se voit dans l’obligation de faire la synthèse dans sa tête entre « le monde créatif » et « le monde financier », avant même d’écrire le moindre mot, contrairement aux habitudes des années 1960 quand l’artiste avait encore son (petit) mot à dire. Le terme « créatif » prend désormais un autre sens : la capacité à marier de manière optimale des qualités dites « artistiques » aux calculs commerciaux, bref de maquiller la soumission réelle en expression individuelle. Toute analyse qui sanctionne cette vision d’individus agissant de façon autonome (« auteurs », « créatifs ») participe de l’idéologie libérale.

Tout cela permet de réanalyser le décalage constaté entre les poids respectifs des catégories en dessus et en dessous de la ligne. Même la mise en avant ces dernières années de la créativité de certains producteurs de séries télévisées (Stephen Bochco, Jon Cassar, David Kelley, J.J. Abrams) fait partie d’une stratégie de promotion plus vaste en focalisant l’attention des médias, notamment en étant les récipients de trophées, au même titre que les comédiens. L’importance publique de ces personnalités, qui incarnent la synthèse entre les affaires et la création artistique, est symptomatique du brouillage entre ces deux mondes. Dans la « vieille économie » fordiste, les départements de marketing et de gestion intervenaient en dehors de la production, s’appuyant sur des études de marché (de masse) pour identifier le consommateur moyen, et développant ses campagnes publicitaires dans le but de l’atteindre et de le fidéliser. Dans la « nouvelle économie », caractérisée par des marchés « niches » (où le simple « marquage » du produit ne suffit plus) [25], l’accent se déplace vers des stratégies visant à bâtir une relation « émotionnelle », « thérapeutique » avec le consommateur (d’où le débat sur la capacité de la télévision à s’adapter face à la concurrence naissante des réseaux sociaux). Pour certains gourous du marketing [26], les stratégies promotionnelles devraient se préoccuper moins désormais de parts de marché que de parts « d’émotion et de conscience » (mind and emotions share). Autrement dit, il ne s’agit plus d’agréger un grand public autour d’une série produite en amont, mobilisant des penchants sans rapport avec la consommation (les fameuses « valeurs traditionnelles » du western, qui a fait les beaux jours de la télévision américaine pendant les années 1950 et 1960), mais d’imaginer à l’échelle internationale des consommateurs optimaux, « émotionnellement » disposés comme tels ; ce, dès la conception d’une série, tâche assez difficile. Les taux d’audience d’une première télédiffusion aux États-Unis comptent moins désormais que la capacité à se maintenir dans différents marchés, nationaux et internationaux, dans la durée. Dans cette nouvelle donne, il est logique que les cadres du département de marketing participent aux premières étapes d’un nouveau projet, n’hésitant plus à peser dans des décisions relevant autrefois du domaine « créatif ».
« La classe créative »

La distinction opérée au sein de l’industrie entre créatif et non-créatif est en tout cas incompatible avec le concept avancé en 2002 par Richard Florida, sociologue versé dans le marketing, d’une « classe créative », composée d’un noyau « surcréatif » (« innovateurs » dans les domaines de science, d’ingénierie, de recherche, d’informatique, des médias), et de « professionnels créatifs » (dans les domaines de la santé, la finance, la justice, et l’éducation) maîtrisant des connaissances spécifiques [27]. Ici n’est pas le lieu pour faire la critique d’une notion destinée à passer à la trappe comme d’autres artefacts pseudo-scientifiques. Mais elle est intéressante justement parce que de toute évidence idéologique. La « classe créative » de Florida, faiblement élitiste [28], épouse les contours et les intérêts d’une nouvelle classe moyenne soi-disant porteuse de richesse sociale et, à ce titre, prétendante à un sursalaire. Quant au concept accompagnateur de « professionnels créatifs », qui donne du poids politique au noyau innovateur « surcréatif », il contient en creux celui de « professionnels non créatifs ». En cela, il est symptomatique de l’anxiété répandue quant au statut des uns et des autres par rapport aux changements technologiques et organisationnels. En effet, dans l’industrie de la production audiovisuelle comme ailleurs, la revendication d’un statut professionnel se généralise aussi en dessous de la ligne [29].

Or, le statut même de « créatif » devient fragile. L’intervention de plus en plus précoce de critères purement gestionnaires, loin de renforcer le pouvoir des producteurs dans une nouvelle alliance de « créatifs » de tous bords, les minore ; la tension historique entre les mondes artistiques et financiers tourne à l’avantage de ces derniers, insérés dans un organigramme fortement hiérarchisé. Déjà, dans son étude classique des milieux professionnels du cinéma à Hollywood en 1950, l’ethnologue Hortense Powdermaker avait scandaleusement insisté sur le côté « travail à la chaîne », même chez les réalisateurs [30]. En d’autres termes, dans une organisation du travail de plus en plus rationalisée, on ne peut plus savoir avec certitude si son apport particulier est créatif (de plus-value) ou non, d’où le souci permanent de soigner une image de professionnel hautement individualisé, irremplaçable. Dans les circonstances, tous ceux prétendant au statut de « créatif » se trouvent dans l’obligation de cultiver une image correspondante, susceptible d’être complaisamment relayée dans les revues professionnelles. Ce portrait d’un « producteur dirigeant » (executive producer) est typique :
Paul Simms est un Wunderkind éduqué à Harvard qui est passé de [la célèbre revue potache de celle-ci] « National Lampoon » à l’équipe de rédaction de [l’animateur de talk-show] David Letterman, puis à [la sitcom satirique] « Larry Sanders », et finalement à la production de sa propre sitcom… On retrouve un homme un peu plus mûr dans son bureau sombre à Renmar Studios, jouant de sa basse Fender bien-aimée… Sur la bibliothèque, s’alignent « Les Misérables » [en français], « In Praise of Folly » d’Erasmus, un livre [de l’animateur provoc trash] Howard Stern et un livre de partitions [du groupe rock sudiste des années 1970, les Allman Brothers]. D’après ses associés, on le voit rarement pendant la journée, car ses horaires dignes d’un vampire – il ne commence pas à écrire avant 23 heures – sont légendaires dans le monde des sitcoms [31].

On l’a compris, Paul Simms n’est pas un simple rouage dans la machine, c’est un « créatif » qui marie le succès commercial à une culture très éclectique, un background prestigieux (Harvard) à une persona vaguement rebelle qui tâte de la basse dans son bureau « sombre ». Tout dans ce portrait donne l’impression d’une tentative orchestrée pour apporter de la valeur non seulement aux productions de Renmar Studios, mais aussi à l’homme lui-même, sous la forme d’un marquage personnel assez répandu dans le milieu. Comme le dit à sa manière Caldwell, « plus un producteur occupe une position élevée dans la chaîne alimentaire, plus on lui donnera de la marge pour faire le bad-boy ou pour cultiver des prétentions avant-gardistes, ce qui serait partie prenante de l’image de marque de la société » [32].

DU MÊME AUTEUR DANS LA WEB-REVUE :
L’économie politique des séries américaines
La musique des séries télévisées : de l’underscore au sound design
Innovation et technologie numérique dans les séries (vidéos en anglais) :
Notes
1. Horace Newcombe et Robert S. Alley (dirs), The Producer’s Medium : Conversations with Creators of American TV (Oxford University Press (Oxford ; New York), 1983.
2. Il est vrai que les études universitaires tendent à privilégier des séries produites pour les chaînes de câble (Les Soprano, The Wire, Breaking Bad, etc.) dans des conditions moins « industrielles », et bénéficiant d’une relative liberté de ton.
3. John T. Caldwell, Televisuality : Style, Crisis and Authority in American Television, Rutgers University Press (New Brunswick, New Jersey), 1995.
4. John Thornton Caldwell, Production culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Duke University Press (Durham, Caroline du Nord), 2008.
5. Vicki Mayer, Below the Line. Producers and Production Studies in the New Television Economy, Duke University Press, Durham, Caroline du Nord, 2011.
6. Caldwell (2008), op. cit., pp. 377-78 (je traduis).
7. Ibid., p. 378.
8. “24” behind the scenes : the editing process, Academy of Television Arts and Sciences Foundation, First Light DVD. Wiki ici.
9. Karl Marx, Un chapitre inédit du Capital (traduit et présenté par R. Dangeville), 10/18, 1971, pp. 191 et sq. (« Nous appelons subsomption formelle du travail au capital tel qu’il était développé avant que n’ait surgi le rapport capitaliste »). Texte intégral disponible en ligne.
10. Le marché international pour des produits télévisuels américains s’est mis en place vers la fin des années 1950. En 1961, CBS a vendu The Lone Ranger dans 24 pays. La série Lassie n’a rapporté que 4 millions $ (27,6 millions $ en dollars 2013) en recettes étrangères en 1958 (William H. Marling, How « American » is globalization ?, Johns Hopkins University Press, 2006, p. 39). La série Mission : impossible (1966-73) fut vendue dans 87 pays, alors que dans les années 2000 CSI a été diffusé dans environ 150 pays pour une audience cumulée de deux milliards.
11. Les tarifs des séries américaines sur le marché européen ont augmenté de 50 % à 75% entre 2003-2006 (après une augmentation comparable dans la décennie 1980-1990). Voir Sylvia Chan-Olmsted, Jiyoung Cha, Goru Oba, « An examination of the host country factors affecting the export of U.S. video media goods », Journal of Media Economics, 21, 2008, pp. 191-216. Accès en ligne payant.
12. Les valeurs en dollars constants (2013) ici et ci-dessous ont été calculées à partir du tableau de conversion établi par Robert Sahr (https://oregonstate.edu/cla/polisci/faculty-research/sahr/sahr.htm). Normalement, une série se vend à perte (à 75-80% de son coût) sur le marché américain ; sa rentabilité dépend des ventes internationales.
13. À titre de comparaison, la norme depuis la fin des années 1980 jusqu’à récemment était une vingtaine de mises en place (camera set-ups) par jour pour un téléfilm et environ 35 pour un épisode de série. (Jon Heitland, The Man from UNCLE Book, St. Martin’s Press (New York), 1987, p. 124). La période moyenne de tournage pour un épisode de série est de 7 jours, temps incompressible si l’on veut parvenir à produire la vingtaine d’épisodes réglementaires chaque saison pour les networks (les séries produites pour les chaînes câblées, moins soumises aux taux d’audience, peuvent se contenter d’une douzaine d’épisodes par saison). Cette distinction entre la quantité d’épisodes pour les networks et pour le câble est en train de s’estomper (voir « Actualités #26, déc. 2014« ).
14. « TV shows getting ambitious », Variety, 21 sept. 2007.
15. The Hollywood Reporter, 26 mars 2010.
16. Ces chiffres, qui me semblent fiables, furent postés en commentaire par « dillan », qui s’est présenté comme professionnel de l’industrie, sur le site tvbythenumbers.com/2009/11/05 (« That was fast : NCIS : LA sold into syndication », 5 nov. 2009). Commentaires visibles sur la page au moment de la consultation (2009).
17. Variety, 21 juillet 1997.
18. tvbythenumbers.com/2009/11/05, post de « dillan », consulté en 2009 (il n’est plus affiché sur le site).
19. Robert Del Valle, The One Hour Drama series. Producing Episodic television, Silman-James Press (Los Angeles), 2008.
20. David Buxton, Les séries télévisées. Forme, idéologie et mode de production, L’Harmattan, 2010, p. 41 et sq.
21. Pour des raisons consubstantiellement commerciales et idéologiques, la mixité est devenue de rigueur dans l’assemblage de personnages récurrents et a contribué à l’inflation de ceux-ci. À la formule de base, hommes et femmes, vieux et jeunes, Blancs et « minorités raciales », conservateurs et libéraux, on peut ajouter stratégiquement des gros, des homosexuels, des divorcés, des ethniques, des geeks, des handicapés ou des combinaisons de ces caractéristiques.
22. Comme les stars de cinéma, de télévision et de rock, les célébrités se présentent comme des modèles d’adaptation existentielle à un capitalisme qui tend vers la marchandisation de tous les rapports sociaux ; cette fonction reste l’apanage des individus en chair et en os, mais n’est plus limitée aux artistes et aux sportifs renommés. Pour une analyse du lien historique entre le rock et la consommation de masse, voir David Buxton, Le Rock : star-system et société de consommation, La Pensée sauvage (Grenoble), 1985 (ouvrage désormais disponible gratuitement ici sur le site).
23. Caldwell (2008), op. cit., pp. 232-33 (je traduis).
24. A partir d’une décision de la Federal Communications Commission en 1993 (renforcée en 1995, référence FCC 95-382, en ligne), les networks ont désormais le droit, précédemment interdit par les lois antitrust, de posséder leurs propres filiales de production, et d’investir dans les sociétés indépendantes, les coûts étant devenus trop importants pour être assumés par ces dernières seules. Ce qui est comptabilisé dans une branche de la société holding comme une dépense (achat du droit de diffusion ou license fee) peut paraître dans une autre comme source de revenue, ce qui complique les calculs de rentabilité d’une série particulière, du moins à court terme.
25. À partir de 1969, c’est la « qualité » de l’audience et non la seule quantité qui commence à compter dans les calculs faits par les directeurs des networks. La société Nielsen, qui faisait aussi des enquêtes de marketing, était désormais en mesure de fournir une corrélation entre la consommation de tel produit et le fait de regarder telle émission, plus une « démographique », une analyse d’audience spécifique en termes d’âge, sexe, habitation et niveau d’études. Les plus grands consommateurs des produits annoncés à la télévision étaient des habitants de grandes et moyennes villes entre 18 et 49 ans, avec une légère majorité féminine. Les professionnels de télévision parlent d’un « changement de mer » en 1970, qui a vu en effet une guerre autour de la bonne interprétation des indices entre CBS (« quantité ») et NBC (« qualité »). Ce sont les annonceurs qui ont finalement donné raison à la conception « démographique » des indices.
26. David F. D’Alessandro, Mark Gobe.
27. Richard Florida, The Rise of the Creative Class : and how it’s transforming work, leisure and everyday life, Perseus, New York, 2002.
28. Pour Florida, la « classe créative », vue comme le moteur principal de croissance dans des sociétés « post-industrielles », représentait 30 % des travailleurs aux États-Unis en 2002, et devait représenter 40 % en 2012. Le concept sous-tend aussi l’alignement de l’université sur les valeurs de « l’innovation » et de « l’excellence », qui accompagnent la soumission réelle à la logique du marché.
29. Symptomatiquement, là où la tension entre « professionnels » et « non-professionnels » est la plus aiguë, c’est dans l’industrie de vidéos pornographiques (voir Vicki Mayer, op. cit., pp. 66-100).
30. Hortense Powdermaker, Hollywood, the Dream Factory. An Anthropologist looks at Movie-Makers, Little, Brown & Company (Boston), 1950. (Un extrait traduit par Dominique Pasquier a été publié dans Réseaux, 86, nov-déc 1997, pp. 115-34). La blessure narcissique provoquée par cet ouvrage est en partie responsable du profond rejet des analyses universitaires dans la culture hollywoodienne, qui continue à ce jour.
31. David Wild, The Showrunners, HarperCollins (New York), p. 24, cité par Caldwell (2008), op. cit., p. 205 (je traduis). On pourrait multiplier les exemples.
32. Caldwell, op. cit., p. 206 (je traduis).

.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)





