À l’occasion de la sortie de L’industrialisation des biens symboliques. Les industries créatives en regard des industries culturelles (Presses Universitaires de Grenoble) par Philippe Bouquillion, Bernard Miège, et Pierre Mœglin, livre théorique important sur les mutations en cours dans les industries culturelles et dans les nouvelles industries dites « créatives », la Web-revue a demandé aux trois auteurs de répondre à un petit nombre de questions par écrit. Voici leurs réponses (les inter-titres ont été rajoutés par nous).
Interdit à la reproduction payante
Contenu
La Web-revue : Votre livre a été écrit de six mains. Comment avez-vous procédé ?

La rédaction de l’ouvrage s’inscrit au sein du programme de recherche « Culture, création » financée par l’Agence Nationale de la Recherche entre 2009 et 2013. Il en présente les principaux résultats. Nous tenons à remercier les collègues impliqués au sein de ce programme pour les échanges que nous avons entretenus pendant plus de trois ans. Outre les trois auteurs de l’ouvrage, les enseignants-chercheurs et doctorants qui ont participé au programme « Culture, création » sont Sylvie Bosser, Vincent Bullich, Yolande Combès, Émilie Da Lage, François Debruyne, Thomas Guignard, Sarah Labelle, Jean-Baptiste Le Corf, Jacob Matthews, Claire Oger, Julien Paris, Julie Peghini, Thomas Perrot, Lucien Perticoz, Laurent Petit, Catherine Vénica, Valeria Young ainsi que des collègues étrangers « associés » dont, au Canada, Éric George et Gaëtan Tremblay et, en Écosse, Philip Schlesinger. Les encadrés constituent l’un des témoignages de l’apport de ces collègues.


Les industries créatives
La Web-revue : Vous êtes assez critiques de la notion même d’« industries créatives » (pp. 54-71). Vous citez Nicholas Garnham (p. 70) qui est d’avis que ce sont les acteurs britanniques des industries culturelles qui ont favorisé la substitution de la notion des industries créatives à celle des industries culturelles. Peut-on recourir au terme « industries créatives », même de manière descriptive, sans charrier en partie les stratégies idéologiques qui y étaient investies à l’origine ? Je pense à l’idéologie blairiste des années 1990 (p. 55) qui envisageait la créativité comme l’apanage de certains pays « post-industriels » dans une économie désormais mondialisée. Je pense aussi à la notion de « classe créative » avancée par Richard Florida (p. 195). Est-ce pour cette raison que vous optez finalement pour le terme « biens symboliques » ?
Pierre Mœglin : Nous insistons en effet sur le fait que depuis la fin des années 1990, la formule « industries créatives » s’ajoute, puis tend à se substituer à « industries culturelles » dans les énoncés de politique publique des pays anglo-saxons ainsi qu’à l’UNESCO et dans les autres enceintes internationales. Comme nous le rappelons donc dans notre ouvrage, à la suite de Nicholas Garnham, c’est bien le New Labour en Grande-Bretagne qui, au lendemain de son accession au pouvoir en 1997, est le premier acteur à opérer une telle substitution à l’échelle nationale. Beaucoup d’autres pays suivront. Mais, si le gouvernement Blair joue ce rôle décisif, trois points importants méritent d’être signalés en complément.
Premièrement, les initiatives travaillistes ne naissent pas ex nihilo. En réalité, elles s’inspirent, sans le dire, d’expériences menées antérieurement sous le gouvernement conservateur. Nous en citons quelques-unes dans notre ouvrage, qui confirment qu’il y a davantage de continuité qu’on ne le dit généralement dans la politique britannique. Au demeurant, le gouvernement Cameron a confirmé les principales options prises dans ce domaine par les gouvernements antérieurs.
Deuxièmement, en Grande-Bretagne et ailleurs, les partisans de la thématique des industries créatives s’autorisent du défi lancé par le numérique aux politiques culturelles pour prôner les interprétations les plus libérales possible des réglementations nationales et des accords internationaux. Les négociateurs états-uniens et les représentants des industries du Web ne sont pas les derniers, à cet égard, à invoquer les changements rapides des conditions techniques de production, de distribution et de diffusion des produits culturels pour orienter autant qu’ils le peuvent les décisions dans le sens d’un abaissement des dispositions protectrices, dans chaque pays, dans le cadre de l’OMC et, à l’UNESCO, pour l’application de la Convention sur la diversité des expressions culturelles.
Troisièmement, la priorité donnée aux questions du droit d’auteur (sous sa version anglo-saxonne) et, plus généralement, des droits de propriété intellectuelle inscrit les discours sur les industries créatives, la création et la créativité dans la filiation d’anciennes thématiques : celles de la « Société de l’information », de la « Société du savoir », de l’« Économie de la connaissance », etc. Il est significatif, à cet égard, que ces discours véhiculent les lieux communs du néo-libéralisme économique, prônant par exemple l’abandon des idéaux de la démocratisation culturelle au profit de la défense des créateurs, catégorie suffisamment vague pour ménager des intérêts extraordinairement disparates.
Plus récent en France, à cause de la prégnance historique de la notion d’industries culturelles et des politiques qui s’en réclament, l’engouement pour les industries créatives témoigne chez nous d’une vitalité qu’il a déjà un peu perdue dans les pays où il est né. Caractéristiques sont, de ce point de vue, les récentes déclarations de la ministre française de la Culture sur l’investissement créatif à considérer comme l’un des principaux contributeurs à la croissance économique et au développement de l’emploi, ainsi qu’à l’image de notre pays sur les marchés extérieurs. Bien sûr, cette rhétorique est pour l’essentiel destinée à Bercy, au Medef et à la Commission européenne, qu’il s’agit de convaincre de la valeur économique des activités artistiques. Plus fondamentalement, néanmoins, la thématique des industries créatives nous paraît être le produit d’un discours dont, dans ce livre, nous essayons de déconstruire les déterminants idéologiques.
Ainsi montrons-nous qu’il y a une idéologie (et même un paradigme) de la créativité et que celle-ci (celui-ci) révèle d’importantes contradictions 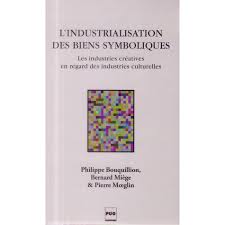
Tel est le contexte dans lequel, comme vous le signalez, nous mettons en avant la notion de biens symboliques. À nos yeux, cette notion a trois utilités. En premier lieu, elle introduit une distance salutaire par rapport aux discours de la créativité et de la création. Notre définition est simple : par « biens symboliques », nous désignons la catégorie de biens que leur dimension symbolique fait (ou aide à faire) échapper dans une certaine mesure à la concurrence par les prix et aux facteurs habituels de fixation de la valeur. En deuxième lieu, la notion de biens symboliques nous paraît utile pour caractériser la complémentarité de deux processus inversés : d’une part, l’industrialisation (serait-elle partielle) de pans entiers d’activités artisanales et artistiques ; d’autre part, la culturisation (par la grâce du design) de certains secteurs de la production de biens ordinaires de consommation (alimentation, automobile, informatique et électronique grand public, etc.). En troisième et dernier lieu, la référence à la notion de biens symboliques nous semble être un bon point de départ pour élaborer une grille de lecture des mécanismes de financiarisation et de spéculation, en amont, et d’intermédiation et de courtage informationnel, en aval. Ces mécanismes, nous proposons de les appréhender, en effet, comme des modes d’organisation et de fonctionnement que les acteurs du Web et des réseaux utilisent en complément ou en concurrence de ceux qui valent dans les industries culturelles (avec les modèles éditorial, du flot, du club et du compteur). Mais la question – à laquelle nous ne sommes pas encore en mesure de répondre – est de savoir si ces nouveaux modes sont transitoires ou permanents, et quelle ampleur ils vont prendre.
La Web-revue : Vous vous référez à trois exemples d’industries créatives (les industries de la mode, des biens de luxe, et de l’artisanat d’art), non pas pour les intégrer dans un ensemble, mais pour faire une mise en parallèle avec les industries culturelles (p. 100). Pourquoi y avoir écarté l’industrie des logiciels, notamment le web design qui figure dans les programmes universitaires consacrés aux « industries créatives » ? Quels sont les différents critères d’inclusion et d’exclusion qu’opère le terme industries créatives, et quels en sont les enjeux, selon vous ?
Bernard Miège : Il y a d’abord des raisons d’ordre pratique qui expliquent cette différence de traitement que vous notez : les données disponibles sur les industries créatives, et surtout les analyses portant sur elles, sont incomparablement moins approfondies et moins fréquentes que celles portant sur les filières culturelles, historiques et même nouvelles. Nous avons donc été conduits à procéder nous-mêmes à des travaux de synthèse sur ces industries créatives, alors que, s’agissant des produits culturels, nous disposions de nombreuses études « partielles », ainsi que de données officielles ou professionnelles. Mais ce n’est pas l’essentiel. Pourquoi, en réalité, les travaux de mapping, effectués çà et là, ont-ils échoué ? Pourquoi, aujourd’hui encore, aucun accord minimal n’a été obtenu à l’échelon international (à plus forte raison national, pourrait-on ajouter) sur une liste d’activités et d’expressions qui correspondrait à ce que bien des discours de sens commun envisagent sous le syntagme d’industries créatives ? C’est tout simplement parce qu’un listing, même élaboré avec professionnalisme, ne saurait par lui-même résoudre des problèmes sur lesquelles la réflexion d’ordre théorique reste indécise ou impuissante. Et c’est le cas avec ce que l’on entend encore avec une assurance toute de façade à propos des industries qualifiées de créatives. On ne sait pas où arrêter la liste, et finalement, on ne sait pas sur quels critères s’appuyer pour y parvenir ; et pour certaines d’entre elles on ne sait pas s’il s’agit vraiment d’industries.
C’est pourquoi nous avons choisi de mener ce travail, à la fois critériologique et réflexif, à la fois interne à ce type d’industries et comparatif avec les industries culturelles historiques, en nous centrant sur un certain nombre de filières (mode, y compris ses relations avec la haute couture ; biens de luxe ; et artisanat d’art). Ce faisant, nous savions que nous laissions de côté des activités participant de l’industrialisation de la créativité. Au premier rang de celles-ci, se trouve surtout le design ; mais celui-ci ne donne lieu que pour partie seulement à des réalisations industrielles (ou semi-industrielles) de biens propres ; généralement l’activité des designers est insérée dans d’autres biens : ameublement, décoration, et même maintenant automobile, logements, etc. (on est en plein dans la perspective de l’industrialisation de biens symboliques) ; dans cette hypothèse, leur activité ne débouche pas directement, par elle-même, sur la production de biens accessibles au consommateur final ; elle participe à ce que l’on désigne en comptabilité nationale comme étant une consommation intermédiaire, débouchant sur la production d’autres biens. Discussion de spécialistes ou raffinement digne de théologiens médiévaux ou byzantins ? Pas tant que cela, car, à y regarder de près, il n’y a pas que le design qui serait ainsi impliqué. On pourrait en effet y ajouter les services d’architecture (ce que l’on fait au Brésil), la conception publicitaire (activité intermédiaire destinée aux médias), la conception des progiciels de gestion (c’est-à-dire l’adaptation quasiment sur mesure de logiciels pour les activités entrepreneuriales) et au bout du compte l’ensemble de l’industrie du logiciel (c’est apparemment ce qui vaut à la Chine de se retrouver en première position mondiale dans certains classements des industries créatives).
Alors vous évoquez le web design, effectivement au premier rang des préoccupations dans les Écoles d’Art où il est considéré comme un moyen de renouvellement des filières ouvrant à de nouveaux débouchés pour les diplômés. Pas seulement, doit-on ajouter, dans les filières centrées sur le graphisme, mais tout autant en dehors des Écoles d’Art, dans les formations professionnalisées de communication, ainsi que de communication publicitaire ; et même de communication politique. Mais, précisément, les produits du web design ne sont pas destinés aux consommateurs individuels finaux ; et quand ils le sont, c’est en tant que produits semi-reproductibles, peu industrialisés donc, dans une position à bien des égards analogue aux multiples ou à l’artisanat d’art. Et vous conviendrez que pour le moment, ce n’est pas le principal dans les visées du web design.
Alors, prenant en compte cette grande variété des situations, ce à quoi nous avons procédé, ce n’est pas à des classements, qui pourraient apparaître discriminants et arbitraires, mais à des catégorisations, que nous avons cherchées à fonder théoriquement. Et on ne prétend pas qu’elles soient complètes, ni intangibles. Mais elles ont été établies à partir de filières où il était envisageable d’avancer dans les comparaisons avec les filières culturelles.
Pierre Mœglin : Ce que Bernard vient de dire à propos du statut de consommation intermédiaire du web design peut être élargi au design en général. Ainsi que nous le suggérons à plusieurs reprises dans notre ouvrage (et les professionnels du design ne sont pas les derniers à le signaler), le design joue un rôle majeur dans la structuration de nombre de filières consacrées à la production de biens symboliques. Par exemple, comme nous l’avons montré à propos de la filière de l’artisanat d’art, la ligne définie par les designers assure la coordination et l’articulation entre les différentes étapes, depuis la conception jusqu’à la production des argumentaires de vente. En outre, le fait qu’une firme fasse largement appel au design, a fortiori qu’elle décline toute sa production à partir d’une charte design – comme Apple le fait depuis sa création – constitue l’un des éléments les plus rassurants pour capital-risqueurs et investisseurs en Bourse. Or, la confiance des marchés financiers est un enjeu majeur pour les industries dont nous parlons, notamment à leurs débuts.
Le lien entre industries culturelles et créatives
La Web-revue : Dans la perspective critique qui est la vôtre, pouvez-vous revenir sur le lien entre industries culturelles et créatives ? Notamment, au niveau macroéconomique, en termes d’industries capitalistes parmi d’autres ? Vous précisez en effet qu’à ce niveau justement, les traits communs entre les filières se multiplient (p. 97).
Bernard Miège : Lorsque nous faisons observer que des traits communs entre filières se multiplient, c’est très clairement à propos des filières culturelles historiques et entre elles (édition de livres, musique enregistrée, cinéma et audiovisuel, information périodique) ainsi qu’avec la nouvelle filière du jeu vidéo. Après avoir précisé aussi rigoureusement que possible ce que nous entendions par filières (on peut nous reprocher de ne pas l’avoir fait plus tôt, attaché que nous étions comme beaucoup d’autres auteurs à analyser ces filières et même des sous-filières, séparément les unes des autres), la méthodologie que nous avons employée nous a permis dans un premier temps de vérifier leur consistance voire même leur résistance, au-delà de ce que nous envisagions. Pourquoi ? Sans doute parce que, successivement dans un passé plus ou moins proche, nous avons surestimé les effets des stratégies multimédias des groupes, puis ceux de la financiarisation, puis plus récemment ceux liés à l’individualisation des pratiques culturelles et informationnelles autour des TIC. Nous ne voulons pas dire que des mutations n’en ont pas résulté, mais que ces filières culturelles s’y sont adaptées ; elles se sont organisées pour y répondre et maintenir un certain nombre de traits qui leur sont spécifiques. Rien n’assure qu’il en ira de même avec l’avancée de la nouvelle intermédiation, c’est en cours, et celle-ci peut très bien amener avec elle une mutation décisive des modèles d’exploitation des différents produits industrialisés ; mais ce n’est pas à nous d’établir des prédictions. À quoi attribuer cette résistibilité des filières ? Sur ce point, nous avançons des arguments tirés précisément de leur structuration en filières, et par exemple la succession de métiers allant de la création ou conception jusqu’à la consommation finale (à la différence de la sociologie des professions artistiques qui voit dans cette chaîne seulement des intermédiaires entre les créateurs et les usagers-amateurs) ; et il faut également prendre en compte, et nous insistons par ailleurs sur cet aspect essentiel pour nous, la dimension symbolique forte de ces productions artistiques fussent-elles industrialisées.
Et ce n’est que dans un deuxième temps que nous montrons que des traits communs entre les filières, culturelles donc, se multiplient : concentration des capitaux dans quelques groupes multi-médias dominants (et réunissant des firmes de plusieurs filières), centralisation des investissements dans la production des contenus sur quelques produits phare, rationalisation selon des méthodes voisines de la distribution — diffusion, et formation de portails (une modalité ou une déclinaison qui, à terme, pourrait devenir centrale pour l’exploitation des produits culturels et informationnels), etc.
C’est donc à ce niveau que nous avons essentiellement trouvé une multiplication des traits communs, et non pas entre les filières culturelles et les autres filières créatives, comme votre question inciterait à le penser.
Effectivement, la consistance des produits semble proche sinon analogue, mais dans les deux séries de filières, les analogies portent surtout sur des produits semi-reproductibles (cf. le type 3 des produits culturels) et assez rarement sur des produits reproductibles (ce qui va bien au-delà des produits dits de masse). Et une différence significative apparaît dès lors quant à la nature même de ces produits : si les uns comme les autres font appel à la créativité dans la phase de conception, les produits des industries créatives sont également adossés au patrimoine qu’ils reproduisent et même qu’ils étendent, étant conservés pour être échangés et revendus (ainsi dans les industries du luxe, et même de la mode) ; ce n’est qu’exceptionnellement le cas pour les produits culturels, avec des « seconds marchés » pour collectionneurs passionnés. Quant au management de la créativité, si les phénomènes de starisation sont apparemment communs, il révèle des dissemblances notables. Il concerne les créateurs dans les industries créatives, et avant tout les interprètes de premier plan dans les industries culturelles. En outre, la forme entrepreneuriale est maintenant largement dominante dans les premières, depuis les entreprises personnelles de l’artisanat d’art jusqu’aux firmes et même groupes des industries du luxe et de la mode ; la conception/création est largement internalisée (même si le travail garde des traits de la petite production artisanale) et cela s’explique par l’adossement à la maison et à la marque ; il en est différemment pour les industries culturelles, où la phase de conception reste — principalement — externalisée (livre, musique enregistrée et cinéma), sauf dans celles qui s’organisent comme industries médiatiques (presse, radiotélévision) et dans les récentes filières (jeux vidéo et infomédiation). Il est vrai que les unes et les autres ont à assurer un renouvellement permanent et régulier des valeurs d’usage des produits offerts ; mais même à ce niveau, des particularités apparaissent : on n’achète pas du Gallimard, mais un roman de tel auteur, sous contrat avec la prestigieuse maison d’édition comme des dizaines ou des centaines d’autres auteurs ; et le caractère incertain ou volatil des valeurs d’usage ne conduit pas aux mêmes résultats et aux mêmes pratiques, dans le cas de marchés de masse, certes segmentés comme celui des livres ou des films, et dans celui de marchés de biens créatifs encore (très) sélectifs socialement et économiquement. On doit également rappeler que subsiste dans les industries culturelles un écart très important entre ce qui est produit et ce qui est consommé (cf. le pilon pour les livres non vendus), et que l’ajustement des offres et des demandes s’effectue toujours ex post (en dépit des toutes les méthodes utilisées) et avec une énorme déperdition de la production. En réalité, c’est avec les industries culturelles médiatiques que des rapprochements sont à opérer ; c’est avec elles que les informations socio-sémiotiques (ainsi que pratiques) qui sont au cœur des stratégies de marques, génèrent sans doute le plus d’effets d’addiction ; c’est là aussi que les publics s’identifient le plus à des signatures, à des présentateurs ou à des animateurs.
Enfin si l’on s’intéresse aux modalités de distribution des produits, on remarque que la distribution des produits des filières créatives semble obéir à des règles toutes spécifiques qui, précisément, les éloignent des industries culturelles). Toutes ces entreprises créatives sont tenues de réserver une part importante de leurs ressources aux immobilisations de nature immobilière ; car les clients préfèrent encore se déplacer, de sorte que les ventes à distance via des sites numériques sont loin de les concurrencer. Par contre, il n’y a que l’exploitation cinématographique qui, dans certains pays seulement, suppose des immobilisations importantes.
Cependant, une fois ceci admis, nous avons recensé et analysé tout un ensemble de différences significatives que je me contente d’énumérer ici : les produits des industries créatives sont adossés à des patrimoines et ils sont le plus souvent acquis pour être revendus ; le star-system concerne surtout des créateurs et non des interprètes prestigieux comme dans les industries culturelles ; la conception des produits créatifs est très largement internalisée alors que c’est l’inverse pour les produits culturels ; les marques et la confiance dans les marques y est essentielle dans la formation des valeurs d’usage, alors qu’elles s’attachent aux produits culturels eux-mêmes où la leur volatilité entraîne une importante et régulière déperdition de la production qui n’est pas consommée ; enfin la distribution des produits des industries créatives suppose la mise en œuvre d’un dispositif physique de distribution et l’accès à distance aux produits y reste marginal.
Finalement, si on peut recenser entre les industries culturelles et les industries créatives des similitudes ainsi que des tendances vers un rapprochement (les principales étant l’incitation à la créativité et l’appel au travail collaboratif dans la phase de conception), cette façon de procéder laisse de côté toute une série de différences qui perdurent d’autant plus clairement que les « systèmes juridiques » (d’un côté droit d’auteur et copyright d’un autre côté, droit des marques et propriété intellectuelle de l’autre) restent étanches.
L’École de Francfort
La Web-revue : Vous inscrivez votre approche dans les orientations d’Horkheimer et d’Adorno qui, dites-vous, ont prêté une très grande attention à la dimension créative dans la production des œuvres, contrastant activité créative et industrialisation (pp. 17-18). Mais ailleurs, vous vous éloignez explicitement de la notion de « système » avancée par Adorno (p. 34-5) en faveur d’une articulation entre branches (et non pas une « ressemblance »). Certes, on peut penser que l’accent mis par l’École de Francfort sur la mainmise idéologique des industries culturelles sur l’ensemble de la société soit exagéré, mais ne risque-t-on pas de trop courber le bâton dans l’autre sens en minimisant de la sorte la fonction idéologique des industries culturelles dans l’adhérence (complexe et contradictoire) au « système » capitaliste ? N’est-ce pas là l’essentielle unité de ce qu’Adorno appelait Kulturindustrie (au singulier) ?
Pierre Mœglin : Horkheimer et Adorno emploient en effet le terme « système » pour caractériser ce qu’il y a de systématique dans la
Nouvelles stratégies des majors de la communication
La Web-revue : Vous dites dans une phrase forte que le numérique n’a pas encore donné lieu à la création d’une nouvelle forme, à part
Philippe Bouquillion : Les stratégies d’acteurs importants des industries du Web et des matériels électroniques grand public ont conduit à de profondes transformations des principaux marchés des industries de la culture et de la communication. Rappelons que ces acteurs, avec les opérateurs de télécommunications, peuvent être rassemblés au sein de la catégorie des industries de la communication. Ils présentent des différences significatives sur le plan socio-économique, mais aussi des points communs qui les distinguent très nettement des acteurs des industries de la culture (que nous nommons aussi industries des contenus en y incluant l’information, les formes diverses d’information produite). Leur rapport aux technologies est plus étroit ; elles sont à la base de leur activité principale. En outre, si l’on considère les très grands groupes industriels, leur chiffre d’affaires et leur valorisation boursière sont sans commune mesure avec celles des acteurs des industries des contenus. Grâce à leur positionnement industriel, notamment dans les matériels grand public ou les plateformes, et également à leur puissance financière, les acteurs du Web ou des matériels, qui initient des stratégies dans les contenus, peuvent acquérir des positions dominantes dans les marchés des produits culturels industrialisés. Les contours précis de ces positions dominantes seront précisés plus loin, mais, d’ores et déjà, il convient de souligner que ces mouvements s’opèrent assez largement au détriment des acteurs historiques des contenus et, notamment, bien que pas seulement, des majors. À travers ces stratégies dans les contenus, les acteurs des industries de la communication cherchent prioritairement à dynamiser leurs marchés de base (ceux des matériels ou liés au Web, dont la publicité en ligne par exemple) et à se distinguer de leurs concurrents. Bref, les bouleversements sont importants, tant dans les industries de la culture que dans celles de la communication. D’importantes redistributions des cartes sont à l’œuvre. Pourtant, comme cela est souligné à la page 129, ces stratégies et les transformations qu’elles induisent ne peuvent guère s’interpréter en termes d’innovations techniques radicales selon le modèle de l’innovation schumpétérienne. Schématiquement résumé, il apparaît que ces stratégies conduisent pour l’essentiel à réaménager selon des appariements nouveaux divers éléments déjà existants tandis que les « innovations », lorsqu’elles existent, sont plus d’ordre socio-économique que technologique. Les stratégies d’acteurs tels que Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, conduisent ainsi à mettre en place de nouveaux appariements entre :
- Tout d’abord, des outils et technologies que ces grands acteurs n’ont généralement pas créés eux-mêmes et qui, de surcroît, peuvent être anciens.
- Ensuite, des contenus culturels et informationnels qu’ils ne concourent le plus souvent ni à produire ni même à financer.
- Enfin, des modes de valorisation dont la plupart sont des adaptations de modalités de financement déjà à l’œuvre, et souvent depuis longtemps, en particulier au sein des industries culturelles.
Les appariements qu’ils construisent sont sensiblement différents, car ceux-ci sont liés à la nécessité de positionner de façon évolutive dans le temps des acteurs dont la trajectoire industrielle, le marché de base et les concurrents sont différents.
La stratégie de Google
La stratégie centrale de Google durant la première moitié des années 2000 était de développer le marché de la publicité en ligne, alors embryonnaire, en associant un moteur de recherche avec des contenus informationnels et culturels. Il existait déjà des moteurs de recherche, et en particulier AltaVista, parallèlement aux annuaires en ligne dont Yahoo était, au début des années 2000, la figure emblématique. L’innovation principale portée par Google a donc résidé dans l’association entre des dispositifs de collecte de publicité en ligne et un moteur de recherche. Celui-ci s’est radicalement différencié des autres, ainsi que des annuaires, aux yeux des internautes, tandis que la stratégie de Google a permis de conférer un mode de valorisation à des services qui peinaient antérieurement à en trouver.
Rappelons aussi que les stratégies de « coopétition » mises en œuvre par Google ont été particulièrement pertinents. Elles ont précédé l’articulation avec des contenus. De même, tout en amont, c’est le soutien sans faille des acteurs américains du capital-risque qui a conditionné la capacité de Google à exister et à se développer. Si Google a atteint le stade de la rentabilité très rapidement avec d’ailleurs un taux de marge élevé, les montants en valeur absolue des bénéfices de Google sont restés à un niveau relativement modeste pendant plusieurs années et, en tout cas, à un niveau insuffisant pour financer les acquisitions d’entreprises externes par l’autofinancement. Dès les mois qui suivent la création de Google en 1998, des accords très nombreux sont conclus avec différents sites, fournisseurs d’accès à Internet ou aux meta-moteurs, pour que le service de recherche de Google soit associé à l’offre de ces derniers. L’accord avec Yahoo, intervenu en 2000, et permettant à Google de fournir son service de recherche en complément de service de répertoire de Yahoo, n’a pas été le premier, mais il a été l’un des plus marquants, car Yahoo dominait alors l’activité de « guidage » des internautes sur le Web.
Dans cette même logique, le partenariat avec AOL en mai 2002 a ouvert à Google les dizaines de millions d’internautes utilisant CompuServe, Netscape et AOL.com. Ainsi, Google est progressivement devenu quasiment incontournable grâce à ces accords avec d’autres acteurs. Ces accords, dans un premier temps du moins, semblent avantager les diverses parties en présence. Les partenaires de Google y voient alors une façon d’attirer du trafic à moindre frais, tandis que les internautes bénéficient de l’apparente gratuité du service. Un ensemble complexe – dont on ne peut rendre compte ici – de transformations et d’extensions des services de Google concourt aussi à construire, en fait assez rapidement, la position dominante de cette firme. Citons, par exemple, la création d’Adwords en octobre 2000, puis sa modification en février 2002, qui permet de mettre en concurrence les annonceurs. L’internationalisation très rapide et très large, en particulier grâce à des accords avec des acteurs du web étrangers, et à des traductions en de nombreuses langues, est aussi à rappeler. L’association avec des contenus extérieurs du groupe via des référencements constitués en « services » offerts aux internautes commence notamment avec la création de Google Actualité en septembre 2002. Elle s’étendra considérablement un peu plus tard, à partir de la fin 2004 et de 2005 avec, pour ne citer que l’un des premiers services, la création de Google Livres (en décembre 2004). C’est donc l’accumulation et la conjugaison de nombreuses et de diverses innovations socio-techniques et socio-économiques, dont aucune ne constitue une innovation radicale de type schumpétérien, qui permettent à Google de se différencier et à se développer. À défaut d’innovation radicale, l’acteur qui conduit une telle stratégie de création ou de développement d’un marché embryonnaire a de grandes chances, en arrivant le premier ou mieux en le créant, d’acquérir une position dominante au sein de ce marché, et de la conserver au moins durant un temps court ou moyen.
La logique du winner takes all
La logique dite du winner takes all est en effet à l’œuvre dans ces activités où les logiques d’externalités sont fortes. Dans le cas de Google, rappelons que les acteurs produisant les contenus et détenteurs des droits ont protesté, y compris sur le plan judiciaire, face aux utilisations de leurs contenus réalisées sans autorisation et sans reversement à leur profit. Ces protestations et, en particulier, les procès généralement perdus par Google, ont obligé ce dernier à payer des amendes. Quoi qu’il en soit, leur montant était dérisoire face aux gains permis par la réussite de la stratégie de cet acteur qui a ainsi transformé en norme d’usage un mode d’accès aux contenus au départ particulièrement « sauvage ». Ce n’est que récemment que quelques accords ont été conclus avec les détenteurs des droits sur les contenus. Le Fonds pour l’innovation numérique de la presse créé en 2013 en France par Google et doté d’un capital de 60 millions d’euros en constitue un exemple modeste. Notons aussi que lorsque l’étape du capital-risque a été dépassée compte tenu du développement du chiffre d’affaires et de la rentabilité du groupe, le soutien des acteurs dominants de la sphère financière (agences de notation, grandes banques d’affaires, gourous de la finance, etc.) a été déterminant, en particulier durant la période qui se situe entre la sortie du stade où les capital-risqueurs peuvent être sollicités et celle où les bénéfices et les réserves sont devenus si importants qu’ils ont dépassé très largement les besoins de financement liés aux acquisitions d’entreprises externes. Durant cette période, les augmentations de capital ont permis d’acquérir, sans s’endetter, des firmes extérieures détenant des savoir-faire stratégiques pour des montants dépassant largement les capacités d’autofinancement dont le groupe disposait alors.
L’exemple de l’acquisition en 2007 de Doubleclic, la régie publicitaire spécialisée dans le ciblage comportemental, pour une somme de 3,1 milliards de dollars, est fréquemment cité. Cette même année, le résultat net de Google n’était que 4,2 milliards. Cet achat a été essentiel en vue du positionnement de Google sur le marché de la publicité dite de search, renouvelant ainsi le marché de la publicité en ligne antérieur centré, selon le jargon professionnel, sur le display (les bannières). Sans l’acquisition de compétences externes, Google n’aurait certainement pas été en mesure de pénétrer ou plutôt de développer le marché du search. Du moins, Google aurait pu se faire devancer par d’autres acteurs. Quelle que soit l’ampleur de cette stratégie (et son caractère jusqu’à présent pertinent du point de vue de la croissance du groupe), il est difficile de qualifier le développement du marché de la publicité en ligne d’innovation radicale. En tout cas, l’innovation n’est pas essentiellement d’ordre technologique, même si des compétences logicielles nouvelles ont été requises pour développer la publicité comme d’ailleurs l’illustre le cas évoqué de Doubleclic. On peut en effet s’interroger pour savoir si la publicité en ligne et, en particulier les dispositifs de Google, se situent dans la continuité des formes antérieures de publicité, la vente d’espace en fonction de l’importance quantitative et des caractéristiques qualitatives d’une « audience », ou si Google ne fonctionne pas aussi tel un courtier mettant en relation des offreurs (les annonceurs) et des demandeurs (les internautes) et se rémunérant que lorsque le contact s’opère (le clic qui donne lieu à une rémunération de la part de l’annonceur ainsi que l’exploitation des données personnelles ainsi révélées). Les deux formes sont en fait présentes, mais quoi qu’il en soit, si innovation il y a, elle est plus d’ordre socio-économique que d’ordre technologique.
Le Web collaboratif
De même, le déploiement des sites dits de réseaux sociaux ne relève pas d’une innovation technologique radicale. S’agissant du service proposé, il s’inscrit dans la perspective, dans l’air du temps lorsque ces sites sont créés, du Web collaboratif. Cette logique de collaboration et d’échanges entre internautes, on pourrait dire aussi de mise au travail de ces derniers, n’est donc pas nouvelle même si elle se déplace des sites de partage de vidéos vers une nouvelle offre, les réseaux sociaux. La part d’innovation sociale portée par ces sites réside essentiellement dans l’ampleur des usages dont ils font l’objet, tant l’usage domestique que professionnel. L’importance de ces usages est d’autant plus spectaculaire qu’ils se concentrent sur un petit nombre de plateformes, en particulier du fait de la logique dite d’effet de club qui caractérise les réseaux de communication. S’agissant du mode de valorisation, l’innovation est aussi présente, mais limitée. Ces acteurs, dont au premier rang Facebook, grâce à leur succès d’usage, sont devenus des acteurs du marché de la publicité en ligne, marché qu’ils n’ont pas créé. Néanmoins, ils ont tenté de développer un segment particulier de ce marché. L’un des axes stratégies de Facebook est ainsi de miser sur le Customer Relationship Management (CRM), c’est-à-dire sur la possibilité dont disposeraient les annonceurs grâce à la plateforme Facebook de gérer les relations avec leurs clients. Notons que les données chiffrées publiées par Facebook et relatives à la composition de son chiffre d’affaires ne permettent pas d’identifier comment se répartissent les recettes entre les diverses formes de publicité.
Apple, environ 10 ans plus tôt, a également mené une stratégie de création de segments dans un marché existant. À la fin des années 1990, ce fabricant de matériels était en position industrielle et financière très difficile. Il était essentiellement positionné sur le marché des micro-ordinateurs, sans que son offre n’ait pu conserver les spécificités qui la caractérisaient antérieurement, avant que Microsoft n’offre des systèmes d’exploitation rendant assez comparables pour les consommateurs l’usage des PC et celui des Macintosh, spécificités qui justifiaient les prix élevés de ces ordinateurs. La stratégie conduite par Apple va alors consister à articuler différents matériels (des ordinateurs, des baladeurs puis des téléphones avancés et enfin des tablettes) avec des contenus musicaux (pour commencer), offerts via une plateforme, iTunes, à un tarif relativement bas. Le groupe prétend alors avoir créé, selon son slogan, un « écosystème ». Dans cette perspective, Apple ne vendrait plus des ordinateurs ou des baladeurs, mais des composants solidaires d’un système de points d’accès, de consommation, de traitement et même de création d’un vaste ensemble de produits culturels. La référence à la biologie dans le discours marketing d’Apple autorise ce fabricant à suggérer que ces matériels fonctionnent tel un organisme autonome. Cette stratégie renvoie à la tradition de dispositifs fermés et propriétaires de ce fabricant, qui paradoxalement a réussi à ouvrir ses matériels et « son univers » à l’ensemble du Web, tout en préservant leur dimension propriétaire. Apple cherche ainsi à distinguer radicalement son offre, afin qu’elle devienne incomparable aux yeux des consommateurs finaux, lesquels sont incités à acquérir plusieurs des composants de cet écosystème, à les renouveler rapidement et à accepter des tarifs élevés.
Le développement d’une dimension de bien symbolique
En somme, les innovations portées par ces acteurs relèvent pour l’essentiel de stratégies et positionnements socio-économiques et même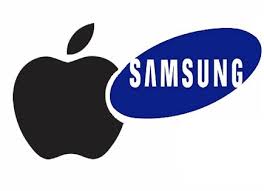
La fragilisation des acteurs historiques des contenus
Comme cela est suggéré par votre question, les acteurs des industries de la communication développant les stratégies présentées ci-dessus se comportent assez largement tels des parasites face aux contenus et à leurs acteurs. L’articulation des contenus avec leurs offres leur permet d’acquérir des positions dominantes dans l’accès des consommateurs finaux aux produits culturels. Cela est déjà le cas de la musique enregistrée, de la presse et cette domination s’étend désormais aux livres, notamment du fait des stratégies d’Amazon. La situation dans l’audiovisuel et le cinéma est plus nuancée et différenciée selon les aires géographiques. Dans les filières déjà très concernées par ces mouvements, ces stratégies ont tendance à priver les acteurs historiques des contenus de ressources et de pouvoir. Le stade aval des filières est généralement le plus rémunérateur et celui qui permet de contrôler l’ensemble de la filière. Seuls les grands acteurs, les majors, ont les moyens de gérer des structures de diffusion d’ampleur nationale ou internationale. Ainsi, avant que les acteurs des industries de la communication ne viennent leur contester cette position, elles étaient en mesure d’extraire une part significative de la valeur ajoutée produite au sein de l’ensemble de la filière. De surcroît, les dispositifs d’offre des grands acteurs des industries de la communication fixent des prix qui fonctionnent tels des prix de référence pour les produits distribués par voie électronique et qui peuvent peser également sur les tarifs pratiqués sur les supports en place. Les acteurs des supports en place ne peuvent maintenir des tarifs présentant des différences trop fortes par rapport à ceux des versions on line. Or, dans la mesure où la plupart des acteurs des industries de la communication ne cherchent pas à se rémunérer par la vente directe des contenus, leur intérêt est d’abaisser les prix. Face à cette situation, certaines dépenses artistiques des acteurs des contenus peuvent devenir des variables d’ajustement. De même, la représentation promue par les acteurs des industries de la communication que la créativité est plus liée aux services (d’échanges, de choix, de comparaison, etc.) permis par leurs dispositifs, plutôt qu’aux caractéristiques intrinsèques des contenus, fragilise les revendications des acteurs des contenus relatives au maintien de réglementations en leur faveur (droits de propriété, obligation de diffusion de contenus originaux, obligations d’investissement et subventionnement de la production, etc.).
Ainsi, à défaut de constituer des innovations radicales de type schumpétérien, les transformations en cours sont profondes, impliquent des renouvellements permanents des stratégies des acteurs des industries de la communication. De même, les redistributions des cartes dont pâtissent les acteurs historiques des contenus sont porteuses d’incertitudes quant à leurs enjeux pour la création et la production de contenus originaux que les discours enchantés sur les logiques collaboratives ou créatives ne peuvent occulter.
Bernard Miège : C’est dire que pour la période à venir notre regard ne se porte pas seulement sur l’industrialisation des biens symboliques et leur extension (comme indiqué précédemment), mais également sur les rapports entre les grandes industries de la communication (qui ont acquis en peu d’années finalement une position dominante, et qui sont particulièrement choyées par les marchés financiers) et les industries du contenu, culturelles historiques ou autres créatives. Les conditions faites à ces dernières par les premières sont un enjeu de toute première importance, d’ordre théorique bien sûr, mais réellement stratégique, et qui touche chacun de nous dans sa vie quotidienne de pratiquant, d’usager et de consommateur.


Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)





 Adorno vs pop culture
Adorno vs pop culture David Buxton – Jean-Baptiste Favory – Hommage à Pierre Henry
David Buxton – Jean-Baptiste Favory – Hommage à Pierre Henry Comicalités. Études de culture graphique.
Comicalités. Études de culture graphique.