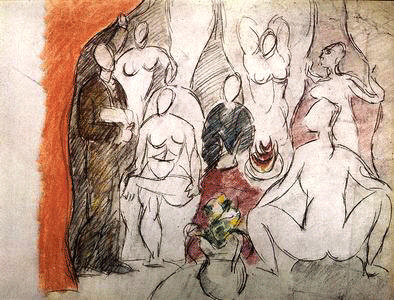La question du jazz dans l’esthétique de T.W. Adorno : un obstacle à sa réception en France – Marc HIVER
La question du jazz chez Adorno

.
- Art authentique ? La notion d’art authentique signifie art vs industrie culturelle. C’est d’abord une notion polémique (et pas un concept) contre la « création publicitaire », modèle des industries culturelles.
- Art savant ? Rien à voir avec un art d’élite. Il s’agit d’un questionnement qui parcourt toute l’histoire de la philosophie occidentale, donc son esthétique : les médiations entre science/philosophie, art et morale/politique : le vrai, le beau, le bien.
- Art populaire [industrialisé] ? = industries culturelles, différent d’arts et traditions populaires : tourné vers le divertissement géré par les grands groupes de communication, dans le meilleur des cas : sublimation, dans le pire : emprise idéologique.
Doc H.
Contenu
La place et la fonction de la question du jazz dans la problématique d’Adorno
À propos du jazz, et de la théorie critique des industries culturelles, pour comprendre T.W. Adorno, il faut s’immerger dans sa logique, dans les enjeux de sa pensée, bref dans sa problématique et non pas pointer ça et là des contradictions forcément présentes chez un auteur qui refusait l’esprit de système (philosophique) au profit de L’Esprit de l’utopie (titre de l’ouvrage d’un de ses maîtres à penser : Ernst Bloch). Se rappeler aussi que c’est un polémiste (Minima Moralia), et pas seulement un théoricien et surtout pas un théoricien ayant créé un modèle : par exemple la Théorie esthétique est une compilation de fragments écrits avant sa mort en 1969 et compilé et publié après sa mort qu’on a eu trop tendance à assimiler à un système esthétique philosophique.
T.W. Adorno défend le peuple en prise à l’idéologie que matérialisent les industries culturelles dans le cadre du capitalisme tardif. La caste supérieure, les alpha, ne serait-ce qu’à des fins de distinction sociale, comme l’expliquait Pierre Bourdieu, continuera à aller au musée, au théâtre, dans les expositions Soulages, César, Picasso, mais comment émanciper le quidam qui continue à penser que peindre du noir (Pierre Soulages), c’est un canular ou une supercherie, que César se moquait du monde avec ses compressions de voitures récupérées à la casse, que c’est dommage que Picasso qui peignait de si jolis tableaux pendant sa période bleue se soit moqué du monde ensuite avec le cubisme sur le dos d’un snobisme ambiant. Combien de films, de séries TV et encore aujourd’hui, ridiculisent l’art contemporain au nom d’un art populaire industrialisé ?
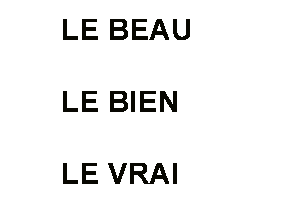
.
T.W. Adorno oppose art savant et art populaire. Art savant ne renvoie pas à art d’élite ( l’éternel procès en élitisme intenté à Adorno). On ne comprend pas cette distinction si on ne la recadre pas dans une tradition philosophique occidentale qui remonte à Platon : le jeu de médiations entre le vrai (sciences, philosophie), le beau (l’art) et le bien (la morale, l’éthique, le politique). Pour ce qui concerne notre objet, l’art, voilà ce qui se joue dans les œuvres, comme le rappelait Hegel :
Car dans l’art, nous n’avons pas affaire à un jeu simplement agréable et utile [ce que peut être au mieux l’industrie culturelle via la sublimation et la catharsis, c’est moi qui glose], mais… au déploiement de la vérité
Aussi ne pas accéder à cet art savant, c’est se priver d’une approche prospective de la complexité du monde qui nous entoure : un tableau cubiste de Picasso peut être au niveau de la sensibilité esthétique une médiation vers la théorie de la relativité et ses équations. Mais cela ne signifie pas comme le soulignait Picasso qu’il y a une influence directe, encore moins de vulgarisation. Les demoiselles d’Avignon ne sont pas une illustration de la Théorie d’Einstein même si on peut noter des corrélations quant à la réalité augmentée qu’elle apporte dans la culture de leur temps. Freud lui-même, se référant aux tragiques Grecs (Œdipe) et à Shakespeare (Hamlet), ne rappelait-il pas que les artistes avaient été des précurseurs de ses propres intuitions ?
L’art populaire et a fortiori l’art populaire industrialisé d’aujourd’hui permet un défoulement, une catharsis voire, au mieux, une sublimation. L’enjeu est donc de permettre aux masses, comme on disait autrefois au XXe siècle, d’accéder à une alternative qui permette de se divertir du poids de la reproduction de la force de travail ET :
Ils recherchent donc la nouveauté, mais dans la mesure où le travail va de pair avec la peine et l’ennui, ils cherchent à éviter tout effort pendant ce temps de loisirs qui leur offre pourtant la seule chance de faire de nouvelles expériences.
La question pour Adorno c’est qu’un art populaire de plus en plus industrialisé, par la force de frappe des grands groupes de communication éloigne irrémédiablement le « populaire » de toute alternative esthétique (ce qui est aussi un enjeu en terme d’éducation populaire : cf. les tentatives des cinéclubs, du TNP, de Brecht, etc.) en faveur de l’offre diversifiée, segmentée et désormais profilée des industries de l’entertainment.
Réactualisation de la polémique sur le jazz contre Adorno
Dans le champ interdisciplinaire de recherches sur les industries culturelles, j’interroge la position controversée d’Adorno sur le jazz. Combien de spécialistes des industries culturelles évacuent toujours la question du jazz chez Adorno au prétexte que ce dernier ignorait la richesse, les courants, l’histoire de cette musique du vingtième siècle ?

Une objection qu’on ne peut même pas appeler subjective mais plutôt émotionnelle, voire irrationnelle et que j’ai appelé, par comparaison avec la philosophie spontanée des savants de Louis Althusser : la culture spontanée des chercheurs. Un véritable conflit d’intérêt entre la position scientifique et d’autorité de certains spécialistes des industries culturelles et leur bon plaisir quand ils aspirent, eux aussi, à se divertir de leurs chères études.
Doc H.
Dans le livre récent de Christian Béthune (qui avait déjà, en 1991, préparé avec Francis Hofstein un numéro spécial de la Revue d’esthétique : Jazz), il est écrit, avec l’aval de Marc Jimenez, traducteur de la Théorie esthétique et défenseur du jazz dans le séminaire d’Olivier Revault d’Allonnes au début des années 1980 dans la salle Cavaillès de la Sorbonne, qui le publie dans sa « Collection d’esthétique » aux éditions Klincksieck :
Contrairement à ce que l’on a pu affirmer, la réflexion sur le jazz n’est pas réductible à une simple anecdote dans l’esthétique d’Adorno, un chemin vicinal où, pour d’obscures raisons, le philosophe se serait accidentellement fourvoyé. C’est, nous l’espérons, ce que cette étude aura au moins mis en évidence.
Parcourant ce qui lui semble être l’histoire d’un déni esthétique, Christian Béthune, dans un terrible réquisitoire, argumente pour montrer comment Adorno s’est, non pas accidentellement, mais essentiellement fourvoyé.
Ainsi, chaque discipline revendique ou attaque son « Adorno ». Gilles Mouëllic, à propos du texte d’Adorno : « Sur la musique populaire », essaie, lui, sur la base de la vieille distinction entre « art et industrie », de rendre un jugement plus « équilibré » :
Dans ce texte passionnant [« Sur la musique populaire »], Adorno fait preuve d’une grande lucidité quant à la fabrication des produits de consommation culturels de masse. Son étude annonce les grands courants musicaux des décennies à venir, que ce soit le rock, la pop ou autre new-wave et techno des années quatre-vingt-dix. C’est d’ailleurs par un pillage de la musique noire, puis par son exploitation organisée, qu’un ersatz du blues et du jazz — le rock — deviendra exemplaire de la puissance de la machine industrielle américaine. En revanche, il est impossible de le suivre quand il oppose violemment musique sérieuse et jazz en prenant pour exemple Beethoven pour la première, mais Benny Goodman, Paul Whiteman, voire l’obscur Guy Lombardo et les mélodies des films avec Ginger Rogers pour le second. Si, en 1937, Adorno ne pouvait qu’ignorer le bop à venir, il ne cite jamais Duke Ellington, Count Basie ou Louis Armstrong, musiciens d’une autre tenue, réduisant la musique noire américaine à quelques chansonnettes séduisantes.
Adorno aurait donc raison concernant l’exploitation industrielle du jazz, mais tort quant à son refus d’y voir un art authentique, mais une matrice haut de gamme de l’industrie culturelle musicale renouvelant sa gamme de produits dérivés. Pour résumer la situation, la pertinence des analyses d’Adorno ne se justifierait qu’en partie dans le champ interdisciplinaire des industries culturelles. En effet, les analyses sociologiques et économiques d’une industrie culturelle ne s’appliqueraient qu’à des produits de grande consommation. Si c’est le cas, alors comment proposer d’ouvrir un nouvel angle, complémentaire de l’angle économique dans l’approche des logiques des industries culturelles, qui ne se réduise pas à l’inventaire de stéréotypes culturels ?
L’approche esthétique — musicale — en terme de forme, technique et matériau, des concepts-clefs de la Théorie esthétique, propose une critique non seulement des stéréotypes culturels, mais aussi des stéréotypes idéologiques « politiquement corrects » qui polluent le débat. Le stéréotype sur le rapport entre le jazz et l’Afrique permet de ne pas entendre que le jazz ne peut se réduire à une musique de noirs opprimés et exploités par les blancs, ce qui permet à certains Européens d’afficher un anti-américanisme rapide tout en revendiquant leur amour du jazz, cette musique afro-américaine pour certains, noire américaine pour d’autres, ou encore musique « classique » noire américaine pour Nina Simone.
Une réflexion préalable sur le mythe des origines africaines du jazz
Les détracteurs d’Adorno sur la question du jazz ont une équation à résoudre : comment fonder le caractère authentiquement artistique du jazz, comment l’extirper de la sphère des industries culturelles où voudrait le cantonner l’auteur de « Sur la musique populaire » ? À la notion d’art authentique, dont Adorno lui-même soulignait le flou artistique, donnant aussi des verges pour se faire fouetter, il vaut mieux se référer à la distinction art savant/art populaire (industrialisé). Alors la question qui nous intéresse dans cet article est celle de la fonction esthétique, sociale et politique du jazz et peut être avant tout sa fonction heuristique de médiation entre l’art et la connaissance, le « contenu de vérité » des œuvres d’art ( à ne pas confondre avec le « message » d’un art « engagé ») pour reprendre ce concept de la Théorie esthétique. En réactivant le mythe des origines, en fondant « l’authenticité » du jazz sur une culture africaine, sur des racines archaïques qu’on ne peut soupçonner de complicité avec une quelconque industrialisation de la culture. Quitte, pour justifier les scories de l’industrie, à réactiver l’antienne de la « récupération » sous les auspices de l’exploitation de cette culture authentique par les marchands blancs, américains, de l’industrie du disque. La polémique est en place autour de cette notion à l’origine polémique de la notion d’art authentique contre les velléités artistique de la publicité, ce modèle des industries culturelles. Car la seule question qui vaille c’est la place et la fonction sociales du jazz (et surtout de son devenir, de ses séquelles) et non pas la question de son essence esthétique.

La création de la « Revue nègre » a pour cadre le théâtre des Champs-Élysées qui avait connu ses heures de gloires et de scandales au moment de la période « Ballets russes » (1913-1917) et cherchait un second souffle.
En 1925, André Daven, directeur artistique de ce théâtre parisien, se met en quête d’un nouveau type de spectacle. Son ami le peintre Fernand Léger qui avait travaillé sur les « Ballets suédois » au succès mitigé, était par ailleurs depuis longtemps marqué par l’Art nègre, tout comme ses complices Apollinaire, Picasso, Max Jacob et certains des

premiers surréalistes : Léger suggère de créer un spectacle entièrement joué par des Noirs. Daven croise alors une américaine, Caroline Dudley Reagan (qui deviendra la compagne de Joseph Delteil), laquelle se met en quête pour Daven d’une troupe composée de Noirs. C’est à New York que Dudley, en véritable impresario, réussit à convaincre douze musiciens noirs dont Sydney Bechet, et huit chorus girls dont Joséphine Baker, soit 20 personnes en tout, de partir pour Paris. Wikipédia
Je me propose, pour ma part, en référence au livre de René Langel : Le jazz orphelin de l’Afrique de tester, de mettre à l’épreuve du débat entre ces différents spécialistes une première hypothèse hétérodoxe : Et si le devenir du jazz, la musique noire américaine, c’était d’incarner la nouvelle musique « populaire » américaine ?
Une thèse sur le devenir du jazz comme paradigme musical et formel des industries culturelles
Si le devenir du jazz n’était pas seulement celui du martyrologe d’un fonds musical « noir » pillé par l’industrie « blanche » de la musique populaire américaine, une musique populaire à l’ère de la reproduction mécanique ? Et si le jazz était devenu le paradigme musical et formel des industries culturelles ? J’ai déjà entr’ouvert ce débat à propos du rapport entre Adorno et la musique de cinéma en approchant la position d’Adorno par cette formule :
Si la publicité au plan de l’information et de la communication est le modèle esthétique général de l’industrie culturelle, le jazz en est devenu le paradigme musical et formel.
Pourquoi cet « acharnement » d’Adorno contre le jazz ? Aurait-il compris que, dans leur volonté hégémonique, les industries culturelles d’inspiration américaine tentent d’inféoder l’Europe condamnée culturellement par ses contradictions historiques ? Dans une posture quasi gaullienne, aurait-il anticipé que dans cette préfiguration (les textes antérieurs à 1945) ou dans ce constat (les textes d’après 1945) du plan Marshall dans son versant culturel, le jazz, sous toutes ses formes, devient un enjeu décisif ?
Cette posture « quasi gaullienne » est difficile à tenir quand on défend une langue — l’allemand — et un pays — l’Allemagne — qui n’a pas seulement, comme la France, failli pour les uns et résisté pour les autres, mais le pays par qui le désastre européen est arrivé et que, dans ce pays, on fait partie soi-même, en tant que juif par son père, de ceux qui y ont payé le plus lourd tribut ?
Les réceptions du cinéma et du jazz en France sont intéressantes à comparer. Le grand public découvre ou redécouvre à la Libération le jazz (en fait plus le Swing « blanc » d’avant-guerre d’un Glenn Miller dont témoigne le tube planétaire In the mood (1939) que les boppers des années 45-48 comme le Noir Charlie Parker) et le cinéma américain sans trop se poser de questions. Les professionnels de la culture, eux, vont devoir se positionner idéologiquement et politiquement par rapport à cette invasion de produits venus d’outre-Atlantique accompagnant le Plan Marshall.

.
Ainsi, pour les professionnels du cinéma, la concurrence est rude et entraîne un front syndical et culturel, sur la base d’un anti-américanisme qu’on pourrait dire, pour faire court, gaulliste et communiste. Dans le secteur du cinéma, il faut défendre la bonne culture populaire française contre l’industrie hollywoodienne. Pour le jazz, moins sujet aux quotas, l’engouement partagé par le monde de la culture, à l’instar de Sartre, se retourne aussi contre « l’Amérique » : le jazz est la musique des Noirs américains, de leur souffrance, et n’est donc pas la voix de l’Amérique impériale sauf dans ses séquelles les plus commerciales.
Doc H.
Retour sur un mythe : la négritude et le jazz
Le jazz ne pourrait prétendre à l’authenticité artistique qu’à condition de se fonder sur ses racines africaines préindustrielles.
Langel, Mouëllic, Béthune, mais aussi Malson, il est temps de présenter mieux ces spécialistes français du jazz d’aujourd’hui, dont la lecture ou la relecture, ainsi que celle de « l’incunable » Sur la musique populaire, m’a poussé à rouvrir le dossier.
Lucien Malson : le jazz, une musique afro-américaine
Quand, au début des années 1980, Olivier Revault d’Allonnes avait voulu que soit traitée la critique du jazz par Adorno, il avait fait appel au grand spécialiste français, auteur en 1976 d’une première édition d’une Histoire du jazz et de la musique afro-américaine, rééditée en mai 1994 : Lucien Malson. Lucien Malson est le coauteur (avec Christian Bellest, compositeur et arrangeur, professeur honoraire de Conservatoire à la Ville de Paris) du Que sais-je ? Le Jazz.
Dans son Histoire, Malson ne cite pas Adorno, mais il fait référence une fois au concept d’industrie culturelle dont il conserve le nom allemand Kulturindutrie. En passant, il entérine la distinction entre un Adorno pertinent quand il vise les séquelles jazziques de l’industrie culturelle du disque, et à rebours, impertinent par rapport au jazz lui-même :
Le rhythm and blues accouche chaque année de mille vedettes provisoires, presque toutes englouties aussitôt que nées par le « show business » et la Kulturindustrie.
Lucien Malson, docteur d’État ès lettres, agrégé de philosophie, possède une culture musicale qui lui permet de ne pas s’enfermer dans les dogmes trop rapides sur le jazz. Sur cette base musicologique, il peut comparer le jazz à toutes les musiques et notamment celle à laquelle on l’oppose : la musique européenne.
Et la première tâche de Malson est de s’en prendre aux définitions des dictionnaires qui, en tentant de spécifier ce qu’est le jazz, ne proposent que des fausses dissemblances. Ainsi, quand on compare techniquement et formellement ce qui ferait cette spécificité, on s’aperçoit, nous montre-t-il avec des contre-exemples, que ce n’est pas nouveau, par exemple la variation de l’orchestre et du choix des instruments qu’il résume ainsi :
L’instrumentation ne peut, en effet, suffire à définir, par opposition, un ensemble afro-américain et un ensemble européen, et le nombre des exécutants pas davantage.
Sur l’importance de l’improvisé, il rappelle, entre autres, la tradition d’improvisation chez les organistes d’église. J’ajouterai que Jean-Sébastien Bach, par exemple, était un merveilleux organiste, expert en improvisation. En 1747, quand Bach entre dans la Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften (Société pour la Correspondance des Sciences musicales) fondée en 1738, il compose à l’intention de cette société L’Art de la fugue. Mais cette dernière œuvre n’est-elle pas aussi, d’une certaine façon, la trace écrite et matérialisée dans une forme de cette pratique musicale où il fallait « assurer » et accompagner les rituels sociaux du mariage et de l’enterrement pour lesquels on ne composait pas toujours une « messe » complète ?
Malson, après avoir noté que : « Ainsi, l’improvisation jazziste, qu’elle soit paraphrastique ou commentatrice, n’apporte-t-elle point de nouveauté dans son idée. », conclut sur ce thème tant rebattu des amateurs de jazz : « Toutefois, la coutume d’improvisation, non plus qu’un relatif désintérêt pour les problèmes de formes ou de pensée élaborée, ne peut suffire à définir l’art afro-américain, à désigner ce en quoi, chez lui, une incomparable joie trouve sa source. ».
Si ce n’est pas au plan technique que s’opère la distinction, il faut la chercher, et c’est ce que suggère la deuxième partie de cette dernière citation, dans le plaisir qu’on en tire. Et là, Malson distingue l’image épurée de la musique européenne « classique », sans « humour » (du moins jusqu’à Beethoven), du caractère « orgastique » du jazz, engendrant des « spasmes » dans un jeu de tension/détente.
Il reconnaît l’existence d’une rencontre entre deux traditions, il pose même l’idée d’une synthèse créatrice :
Le jazz est le produit d’une rencontre — d’une rencontre et d’une synthèse créatrice de la tradition européenne et de la tradition africaine.
La tradition des colons américains, cette diaspora souvent protestante de sectes, renvoie autant à la musique classique — surtout religieuse — qu’à la musique populaire des différents pays d’origine. Les racines « africaines » du jazz renvoient à des cultures tribales plus qu’à des pays (il faudra attendre le découpage arbitraire de la colonisation) et pas forcément à un continent. On sous-entend donc l’Afrique noire et, même si la négritude a été revendiquée souvent comme une projection ou un horizon politique, la couleur de la peau renvoie d’abord à une catégorie créée par l’amalgame en terme de domination — esclavage, colonisation, ségrégation —, donc à une rencontre entre un dominant et un dominé. Précisons que le dominant n’est pas forcément un adepte de Bach et le dominé, un représentant d’une culture africaine telle qu’ont voulu la présenter certains adeptes du free jazz (très tardivement d’ailleurs dans l’histoire du jazz). Cette culture africaine globalisée à l’échelle du continent est parfois aussi mythique que le cimetière des éléphants dans un film hollywoodien aux relents de colonialisme appartenant à la série Tarzan des années trente !
Tout en reconnaissant la rencontre, la synthèse, Malson, sur la base de son caractère de domination et d’exploitation, ne peut, pour approcher ce qu’est le jazz, que se raccrocher à son appellation de musique afro-américaine qui permet de réconcilier authenticité artistique africaine et plaisir au cœur de la négritude. Il ne privilégie (question de stratégie et de droits), par exemple dans l’iconographie de son Histoire du jazz, que les musiciens ou chanteurs noirs. Seuls, quelques « Blancs » accèdent au Panthéon iconographique comme Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Stan Getz, Henri Renaud, et Michel Portal.
Même pour les sous-produits rock and roll, ne sont « sauvés » dans le texte, outre bien entendu les « vedettes » noires du rhythm and blues et ses dérivés : Michael Jackson ou James Brown, que les Beatles, fils d’ouvriers, qui aiment Little Richard et Chuck Berry et ont joué d’abord du « skiffle » — du vieux jazz blues aux instruments bricolés — et enregistré des thèmes de tradition (When the Saints, Sweet Georgia Brown) ou les Rolling Stones dont le nom collectif est emprunté au titre d’un morceau de Muddy Waters. Lapsus éditorial ? Ni les Beatles, ni les Rolling Stones ne figurent dans l’index final des musiciens alors que Michael Jackson ou James Brown y trouvent leur place.
Si l’on donne un poids éditorial à cette iconographie, ce déséquilibre prouverait « par l’image » que la majorité des « grands noms » du jazz sont noirs, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question ici. Et qu’ils sont noirs américains.
Gilles Mouëllic : le jazz, une préhistoire africaine, une histoire américaine
Gilles Mouëllic collabore régulièrement à la revue Africultures. Il est l’auteur, aux éditions des Cahiers du cinéma, d’un essai intitulé Jazz et cinéma.
Dans son livre, auquel je fais référence ici : Le Jazz, une esthétique du XXe siècle, le thème de la rencontre est aussi présent sous sa forme canonique :
Le jazz est né de la rencontre de deux cultures, l’une africaine, réputée plus spontanée, l’autre occidentale, fondée sur l’idéalisme de la Grèce classique […] Cette étude tente d’abord de définir une musique qui trouve ses racines dans la déportation massive des esclaves venus d’Afrique, une musique dont les qualités fondamentales, le rythme et le son, sont issues du continent noir. Mais si la préhistoire du jazz est africaine, son histoire est américaine, entre La Nouvelle-Orléans et les grandes villes qui ont vu naître les big bands, le bebop puis le Free jazz.
Je signale le caractère artificiel de l’identification « continent noir ». Jean Rouch, dans un très beau film réalisé par Dominique Dubosc : Jean Rouch, premier film : 1947-1991 (Kinofilm en association avec La Sept, 1991), révèle comment, après avoir acheté une caméra « aux puces », il est parti filmer une chasse à l’hippopotame au Niger (et pas dans une Afrique indéterminée). Par manque d’argent, il cède les rushes à un responsable des actualités cinématographiques françaises.

.
Celui-ci les avait montés avec un commentaire impossible et en ajoutant à la fin, pour glorifier l’Afrique noire sauvage, authentique, mystérieuse, des plans d’animaux tirés de stock-shots, à la manière des films de Tarzan, animaux qui, on le devine, n’avaient jamais mis les pieds au Niger. Et ce film, rebaptisé Au pays des mages noirs, était passé en première partie du film Stromboli de Roberto Rossellini.
Doc H.
Pour beaucoup de spécialistes du jazz, la « rencontre » dont il est question ne peut s’instituer en devenir, celui de la musique américaine (en noir et blanc), mais est condamnée, pour ne pas se perdre, à s’accrocher à ses racines africaines, en ne concédant n’avoir subi que quelques influences « occidentales » par le fait de la domination et d’une tentative de contournement de cette domination par l’adhésion à quelques valeurs religieuses et musicales de l’oppresseur.
Gilles Mouëllic, lui, entre autres termes, ajoute celle de musique négro-américaine, tout en oscillant dans ses appellations. Il ancre même cette dénomination dans celle de civilisation négro-africaine :
La plupart des esclaves sont originaires du golfe de Guinée, du Cameroun au Sénégal, lieu de la plus riche civilisation négro-africaine. Il n’existe pas de documents écrits sur la musique ancienne de l’Afrique occidentale, issue de ces peuples de traditions orales. Les sources proviennent des récits de voyageurs et de commerçants européens. Tous ces témoignages convergent.
Préhistoire africaine, histoire américaine, le texte oscille : « L’histoire du jazz est indissociable de la montée en puissance des villes américaines. ».
N’ajoute-t-il pas aussi pour ne pas trop concéder à la tradition « blanche » :
De l’appropriation des cantiques protestants dans les camp meetings à la maîtrise des boppers, les créateurs ont peu à peu trouvé un équilibre entre l’Afrique et l’Europe […] Des spirituals aux gospels, des work songs au blues, leur grande force, et celle de leurs descendants, fut de conserver la part africaine. […] S’il a su intégrer dans son esthétique les innovations de l’harmonie propres au XXe siècle, il n’est pas devenu pour autant un genre de la musique occidentale.
D’ailleurs, dans la première phrase de l’introduction, il ouvrait sur un lyrique :
Les « sources grondantes » [expression de Malson dans son Histoire] de la musique noire américaine coulent du côté du golfe de Guinée, de ces territoires saignés par l’esclavage.
Tout en renvoyant dès la deuxième phrase de la même introduction à ce thème de la rencontre que personne ne nie :
Le jazz naîtra de la rencontre des traditions musicales venues d’Afrique et des formes importées d’Europe par les émigrants.
On se sent piégé comme dans un débat télévisé régi par le politiquement correct, fût-il « progressiste ». Qui oserait s’en prendre à la fierté noire, alors que ce n’est pas la question, qui se permettrait le risque d’être malentendu au nom d’une vérité qui, justement, met la tension, les luttes au cœur du dispositif de compréhension, mais aussi les ajustements des uns et des autres ? Et après tout, dans la dialectique du maître et de l’esclave, celui-ci ne peut-il au moins sur le plan musical prendre le pas sur celui-là ?
L’enjeu esthétique et politique est de taille si l’on se propose de montrer que le jazz est devenu le paradigme musical et formel des industries culturelles, dont la terre d’élection est l’Amérique. Plus exactement, est en jeu le rapport du politique et de l’esthétique dans le cadre de la thèse adornienne : la forme est du contenu [social et politique] sédimenté.
René Langel : le jazz orphelin de l’Afrique
Le jazz orphelin de l’Afrique, le livre de René Langel a un titre ambigu qu’il ne faudrait pas asservir inopinément à la cause des contempteurs du jazz dans sa prétention artistique. René Langel a été rédacteur en chef de Hot-Revue, première publication francophone d’après-guerre (1939-45) consacrée au jazz. Journaliste suisse, cofondateur du festival de Montreux, il enseigne aujourd’hui l’histoire du jazz. C’est dire que son livre, s’il malmène le mythe africain du jazz, défend son statut artistique.
Le titre est ambigu et cette ambiguïté tient à l’idée de musique orpheline. Aujourd’hui, un certain discours psychologisant relayé par les médias impose à l’orphelin et ses parents un parcours du combattant, nourrissant le psychologiquement correct. Les parents adoptifs doivent révéler dès l’enfance à l’orphelin ses origines biologiques. Enfin, adolescent ou jeune adulte, il se mettra en quête de ces mêmes origines et vivra dans la dissociation entre ses origines biologiques et le contexte familial et social d’adoption où il a vécu sa jeunesse. On peut ironiser sur la réception et la diffusion médiatiques de ce psychologisme dénoncé par Adorno. Cette analogie permet de pointer l’ambiguïté que j’ai relevée. Le jazz, orphelin de l’Afrique, serait dans cette situation inconfortable de l’enfant orphelin, tiraillé entre des racines qu’il n’a jamais connues directement, une langue, s’il est « d’origine étrangère », qu’il ne parle pas.
Le Free Jazz ou New Thing : l’exaspération du mythe
C’est en 1960 que le saxophoniste Ornette Coleman enregistre un morceau de 36’ 23’’ intitulé Free Jazz qui bouleverse les règles du jazz pour résister à son assimilation par les Blancs ou par les « Nègres » complices, injure proférée par des Noirs contestataires contre « les Noirs américains qui tentent de s’intégrer à la société blanche en la mimant ».
Dans les faits, il s’agit bien de défendre la fierté noire, plus que de résister aux Blancs. Pour les musiciens américains le jazz n’est pas musicalement une affaire de couleur. C’est une interprétation idéologique franco-française d’insister sur l’essence purement noire du jazz, qui est vite devenu une musique internationale (Europe, Japon, Brésil) avec des apports musicaux divers. Deux membres du célèbre double quartet d’Ornette Coleman (Free Jazz) en 1960 étaient Blancs (les contrebassistes Scott Le Faro, et Charlie Haden).
Même le très militant et Afrocentrique Archie Shepp a embauché des musiciens blancs (Rosswell Rudd, Perry Robinson, Charlie Haden). Idem pour Cécil Taylor, qui a longtemps joué avec le contrebassiste Buell Neidlinger. Quant à Miles Davis, il s’est largement ouvert à des collaborateurs blancs pour les sessions de Bitches Brew (Joe Zawinul, Keith Jarrett, Chick Corea, sans oublier le guitariste britannique John McLaughlin).
Prof B.
Si le mythe du jazz se réinvente avec chaque courant, la constante reste donc son origine africaine et il en va ainsi de l’histoire du jazz revisitée politiquement et sous une forme exacerbée par les tenants du Black Power et du Free jazz :
… on valorise le Noir et l’Afrique, contre le Blanc et l’Occident, et contre le « nègre » qui les imite. Les Black Muslims, qui avaient adopté la religion islamique, avaient renoncé à leur « nom d’esclave », remplacé par un X emblématique. [cf. Malcom X]. Après la musulmane, ce sont les religions et civilisations africaines qui sont sollicitées (de nombreux musiciens de jazz adoptent des noms arabes ou africains). Les universités noires créent des départements de Black Studies, et dans les ghettos, des militants (tel LeRoi Jones) enseignent aux jeunes Noirs une autre histoire, une autre culture et d’autres mythes que ceux que les écoles blanches leur donnent comme « universel ».
Notons que, passé ce moment fort de révolte idéologique, le mouvement mûrit une rupture politique elle-même plus « universaliste » :
Le risque démobilisateur de cette satisfaction fantasmatique (apprendre et parler le swahili par exemple, se vêtir à l’africaine, etc., jouant comme substituts et exutoires de l’action révolutionnaire) est donc vivement dénoncé, en même temps que, dans le souci de briser les divers systèmes de clôture sociaux, culturels, politiques (l’isolement au stade du ghetto, du cercle culturel africaniste, de la Nation noire comme minorité raciale, etc.), l’on insiste sur le fait que les Noirs américains sont des victimes parmi les autres de l’impérialisme américain : peuples du tiers-monde, majorité de couleur.
René Langel, comme Lucien Malson d’ailleurs, tord le cou à quelques arrangements avec l’histoire des États-Unis :
L’exaspération noire touchera à son comble dans les années soixante avec l’avènement du Free jazz. Une manifestation avant tout politique, associée à la montée de la révolte noire des Black Panthers. Il fallait détruire tout ce qu’on pouvait devoir aux Blancs, même ce jazz qu’ils avaient volé à cette race qui n’était pas la leur. Abolition de toute structure, plus le moindre rythme suspect de swing, plus de successions harmoniques, plus de mélodies entachées d’occidentalisme. Cette anti-musique devait déboucher sur un pseudo-retour aux sources africaines avec l’avènement du modalisme, à l’honneur par ailleurs dans nombre de folklores du monde. John Coltrane et les nombreux disciples qu’il suscita en sont un exemple. Aujourd’hui encore, l’antagonisme persiste. On n’écrit pas « négro-américain », mais « afro-américain ». Et les Noirs revendiquent haut et fort les sources africaines du jazz. D’autant plus confortés dans cette idée univoque que nombre de commentateurs ne manquent pas de propager sur le sujet des informations approximatives ou franchement erronées.
Se fondant souvent sur le Free jazz pour faire du jazz une nouvelle musique contemporaine n’ayant plus grand-chose à voir avec le jazz, maîtrisant peut-être mal la chronologie du jazz, certains amateurs et critiques vont jusqu’à rejeter hors du jazz Sidney Bechet et Louis Armstrong comme si ces derniers pouvaient être réduits à leurs caricatures : Bechet avec Claude Luter dans Petite fleur, oubliant, pour reprendre la formule de Lucien Malson, la période « Nouvelle-Orléans héroïque » de cet « impérieux aîné » ; Armstrong et sa caricature dans Hello Dolly oubliant son Hot Five de Chicago en 1925.
Face à cette sorte « d’argumentation du chaudron » où ces « amateurs » adoptaient successivement différentes postures au gré de leurs besoins rhétoriques, le jazz devenait un grand fourre-tout, tantôt synonyme de musique classique (noire américaine), tantôt avec le free de musique contemporaine (en noir d’abord, puis en noir et blanc avec Michel Portal, par exemple), voire de variété haut de gamme comme le rhythm and blues, bref synonyme de musique ; le mot « jazz » se substituant au mot « musique », ce qu’avait sans doute très bien anticipé Adorno en écoutant les discours accompagnant sa mutation.
Comme Lucien Malson, René Langel refuse des définitions sur des bases musicales hasardeuses. Comme le premier l’avait fait avec l’improvisation, le second règle son compte à l’antiphonie :
Attribuer, par exemple, à l’héritage africain l’antiphonie, cette pratique du dialogue entre le soliste et le chœur, ou le chant accompagné de battements de mains comme dans le gospel, c’est ignorer que les puritains de la Nouvelle-Angleterre et la secte des « Trembleurs », notamment, poursuivaient ces pratiques bien avant que les noirs des plantations ne les découvrent. De même, la gamme pentateunique ne doit rien à l’Afrique, elle régnait déjà sur les premiers psaumes importés d’Europe au XVIIe siècle. Cette propension des exégètes à privilégier les sources africaines de la culture noire, quitte même à falsifier les faits, est encouragée par les Noirs eux-mêmes qui pensent retrouver dans leurs ascendances une dignité que les Blancs leur refusent encore et toujours.
On pourrait multiplier les exemples. Pourtant, René Langel, en concluant sur « le triste destin du rap, spectacle de rue, puisant sa véhémence vociférante dans la haine du Blanc », se raccroche à cette idée exclusive d’une exploitation blanche du jazz, cette « récupération » aurait-on dit dans les années 1968, pour préserver sinon les racines africaines du jazz, du moins son authenticité artistique, sa force esthétique garantie par la résistance et les luttes politiques. René Langel ne peut se résoudre à conceptualiser le devenir du jazz autrement que comme un destin, éventuellement tragique :
Une fois de plus l’Amérique des Blancs avait phagocyté le génie noir. Il en sera toujours ainsi tant que la mentalité puritaine et obscurantiste américaine nourrira le mépris des autres, des Noirs, des Jaunes, des Juifs, des Mexicanos et des… non-États-Uniens.
Alors comment Adorno, émigré, ne l’a-t-il pas admis, semblent se demander ses détracteurs français d’aujourd’hui ? La réponse est bien sûr dans son esthétique et sa théorie de la nouvelle musique, ce qu’a très bien compris Christian Béthune dans Adorno et le jazz, analyse d’un déni esthétique. Mais cette réponse, il va la retourner contre Adorno avec l’appui éditorial de certains de ceux qui ont permis sa réception en France (par la traduction et l’édition en français). Ce retournement d’alliance intellectuelle ne laisse pas d’impressionner comme s’il s’agissait d’un enjeu théorique décisif. Si la musique joue un rôle psychologique et social déterminant, y compris pour des chercheurs (la culture spontanée des chercheurs déjà évoquée), forte est la tentation de refuser finalement l’héritage critique d’Adorno dans ce qu’il a de plus crucial.
Christian Béthune : analyse d’un déni esthétique
Dans ce livre savant, où l’auteur passe au crible des thèses esthétiques d’Adorno tous les griefs de ce dernier contre le jazz, la référence à la négritude est pour le moins brutale.
En effet, contrairement à ce que certains suggèrent, il n’est pas dit, à tout prendre, que jazz et musique classique puissent effectivement cohabiter en bonne intelligence à l’intérieur d’une même catégorie de l’être ou comme instances siamoises d’une esthétique réconciliée. En dépit des allégations lénifiantes entendues çà et là, échos d’un irénisme politiquement correct, il subsiste en jazz — n’en déplaise à Adorno et à quelques autres — une part de négrité qui tient moins à la couleur de la peau qu’à une manière d’être, une « attitude » irréductiblement étrangère à notre compréhension du goût, mal adaptée à un mode de fonctionnement intellectuel qui s’organise à l’intérieur de catégories propres au monde occidental de la pensée. Un clivage que revendiquent de manière tout à fait consciente bon nombre de jazzmen :
« Pour ma part j’en sais assez sur la musique classique pour savoir que je n’ai pas envie d’en jouer parce que ce n’est pas ma musique. Et je dois préciser ici que ce n’est pas une question de couleur de peau, pas une question de ségrégation ; mais il y a certaines choses qui font que les Noirs qui restent noirs ne peuvent pas jouer de musique classique. » (Donald Byrd, entretien avec François Postif, Jazz Hot, n° 138, cité par Michel Jalard dans Le Jazz est-il encore possible ? , Marseille, Parenthèses, 1986, p. 21).
Comment expliquer alors, et c’est aussi l’objet de la présente étude, la réception « blanche », de cette musique « noire » ? Dans un contexte d’industrialisation croissante, comment rendre compte de la rencontre progressive entre la musique noire et un prolétariat noir et blanc ? Pourquoi les corps de tous ceux qui travaillaient dans les usines se retrouvaient-ils autour d’une pulsation idéologique qui les libérait et les asservissait à la fois ?
Saisi par une nouvelle posture anti-occidentale qui rappelle les premiers excès du Free Jazz, Christian Béthune, en critiquant Adorno, met à jour ce que ce dernier avait bien pressenti comme risque majeur : que la crise de la rationalité, la musique « classique » faisant partie de cette culture de la raison, apparaisse indépassable. Or, c’est tout le contraire que recherche Adorno dans sa défense de la culture européenne au sein même de sa crise. L’opposition frontale chez Christian Béthune — et soulignons sa différence avec nos autres intervenants — est donc exemplaire d’une ligne de fuite qui, pour se dire moins brutalement ailleurs, n’en innerve pas moins en creux les discours des uns et des autres.
Adorno et la négritude dans le jazz
Certains de ses détracteurs se demandent donc pourquoi Adorno, l’intellectuel allemand et juif par son père, le critique des dérives de la Raison, forcé de s’exiler, s’en est pris aussi violemment au jazz. Dans les critiques qui lui sont faites pointe parfois le soupçon de racisme, au moins culturel. Il est vrai qu’il prend à contre-pied le travail des couches progressistes qui ont érigé peu à peu le jazz en étendard des luttes antiracistes. Mais n’étaient-ce pas aussi les mêmes qui voulaient le promouvoir culturellement comme substitut à la nouvelle musique européenne complice d’une Europe qui avait sombré dans le chaos et les enfers de la Raison révélés par Auschwitz et ses usines de la mort ?
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. En de rares endroits, Adorno précise sa position. Dans « Mode intemporelle, A propos du jazz », écrit en 1953, il déclare :
Il est d’ailleurs difficile d’isoler les éléments authentiquement nègres du jazz. Il semble que le lumpenprolétariat blanc ait lui aussi sa part dans sa genèse, avant que se braquent sur lui les projecteurs d’une société qui semblait l’attendre, déjà familiarisée avec ses impulsions par le cake-Walk et les claquettes.
Cake walk, dirty note, break, notons que tout le glossaire du jazz lui était familier et qu’il ne se prive pas d’en user dans ses textes.
En défenseur de la raison contre elle-même, Adorno s’en prend à la construction, à laquelle il peut assister, d’un des mythes des industries culturelles qui, non seulement prétend fonder une nouvelle musique « afro, négro, noire américaine », mais aussi dévaluer la nouvelle musique européenne. Une fois de plus, comme pour la musique de cinéma, surgit un double problème de production et de réception. L’adversaire, pour Adorno, ce n’est pas bien entendu le Nègre, le Noir, ce sont d’abord les amateurs, les puristes, les spécialistes du « vrai jazz noir » qui bâtissent ce mythe. Il s’agissait, en son temps, d’un combat entre un théoricien, un chercheur et des journalistes spécialisés, inféodés aux industries culturelles, qui prétendent imposer « leur » nouvelle musique et disqualifier ce qu’ils appellent la musique savante, sérieuse, européenne. La critique des exploiteurs du show-business, si elle conforte la construction du mythe pour les premiers, est secondaire pour Adorno.
Les « amateurs » (en fait, les « critiques » des revues), auxquels s’ajoutent aujourd’hui des chercheurs défendant leur culture spontanée en terme de plaisir immédiat, risquent de produire sinon l’Entkunstung de l’art (la perte par l’art de son caractère artistique), mais aussi la chute dans l’oubli de la nouvelle musique européenne défendue par Adorno — du moins chez un public populaire bombardé et détourné par la Kulturindustrie. L’évitement de l’art se prolonge par un effacement, un peu à la manière de ces pharaons qui faisaient effacer les cartouches de leurs prédécesseurs.
Qu’on n’attende pas de ce texte sur le jazz de trancher définitivement la question, mais de tenter, dans la démarche qui est la mienne, de mieux éclairer les termes d’un débat opacifié par ce racisme antiraciste (Sartre) lié à la construction d’un mythe contemporain.
Le devenir du jazz comme paradigme musical et formel des industries culturelles
Les présupposés pour défendre le caractère authentiquement artistique du jazz sont de deux ordres. Le premier que j’ai tenté d’explorer repose sur la constitution d’un mythe. Le jazz, par ses racines africaines, ne pourrait être rangé, sauf dans ses séquelles industrialisées inspirées du courant Blues, la variété jazzy ou le rock and roll, dans le camp des industries culturelles. Ce recours au mythe peut être conciliant : Adorno aurait raison pour les séquelles, mais pas pour le jazz lui-même. D’ailleurs, il ne connaissait vraiment que la période swing. Ce recours peut être plus violent : Adorno serait le représentant figé de la musique classique européenne et de ses prolongements contemporains, une musique savante, sérieuse d’une élite où le plaisir sensuel serait banni. À trop critiquer la communication de masse, il ne pourrait accepter une autre nouvelle musique que la sienne.
Et en effet réapparaît chez tous ces auteurs l’opposition entre musique savante et jazz. Il est vrai que le texte Sur la musique populaire commence par cette phrase :
La musique populaire, qui engendre les stimuli que nous analyserons ici, est habituellement définie par sa différence avec la musique savante.
Au travers du débat entre Adorno et ses détracteurs, apparaissent les éléments qui permettent d’analyser l’évolution des processus de ces industries. Ainsi, le mythe africain repose la question du plaisir dans la musique et dans l’art en général. En première approximation, j’avance l’idée que l’authenticité du jazz renverrait d’abord à sa nature pré-industrielle liée à ses racines africaines ; quant au rapport avec l’industrie du disque qui lui est inhérent, il est revisité en terme de captation d’une performance, d’enregistrement unique d’une musique vivante sur le modèle ethnomusicologique. Il s’agit de découpler le jazz d’une logique purement économique liée à l’industrie du disque. La seconde serait son origine populaire, mais dans un rapport au plaisir qui la détacherait du simple entertainment, rapport qu’il faudra préciser.
Le disque complice du mythe
Adorno ne fait pas partie de la bibliographie de René Langel. Pourtant, la première phrase du Jazz orphelin de l’Afrique qui n’est pas de l’auteur, mais de Jean-Louis Ferrier, dans un Avant-propos, reprend sous une forme plus brutale ce que des contempteurs du jazz soulignent par ailleurs. Une formulation brutale que n’aurait pas désavouée l’auteur de la Théorie esthétique : « Le disque complice du jazz ».
Cette formule est à double sens. Premier sens : l’histoire du jazz est parallèle à l’histoire de l’industrie du disque et si l’on applique une grille adornienne caricaturale, la messe est dite. Deuxième sens, celui que relèvent les exégètes du jazz : le jazz est une musique vivante, d’improvisation, n’existant qu’en tant que spectacle vivant, comme performance dirait-on aujourd’hui, souvent sans partition puisque les jazzmen seraient à l’origine des autodidactes, et le disque remplit alors une fonction de captation à l’instar de celle pratiquée par les ethnomusicologues.
Cette complicité du jazz et de l’industrie du disque, si elle n’échappe à personne, est donc réinterprétée d’une façon qui trouble, il est vrai, l’interprétation qu’en donnent Adorno et Horkheimer. En effet, dans ces histoires du jazz, le disque est renvoyé, non pas à son prolongement industriel (« L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique »), mais au projet initial de Thomas Edison quand il brevète en 1877 son phonographe, un projet qui serait quasiment « anthropographique ». Ce projet de départ est partagé sur un mode plus « poétique » par Charles Cros qui, la même année, inventait son Paléophone, dont le nom pourrait être illustré par son poème :
Comme les traits dans les camées,
J’ai voulu que les voix aimées
Soient un bien qu’on garde à jamais
Et puisse répéter le rêve
Musical de l’heure trop brève.
Le temps veut fuir, je le soumets.
Dans les industries culturelles et leur histoire, le disque occupe une position médiane entre le XIXe siècle (enregistrement du mouvement) et le XXe (reproduction et diffusion élargie).
Le rapport entre jazz et industrie du disque étant posé, une autre « petite phrase » de René Langel pourrait rejoindre la critique d’Adorno dans Sur la musique populaire : « Le folklore, on le sait, est par essence conservateur. Populaire, il se légitime par son utilité sociale ».
Cela rejoint tout à fait la pensée d’Adorno : ce qui est en question dans la thématique du « ciment social », c’est le respect du statu quo. Force est de reconnaître que ce thème semble, dans le contexte d’aujourd’hui, traité de façon critique et à contre-courant.
La nouvelle musique, par exemple chez Arnold Schönberg, si elle doit faire entendre le tumulte, voire la cacophonie du monde, nous projette aussi dans un avenir utopique, déjà présent dans la sphère croisée du symbolique et de l’imaginaire. Il faut rêver le futur et la promesse de liberté qu’on en attend participe elle-même des trois niveaux de notre humanité. L’œuvre d’art est réelle puisque, si elle se détache du monde empirique, elle « en engendre un autre possédant son essence propre, opposé au premier comme s’il était également une réalité ». L’œuvre d’art est imaginaire puisqu’elle permet de rêver ses rêves au travers de son caractère énigmatique. Mais ce qui distingue l’œuvre d’art des autres produits culturels qui ne font que meubler notre environnement, c’est qu’elle ne se contente pas quand elle paraît, de restructurer, de ressouder le cercle de famille, voire de faire évoluer le statu quo. L’œuvre d’art, avec ses propres armes esthétiques, est critique du monde où elle naît, tout en étant utopique. Dans son mouvement de recherche, elle rejoint les sciences et la philosophie qui, pour un temps, s’en prennent au fondement symbolique de l’ordre établi.
Dans la sphère esthétique, le projet imaginaire s’articule sur une réalisation symbolique (par exemple la musique) d’où le social n’est pas absent puisque, dans la Théorie esthétique, la forme esthétique est du contenu [social] sédimenté. Ce projet critique, négatif, donc utopique suscite l’irruption d’objets énigmatiques bouleversant les logiques communicationnelles existantes.
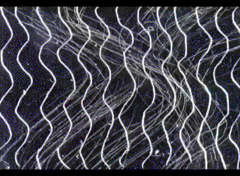
.
Quand l’enfant monstrueux paraît, dans son altérité, le cercle de famille peut le rejeter ou, par un long cheminement sur soi, entrevoir une autre beauté, une autre vérité. Faire cheminer l’altérité, qui ne se réduit pas à la différence, suffit à remplir le projet imaginaire. Car la sphère esthétique, même si elle est le lieu utopique de la résistance au statu quo, ne saurait à elle seule poser — et encore moins résoudre — toutes les questions liées à la souffrance sociale et relevant du politique.
Doc H.
Alors, si l’on admet l’idée que le jazz, dans son histoire, et même sous des formes édulcorées, a au moins rapproché deux « communautés », il a rempli, dans son devenir, une fonction sociale. Repenser le jazz sur la base de son devenir, à partir de la critique d’Adorno, permet de comprendre la nécessité qui lui est apparue de défendre, sous une appellation ou sous une autre, la nouvelle musique européenne. Aujourd’hui, cette nécessité n’a pas disparu. Pour prolonger cette pensée, avec juste ce qu’il faut pour ne pas la raidir dans la mort de son auteur en 1969, et parce que toute réception comporte sa marge d’erreur qui permet au lecteur d’avancer (à moins d’être dans le fantasme de la toute-puissance immanentiste), la lecture des textes nous invite à repenser aussi l’évolution des logiques des industries culturelles.
La thèse suivante peut donc se lire à deux niveaux : comme critique de l’industrie culturelle et comme une des clefs pour en comprendre l’évolution :
- Une fonction purement socio-psychologique se substitue à l’autonomie de la musique. De nos jours, la musique sert de ciment social.
- Et cette fonction socio-psychologique ne peut être abstraite du type de plaisir qu’elle procure.
Le plaisir du jazz
Deux Freud s’affrontent dans ce débat que j’ai instauré entre Adorno et les spécialistes français du jazz. Il est d’ailleurs intéressant de noter que ces derniers font plus souvent ouvertement référence à Freud que ne le fait Adorno. Ces spécialistes du jazz transforment Freud en un homme qui aurait secoué l’Occident, qui aurait réveillé une sexualité empreinte de tabous, bref en celui qui aurait libéré le plaisir dans une société judéo-chrétienne où seul un plaisir désincarné, d’élévation morale vers le divin ou un de ses avatars, la beauté, le vrai et le bien, était permis, sauf dans la musique populaire… Adorno reconnaît d’ailleurs cet aspect de la musique classique européenne. Si Adorno, sans citer Freud ou la psychanalyse en toutes occasions, lui emprunte un mode de pensée, alors le débat sur l’essence du jazz pour les uns, ou sur le devenir de sa production et de sa réception pour la présente étude, se double d’une mise en tension des textes de Freud.
Lucien Malson se réfère à Nietzsche, pour la philosophie, avec l’opposition entre l’apollinien et le dionysiaque, à Michel Leiris, l’ethnologue, pour qui le jazz serait d’abord « un étendard orgiaque » et à Freud pour sa prétendue théorie du plaisir. Le jazz serait une musique dionysiaque, nous invitant à une transe africaine décontextualisée de sa dimension rituelle au profit d’un simple procès gestuel pour nous faire participer à une joie humaine, très humaine, qui s’originerait dans la négritude.
Dans la période de grande licence qui suivit les hostilités, le jazz fut un signe de ralliement, un étendard orgiaque aux couleurs du moment. Il agissait magiquement et son mode d’influence peut être comparé à une possession. C’était le meilleur élément pour donner leur vrai sens à ces fêtes, un sens religieux, avec communion par la danse, l’érotisme latent ou manifesté, et la boisson, moyen le plus efficace de niveler le fossé qui sépare les individus les uns des autres dans toute espèce de réunion.
Michel Leiris, L’Âge d’homme.
.
1953, cave de Saint-Germain-des-Prés
Or, chez Adorno, les références à Nietzsche et à Freud existent aussi — et pour cause —, mais les conclusions sont quelque peu différentes. En effet de quel Freud parle-t-on ? Pour faire court : s’agit-il du Freud pan génital, pan sexualiste et chantre du bonheur, tel que l’interprète un courant américain, ou le Freud de la fin, celui de Malaise dans la civilisation et d’Au-delà du principe de plaisir qui, sans renier l’importance de la sexualité, convoque Thanatos à côté d’Éros ? On ne peut séparer la question esthétique de la question épistémologique.
Quant à l’humour, Adorno et Lucien Malson reconnaissent que ce ne serait pas une caractéristique de la musique « classique » européenne. Malson, regrette sans doute le manque d’humour dans cette musique lorsqu’il écrit :
Le ravissement que l’on va chercher aux concerts classiques est exclusif des plaisirs de l’humour : la musique a son écrin de silence, l’homme se moque rarement de l’homme.
Adorno, lui, pour séparer la tradition classique de la tradition « contemporaine » de cette musique européenne, déclare non sans humour :
Pour l’auditeur dressé par la radio, la cohérence musicale qui crée le sens ne reste pas moins cachée dans une sonate de jeunesse de Beethoven que dans un quatuor de Schönberg, qui du moins lui rappelle qu’il n’est pas aux anges à se délecter d’un chant agréable.
Il est vrai que la nouvelle musique, celle que défend Adorno, participe surtout du mouvement de la connaissance, d’un plaisir qui n’est pas réductible à un simple divertissement du quotidien :
Dans la sphère de la musique européenne, Adorno défend donc la musique « nouvelle », « contemporaine » qui s’inscrit, tout en s’opposant dans la tradition « classique », dans une filiation, dans une histoire avec ses préfigurations en termes de dissonances, par exemple. Alors, qu’une musique d’autodidacte, le jazz, prétende se substituer (par l’intermédiaire de ceux qu’il critique : les amateurs, les critiques spécialisés) à ce mouvement critique de l’intérieur de la musique européenne lui semble un hold-up esthétique. L’enjeu est de taille qui prolonge vraiment, tout en la révolutionnant formellement, la musique européenne « classique » : Alban Berg et Arnold Schönberg ou Duke Ellington, Count Basie ou Louis Armstrong ?
Une logique médiatique à l’œcuménisme culturel, médiatiquement correcte, rétorquerait sans doute, au nom d’un dogme que j’ai décrit par ailleurs, celui de la « bonne » musique qui engloberait toutes les musiques sans distinction — la bonne variété, le bon jazz, le bon rock, le bon rap, le bon classique, le bon contemporain —, que cette contradiction n’est qu’apparente. Cette même logique exhiberait les « passerelles » entre des représentants des uns et des autres, en taisant l’enjeu économique pour ceux qui prétendent « populariser » leur art sur le petit écran. Et aujourd’hui, quarante ans après la mort d’Adorno, bien des amateurs de jazz revendiquent cette musique sans frontière au risque d’y perdre, de leur point de vue, ce jazz qui les réunit en le noyant dans l’universalisme de La Musique.
Et par rapport à cette logique médiatique, rappelons aussi ce qui innerve notre projet depuis le début. Dans le jeu entre David et Goliath, il ne faut pas inverser les rôles : Adorno est David. Face à la puissance de frappe des industries culturelles, il s’agit d’abord de défendre l’existence même d’un art authentique dont Adorno ne cesse de dire que l’appellation est maladroite. Et pour cause : idéologiquement, l’industrie, dans sa logique publicitaire, ne cesse de singer ce qu’elle combat dans une lutte à mort. Tout, aujourd’hui, n’est-il pas prétendument authentique, personnalisé, du poulet « Père Dodu » au camembert « Le Rustique » ? C’est pourquoi la formule hégélienne, s’inscrivant elle-même dans la tradition philosophique héritée de Platon, est citée en exergue à La nouvelle Musique :
Car dans l’art, nous n’avons pas affaire à un jeu simplement agréable et utile [ce que peut être au mieux l’industrie culturelle via la sublimation et la catharsis, c’est moi qui glose], mais… au déploiement de la vérité.
Mais ce déploiement de la vérité n’est pas écrit de toute éternité. De ratés en catastrophes, la Raison peut se perdre. Quant au pire, il n’est pas certain non plus ; le repli sur une origine hypothétique, discutable. Il y a un risque majeur que Goliath-Big brother, dans un Meilleur des mondes, risque de mener à l’Entkunstung de l’art authentique. Mais au travers de cet art, qui participe dans sa sphère au mouvement de l’histoire de la Raison (qui n’est pas forcément un progrès) et de la vérité, le gestus intellectuel que propose Adorno n’est pas celui de Cassandre, mais du résistant.
Esthétique, histoire et politique
Reprenant le titre de l’essai : « Mode intemporelle A propos du Jazz » d’Adorno dans Prismes, Christian Béthune, poursuit son réquisitoire sur l’analyse d’un déni esthétique et contre l’Occident. Ce que le jazz remettrait en question, c’est la notion même d’histoire dans laquelle s’inscrit la Raison. Déplacé au plan musical, le jazz refuserait de souscrire à cette exigence :
Dans ses approximations, la critique d’Adorno possède au moins le mérite de pointer le doigt sur une particularité du jazz : les rapports originaux qu’entretient cette musique avec l’ordre du temps.
Béthune pointe dans la composition et la réception musicale occidentale même son propre rapport ordonné au temps :
L’amateur éclairé — celui qu’Adorno définirait sans doute comme le « bon auditeur » — qui écoute une pièce de musique classique — une sonate par exemple — se pose la question de savoir dans quelle mesure le compositeur se montrera capable de conduire jusqu’à son terme — l’indispensable « final » — l’argument musical dont il développe les lignes, à partir des éléments formels mis en place dès l’introduction, sans que jamais ne se brise la pertinence du propos.
Il ajoute pour bien fixer sa critique à venir : « En assumant le projet discursif, le compositeur occidental se veut avant tout fondateur d’Histoire. »
Méconnaissant tous ces ethnologues qui se sont intéressés aux mythes fondateurs des sociétés dites archaïques, Béthune essaie de coupler pour les opposer une réception culturelle occidentale contre une réception naturelle (le plaisir immédiat) du jazz :
Il n’est guère étonnant, dans ces conditions, que pour jouer ou écrire de la musique — surtout de la musique — il faille, en Occident, d’abord assimiler un code, se conformer à d’innombrables préceptes, vaincre maints obstacles et intérioriser les interdits qui en découlent.
Le mythe du bon sauvage, apprenant seul à jouer du tam-tam, s’opposerait aux heures passées à apprendre le solfège et à faire ses gammes ou ses accords sur son piano ou sa guitare. Si l’Occident a ses interdits, d’autres sociétés humaines ont leurs tabous, et une culture orale, même si elle se transmet autrement, n’en est pas moins une culture à part entière nécessitant un apprentissage, une initiation qu’étudie l’ethnologie.
Par contre, l’argument contre l’Occident pourrait renvoyer de façon intéressante à la question de la parataxe. D’un côté, l’histoire, le récit, le continu, la syntaxe ; de l’autre côté, le discontinu et la parataxe. Mais Béthune, tout à sa visée polémique, développe sa thèse, confondant peut-être l’histoire du jazz et le jazz comme histoire :
C’est pourquoi l’on a peut-être tort de parler d’une « histoire du jazz », contrairement à notre musique dite sérieuse, où les styles s’échelonnent dans le temps : en jazz, les styles cohabitent et se chevauchent dans le temps avec une étonnante facilité.
Et après tout, pourquoi Béthune polémique-t-il sur une opposition qui pourrait dans un autre contexte faire débat ? Dans une dialectique de la parataxe et de la syntaxe, par exemple, le rapport au temps se pose effectivement. Ainsi, chez Freud, l’histoire de l’analysant ne peut se dérouler qu’au travers d’un mouvement non linéaire de va-et-vient.
Quant à assimiler musique contemporaine et musique classique même s’il y a une filiation — critique —, c’est aller un peu vite en besogne. Et là encore, à l’instar de Lucien Malson ou de René Langel, on pourrait montrer que le rapport au temps chez les compositeurs européens contemporains, comme en poésie celui de Hölderlin ou de Mallarmé, est autrement plus compliqué.
Et puisqu’il est question de sonate dans l’exemple de Béthune, rappelons ce qu’Oliver Revault d’Allonnes disait et écrivait à propos des dernières sonates de Beethoven qui annonçaient les ruptures musicales à venir :
Beethoven était pianiste de métier et de formation. Il a transgressé les formes. Ses sonates n’ont pas forcément une structure de sonate ; le mouvement lent central peut ne pas exister, comme dans l’Opus 111. S’il construit sa sonate autrement que l’aurait voulu la tradition, il a des raisons. D’ailleurs, il ne construit pas toutes ses sonates « autrement ». Il retrouve parfois la forme sonate qui s’était perdue en devenant une règle canonique.
Pour mémoire, Olivier Revault d’Allonnes fait référence à la Sonate pour piano n° 32 en ut mineur, opus 111 ne comprenant que deux mouvements au lieu de trois :
1) Maestoso – Allegro con brio ed appassionato ;
2) Arietta. Adagio molto semplice e cantabile.
S’opposer à un Occident hypothétique et castrateur hors d’une histoire traversée par des chocs, mais aussi des rencontres culturelles, n’a pas beaucoup de sens. Et quand le racisme antiraciste se double, même si c’est a contrario, d’un intégrisme culturel pour défendre l’essence du jazz, c’est aller un peu loin sur la voie d’une fausse et vaine polémique. En tout cas, cet excès a pour mérite d’exhiber ce que craignait Adorno pendant cette période de crise, où la Raison fragilisée risque d’être emportée par un mal sinon plus grand que celui qu’elle a provoqué par ses débordements (Auschwitz ne peut être dépassé en horreur rationnellement programmée), mais définitif sur l’avenir d’une histoire riche intellectuellement…
Dans une modulation entre le politique et le musical, Adorno aurait-il saisi que, pour le grand vainqueur politique de la Deuxième Guerre mondiale passé maître dans les industries culturelles, mais aussi pour les thuriféraires du jazz proaméricain ou proafricain, il n’y a pas de place pour deux nouvelles musiques, celle de Duke Ellington, Louis Armstrong ou Count Basie et celle d’Alban Berg ou d’Arnold Schönberg ? Du moins en terme d’éducation et de culture populaires dans un meilleur des mondes totalement administré par un soft power, une pulsation idéologique qui rythme la vie personnelle et sociale du plus grand nombre ? Et quand Christian Béthune mobilise dans un numéro spécial de la Revue d’esthétique sur le jazz une partie de l’équipe qui a permis la réception française des textes d’Adorno, on se prend à penser que le danger n’était pas illusoire.
Toute l’œuvre de ce marxiste non communiste, freudien, refuse ce slogan de l’Internationale : Du passé faisons table rase. Adorno ne pouvait accepter une tabula rasa qui s’étendrait sur les ruines de l’Europe et détournerait le diagnostic — que partage Adorno — d’une crise de la rationalité. En aurait-il déduit que, dans ce rapport de force, l’Europe risquait de ne pas faire le poids face à la puissance de frappe de ce cinéma et de cette musique américaine, vecteurs d’une propagande à l’agressivité souriante et d’une autre modernité ? D’où l’agressivité d’Adorno à l’endroit du cinéma et à l’envers du jazz, et surtout de ses amateurs suspectés de vouloir faire de la musique « européenne » table rase… à l’instar de la caste dominante dans Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley auprès des castes inférieures encadrées par les industries culturelles et les séquelles commerciales du jazz.
BIBLIOGRAPHIE
ADORNO, T. W., Philosophie de la nouvelle musique, Paris, Gallimard, « Tel » (traduction française Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg), 1962.
ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M., La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, « Tel » (traduction française Eliane Kaufholz), 1974.
ADORNO, T. W., Prismes, Paris, Payot (traduction française Geneviève et Rainer Rochlitz), 1986.
ADORNO, T. W. avec la collaboration de George SIMPSON, « Sur la musique populaire », texte de 1937, in Revue d’esthétique n°19, Jazz (traduction française Marie-Noëlle Ryan, Peter Carrier et Marc Jimenez), 1991.
ADORNO, T. W., Théorie esthétique, Paris, Klincksieck (traduction française Marc Jimenez), 1982.
ALTHUSSER, Louis, Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspéro, « Théorie », 1974.
BETHUNE, Christian, Adorno et le jazz, analyse d’un déni esthétique, Paris, Klincksieck, 2003.
BOURDIEU, Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de Minuit, 1979.
BUXTON David, « Le Rock, star-system et société de consommation – e-book PDF de david Buxton », Livre [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2014, mis en ligne le 1er septembre 2014, édition originale, 1985. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/rock_david_buxton.pdf
CARLES, P., COMOLLI, J.-L., Free jazz, Black power, Paris, Gallimard, « Folio », 2000.
FREUD, Sigmund, Au-delà du principe de plaisir (traduction française S. Jankélévitch).
FREUD, Sigmund, Malaise dans la civilisation, 1929, traduction française, 1934
HEGEL, G. W. F., Esthétique, Paris, Flammarion (traduction française Ch. Bénard), 1979.
HIVER, Marc, Adorno et les industries culturelles -communication, musique et cinéma, Paris, L’Harmattan, collection « Communication et civilisation », 2010.
HÖLDERLIN, Friedrich (1770,-1843), Un choix de poèmes.
HUXLEY, Aldous, Le meilleur des Mondes, Paris, Plon, Pocket (traduction française Jules Castier), 1932.
LANGEL, René, Le jazz orphelin de l’Afrique, Paris, Payot, 2001.
MALSON, L., BELLEST, C., Le Jazz, Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je ? n°2392, 1987.
MALSON, Lucien, Histoire du jazz et de la musique afro-américaine, Paris, Seuil, 1994.
MOUËLLIC, Gilles, Le Jazz – Une esthétique du XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000.
MOUËLLIC, Gilles, Jazz et cinéma, Paris, Editions Cahiers du cinéma, collection « Essais », 2000.
MULLER-DOOHM, Stefan, Adorno, une biographie, Paris, Gallimard (traduction française Bernard Lortholary), 2004.
REVAULT D’ALLONNES, Olivier, « Beethoven et le jazz », in Revue d’esthétique n°19, Jazz, 1991.
Revue d’esthétique n°19, Jazz, Paris, Editions Jean-Michel Place, 1991.
Lire les articles de Marc Hiver


Philosophe, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, d’Adorno et des industries culturelles
Dernier livre : « Adorno et les industries culturelles – communication, musique et cinéma »,
L’Harmattan, collection « communication et civilisation »