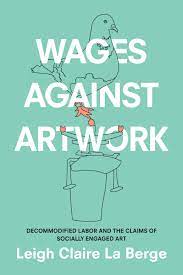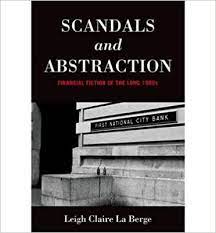Quand la vie, c’est de l’art, et le travail, toute la vie – Leigh Claire LA BERGE, interviewée par Wen ZHUANG
Cette interview a été faite sur Zoom en mai 2020, lors du confinement aux États-Unis, et publié dans The Los Angeles Review of Books, le 9 juillet 2020. Le texte original, qui contient quelques passages non traduits portant sur l’actualité du moment et sur les spécificités du diplôme de master américain, peut être consulté ici (David Buxton).
Dans son dernier livre Wages Against Artwork (Duke University Press, 2019), Leigh Claire La Berge maintient que l’artiste – qu’il soit étudiant, enseignant ou travailleur culturel – est peut-être à l’avant-garde d’une reconfiguration du système capitaliste. La Berge montre comment des artistes engagés réagissent à ce qu’elle appelle « le travail démarchandisé » – la lente diminution des salaires accompagnant une augmentation de la charge de travail – et comment l’expansion des programmes de master en beaux-arts et de la dette estudiantine créent les conditions pour cela. Je voulais discuter avec elle comment ce processus a été touché par la fermeture des universités, et quelles seront les conséquences pour la relation entre art et capitalisme (Wen Zhuang).
[…] Wen Zhuang : Pourrais-tu recadrer tes idées sur l’étudiant en beaux-arts comme travailleur et sur l’école de beaux-arts comme institution dans le contexte de la pandémie actuelle ?
Leigh Claire La Berge : C’est un moment angoissant pour l’éducation, particulièrement dans les humanités et dans les écoles de beaux-arts. Cela dit, la situation était déjà angoissante avant la pandémie. Sans être trop optimiste, je pense que le modèle d’éducation en régime capitaliste qui fonctionne avec la dette estudiantine doit être contesté et rendu obsolète. Si je commence mon premier chapitre avec les activités d’organisation des étudiants dans les années 1970, c’est pour suggérer qu’on pourrait penser à la condition d’étudiant (studentdom) de manière complètement différente. Plutôt que quelque chose qu’on achète, ce serait un travail pour lequel on est rémunéré. C’est toujours le modèle par-ci par-là au Mexique et en Europe, où on peut être payé pour faire des études, considérées comme un travail. À mon avis, c’est un modèle beaucoup plus équitable et soutenable. Est-ce que la crise actuelle mènera à cela ? Je ne sais pas, mais je pense que c’est le moment de faire connaître d’autres modèles possibles.
WZ : Je retiens ton terme « condition d’étudiant ». Il me semble que la crise qui frappe les institutions de beaux-arts ait compromis la possibilité d’un autre statut.
LCLB : La force politique et l’organisation qu’on a vues à Occupy Wall Street en 2011, et lors des manifestations contre la dette en 2012 étaient centrales pour ces mouvements. Mais que peuvent faire les artistes et les travailleurs culturels ? Quid de la relation entre les deux ? En somme, que peuvent faire les diplômés des écoles de beaux-arts qui deviendront des travailleurs culturels (pas le cas de tous) pour impulser une reconfiguration radicale dans l’enseignement des humanités et des arts aux États-Unis au 21e siècle ? Le modèle actuel est extrêmement problématique, et ne peut plus durer longtemps. En plus, il est relativement récent, qui date des années 1970, et qui peut donc être transformé en autre chose.
WZ : La réalité pour les étudiants en beaux-arts dans le moment actuel est sombre. Beaucoup d’entre eux sont dépourvus des moyens permettant de produire des œuvres pour leur propre bénéfice, mais qui servent aussi à renforcer le potentiel de l’institution. Le discours qui justifiait les frais de scolarité obscènes à certaines écoles – l’espace pour travailler, les interactions avec des artistes connus, la possibilité d’exposer ses œuvres – n’est plus audible.
LCLB : La séparation des étudiants en beaux-arts de leurs moyens de travail résonne avec certaines formes de désindustrialisation, mais qui se déroulent en l’espace de quelques semaines, et non des décennies ou des siècles. J’aimerais dire ici que, à dessein, je n’utilise pas dans mon livre le terme « capital culturel » introduit par Pierre Bourdieu en 1970. Pour moi, ce concept semble être une extension du capital au sens économique : autrement dit, ceux qui possèdent du capital économique possèdent aussi du capital culturel, et inversement. En réfléchissant, je pense qu’il serait plus intéressant de poser la question ainsi : est-ce que les artistes eux-mêmes ont adopté ce concept, et si oui, pourquoi ? Et qu’est-ce que cela nous dit sur l’état actuel des arts et de l’éducation artistique ? Dans les années 1970, dans le mouvement « Salaires pour étudiants », on ne disait pas « nous possédons déjà du capital, [mais] … » Plutôt, on disait que « nous avons besoin de l’argent, d’un salaire, nous ne considérons pas [notre éducation] comme une forme d’accumulation ». Est-ce que la pandémie interrompra le discours du capital culturel, tel qu’il circule dans les écoles de beaux-arts, dans les mondes de l’art, chez les étudiants ? Qu’est-ce que ce discours a vraiment fait pour des artistes ? S’agit-il d’une histoire qu’ils racontent entre eux, pour eux-mêmes ? Comment l’histoire du capital culturel concorde-t-elle avec les demandes d’un collectif comme W.A.G.E. (Working Artists for a Greater Economy) qui a établi un barème de compensations pour certains évènements ? Je ne connais pas la réponse, mais la question est importante.
WZ : Un souci pour moi est le transfert du travail démarchandisé dans les institutions au système du travail similaire en ligne. Les musées, les galeries et les écoles ont simplement déplacé les modes de capital avec lesquels on s’engage sur Internet.
LCLB : Il est indéniable qu’on passe plus de temps en ligne, mais il faut se demander ce qu’on y fait exactement. S’agit-il du travail démarchandisé ? Ou s’agit-il de ce que Christian Fuchs appelle « le travail numérique » ? Faut-il parler du « travail affectif » ? Un livre passionnant à cet égard, c’est Platform Capitalism de Nick Srnicek, qui analyse les différentes plateformes comme Facebook, Google, etc. Srnicek se demande si le capitalisme des plateformes est une nouvelle forme d’accumulation, ou une forme de rente monopolistique ; dans le dernier cas, Facebook et Zoom s’assimileraient à des biens fonciers. Une chose sur laquelle il insiste, et qui correspond à mon concept de démarchandisation, est que ces entreprises font de l’argent en payant leurs employés très peu. Il y a une certaine continuité ici. Ce serait aller trop vite en besogne que de penser que le capitalisme qui existe sur Internet est distinct du capitalisme qui existe dans le cinéma et la télévision, où même dans la culture imprimée du 19e siècle. Cela dit, si l’éducation est une forme de travail, et que son travail s’effectue désormais par le truchement des plateformes, ne faut-il pas repenser le capitalisme des plateformes ? Ne s’agit-il pas d’une nouvelle forme de biens fonciers monopolistiques ? Pourrait-on dire qu’on fait ses études à telle université et, en même temps, sur Instagram ou Zoom ? Quelle est la relation entre ces différentes formes d’accumulation ? Il ne faut pas trop rapidement fétichiser ces technologies en raison de leur nouveauté, gommant ce que font réellement ces entreprises : faire de l’argent en maintenant les salaires à un niveau très bas. Cela nous fait revenir à la question du salaire, qui est en rapport avec une de tes questions : à quoi ressemble une nouvelle institution d’art ? […]
WZ : Le domicile lui-même peut désormais être justement considéré comme une institution, sinon un espace en voie d’institutionnalisation. La chambre est un studio, et la cuisine est une gym, n’est-ce pas ? Pourrais-tu en parler un peu ? Quelle est la relation entre le processus de décentralisation et l’espace domestique à multiples facettes ?
LCLB : Parler ainsi du domicile est une application vraiment intéressante du concept de désindustrialisation. Lorsqu’on pense à la désindustrialisation, et quand ce terme est utilisé dans les sciences sociales, c’est généralement pour référer à la dévaluation massive du capital fixe. Ce sont les usines, les logements des travailleurs, l’infrastructure, les rues, l’éclairage, les tuyaux, l’eau potable, etc., bref, tout ce qui rend possible la production industrielle. Dans mon livre, je parle de Manchester en Angleterre, grande ville industrielle au 19e siècle, qui l’est beaucoup moins aujourd’hui. Le nom du célèbre label de disques, Factory Records, fondé dans une usine désaffectée, était ironique. Aux États-Unis, on parlerait de Detroit. Au sommet de sa puissance industrielle dans les années 1940 et 1950, la ville avait une population de deux millions ; maintenant celle-ci est tombée à moins d’un million. Ce n’est pas seulement que le capital fixe perd sa valeur, mais que les habitants eux-mêmes disparaissent. Ce qui a permis à la population de s’assembler initialement, c’est le mode de production. On peut considérer le confinement comme une sorte de désindustrialisation au sens que les écoles et les universités fournissent un appareil industriel pour des étudiants qui n’y ont plus forcément accès : le Wi-Fi en état de marche, l’ordinateur, « l’atelier », les outils, la technologie qu’on trouve dans les écoles de beaux-arts, tout cela a disparu, on ne sait pas pour combien de temps. […]
Maintenant, si on pense à une économie industrialisée, c’est probablement la Chine qui vient à l’esprit. Dans les endroits que la sociologue Saskia Sassen appelle des « villes mondiales » (New York, Hong Kong, etc.), il existe une sorte « d’infrastructure numérique ». Celle-ci est également une infrastructure industrielle, ou dépend d’une infrastructure industrielle. C’est peut-être une façon indirecte de répondre à ta question, mais là où je veux en venir, c’est que les termes qu’on utilise pour périodiser le capitalisme – industrialisation, désindustrialisation, production, finance, financiarisation – n’ont pas lieu en séquence. Ils ont lieu à des moments différents, mais non progressivement. Ce que démontre cette crise, c’est que l’infrastructure conventionnelle qu’on estime nécessaire pour la poursuite d’une éducation artistique n’est pas en fait si nécessaire que cela. Il est trop tôt pour en juger les effets. Verra-t-on un moment de reconfiguration d’une éducation en arts libéraux, pour le meilleur et le pire ? Serait-il possible, voire idéal, de faire conduire l’éducation artistique par des étudiants répandus dans le monde entier, à partir de leurs chambres, en supposant qu’ils ont une chambre ? Cela met en évidence la panacée qu’offre l’université quand elle fonctionne correctement, mais aussi les limites de l’institution, de sa capacité à pourvoir aux besoins des étudiants en situation de contrainte.
WZ : Dans ton livre, tu mentionnes la notion avancée par Claire Bishop que « tout le monde est un étudiant en beaux-arts ». Je pense que cela est d’autant plus vrai maintenant que la ligne de démarrage s’éloigne pour tout le monde, et pas seulement pour les étudiants en beaux-arts. Comment vois-tu les théories présentées dans le livre s’étendant à d’autres domaines, les humanités naturellement, mais même les sciences et le commerce ?
LCLB : J’apprécie vraiment la question, car j’espère que le concept de travail démarchandisé pourra être utilisé plus généralement. Je me focalise sur quatre sites où on peut voir du travail démarchandisé. J’insiste sur le fait qu’aux États-Unis, depuis le milieu des années 1970, il n’y a pas eu d’augmentation salariale pour la vaste majorité de travailleurs. La Bourse a décuplé en valeur, voilà une mesure de la richesse sociale. L’autre, la valeur du travail, est restée stagnante ; les salaires n’ont pas augmenté par rapport à l’inflation. Ces deux indices de valeur ont une relation mutuelle. Ce qu’exige une économie dominée par la finance est d’abord la stagnation des salaires, et ensuite leur disparition. C’est cela que le concept de travail démarchandisé est censé aborder.
WZ : Vois-tu cette forme de travail démarchandisé exister dans d’autres domaines ?
LCLB : Quand je commençais à élaborer ce concept, je voyais son application d’abord dans le monde de l’art : dans les galeries, dans les pratiques sociales, dans les scènes informelles, autour de 2012-13. Après, je l’ai remarqué dans d’autres domaines, les sports professionnels par exemple, qui n’ont pas en principe de relation proche avec le monde de l’art. De bien des façons, ils sont construits et fonctionnent de manière similaire. Quelques vedettes gagnent énormément d’argent, et ont une grande visibilité, mais la plupart des gens dans le monde de l’art sont des « amateurs », comme dans le monde sportif. La différence est qu’on peut aller à une école de beaux-arts pour se former, chose impossible dans le monde sportif. Aujourd’hui, on peut décider d’obtenir un master pour devenir un artiste professionnel, mais on ne pourrait décider d’être un joueur de football [américain] professionnel. Rien n’existe pour que ce soit possible. Néanmoins, la plupart des sports professionnels dépendent du travail bénévole. Si vous allez à un tournoi de golf ou de tennis, la majorité des gens qui y travaillent sont des bénévoles, même s’ils doivent respecter certaines règles, porter un uniforme et être dirigés par un patron, tout ce qu’on associe à un travail normal. La même chose existe dans l’université : l’évaluation de textes par des pairs, les exposés d’étudiants, la recherche faite à son compte. Idem pour le monde de l’art. Je pense aux bénévoles au Musée métropolitain d’art, au MOMA (Museum of Modern Art) et aux musées d’art plus petits. L’éducation secondaire publique aux États-Unis est gérée en partie par la PTA (Parent Teacher Association), la plus grande organisation de bénévoles du pays.
On ne pense pas qu’une activité bénévole faite pour le plaisir soit comme une forme de travail démarchandisé, mais il l’est. On pourrait toujours payer quelqu’un pour le faire, même s’il ne manque pas de gens proposant leurs services gratuitement. Maintenant que nous sommes en pleine crise sanitaire, il faut attendre pour voir quels seront les effets économiques sur le long terme. Cette crise n’a pas commencé comme une crise économique, mais elle le deviendra. En conséquence de la crise financière de 2007-08, beaucoup de postes ont été perdus dans les humanités, et les institutions ont demandé aux enseignants et aux doctorants de travailler plus pour moins d’argent. On ne reviendra pas aux conditions de travail d’auparavant. Je m’attends à ce que quelque chose de similaire ait lieu dans d’autres domaines. Cela dit, je suis excitée par les efforts d’organisation qui ont émergé pendant la crise sanitaire, même si on ne les voit pas encore, à mon avis, dans les domaines du travail démarchandisé. J’ai récemment vu un titre dans The New York Times qui disait « le chômage monte en flèche, mais le nombre de bénévoles aussi ». Les deux sont étroitement liés.
WZ : Déjà, ton livre transcende des disciplines, du moins dans son élaboration : tu as travaillé dans l’université et collaboré avec des artistes divers avant de concevoir ce livre. Quelle est la différence dans le processus d’élaboration de ce livre par rapport au précédent ?
LCLB : Mon premier livre s’intitule Scandals and Abstraction, qui traite la relation entre finance et littérature. La finance est une forme économique, alors que la littérature est une forme artistique. Mon dernier livre traite une autre forme économique, le travail démarchandisé, et une autre forme artistique, l’art socialement engagé. Il est vrai que j’enseigne dans un département de lettres [aux États-Unis], mais mon doctorat est en American Studies et mon approche est assez interdisciplinaire. Je ne cherchais pas à enseigner la littérature, mais il n’y a pas beaucoup de départements d’études américaines, et donc pas beaucoup de postes ; je suis très reconnaissant d’en avoir un. Dans mon premier livre, les écrivains traités appartiennent bien au canon : Brett Easton Ellis, Don DeLillo, Jane Smiley, de grands noms. Dans le livre actuel, par contre, je suis devenue amie avec certains artistes qui y figurent. Dans tous les cas, j’ai partagé ce qui j’ai écrit avec les interviewés, et j’ai sollicité leur avis. Beaucoup d’entre eux m’ont introduite dans le monde de l’art engagé, qui n’est pas si grand à New York. Je n’y ai pas pensé avant, mais ta question inspire cette remarque.
Rétrospectivement, je dirais que j’ai essayé d’adapter la pratique sociale comme méthodologie, autrement dit de collaborer avec des gens dans un autre domaine que le mien, d’intervenir dans un autre monde. Je ne sais pas si j’ai changé quoi que ce soit, mais j’ai essayé de produire un concept nouveau. Mais celui-ci n’aurait pas pu émerger sans les conversations avec les artistes. J’ai essayé d’interviewer des artistes assez divers qui comprenaient et qui réagissaient de manière différente à la démarchandisation de leur travail. Pour certains, celle-ci est réellement libératrice. Pour d’autres, elle est appauvrissante et contraignante. Je n’ai pas tant cherché à dire qui a raison, et quelle est la bonne façon de réagir à cette forme économique qu’à dire ceci : la démarchandisation existe, voilà à quoi elle ressemble, quelle sera notre réaction ? Le livre se termine sur une question que j’espère ouverte.
WZ : Tout cela fait penser à l’idée des « communs », qui a été étendue à la prise en compte des « sous-communs ». C’est ce qui se passe dans le cas des étudiants qui se libèrent de ce qui les contraint, les cursus en beaux-arts, etc. Quelle est la relation entre le travail démarchandisé et l’approche des communs ?
LCLB : C’est une question intéressante et je suis contente que mon concept l’ait suscitée. Je pense qu’une des caractéristiques du concept de travail démarchandisé est qu’il essaie vraiment de maintenir un lexique issu de l’analyse marxiste, à savoir la forme-marchandise. Cette dernière est générative non seulement du monde social, mais aussi d’une grande part de nos discours esthétiques. À un certain point, c’est une question de méthode. Une autre réponse est de dire que la démarchandisation est un terme modeste en ce qu’il décrit ce qui existe déjà en creux dans un monde dominé par la marchandise, alors que l’espoir pour les communs est celui d’une transformation non seulement de notre monde, mais aussi de notre imaginaire. C’est ce que j’apprécie du concept, mais aussi ce qui m’exaspère. Je pense aux critiques d’art qui utilisent des mots comme « révolutionnaire » et « transformateur ». Pour moi, il y a un vrai fossé entre ce genre de langage, et ce qui se passe réellement dans des espaces artistiques divers. Ainsi, je voudrais imposer une sorte de réconciliation entre la provenance de l’art et ce qu’on en fait.
Un livre intéressant en rapport avec cette question est Poor Queer Studies par un collègue à la CUNY (City University of New York), Matt Brim. Il se demande comment appliquer ce genre de théorie dans une université publique sous-financée. Est-ce que mon livre a changé ma propre relation à l’université ? J’ai partagé une partie du premier chapitre avec mes étudiants. Je leur ai demandé : pourquoi ne luttez-vous pas pour obtenir un salaire ? Apprendre cette histoire [des grèves estudiantines des années 1970] a changé les types de questions que je pose désormais aux étudiants, qui ne me comprenaient pas. La plupart d’entre eux ne sont même pas opposés à des augmentations des frais de scolarité. Ils ne veulent pas de l’éducation gratuite, même si la CUNY était gratuite autrefois. Voilà une réponse réaliste à ta question : le fossé entre ce dont je parle dans le livre et les réalités quotidiennes de l’enseignement est assez grand, et a besoin d’être abordé autrement.
WZ : As-tu des conseils à donner aux étudiants qui suivent actuellement un cursus en beaux-arts ? Quelle est la question la plus importante demandant de la réflexion ?
LCLB : Pour moi, c’est ceci : dans quelle sorte de monde de l’art voulez-vous habiter ? Peut-être que ce n’est pas ce que vous voyez quand vous zoomez depuis votre chambre, j’espère que ce monde sera plus communicatif que cela. Mais je pense que votre communauté actuelle est votre monde de l’art. C’est mon espoir que l’expérience de cela provoquera la question : si c’est cela le monde de l’art que nous habiterons, qu’en pensons-nous ? Ce monde n’est pas ailleurs, à Chelsea [quartier bohème de New York], dans une biennale, dans une autre « ville mondiale ». S’il existe là où nous vivons, quelles sont les possibilités de développement et de transformation ? Beaucoup de discours universitaires, que ce soit dans une école de beaux-arts ou dans un programme doctoral, cherchent à se déplacer ailleurs, à s’engager dans une autre conversation, dans un autre lieu, où que ce soit. Comment exister dans l’espace où on se trouve, comment se réconcilier avec lui, et comment le transformer ? Cette question est moins excitante que celle d’un autre monde. Mais nous y sommes, n’est-ce pas ?

Wen Zhuang est une écrivaine et éditrice qui vit à New York. Elle a un master en American