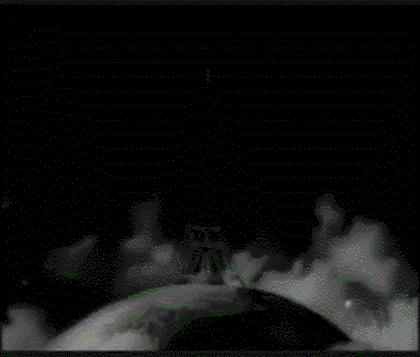Hollywood Story de Frank Capra – Marc HIVER
Frank Capra, né en 1897 à Palerme, Sicile, Italie, mort en 1991 à Los Angeles aux États-Unis, est l’incarnation des plus belles années de la comédie hollywoodienne. De ses quarante années de carrière, il donne au cinéma les films les plus représentatifs de son art. En 1976 paraît en France la traduction de son autobiographie Hollywood Story. Mais quoi de plus suspect qu’une autobiographie ? D’autant qu’elle se double d’un soupçon quant à la thèse avancée par Frank Capra : j’ai été un précurseur du cinéma d’auteur au sein des grands studios hollywoodiens [1920 — 1950]. Pourquoi ne pas accepter de le suivre dans sa description dont le mérite incontestable, au-delà des anecdotes de service, réside dans une topologie assez complète des différentes sphères de l’industrie cinématographique américaine de l’époque ?
Article interdit à la reproduction payante.
Contenu
Frank Capra – Autobiographie d’un réalisateur hollywoodien (système des studios – 1920, début des années 1950)
Frank Capra, interview, vostf
Quoi de plus suspect qu’une autobiographie ? Matériel anecdotique, justifications rétrospectives, narcissisme ambivalent, bref, le plus souvent, reconstruction des faits et liberté prise avec l’histoire. C’est justement cette contradiction première qui séduit, d’autant qu’elle se redoublait aussitôt d’un soupçon quant à la thèse avancée par Frank Capra dans son livre Hollywood Story : « j’ai été un précurseur du cinéma d’auteur au sein des grands studios hollywoodiens ». Et il affirme avoir toute sa vie combattu de l’intérieur pour rééquilibrer le pouvoir en faveur du réalisateur. Peu importe qu’il se vante ou non : pourquoi ne pas accepter, au nom d’une démarche dialectique, de le suivre dans sa description du système des studios dont le mérite incontestable, au-delà des anecdotes de service, réside dans une topologie assez complète des différentes sphères de l’industrie cinématographique américaine de l’époque. Chaque citation devra donc être doublement mise entre parenthèses et faire l’objet d’un commentaire critique.
James Stewart, Donna Reed, La vie est belle, Frank Capra, 1946
La lutte entre les auteurs et les producteurs est presque aussi vieille que le système des studios hollywoodiens. Dès les années 20, Erich von Stroheim, dénonçait l’emprise de l’industrie sur le cinéma, cette énorme « machine à fabriquer des saucisses » dont il parlait avec mépris et qui l’a broyé, l’exilant à tout jamais de sa place de réalisateur. Car l’auteur, dans le système hollywoodien, celui qui synthétise le film et distribue les tâches, c’est d’abord le producteur.
L’industrie cinématographique hollywoodienne décrite par Frank Capra
Il faut rappeler, dans le cadre de la production hollywoodienne considérée globalement, la sévère et rigide répartition des compétences au sein des grands studios où tous les postes clefs étaient depuis longtemps occupés et contrôlés par des producteurs, seuls responsables pour tout ce qui concernait le film tant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Aussi disposaient-ils d’une grande autorité sur le réalisateur dont le nom correspondait strictement à la fonction dans la plupart des cas : un exécutant, un technicien de l’art. C’est-à-dire un employé dépendant, révocable à tout moment.
Pour illustrer le climat qui régnait à cette époque, donnons la parole à ce réalisateur qui représente bien Hollywood dans ses contradictions. Il s’agit de Frank Capra et de son livre autobiographique : Hollywood Story.
Première « anecdote » alors qu’il débutait comme monteur sur un film mis en scène par Bob Eddy :
Je montai les trois comédies de Bob Eddy qui suivirent. Je devins pour lui ce que sa couverture était pour le Linus de Peanuts. Pour satisfaire ma curiosité, je lui demandai un jour pourquoi il me laissait, moi ou un autre, « composer » ses séquences de films. Sa réponse fut brève et sèche : « Parce que je suis un metteur en scène, pas un monteur. » Personnellement, je trouvai que ça n’avait pas de sens. Et si Beethoven avait confié ses thèmes originaux à un « arrangeur » pour que celui-ci les lui « ordonne » ? Les symphonies ainsi conçues auraient-elles été celles de Beethoven ou celles de l’« arrangeur » ? (Hollywood Story p. 59).
Certes, Frank Capra écrit son livre après coup : comme toute autobiographie, celle-ci doit être utilisée avec précautions, la part étant faite de la reconstruction a posteriori. Mais ces informations permettent une première approche d’une topologie des « partenaires » de la « production créatrice » à Hollywood reposant sur une division du travail forcenée. Chez Hal Roach, même les gagmen n’ont pas le droit d’entrer sur le plateau. Chez Mack Sennett, interdiction de parler au metteur en scène sans la permission du patron.
Gary Cooper, Barbara Stanwyck, L’Homme de la rue, Frank Capra, 1941
Les producteurs par Frank Capra
Capra raconte qu’à la Metro Goldwyn Mayer :
… les producteurs de Mayer n’avaient rien à envier aux stars en matière de célébrité ; Thalberg, Selnick, Mannix, Rapf, Stromberg, Franklin, Wanger, Weingarten, Lewin, Thau, Cummings, etc. tous recevaient un salaire qui était de trois à dix fois supérieur à celui du président des États-Unis. Sous leurs ordres, soixante-quinze scénaristes d’élite noircissaient du papier et quelques vingt metteurs en scène, représentant le crème de la crème des cinéastes d’alors, dirigeaient leurs superproductions (…) Il était curieux de constater à quel point ces illustres cinéastes, s’ils étaient considérés comme des dieux à Hollywood, étaient inconnus du public. C’étaient des « organisateurs » aussi anonymes que les vice-présidents de la Général Motors. Le slogan, ici, ce n’était pas « un homme, un film », mais « moult films, moult chaînes de montage ». Une enseigne posée sur le bureau d’Eddy Mannix disait : « A la MGM la seule vedette c’est Leo le Lion (p 172-173).
Affirmer, comme le producteur cité par Capra, que Leo le Lion était la seule vedette de la Metro-Goldwyn-Mayer implique une mise en place d’un mode de production culturelle, où l’effet collectif remplit une fonction de massification.
James Stewart, Jean Arthur, Monsieur Smith au sénat, Frank Capra, 1939
L’anonymat du produit garantit la contradiction entre son origine mythique (au même titre que le star- system qui le sous-tend) et son caractère de marchandise. Quand le lion rugit sur l’écran, il biffe du même coup l’intervalle qui s’est écoulé entre deux séances cinématographiques, entre ce film-ci et ce film-là du précédent programme. Le rugissement homogénéise les bandes filmiques à l’instar d’un supra-raccord extracinématographique. Les notions d’auteur, d’œuvre, de style sont dissoutes par le mouvement de tête qui accompagne le logos du Dieu Leo. Tout écart différentiel gommé, la réification peut s’exercer dans une massification renouvelée. Car dans le même temps, l’impact publicitaire est évident et restera toujours au cœur de la lutte pour le pouvoir créatif : qui détient le label ? Quel est le nom du père qui garantit la continuité et la nature de l’enfant orphelin élevé par un lion comme Mowgli par la panthère dans Le Livre de la jungle ? Comme le montage transparent masque les ruptures entre les plans du matériau filmique préservant le lien ontologique entre l’image sonore et le réel pour le plus grand bénéfice du réalisme au service du mythe hollywoodien, le plan du lion de la M.G.M., de la montagne de la Paramount ou la statue de la Columbia comble le blanc qui sépare le final précédent et le générique qui commence. Il rassure le consommateur quant à la « qualité » du produit. Lorsque le collectif se dissout dans l’anonymat, lorsque le collectif se transcende en métaphysique publicitaire… cf. Ronald Levaco et Fred Glass : « Quia ego nominor Leo » in Le Cinéma américain (Paris, Flammarion, 1980).
Les syndicats américains et le statu quo dans l’art
Partenaire de la « production créatrice » à Hollywood, les syndicats. Dans le monde du cinéma, les syndicats américains remplissent là aussi une fonction strictement corporatiste. On peut même dire qu’ici ce caractère est particulièrement exacerbé. Bien entendu, ils vont participer à la lutte pour le pouvoir créateur à Hollywood.
Capra rappelle : « En arrivant à Lakehurst, nous avions trouvé six dirigeants syndicalistes de New York qui nous attendaient pour nous dicter leur « loi » (p. 181). »
Pourtant, en 1935, ils vont contribuer à un recentrage dans le conflit qui oppose les « artistes » aux producteurs.
Toujours Capra : « Mais, en 1935, le conflit-patronat-artistes était à son apogée. L’acteur Ronald Reagan, le scénariste John Lawson et le metteur en scène King Vidor menaient la lutte pour leurs associations respectives (p. 248). »
On sait où cela a entraîné l’acteur en question dans sa carrière politique…
Les agences et les acteurs
Les fameuses stars, aux images gonflées par une publicité tapageuse, dans l’enceinte des studios, étaient soumises au bon vouloir des producteurs. Ainsi, pour punir Clark Gable coupable de « n’en avoir fait qu’à sa tête », Louis B. Mayer le força à accepter un rôle chez les « pouilleux » (entendons une maison de production moins importante à laquelle il avait été sous-loué comme un demi-esclave) : son rôle dans Autant en emporte le vent ! À la MGM, on disait : « envoyer en Sibérie » les vedettes qui se montraient trop difficiles.
Clark Gable, Claudette Colbert, New York – Miami, Frank Capra, 1934
Plus tard, par un de ces jeux de pouvoir qui sourdaient à Hollywood, les acteurs recentrèrent la création autour de leurs noms au sein des productions indépendantes quand les grosses compagnies commencèrent à perdre des plumes. En 1948 un conflit historique opposa la direction des majors aux indépendants.
Les agences d’acteurs imposèrent de plus en plus leur loi. Citons deux des plus importantes : la Music Corporation of America et, bien sûr, l’agence William Morris.
Les syndicats
Partenaire institutionnel à Hollywood, les fameuses « guildes », meilleurs garants pour les producteurs du respect des codes cinématographiques et extra cinématographiques.
Pour soumettre un document à une compagnie signataire, un studio par exemple, il faut être un professional writer. Le MBA (Minimum Basic Agreement) le définit comme une personne ayant été employée par un studio de télévision ou de cinéma pendant treize semaines au moins, ayant été créditée au générique d’un film ou d’un téléfilm (séries incluses), ou ayant reçu un crédit, une mention pour une production professionnelle de théâtre ou une nouvelle publiée. Pourtant, le Writers’ Guild ne requiert pas automatiquement ces critères pour en devenir membre. (http://www.courte-focale.fr/cinema/dossiers/combien-de-scenaristes-faut-il-pour-ecrire-un-film-a-hollywood/)
Alors qu’aucun réalisateur ne possédait le statut de créateur, en amont, l’auteur (au sens littéraire du terme, au sens où le scénariste a bénéficié bien avant le réalisateur d’un statut reconnu) était éclaté au sein d’une structure collégiale où régnait aussi une division du travail et une concurrence interindividuelle forcenée dans la chasse aux « idées », aux « gags », bref à des matériaux ponctuels qui occultaient une véritable prise sur le matériau culturel cinématographique.
À propos des syndicats, il faut insister sur une idée-force sans laquelle il n’est pas possible de spécifier une esthétique du cinéma : ces différents partenaires interviennent directement dans la fabrication du produit. En première analyse, on peut dire que le cinéma est un art collectif à plusieurs titres :
-
- Par son implication économique : la cinématique hollywoodienne des studios repose sur des mouvements d’appareil sophistiqués et d’une grande pureté géométrique, permettant, entre autres, par une codification scrupuleusement respectée de la part des réalisateurs, ces envolées lyriques à partir d’un Jésus sur sa croix dans un péplum bon teint ou à partir du visage de l’héroïne morte dans un sombre mélodrame ; tous ces mouvements d’appareil imposent une infrastructure lourde, une bonne maîtrise du studio hollywoodien et la direction d’une armée de techniciens. Rien à voir avec les mouvements volontairement heurtés en caméra portée et les enchaînements cut/faux raccords (jump cut) dans les films et les séries télévisées d’aujourd’hui.
- Par son implication idéologique : reconduire le matériau cinématographique sans le retravailler pour en figer les codifications. Produire une culture de masse dans le sens où le film ne provoque pas une lecture, une méditation, mais une consommation-reconnaissance d’une marchandise prédigérée. Bien entendu les codifications évoluaient par un phénomène d’acculturation du public suivant la créativité des réalisateurs et des monteurs pour en renouveler l’intérêt, mais aussi parce que toute machine paranoïaque, même la mieux huilée, présente des failles, des lieux mal-sur-trop-pas assez codés, car, même si le paranoïaque se prend pour Dieu, même s’il croit maîtriser les codes à l’instar de son divin modèle, ce n’est pas pour autant qu’on doit le prendre au mot. Et puis, ne souffre-t-il pas en cachette d’un énorme complexe d’infériorité ? .
Les archétypes et le matériau dans l’Hollywood de Frank Capra
Quoi qu’il en soit, le système des studios hollywoodiens a produit massivement des archétypes qui se figent très rapidement.
Il y a un équivalent « Commedia dell’Arte » à cette création de grands types de personnages. Pensons à celui de la blonde écervelée et cynique : si Marilyn Monroe, dans Les Hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, en est une incarnation éclatante et Jayne Mansfield, dans La Blonde et moi de Frank Tashlin, la caricature assumée, elles ne sont ni les premières ni les dernières à habiter le rôle qui s’inaugure, pour le parlant, avec Blonde platine, Jean Harlow, en1931 de Frank Capra. Plus près de nous, Une vraie Blonde de Tom DiCillo, le réalisateur de Ça tourne à Manhattan, reprend le flambeau. Et que dire d’Alfred Hitchcock avec Grace Kelly ou son clone Tippi Hedren ?
Jean Harlow, Robert Williams, Blonde platine, Frank Capra, 1931
Capra donne l’exemple du scénariste Myles Connolly qui lui déclare à propos d’un de ses scénarios :
Frank, c’est facile de voir pourquoi les comédiens rejettent ton scénario, dit Myles après l’avoir lu. Bien sûr, tu as quelques bonnes séquences comiques, mais tes personnages principaux ne sont pas vraiment sympathiques, pas vraiment intéressants. Les gens ne peuvent pas s’identifier à eux. Prenons la fille, par exemple : c’est une enfant gâtée, une riche héritière. L’immense majorité des gens n’ont jamais vu une riche héritière de leur vie. Et ils se fichent pas mal de ce qui peut leur arriver aux riches héritières. Zéro pour la fille. Prenons le héros, maintenant : c’est un peintre de Greenwich Village, un artiste aux cheveux longs. Personnellement, je ne connais pas d’artistes aux cheveux longs, et cela m’étonnerait fort que toi tu en connaisses. Et un type que je ne connais pas est un type qui est susceptible de me déplaire, surtout s’il n’a pas d’idéal, pas d’ennemis, pas de dragons à pourfendre. Ça fait encore un zéro. Et quand un zéro rencontre un autre zéro, l’intérêt de la chose égale zéro… Bon. Ta fille. Il ne faut pas que ce soit une garce parce qu’elle est riche, mais parce qu’elle en a marre d’être riche. C’est plus sympathique. Quant au gars, il ne faut pas qu’il soit du genre artiste sophistiqué. Il faut que ce soit un type que nous connaissons tous et que nous aimons bien. Peut-être un reporter, un gars qui n’a pas froid aux yeux, genre redresseur de torts, trop indépendant pour ne pas être à couteaux tirés avec son grincheux de rédacteur en chef. C’est plus sympathique. Et quand il rencontre la riche héritière… eh bien ! c’est La Mégère apprivoisée. Mais il faut que la mégère vaille la peine d’être apprivoisée, et le gars qui l’apprivoise doit être l’un de nous (p. 224 — 225).
Voilà un exemple à peine caricatural de ce qu’on appelait le canevas ou archétype narratif d’un bon scénario : ici les exemples sont essentiellement extra cinématographiques : le thème idéologique de la réconciliation de classe, la guerre des sexes, le sujet libre, solitaire assoiffé de justice, enfin « la scène à tourner » la rencontre de deux personnages aux caractères excessifs.
Pourtant la rhétorique de Connolly quand il sermonne Capra est exemplaire : l’interpellation de l’auteur par ses personnages doit fonctionner sur le mode de l’identification, du jeu de la sympathie et de l’antipathie et surtout de l’intégration : intégrer l’autre comme il le faudra ; sur un plan plus spécifiquement cinématographique, intégrer le matériau : car le social ne se sédimente pas seulement dans les thèmes, mais aussi dans les mouvements d’appareil : tel effet grue, codé par la Loi (la loi du studio bien entendu) intégrera lui-même la typologie idéologique des personnages et la place de l’instance filmique sur eux : pas le regard d’un auteur sur ses créatures, mais le regard anonyme, plongeant, de l’auteur hollywoodien, masque sous lequel il n’y a rien, sinon le regard de Dieu : omniprésent et supérieur. Le studio lui-même permet le simulacre de cette géométrie visuelle trop euclidienne pour être honnête.
Gary Cooper, Jean Arthur, L’Extravagant Mr Deeds, Frank Capra, 1936
Parfois la machine se prend franchement au jeu de sa paranoïa et cela donne l’anecdote rapportée par Luis Buňuel dans Mon dernier soupir lors de son séjour à Los Angeles : invité à une sneak-preview du film Dishonored, avec Marlène Dietrich, Buňuel se dispute avec le producteur du film quant à la prétendue originalité du sujet : Marlène Dietrich y joue le rôle d’une Mata Hari, et à la fin du film, Sternberg la fait mourir fusillée, bafouant, dit le producteur heureux de la nouveauté, toutes les règles. du star-system. Buňuel propose de s’en remettre au jugement de son ami Ugarte, romancier espagnol, travaillant pour Hollywood :
Nous entrons et je monte réveiller mon ami Ugarte. Je lui dis :
— Descends, j’ai besoin de toi.
En maugréant, les yeux fripés de sommeil, il descend en pyjama, je le fais asseoir en face du producteur et je lui dis lentement :
— Écoute-moi bien. Il s’agit d’un film.
— Oui.
— Ambiance viennoise.
— Oui.
— Époque : La Grande Guerre.
— Oui
— Au début du film, on voit une putain. Et on voit clairement qu’il s’agit d’une putain. Elle racole un officier dans la rue, elle…
Ugarte se relève en bâillant, m’interrompt d’un geste et sous les yeux très étonnés — mais rassurés, au fond — du producteur, il remonte se coucher en me disant :
— Arrête. Elle est fusillée à la fin (Mon dernier soupir, p. 160 — 161).
Bien sûr, il faut compter avec le sens de l’humour de Buñuel mais l’histoire recoupe bien des témoignages de l’époque. Le cinéaste espagnol affirme qu’il avait imaginé et fabriqué pendant sa période d’oisiveté à Hollywood un tableau synoptique du cinéma américain : sur un grand carton, des colonnes mobiles, à tirettes, faciles à manœuvrer. Dans la première colonne, on pouvait lire, par exemple, les ambiances : ambiance parisienne, de western, de gangsters, etc. Dans la deuxième, les époques, dans la troisième les personnages principaux, et ainsi de suite.
Grâce au système de tirettes, il pouvait reconstituer la quasi-totalité des canevas des films hollywoodiens.
Les distributeurs et le public : la massification
Pourquoi lier distributeur et public ? Parce que dans le processus de massification inhérent à Hollywood, le « public » correspond à un certain nombre de critères définis par la publicité : cible, étude de marché, etc. Aussi, plutôt que d’étudier ce qui a déjà été fait dans d’autres ouvrages, il convient de s’intéresser à ce qui correspond à l’axe de cette recherche : non pas la place du cinéma dans la société et son rapport au public via les distributeurs, mais plutôt, en inversant le rapport et pour ce qui concerne le public, la place de celui-ci dans le film même.
L’intervention est double. D’abord, par une intériorisation a priori des goûts du public avec, pour règle, une constante des idéologies dominantes : plaire, flatter l’immédiateté. L’industrie de la culture présente un plaisir immédiat, une vision obligatoirement hédoniste de l’art avec pour corollaire une adhésion sans distance critique, articulant celle-ci par un réseau de médiations institutionnalisées, lui-même inscrit dans les conditions de diffusion sonore, visuelle et tous les autres cérémonials du cinéma sévèrement codifiés par les distributeurs.
James Stewart, Jean Arthur, Vous ne l’emporterez pas avec vous, Frank Capra, 1938
L’intériorisation va parfois très loin, et Capra dévoile comment il s’y prenait lui-même pour remanier un de ses films juste après une preview, avant de le livrer aux distributeurs : pendant cette séance et devant un échantillon représentatif du public il enregistrait, synchrones, les réactions de rire, d’émotion (silence sans bruits de fesses sur les sièges, etc.). Puis, sur une table de montage, il pouvait se repasser le film et juger des passages à couper ou à remanier…
Mais « le public » intervient aussi par la censure des groupes de pression, les fameux lobbies, si puissants aux États-Unis. On peut voir ici encore un bel exemple de surdétermination d’un jeu de pouvoir sur la création. Première détermination : la place du méchant dans le canevas hollywoodien (qui renvoie d’ailleurs à une tradition extra cinématographique beaucoup plus ancienne et permanente). Les meilleurs « auteurs » s’y réfèrent : Hitchcock ne dit-il pas que le choix et la force cinématographique du méchant constituent, par le jeu du suspense, la clef de voûte de ses films ?
Il est dans ces conditions intéressant de lire sous la plume de Capra le regret de cet âge d’or, où l’on pouvait fabriquer de bons gros méchants : sous la pression des lobbies, il constate (surdétermination du canevas) « Pour éviter d’offenser qui que ce soit, notre « méchant » devait être un riche play-boy, de race blanche, sans emploi défini, sans domicile fixe — une espèce de personnage mythique et stéréotypé, vide de toute signification et de toute portée (p. 424). »
Le partenaire caché
Et même aux beaux jours des producteurs de cinéma, dans l’ombre, une force qui alimente l’industrie culturelle à partir de l’industrie tout court : « ces gars de New York », ces industriels du textile ou de la métallurgie qui faisaient si peur de la « Côte Est » aux vieux briscards de la « Côte Ouest ». Car le cinéma, à l’époque, est une sérieuse source de revenus, mais aussi un moyen de reproduire sur le plan culturel un public que l’on retrouvera sur les chaînes de montage réconcilié avec le mode de production capitaliste dominant (c’est du moins le désir patronal, mais il faut insister sur ce qui a été écrit précédemment des machines paranoïaques : aussi fortes soient les règles et les codifications, elles ne sont pas la loi d’un dieu omniprésent et omnipotent).
Une phrase de Marcel Dassault à TF1 révèle un état d’esprit qui subsistait en France dans les années 1970 sous un autre ciel et dans un autre contexte. Il déclarait à propos d’À nous les petites Anglaises ou autre Hôtel de la plage dont il était le producteur et… l’auteur de « l’idée originale » :
Je crois que ma mission ne consiste pas seulement à donner du travail aux jeunes dans le cadre des Avions Marcel Dassault, mais il faut que je m’occupe aussi de leurs loisirs en produisant de jolies histoires sur le plan culturel… » (je ne peux garantir le mot à mot).
La consommation cinématographique
Alors ? Les voilà réunis ces « partenaires » comme on dit aujourd’hui dans les associations de consommateurs. Les voilà réunis pour se disputer un pouvoir dont le symbole est d’abord le label publicitaire : qui va donner son nom au film, ou plus exactement quel (s) nom (s) va (vont) être attaché (s) à la création ?
Le lion Leo, symbole de l’auteur anonyme et paravent du pouvoir des producteurs ? La star : ne va-t-on pas voir un film « de » Greta Garbo comme le disaient nos grands-parents ? Ou le réalisateur dont le nom est doublement gommé par une habile division du travail et par l’idéologie même de la transparence du travail imposée par les codes hollywoodiens ?
La notion d’auteur dans l’Hollywood des studios
Une autobiographie étant prise comme point de départ de cet article, il faut essayer de la prendre au piège de son propre jeu, au lieu du plus fort narcissisme, là où l’auteur se flagorne ou se flagelle à tort ou à raison.
D’abord, une autobiographie de réalisateur est le produit d’une lutte comme on dit dans le discours politique, une tension qui a revalorisé le statut du réalisateur en lui conférant le statut d’auteur. Capra le revendique hautement ce statut, il se présente même comme un de ses champions historiques. Il écrit :
Pour moi, c’était le concept « un homme, un film » qui prenait corps, et ce à une époque où le contrôle du pouvoir administratif n’avait jamais été aussi puissant. J’étais un franc-tireur qui demandait carte blanche (p. 246).
Mais cette « carte blanche » n’est pas aussi vierge qu’il le dit : un réalisateur capable d’enregistrer les réactions d’une preview a trop bien assimilé la leçon hollywoodienne de son temps…
Il ajoute :
L’idée « un homme, un film » concrétisait peu à peu, malgré l’opposition farouche des bureaucrates, et de nos jours, bien des metteurs en scène constituent une « valeur » commerciale aussi sûre, sinon plus sûre, que les vedettes (p. 247).
Hitchcock en fournit un très bon exemple. Mais ce qui se dessine mieux au travers de la revendication de Capra c’est une prise de pouvoir commerciale sur le film. Le cinéma coûte de l’argent, l’argent entre dans la composition du film lui-même. Chaque élément d’un film est souvent quantifiable : telle poursuite de western comprend vingt chutes d’Indiens à cheval — tant de dollars. Dix chutes d’Indiens et des chevaux — tant de dollars, etc. De même les mouvements d’appareil : rails, grues, etc. C’est pourquoi le réalisateur à Hollywood devient aussi peu à peu producteur pour garder la maîtrise de son travail. Et là encore Capra se veut un précurseur :
[La position de Capra] attira aussi l’attention de tous les cinéphiles du monde sur le fait de plus en plus évident qu’il n’y avait à présent que deux écoles distinctes à Hollywood : l’école du producteur-réalisateur, fondée par Capra, et l’école du « comité [collectif] » qu’affectionnaient les grandes maisons de production, fondées par Louis Mayer (p. 263).
Et à la fin de son livre, il termine par cette envolée lyrique
J’avais contribué à la création de l’âge d’or du cinéma, l’âge où les cinéastes de l’Hollywood des années 30 et 40 — Cecil B. de Mille, John Ford, Henry King, Leo McCarey, Georges Cukor, Sydney Franklin, Victor Fleming, W. S. Van Dyke, Clarence Brown, Ernest Lubitsch, William Wellman, Mervyn Le Roy, Frank Borsage, Billy Wilder, Michael Curtiz, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, William Wyler, King Vidor et Georges Stevens — savaient prendre un public par la peau du cou et le faire hurler de rire, pleurer de chagrin ou défaillir de terreur (p. 437-38).
Le rapport auteur-public défini par Capra est remarquable : prendre le public « par la peau du cou ». On ne peut pas être plus direct dans la détermination immédiate. La stratégie du plaisir reste engluée dans une problématique du faire ou ne pas faire plaisir, dans cette vision hédoniste de l’art, complètement intégrée par le cinéaste hollywoodien du système des studios, aussi « grand » soit-il.
Reconnaissance, adhésion, réconciliation, fondent l’interpellation signifiante du sujet-auteur au sujet-récepteur et consommateur.
Et toujours ce problème lancinant du pouvoir. L’idée que l’auteur doit prendre le pouvoir dans la structure de production culturelle, prendre le leadership sur l’équipe, prendre le pouvoir sur la distribution en imposant son nom comme image de marque du film ; et prendre le pouvoir sur le public en le fascinant, en gommant les effets critiques du rapport visible et sonore au matériau cinématographique.
L’idée que le pouvoir n’est pas seulement une condition de l’exercice de la production créatrice, mais lui est consubstantielle : créer c’est prendre le pouvoir en un certain lieu sur cette espèce de trou noir que constitue la fonction d’auteur (où s’affrontent d’autres déterminations) pour les unifier : « Un homme, un film ». Cette maxime révèle cette volonté monarchique absolue.
La topique auteur-collectif ne peut se réduire à l’opposition entre le sujet individuel créateur face à l’institution ennemie qui réactiverait les vieux démons de la mythologie romantique de l’auteur maudit et de la belle âme solitaire. La dimension collective s’inscrit elle aussi en place et lieu de la fonction d’auteur. Elle implique une manière critique (comme la notion d’auteur possède aussi historiquement son propre poids critique) d’interroger la fonction d’auteur au cinéma.
Élie Faure l’écrivait dans Fonction du cinéma : le cinéma est un art collectif par excellence. Et il faut se rendre à l’évidence : on ne peut, sans tomber dans une métaphysique de l’auteur, méconnaître des films qui se sont faits autrement, où la fonction d’auteur a été remplie collégialement (c’est l’objet de l’interrogation du Groupe de recherches d’esthétique du CNRS, sous la direction de René Passeron, dans l’ouvrage commun sur différentes sphères artistiques : La Création collective).
Cinéma et idéologie
Frank Capra, Pourquoi nous combattons, 1942-1945
Sur la base de cette topologie des partenaires de l’industrie et de la consommation cinématographique hollywoodienne, la tentation est forte d’éviter le problème esthétique en le rabattant sur l’économique, le sociologique ou le politique. Pourtant, cette première approche a permis de faire quelques incursions dans les procédés de fabrication de la machine et pas seulement d’en décrire les rouages : canevas stéréotypés, archétypes des personnages, géométrisation de l’espace filmique, autant d’éléments qui appartiennent au matériau, même s’il s’agit de ses manifestations les moins artistiques.
Mais si la seule question qui se pose à un authentique artiste est : comment faire fonctionner autrement le matériau, celui-ci se présente d’abord comme ce face à quoi le cinéaste doit se mesurer dans ses éléments les plus progressistes, mais surtout se confronter dans ses aspects les moins créatifs.
À partir de la thèse adornienne : étudier la place de la société dans l’art et non celle de l’art dans la société, il est possible, dans une perspective politique, d’examiner non pas ce qu’on appelle trop rapidement « le cinéma politique » — les films à contenu politique ou qui interviennent sur des problèmes politiques —, mais les effets mesurables dans les œuvres d’une tension spécifique (qu’on ne peut réduire mécaniquement à la lutte de classes générale) intra cinématographique ou tout au moins intra culturelle dont l’enjeu est la prise de pouvoir sur la production créatrice d’un film en particulier. Méthodologiquement, on ne peut réduire l’art à l’idéologie et on doit prolonger la question dialectique de l’auteur et du collectif, de la dimension collective dans les concepts de la Théorie esthétique : forme, technique, matériau, industrie. Il faut encore interroger la dialectique de la création artistique et de la production culturelle dans l’industrie cinématographique.
Car la notion d’auteur, médiation subjective de l’œuvre, opère sur une histoire qui lui préexiste. Ainsi, il ne faut pas oublier la logique qui préside la position d’Adorno et Horkheimer : « L’idée d’un style comme cohérence purement esthétique est un rêve romantique tourné vers le passé. (La Dialectique de la raison, p. 139).
D’où le corrélat de leur thèse :
Les grands artistes n’ont jamais été ceux qui incarnaient le style le plus pur et le plus parfait, mais ceux qui, dans leurs œuvres, utilisèrent le style pour se durcir eux-mêmes contre l’expression chaotique de la souffrance comme vérité négative. (Ibid., p.139)
Cela explique leur conclusion que la recherche forcenée du style rejoint in fine la préoccupation marchande de l’industrie culturelle d’identification du produit ce « succédané d’identité » (Ibid., p. 140), et de son auteur : cette « pseudo-individualité » (Ibid., p. 163) :
C’est ainsi que l’industrie culturelle, qui est le plus rigide de tous les styles, apparaît comme l’objectif même du libéralisme auquel on reproche l’absence de style. (Ibid., p. 140)
Ainsi, Ernst Lubitsch, leur compatriote, l’« auteur » né à Berlin de To be or not to be, de Ninotchka, de The Shop around the corner (Rendez-vous), vénéré par La Nouvelle Vague, notamment Truffaut qui démarque dans Jules et Jim la « Lubitsch touch » de Sérénade à trois ? Exécuté au détour d’une phrase contre le règne de la pseudo individualité, de la recherche du style comme valeur marketing :
La particularité du moi est un produit breveté déterminé par la société, et que l’on fait passer pour naturel. Elle se réduit à la moustache, l’accent français, la voix grave de la femme fatale, la « patte » de Lubitsch : il en est comme des empreintes digitales sur des cartes d’identité qui, par ailleurs, sont exactement les mêmes et sur lesquelles la vie et le visage de chacun — de la star à l’inculpé — sont transformés par le pouvoir de la généralité (Ibid. p. 163).
Évolution du logo Universal, 1926-2013
Bibliographie
ADORNO, T. W., Théorie esthétique, Paris, Klincksieck (traduction française Marc Jimenez), 1982.
ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M., La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, « Tel » (traduction française Eliane Kaufholz), 1974.
BERGÉ, Tristan, Combien de scénaristes faut-il pour écrire un film à Hollywood ? URL : http://www.courte-focale.fr/cinema/dossiers/combien-de-scenaristes-faut-il-pour-ecrire-un-film-a-hollywood/ 2012.
BUΝUEL, Luis, Mon dernier soupir (Robert Laffont), 1982.
CAPRA, Frank, Hollywood Story, Paris, Stock, (traduction française Ronald Blunden), 1976.
FAURE, Élie, Fonction du cinéma, Paris, Gonthier, collection « Médiations », 1964.
HIVER Marc, « Adorno #2 : la forme esthétique comme contenu [social] sédimenté – Marc HIVER », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2013, mis en ligne le 1er octobre 2013. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/adorno-2-forme-esthetique-contenu-social-sedimente-marc-hiver/
HIVER Marc, « Hollywood : « La machine à fabriquer des saucisses », Erich von Stroheim — Marc HIVER », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2015, mis en ligne le 1er juillet 2015. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/hollywood-machine-fabriquer-saucisses-erich-von-stroheim-marc-hiver
HIVER Marc, « Adorno #1 : plaisir, rêve et imaginaire – Marc HIVER », Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2013, mis en ligne le 1er juillet 2013. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/adorno-1-plaisir-reve-et-imaginaire-marc-hiver/
LEVACO, Ronald, GLASS, Fred : « Quia ego nominor Leo » in Le Cinéma américain, Paris, Flammarion, 1980.
Groupe de recherches d’esthétique du C.N.R.S. sous la direction de Serge Passeron — La Création collective (Paris, Clancier-Guenaud, Recherches poïétiques, 1981).
Lire d’autres articles de Marc Hiver


Philosophe, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, d’Adorno et des industries culturelles
Dernier livre : « Adorno et les industries culturelles – communication, musique et cinéma »,
L’Harmattan, collection « communication et civilisation »