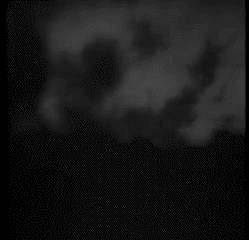Stroheim : Hollywood, la machine à fabriquer des saucisses – Marc HIVER
Pour les tenants de l’École de Francfort qui ont anticipé a priori le devenir d’une industrie culturelle comme le cinéma, son statut conjoint de septième art est loin d’être établi. On peut démonter les clichés de la machine à fabriquer des saucisses (1), selon l’expression d’Erich von Stroheim, pour dénoncer le système hollywoodien qui l’avait broyé. A posteriori, des cinéastes diagnostiqueront la mort du cinéma d’art après une période où l’industrie avait besoin de l’invention par les précurseurs de formes esthétiques pour nourrir son langage para-publicitaire esthétisant. Alors, cet article interroge les conflits idéologiques, commerciaux et esthétiques qui ont fait des Rapaces d’Erich von Stroheim un des films martyrs de l’histoire du cinéma… sauvant l’aura du septième art ?
Article interdit à la reproduction payante.
Les grands auteurs de cinéma sont donc seulement plus vulnérables, il est infiniment plus facile de les empêcher de faire leur œuvre. L’histoire du cinéma est un long martyrologe. (Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, p. 8)
Scénario, adaptation et réalisation : ERICH VON STROHEIM d’après le roman McTeague de Frank Norris (1899).
Montage : Joe W. Farnham (version complète, soit 36 bobines environ) — Stroheim (2e version : 24 bobines) — June Mathis (3e version : 16 bobines). Durée de la version française commerciale : 120 min. Procédé noir et blanc (Stroheim fit colorer à la main 6 bobines pour la première copie). Écran : 1 x 1,33.
Production : METRO-GOLDWYN-MAYER.
RÉSUMÉ DU SCÉNARIO : Début du XXe siècle en Californie. Trina Sieppe et McTeague s’épousent, elle ignorant tout de l’amour physique, lui le découvrant à peine et avide de possession. Trina subira le mariage comme un véritable viol et l’économe qu’elle était va devenir une avare, une rapace forcenée. Juste avant le mariage, elle avait gagné 5 000 dollars à la loterie. Ils vont devenir l’objet de son amour dégénéré. Le couple se désagrège. McTeague perd son emploi. Marcus, cousin de Trina (il voulait aussi l’épouser) est jaloux de McTeague et surtout des 5 000 dollars. Sa femme ne semblant plus l’aimer, la société lui ôtant son gagne-pain, McTeague se laisse aller. Excédé, il tue Trina et lui vole ses 5 000 dollars. Il retourne dans sa ville natale pour se replonger dans ses souvenirs d’enfance. Mais la police — et Marcus qui voudrait hériter — le poursuivent dans la Vallée de la Mort où il fuit. Seul, Marcus le rattrape, l’attache à lui par des menottes dont il n’a pas la clef ; mais McTeague le tue. Le film se termine sur le plan de McTeague accroché au cadavre, sans eau, qui va mourir dans le désert brûlant.
Contenu
Stroheim – éléments de l’histoire du film Les Rapaces
« J‘ai fait plusieurs films, mais je persiste et je persisterai peut-être encore longtemps à n’en signer qu’un, moralement s’entend, et ce film, c’est Greed », disait Stroheim en 1926 à un journaliste américain. Greed (Les Rapaces) est l’adaptation du roman McTeague de Frank Norris. Cet écrivain californien (1870-1902) avait formé avec Stephen Crane et Theodor Dreiser l’école naturaliste américaine et son roman s’était en partie référé à L’Assommoir de Zola.
En cours de tournage de The Merry-go-round, le producteur Irvin Thalberg avait congédié Stroheim. Ce dernier n’avait aucun recours et dut ravaler son humiliation. Il n’en mit que plus de rage et de talent dans Greed entrepris pour Samuel Goldwyn. Greed devait comporter 40 bobines et le tournage durer deux ans, demander lune mise de fonds de plus de deux millions de dollars. La rédaction du scénario nécessita trois mois de travail à raison de 15 heures par jour.
Stroheim fit travailler — et vivre — ses acteurs dans l’ambiance même du drame. Il tourna en partie — chose rare à l’époque — en décors naturels. Il reconstruisit une maison brûlée en plein San Francisco pour les besoins du film, fit rénover une mine de charbon. Le tournage dans la Vallée de la Mort fut le tour de force de sa carrière (112 mètres au-dessous du niveau de la mer, à 60°). Le tournage y dura 37 jours avec 52 personnes. Grâce à son extrême prudence, on ne déplora aucun accident.

Mais entre temps, la fusion des sociétés donnant naissance à la Metro-Goldwyn-Mayer, Stroheim se retrouva à nouveau sous la coupe de Thalberg qui, le poursuivant de ses impératifs industriels (en accord avec Louis B. Mayer), entendit lui faire réduire son film aux dimensions commerciales courantes. Le film fut monté trois fois. La version actuelle réduite à trois heures au lieu de six et neuf (réduite encore à deux heures par un distributeur français) est de June Mathis « qui n’avait lu ni le livre, ni mon découpage » nous dit Stroheim ! (Notons quand même qu’elle avait une grande admiration pour lui, mais des responsabilités financières dans l’affaire). De toute façon, ce fut un drame épouvantable pour Stroheim.
Consentant à voir en 1950, sur les instances d’Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, cette version mutilée, Stroheim pleura et déclara ensuite : « Ce fut pour moi une exhumation : j’ai trouvé dans un petit cercueil beaucoup de poussière, une terrible puanteur, une petite colonne vertébrale, et un os de l’épaule. » Cette déclaration met en garde le spectateur qui voit la version actuelle de deux heures alors que le découpage original prévoyait neuf heures de film.
Censure et raison commerciales
Il ne s’agit pas ici de savoir si la manière dont Stroheim aborde et traite les problèmes dans Les Rapaces était celle qui convenait, si son souci de « naturalisme » — en fait, si l’on joue sur ce type d’appellations, emporté par un « souffle romantique » incontestable — est critiquable ou non. On accepte, dans cette étude, le parti-pris de « l’auteur » Stroheim, on montre, en première analyse ce qu’il y a « d’original » chez lui et pourquoi — et surtout comment — la censure hollywoodienne s’y est prise pour mutiler et dénaturer en grande partie « l’œuvre » d’un cinéaste.
La censure commerciale hollywoodienne a mutilé — a posteriori, au niveau du montage — Les Rapaces : matériellement par les coupures innombrables pratiquées dans les montages successifs confiés à d’autres que Stroheim et souvent dans un sens opposé à celui recherché par l’auteur (le cinéaste Joseph von Sternberg de « L’Ange bleu », entre autres, s’est sali les mains dans cette affaire), et moralement/publicitairement par la légende délirante et malveillante édifiée autour du personnage Stroheim, « l’homme que vous aimeriez haïr » : et qui l’enfermera dans les rôles qu’on lui proposera en majorité dans sa deuxième carrière d’acteur quand les studios lui seront interdits.
En fait, il y a deux causes à l’origine de la légende de Stroheim : d’abord l’origine noble et la généalogie qu’il s’est lui-même forgées en prétendant être le fils d’un colonel du 6e dragon et d’une dame de compagnie de l’impératrice d’Autriche ; et aussi le rôle d’officier prussien sans pitié par lequel il a été révélé au grand public dans les premiers films où il a joué comme acteur avant qu’il ne soit réalisateur. Aussi faut-il reconnaître qu’à l’origine de la légende du « personnage » Stroheim, il assume une part de responsabilité.
Mais quant au développement et à l’ampleur qui lui ont été donnés, ils sont le fruit des calomnies, des haines tenaces envers Stroheim, des publicistes délirants et souvent malveillants d’Hollywood, et nous ajouterons aussi d’une logique commerciale qui était celle du star system et dont Stroheim a lui-même bénéficié : contradiction sur laquelle il faudra bien revenir quand nous aurons terminé cette « expérience de pensée » qui consiste à jouer le jeu du drame romantique de « l’auteur maudit » face à une institution qui l’écrase, une machine paranoïaque sans faille qui le broie par une pure négativité démoniaque dans laquelle il se débat, virginal, sujet volontaire et créateur.
La censure hollywoodienne opère à deux niveaux : cinématographique et extra-cinématographique (2). Extra-cinématographique : comme on pourra s’en rendre compte dans cette étude, Les Rapaces a été massacré parce que la critique sociale — même sous une forme naturaliste — » et parce que la critique de la répression sexuelle dans le roman de Norris et le film de Stroheim ne convenaient pas à Hollywood « machine à fabriquer des saucisses » selon le mot de Stroheim lui-même. (3)
Sur un plan cinématographique-filmique (4), parce que la « mégalomanie » de Stroheim, sa position sur le cinématographique, est critique non seulement dans son « fond » et dans sa « forme », mais par sa redistribution du pouvoir sur l’écran — et — dans les méandres du studio hollywoodien.
Les Rapaces est le film qui ne doit pas exister, qui existe quand même, qui est assassiné et dont on parle encore alors qu’il est matériellement invisible (la version de 2 heures est terriblement décevante si elle n’est pas accompagnée de tout un apparat critique).
La légende continue autour de Stroheim. Et le public, tout imprégné de cette légende, voyant un film mutilé de telle façon qu’il semble être l’œuvre d’un sadique, d’un cynique qui se complaît à contempler la fange des hommes, continue souvent à le « recevoir » comme un film-spectacle.
En s’attardant longuement sur le découpage original, en tenant compte de tout ce qui a été coupé et en montrant en première analyse que cela dénature la « pensée », le « style » d’un « auteur » chez qui la « durée psychologique », les détails jouent un rôle important, nous allons tenter cette expérience de pensée romantique : secouer un peu le mythe Stroheim, pour « retrouver » le « vrai » visage d’un des premiers « auteurs » qui ait osé s’opposer à la routine, au puritanisme hollywoodien et qui eut, tragique destin du « cinéaste maudit » sa carrière brisée dans la force de l’âge et de son talent.
Ensuite, secouant ces vieux concepts de l’histoire de l’art, nous tenterons un retour critique sur le phénomène Stroheim en ce lieu des Rapaces pour interroger la fonction de l’auteur et approfondir cette thèse d’un pouvoir spécifique dans la production créatrice, d’une politique créatrice relativement autonome qui traverse avec ses lois propres, le champ cinématographique.
Travailler sur un découpage — écrit — puisqu’on ne peut pas accéder au film dans son intégrité filmique et son intégralité, implique le choix d’un critère d’analyse. Nous avons donc choisi un critère à la limite du littéraire et du cinématographique parce que l’étude du script publié par L’Avant-Scène, en restituant à leur place les morceaux tronqués et le rôle de la censure, ne peut que mettre en vedette les personnages et l’action à mi-chemin entre le roman — mais un script n’est pas un travail littéraire autonome — et le film — à leur intersection — on peut à loisir comparer la trame de la diégèse (5) aux fameux canevas hollywoodiens dont nous avons déjà parlé. Bien entendu, c’est insister sur le contenu du film, fût-il social. Mais si l’on insiste sur les écarts, les décalages opérés par le film de Stroheim, alors on peut sortir de la double impasse d’une esthétique du contenu et d’une esthétique de la forme en s’intéressant à la fonctionnalité de la forme chez Stroheim et à la distinction entre contenu objectif : exemple le mariage des deux protagonistes du drame renvoyant au mariage comme mythe ; et contenu de vérité : le déclin de l’institution mariage dans un contexte social donné. De même le naturalisme peut-être dépassé du roman de Norris (reprise à l’américaine de l’œuvre d’un Zola), ne remplit pas la même fonction dans le film : car n’oublions pas qu’au cinéma on n’exprime jamais une idée, mais une idée, telle qu’elle est présentée par le cinéma : ainsi peut-on émettre l’hypothèse que le naturalisme de Stroheim — paradoxalement — n’a pas la même portée en 1923 à Hollywood que le naturalisme de Norris.
Contenu objectif, contenu de vérité
C’est pourquoi dans la lecture du film, il ne faut pas que le contenu objectif (commun au roman et au film) fasse écran au contenu de vérité du film pour ses spectateurs contemporains. Il s’agit de mettre en évidence la réelle portée critique du film de Stroheim en dépassant l’opposition peu opératoire entre la forme et le contenu. Comme hypothèse de travail, le « sens » du film doit être pris comme un « poids », un « geste », une action sur son entourage immédiat cinématographique et dans le même temps par son fonctionnement dans le contexte social de l’époque.
La version tronquée des Rapaces ne nous permet pas de saisir dans toutes ses finesses l’évolution des personnages telle qu’elle est décrite par le découpage original. En effet, cette évolution y est présentée de façon très minutieuse par Stroheim qui nous la donne dans sa pleine durée. Ce problème de la durée, au double sens de la durée « romanesque » du film et de la durée de la séance de cinéma, se retrouve au cœur de bien des démêlés entre auteur, producteur et surtout distributeur. L’intervention classique d’Irving Thalberg ne doit pas être prise dans le sens d’une pure opposition entre deux caractères antagonistes.
N’oublions pas que l’argent, au cinéma, intervient à tous les stades de la création et d’ailleurs, dans sa pratique, Stroheim n’était pas de ceux qui ignorent (à leurs dépens artistiques) qu’un film est toujours le produit d’une lutte contre les obstacles financiers et qu’il faut ruser pour que ces obstacles deviennent les moyens de la création. Thalberg, en tant que producteur délégué de la Metro-Goldwyn-Mayer, agit en fonction d’une logique commerciale et on verra qu’on ne peut réduire la fonction des grands producteurs hollywoodiens au pur obstacle à la création des auteurs.
Quoi qu’il en soit, la « durée » au cinéma est souvent l’objet d’un litige comme si le premier devoir critique d’un cinéaste passait d’abord par une remise en cause du mode de consommation du cinéma. Dans Les Rapaces, les nombreuses coupures (plus de la moitié de ce qui a été tourné) nous masquent cette durée si chère à Stroheim.
Ainsi, il s’attache à nous montrer les interactions des caractères : pendant sa chute morale et psychologique, Trina, l’héroïne du film, a de brusques accès de tendresse envers son mari McTeague, mais ils ne correspondent pas à l’évolution d’esprit du moment pour lui et le fossé se creuse entre eux de façon inexorable. Tout cela est pour ainsi dire escamoté dans la version actuelle.
Et surtout, le plus grave, ce sont les coupures nombreuses et longues qui ont été faites au début du film et qui le dénaturent complètement : Stroheim y montrait la sexualité troublée par le milieu de Trina et McTeague, ce qui conditionne tout le déroulement diégétique du film. Or, pour le spectateur non averti, cela peut ne pas sembler très évident. La censure s’est en effet attachée à couper ce qu’il y avait de très dénonciateur pour un film hollywoodien : à savoir que c’est la société qui par sa répression provoque la déchéance des individus. C’est ainsi que la critique sociale laisse le pas à une critique moraliste de la « rapacité » chez l’homme, à la critique des vices qui seraient inhérents à la nature humaine. Voilà encore de quoi alimenter la légende du « cynique », du « sadique » Stroheim qui se complaît d’une manière spectaculaire à se rouler dans la boue.
La question du « style »
Une nouvelle fois, il faut dépasser les notions périmées de forme et de contenu : en coupant des plans et des séquences entières, la censure rend le film à la fois plus spectaculaire (tout est reconstruit autour de quelques scènes-chocs : Trina nue sur son or, la séquence du boucher et bien sûr le final de la Vallée de la Mort).
Mais en même temps cette censure le rend plus sage en lui enlevant son caractère excessif sur un plan plus critique : la durée qui permet à « l’auteur » d’échapper à sa propre raison artistique par une mise en crise de son « style ».
Émettons cette hypothèse :
et si c’étaient Thalberg (peut-être d’une façon haineuse) et June Mathis, la dernière monteuse (admiratrice de Stroheim) qui ont aidé à remettre « l’auteur » sur les rails de son propre « style » ?
Remettre « l’auteur » dans le droit chemin de son œuvre paradoxalement en conciliant raisons commerciale, cinématographique et personnelle. On comprend pourquoi la notion de « style » relève d’une double logique esthétique et commerciale à interroger. Ainsi certains continuent à parler du « naturalisme flamboyant » de Stroheim. En jouant ce jeu, nous tenterons de montrer dans cette expérience de pensée que l’appellation « romantique » collerait mieux si le rôle de la critique esthétique consistait à coller des étiquettes pour le plus grand bien d’une histoire de l’art réconciliée avec elle-même.
Art et spectacle
Penchons-nous sur le découpage original pour essayer d’entrevoir ce qu’aurait pu être Les Rapaces si la censure. ne l’avait pas autant mutilé.
Dès le début de la version actuelle, McTeague nous est présenté, certains critiques mondains diraient « en deux plans et de main de maître » : il montre un petit oiseau blessé à un camarade ; ce dernier jette l’oiseau par terre en riant. McTeague soulève l’homme et l’envoie dans un ravin : voilà « brossé » le tableau du « caractère » de McTeague, son archétype : la brute au cœur sensible.
Le problème, c’est que cette merveilleuse introduction n’était pas voulue par Stroheim : dans une longue partie — coupée, Stroheim présentait d’une manière moins spectaculaire le contexte social dans lequel avait été élevé le héros et la sédimentation progressive de ce « caractère ». De même, dans une des premières scènes sur Trina Sieppe, l’héroïne — et qui a été également coupée — on aurait dû voir celle-ci faire son marché : elle achète des saucisses et surveille la flèche de la balance tandis que le boucher les pèse. Trina, sourcils froncés, lui fait soudain comprendre qu’elle n’est pas dupe et l’oblige à recommencer. Là aussi une indication — l’économie — liée à un contexte social et non pas d’emblée la marque d’une avarice : à nouveau, détournement d’une évolution au profit de l’exhibition d’un caractère monstrueux.
La censure gomme ce qui ne lui paraît pas assez excessif à son goût comme elle gomme ce qui lui paraît trop excessif sur un autre plan : quand justement Stroheim sort d’une vision morale (dans le double sens déjà dégagé). McTeague et Trina se rencontrent par l’intermédiaire du cousin de Trina, Marcus, qui l’amène se soigner une dent : McTeague, après la mort de son père et à l’instigation de sa mère, a quitté la mine pour devenir dentiste à San Francisco.
Avant-Scène, p. 24 :
(McTeague soigne Trina puis s’arrête. Quelque chose ne va pas.Il porte les mains à ses yeux puis à la tête. Gros plan
de McTeague, les yeux exorbités, les narines dilatées, la lèvre inférieure protubérante. Il se penche vers Trina avec concupiscence (il lui a administré de l’éther et elle est endormie). Une fois encore il se rétracte comme si quelqu’un voulait l’en empêcher… Il ôte le masque anesthésiant, soupire… en raison de l’odeur des cheveux de Trina, du parfum doux et innocent émanant de son corps qui le font céder. Gros plan de l’oiseau qui vole dans sa cage. Plan rapproché des deux. McTeague se redresse et tout penaud passe la main dans ses cheveux, se rendant compte de la folie qu’il vient de commettre. Il reprend la roulette et se remet au travail avec une énergie désespérée).
Fidèle à notre hypothèse de travail, nous n’allons pas dégager le « sens » de cette séquence. Ce qui est symptomatique c’est le carton qui a été placé avant elle. Il faudrait interroger la fonction de ces cartons dans les versions définitives du cinéma dit « muet ».
Voici ce carton : « Mais en McTeague, sommeillaient des forces obscures héritées de son père. »
Ce carton est bien artificiel. En effet, dans la suite du film, il ne sera plus fait allusion à ces « forces obscures ». McTeague n’est pas le Lantier de La Bête humaine. Une chose est sûre : ces quelques mots évacuent, surtout placés avant l’image, toute ambiguïté de la séquence par une pseudo-évidence pléonastique : le film ne doit pas dérailler.
Peu de temps après, McTeague avoue à Marcus, qui avait lui aussi le projet d’épouser sa cousine, son amour pour Trina. Celui-ci, apparemment beau joueur, lui cède la place et, sans rancune, amène McTeague à Oakland le dimanche suivant pour qu’il revoie Trina et fasse la connaissance de la famille. Et c’est lors de la description de cette journée que Stroheim réussit une séquence où il critique la morale chrétienne de l’amour. McTeague joue d’une manière un peu ridicule sur son accordéon : « Plus près de toi seigneur ». Il lui sourit timidement. Elle est de plus en plus heureuse de ce bonheur platonique.
Avant-Scène, p. 32-33 :
(McTeague dit soudain : « Dites, Miss Trina, à quoi ça sert d’attendre plus longtemps ? … Pourquoi on ne se marie pas » ? Affolée, Trina répond non d’un geste de la tête. McTeague, peiné, reprend : « Pourquoi ? … Je ne vous plais pas ? » Elle répond oui de la tête. Il semble dire : « Alors, pourquoi pas ? »Elle se retourne en faisant comprendre : « Parce que… », il insiste, s’approche d’elle, la prend dans ses bras et, très maladroitement la presse contre lui et l’embrasse. Elle essaie de se libérer : « je vous en prie… Je vous en prie ! » Les larmes aux yeux. Il relâche son étreinte. Un train passe. Plan rapproché du train sous la pluie : les roues, les rails, les roues. Retour sur le couple : Trina affolée, lui un peu surexcité. Il veut la prendre dans ses bras. Elle s’écarte.)
Forme et formation
On pourrait écrire sur le plan du contenu objectif que Stroheim fait en quelques plans une démystification totale de l’amour platonique, des rapports entre hommes et femmes ; que, dans une perspective freudienne venant « éclairer » son naturalisme, il dégage bien les notions de refoulement et la misère sexuelle de l’époque.
Mais il nous semble plus intéressant « d’éclairer » ce que d’aucuns n’appelleraient que l’anecdote filmique : « Il relâche son étreinte. Un train passe. Plan rapproché du train sous la pluie : les roues, les rails, les roues. Retour sur le couple : Trina affolée, lui un peu surexcité. »
S’agit-il d’une simple mise en forme du contenu ? C’est oublier toute la réalité du montage cinématographique. Bien entendu Stroheim, élevé à l’école de Griffith dont il a été assistant-réalisateur notamment sur Intolérance, appartient à cette génération de cinéastes pour lesquels, non seulement le montage n’est pas interdit, mais au contraire la manière privilégiée d’intervention sur le matériau cinématographique, une manière de faire fonctionner (même inconsciemment) la « forme » pour ne pas rester prisonnier d’un rapport d’expression, de représentation. Ainsi, transcendant le contenu objectif, la forme joue sur les rapports sociaux et les forces productives, instaurant un contenu de vérité par la mise en crise du rapport entre le film et le spectateur à un moment donné.
Car ce qui vient travailler le film de Stroheim, cette plus-value qui remet en cause le rapport de représentation, c’est l’apparition brutale sur l’écran de la sexualité et de ses caractères psychologiques, comme le dit Jean Mitry dans son introduction, « Le Romantisme de Stroheim » à ce numéro de l’Avant-Scène p. 6-7, et de l’érotisme, pas seulement des personnages (contenu objectif), mais de l’instance signifiante filmique. Et Mitry précise en outre que : « Le grossissement, parfois caricatural, est ironique, caustique, sardonique et point dépourvu de cruauté (…) Le réalisme devient alors une sorte de naturalisme critique, plus proche de Mirbeau que de Zola… », Mais il ajoute plus loin : « Mais je voudrais signaler ici le caractère éminemment romantique de Stroheim sous le couvert de ce naturalisme… » Qu’il est difficile de ne pas se faire piéger par la nomenclature esthétique en vigueur !
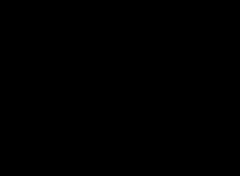
Stroheim met en parallèle le mariage avec un enterrement. Derrière le pasteur qui bénit les futurs époux et par la fenêtre, on distingue un cortège funèbre qui passe très lentement. Voici d’ailleurs le découpage de la fin du mariage. Tous les invités prennent congé. En partant le père dit à McTeague, Avant-Scène, p. 38 :
(Carton : « Doktor (parce que McTeague est dentiste), soyez bon pour elle… soyez très bon pour ma Trina. » Retour en plan rapproché sur lès lieux : McTeague acquiesce alors que die Mama continue à prodiguer des conseils à son gendre. Plan moyen de der Papa, sur le seuil : il s’impatiente et fait des signes. Plan général : la mère quitte les deux époux sans refermer la porte. Trina regarde alors McTeague, essaie de lui sourire, mais son sourire se fige : elle file précipitamment vers la porte et sort. Vestibule + escalier. Trina en plan moyen descend quelques marches, rejoint sa mère et lui parle à l’oreille. La mère la rassure en lui signifiant : « N’aie pas peur… va rejoindre ton mari. »)
Plus loin, dans la même séquence, p. 38
(Appartement de McTeague : plan rapproché de Trina qui referme la porte derrière elle. Panoramique sur McTeague assis le dos tourné et retour sur Trina qui couvre ses yeux des deux mains puis file jusqu’à la chambre. On la suit. McTeague (vu par elle en plan américain) se tourne et demande :
Carton : « C’est toi, Trina ? »
Plan moyen de Trina qui retient sa respiration, la main sur la bouche et ne répondant pas. McTeague (vu par elle) se lève et se dirige vers la pièce. Plan inverse, lui de dos s’avançant avec l’intention de la prendre dans ses bras. Plan rapproché de la cage aux deux oiseaux. Plan sur Trina très émue. Plan de la cage, l’image se trouble. Retour sur Trina qui semble s’évanouir, mais, affolée, se ressaisit et sort. Plan américain de McTeague qui regarde la cage avec amour.
Vestibule : Trina, dos à nous, file vers la chambre au bout du couloir, entre et (flash sur elle à l’intérieur) referme la porte. Chambre. Elle semble excessivement affolée et pour éviter de crier met un mouchoir dans sa bouche. Il entre, dos à nous, bouche l’écran et s’approche. Elle essaie de l’éviter… Il la prend finalement dans ses bras et bien qu’elle tente de se dégager, la tient fermement et l’embrasse. Plan, rapproché des oiseaux qui gazouillent. Plan rapproché des pieds de Trina (chaussures blanches de mariée), sur les pieds de McTeague : elle se met lentement sur la pointe des pieds presque comme une danseuse sur pointes. Gros plan du cou de McTeague (vu de dos) qu’étreignent les mains de Trina. Gros plan du visage de Trina » inondé de larmes.
Carton : « Il faut être très bon pour moi, mon chéri. Très bon. Tu es tout ce que j’ai au monde, maintenant. »
Elle s’écarte et s’assied sur le lit en sanglotant. McTeague reste debout à ne pas savoir quoi faire. Plan moyen de la main sciant du bois sur fond de velours noir.
Travelling arrière pour cadrer la pièce en plan général. McTeague sort et ferme les rideaux. Fermeture verticale par volets noirs).
Le matériau
Fort du postulat de Walter Benjamin, on peut affirmer qu’il est possible de parler, c’est-à-dire de faire une critique de l’œuvre d’art, par le truchement d’une parole différente. Dans une perspective matérialiste, mais non mécaniste, Benjamin pensait que la critique achève l’œuvre dans le sens où elle la dépose dans un continuum formel. Les implications de cette thèse sont évidentes et notamment les questions : qu’est-ce qu’une œuvre achevée ? L’auteur est-il un monarque absolu régnant sur son œuvre ? Une réponse affirmative à ces deux questions ne constitue pas une thèse opératoire dans l’analyse d’une séquence comme celle du mariage de Trina et McTeague. Au gré des adjectifs de la critique romantique, on pourra la traiter de sublime — monstrueuse — géniale, ou au contraire, dans une perspective plus réaliste, de ratée, boursouflée et excessive. Toujours ce « trop » qui s’interprète comme un « plus » ou un « moins », comme si un électron démoniaque venait, suivant sa fantaisie, changer la valence de l’œuvre en fonction de la critique qui s’y applique : électron dont la négativité renvoie sans nul doute à une articulation flottante, comme ces ponts mobiles au-dessus des canaux, et dont il faudrait peut-âtre mesurer la complexité au mètre d’une raison sociale historiquement variable. Comment aborder de manière critique une telle séquence ? Néant d’un recours à la subjectivité, à cette fameuse « intention » qui préfigurerait l’œuvre avant son incarnation signifiante. Qu’y aurait-il donc derrière Stroheim ?
Il faut faire fonctionner autrement la notion d’auteur : non pas poser la question des conditions de possibilités de l’auteur Stroheim, mais se demander où se situe Stroheim dans Les Rapaces en articulant sur la séquence donnée la notion de matériau cinématographique qui pulvérise la contradiction esthétique dans ce champ-là du rapport fond-forme et tenter ainsi de. saisir une rationalité purement cinématographique. Thèse de l’art pour l’art ? Non, mais affirmer que le social est à rechercher d’abord dans la sédimentation filmique elle-même, dans le sens où il faut étudier les structures de la société telles qu’elles s’impriment dans l’art.
Stroheim, dans cette séquence des Rapaces, fait-il fonctionner autrement le matériau cinématographique ? Voilà une des questions socioesthétiques à se poser en priorité. Comment joue-t-il des archétypes, pour les intégrer, les retravailler ou les nier -, quel sort fait-il subir sur le plan filmique au naturalisme littéraire un peu réchauffé de Frank Norris ?
Une première remarque : la filiation, sur le plan cinématographique entre Griffith et Stroheim est ici évidente. Trina Sieppe, outre le personnage du roman de Norris, rappelle fortement ces héroïnes de D. W. Griffith synthétisées par Lilian Gish dans Le Lys brisé.
La contradiction entre vision moralisante et mise en œuvre sadique de la narration : l’image de Trina est celle de l’oiseau prisonnier dans sa cage et Stroheim jouit de l’ambiguïté entre le contenu objectif de la scène et le cérémonial formel qu’il instaure.
Durée, violence, plaisir
Le découpage de l’espace, les entrées et sorties de champ, la répétitivité des personnages que le script nous précise « vus de dos », le suspense quasi hitchcockien : comment Trina va-t-elle être mangée puisque nous savons d’emblée ce qui l’attend, tout concourt à la mise en place d’un gestus sadien. L’écriture de Stroheim, ici, n’est nullement un instrument de communication ; comme le disent les metteurs en scène à un comédien qui en fait trop : « On a déjà compris ». Le cinéma, qui joue si bien des ellipses spatio-temporelles, ainsi que le spécifient les manuels techniques, s’installe soudain dans la durée. Comme Hitchcock, qui utilise à fond cette carte (bannir les « trous » entre les séquences par un rythme fondé sur les ellipses), annoncer stratégiquement une information pour mieux savourer ensuite dans l’exercice de la durée les conséquences dans ce suspense où s’exerce une pratique narcissique de la mise en scène, le jeu du pouvoir sadique d’un créateur sur ses créatures.
Quand la forme contrarie le fond, quand la violence du geste créateur, quand la notion d’équilibre est bafouée, l’harmonie (au sens traditionnel) retravaillée, quand la raison cinématographique tourne le dos à la raison commerciale (Stroheim « dure » trop par rapport à Hitchcock), quand le film articule plaisir et rupture, alors le matériau transcende ses propres archétypes, ses traditions sédimentées et une secousse tellurique le fracture en un lieu parfois « inattendu » (comment expliquer Intolérance de Griffith si on le rapporte au simple contenu objectif de ses œuvres précédentes ?). C’est pourquoi la démarche critique implique une « sensibilité instruite » aux situations conflictuelles qui traversent l’œuvre étudiée. Une pratique elle-même sadique ; mettre le doigt sur la plaie, là où le matériau présente des lignes volcaniques ou des lignes de faiblesse (théorie du maillon le plus faible ?).
Alors oui, dans cette séquence Stroheim se révèle sadique puisque la rupture est dans son découpage même, dans son être antagoniste (Mallarmé : qu’on laisse « l’âme » poétique pour retrouver le corps antagonique du poétique). Une subversion où jouissance se distingue de plaisir — du principe de plaisir. La stratégie du plaisir qui structure la séquence rompt l’immédiateté idéologique, au-delà de la problématique hédoniste. Rupture avec le sadisme intégré des fictions d’Hollywood ; l’enterrement qui passe est de trop, cela jouit trop, cela souffre trop, on ne peut pas prendre son plaisir tranquillement… (Comme si une séquence de viol dans un film au contenu objectif « très progressiste » et pourtant au voyeurisme « réaliste » se pervertissait par un regard-caméra de la victime qui interpellerait le voyeur-spectateur pendant toute la séquence). Le montage cinématographique fonctionne comme ce regard-caméra, il vient rompre la belle continuité réaliste et l’installation du regard ; il distancie celui qui. jouit, il faut regarder et plus seulement voir.
André Malraux écrivait que le cinéma est un art et une industrie (6). Pour T.W. Adorno qui anticipait a priori le devenir d’une industrie culturelle comme le cinéma, son statut conjoint de septième art est loin d’être établi. A posteriori, des cinéastes comme Jean-Luc Godard ou Federico Fellini diagnostiqueront la mort du cinéma d’art ou de poésie après une période où l’industrie avait besoin de l’invention par les précurseurs de formes esthétiques pour nourrir son langage parapublicitaire esthétisant. Alors, en interrogeant les conflits idéologiques, commerciaux et esthétiques de la « machine à fabriquer des saucisses », qui ont fait des Rapaces d’Erich von Stroheim un des films martyrs de l’histoire du cinéma… sauvons-nous l’aura du septième art ?
Notes
[1] Ciné-Club n° 1948-1949-7, citation p. 3, avril 1949 :[2] Sur ce couple conceptuel, voir Christian Metz dans Langage et cinéma (Paris, Larousse, 1971, p. 54) :Le grand public, déclarait Stroheim encore en 1925, n’est pas le pauvre d’esprit qu’imaginent les producteurs. Il veut qu’on lui montre de la vie qui soit aussi vraie que celle vécue par les hommes : âpre, nue, désespérée, fatale. J’ai l’intention de tailler mes films dans l’étoffe rugueuse des conflits humains. Car, tourner des films avec la régularité d’une machine à faire les saucisses vous oblige à les fabriquer ni meilleurs ni pires que des saucisses en chapelet.
Il est mille choses, dans un film, qui ne viennent pas du cinéma (même si leur mise en œuvre au sein du film — leur « traitement » — est susceptible d’emprunter des voies proprement cinématographiques) : ainsi tout ce matériel filmique communément recensé sous des étiquettes comme « psychologie des personnages », « étude de mœurs », « arrière-fond psychanalytique », « thèse sociale » du film (ou religieuse, ou politique), « thématique », etc. (Et il importe peu que tout cela soit mal nommé), que le cinématographique et le non cinématographique, au sein d’un film, ne s’opposent nullement comme une pure « forme » et un pur « contenu »….
[3] La fortune de la formule de Stroheim sur les saucisses, virulente contre le cinéma américain, le doit beaucoup en France après la deuxième guerre mondiale à l’opposition idéologique — de gauche et essentiellement communiste — entre un Hollywood réduit à une conception monolithique, purement mercantile et les supposées réussites de l’URSS et des démocraties « populaires » en termes de cinéma éducatif et de ciné-clubs. Une revue comme Ciné-club citée plus haut (note 1) se donnait pour objectif de contribuer à ce mouvement d’éducation populaire.
Référence à l’histoire des ciné-clubs en bibliographie : le livre d’Antoine De Baecque et l’article d’Emmanuelle Loyer.
[4] Christian Metz dans Langage et cinéma (Paris, Larousse, 1971, p. 7) :À cet égard, la première distinction qui s’offre est celle qu’établissait Gilbert Cohen-Séat en 1946 et qui reste pleinement actuelle, entre le cinéma et le film : « fait cinématographique » et « fait filmique ». On peut la résumer de la façon suivante : le film n’est qu’une petite partie du cinéma, car ce dernier figure un vaste ensemble de faits dont certains interviennent avant le film (…), d’autres après le film (…), d’autres enfin pendant le film, mais à côté et en dehors de lui.
[5] La diégèse, rappelons-le, c’est « ce qui se passe » dans le « monde » induit par le film (« histoire » du film, événements, chronologie, etc.), mais qui n’apparaît pas forcément dans le film.
[6] « Par ailleurs le cinéma est une industrie ». Tout le monde cite la chute de ce texte de Malraux (Esquisse d’une psychologie du cinéma) sans l’avoir jamais lu, et pour cause ; publié une première fois peu après la Libération, il est resté introuvable depuis. S’appuyant sur les références acquises dans les années 1930 (Dietrich, Garbo, Gabin, Stroheim…), Malraux analyse le cinéma comme un mythe et montre ses rapports avec les autres arts : théâtre antique, littérature, peinture. Un texte fulgurant et méconnu, indispensable à tout cinéphile, comme à tout amateur de littérature. La présentation de Jean-Claude Larrat permet de restituer sa genèse, sa publication et sa fortune critique, mais aussi de comprendre le rapport intime de Malraux avec le cinéma et les autres arts.
Bibliographie
Adorno, T. W. ; Eisler, H. (1972) : Musique de cinéma, Paris, L’Arche (trad. française, Jean-Pierre Hammer).
Adorno, T. W. ; Horkheimer, M. (1974) : « La Production industrielle de biens culturels » in La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard (Tel), traduction française, Éliane Kaufholz.
Benjamin, Walter (1983) : « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » in Essais 2, Paris, Denoël/Gonthier, « Médiations » (traduction française, Maurice de Gandillac).
Ciné-Club, n° 1948-1949-7, avril 1949.
De Baecque, Antoine (2003) : La Cinéphilie : invention d’un regard, histoire d’une culture 1944-1968, Paris, Fayard.
Deleuze, Gilles (1983) : L’Image-mouvement, Paris, Éditions de Minuit.
Freud, Sigmund (1970) : « Au-delà du principe de plaisir », in Essais de psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque Payot (traduction française, S. Jankélévitch).
Hiver, Marc (2011) : Adorno et les industries culturelles — communication, musique et cinéma, Paris, L’Harmattan, collection « Communication et civilisation ».
Hiver, Marc, « Adorno #2 : la forme esthétique comme contenu [social] sédimenté », Web-revue des industries culturelles et numériques, 2013, mis en ligne le 1er octobre 2013. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/adorno-2-forme-esthetique-contenu-social-sedimente-marc-hiver/
L’Avant-scène cinéma n° 83/84 : Les Rapaces, film de Erich von Stroheim. Script et découpage du film intégral (9 heures). Juillet-Septembre 1968.
Lignon, Fanny, « L’œuvre écrit d’Erich von Stroheim », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 32, 2000, mis en ligne le 28 novembre 2007, consulté le 19 juin 2015. URL : http://1895.revues.org/117
Loyer, Emmanuelle. « Hollywood au pays des ciné-clubs (1947-1954) » in Vingtième Siècle. Revue d’histoire n° 33, janvier-mars 1992, pp. 45-55. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1992_num_33_1_2487/xxs_0294-1759_1992_num_33_1_2487
Malraux, André (2003) : Esquisse d’une psychologie du cinéma, Éditions Nouveau Monde.
Metz, Christian (1971) : Langage et cinéma, Paris, Larousse, collection « Langue et Langage ».
Norris, Frank (1991) : Les Rapaces (titre original : McTeague, a story of San Francisco), Paris, Phébus.
Norris, Frank (2012) : Les Rapaces (titre original : McTeague, a story of San Francisco, traduction française révisée par Françoise Fontaine), Agone, collection « Manufacture de proses ».
Truffaut, François ; Scott, Helen (2003) : Hitchcock-Truffaut, édition définitive, Paris, Gallimard.
Lire d’autres articles de Marc Hiver


Philosophe, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, d’Adorno et des industries culturelles
Dernier livre : « Adorno et les industries culturelles – communication, musique et cinéma »,
L’Harmattan, collection « communication et civilisation »