Disney, « Salò » et l’art non consommable de Pasolini – Owen SCHALK
Cet article, traduit par moi, est paru dans Monthly Review (New York), 73 : 6, novembre 2021 (original ici). Certes, on peut juger excessive la quasi-équivalence établie par Pasolini (à l’instar de Horkheimer et Adorno) entre le fascisme et l’industrie culturelle ; l’argument est plus convaincant si l’on voit ceux-ci comme des variantes assez différentes au sein d’un même paradigme de contrôle social (lire le texte de Fredric Jameson dans la Web-revue), de même que certains critiques voient un parallèle entre la déformation du langage courant par le régime nazi (lire Lingua Tertii Imperii de Victor Klemperer) et les « éléments du langage » propres à la novlangue néolibérale. Il est désormais évident que la surconsommation dénoncée par Pasolini est devenue mortifère au point de compromettre l’avenir de la vie sur Terre. Par ailleurs, le projet annoncé du « métavers » (une marchandisation totale de l’existence qu’on pourrait aborder comme l’aboutissement logique de l’industrie culturelle, ou alternativement, comme une version moderne du panoptique foucauldien) mérite pleinement d’être qualifié de « totalitaire » dans un sens redéfini. Finalement, je confirme que visionner Salò est une expérience absolument éprouvante (David Buxton).
La concentration actuelle de l’industrie du divertissement dans les mains d’une petite clique de géants du streaming multinationaux constitue la prochaine étape dans ce que Horkheimer et Adorno appellent « la standardisation du style » de l’art de masse. Le style n’est ni le contenu ni la forme, mais existe au-dessus de ceux-ci ; il est la manipulation personnelle et du contenu et de la forme par lequel un artiste inscrit sa vision personnelle. Dans l’industrie du cinéma moderne, cependant, le style est standardisé avec la même rationalité technocratique qui justifie l’exploitation des travailleurs au nom de la maximisation des profits. Dans la mentalité technocratique, le style devient une autre frontière à conquérir, et à transformer avec force violence en une structure homogène à même de générer des revenus massifs, tout en limitant les possibilités pour le consommateur de découvrir une conscience critique dans l’œuvre d’art.
Netflix et les autres géants du streaming représentent l’apothéose de l’impulsion vers une culture de masse entièrement régie par la maximisation des profits. Certes, dans l’industrie du cinéma, on a toujours imposé des formules facilement digérables : un protagoniste fiable, une histoire d’amour charmante, une structure en trois actes, etc. Mais l’emploi chez Netflix d’une méthode algorithmique comme ordonnateur du style est la conséquence inévitable d’un système dans lequel toute responsabilité est transférée à des processus mécaniques inculqués d’une omnipotence infaillible. Cary Fukunaga, réalisateur de la série Maniac pour Netflix, l’a quasiment avoué dans une interview pour GQ Magazine : « Puisque Netflix est une entreprise de données, ils connaissent exactement les habitudes des téléspectateurs, alors ils peuvent examiner ce que vous avez écrit et dire : « Grâce à nos données, nous savons que si vous faites cela, nous allons perdre tant de spectateurs ». C’est une autre forme de mémorandum. Il ne s’agit pas de discuter pour voir quel point de vue prévaudra. À tous les coups, l’argument algorithmique gagnera à la fin. […] C’est un exercice étonnant. […] Je n’ai aucun doute que l’algorithme ait raison (1). »
Disney, la deuxième entreprise du divertissement au monde après la Comcast Corporation, a depuis longtemps utilisé les technologies d’intelligence artificielle. En 2017, elle a eu recours aux « réseaux neuraux artificiels » pour scanner la base de données du site interactif de questions-réponses Quora, interprétant les likes comme « un vote pour la qualité narrative » d’une histoire postée, et analysant les mieux classées d’entre elles afin d’y trouver des constantes (2). Le but de l’analyse était d’affiner les tentatives de prévoir la popularité de certains contenus et de certaines formes. À cette fin, Disney a aussi utilisé des auto-encodeurs de variations factorisées pour identifier les repères anatomiques faciaux exprimés par les spectateurs au cours des projections, et pour générer ensuite des intrigues mieux à même de manipuler les émotions.
La manipulation émotionnelle a toujours été une composante cruciale du cinéma, de l’industrie publicitaire et du marketing de masse en général, mais sa technocratisation atteint de nouveaux sommets avec l’ubiquité des analyses béhavioristes et des technologies de feedback cybernétiques visant à créer « des expériences de visionnement personnalisées ». Cela veut dire que, pour l’essentiel, on nourrira constamment les consommateurs avec des éléments d’intrigue et des structures narratives quasi identiques, les empêchant de s’engager avec le contenu à un niveau intellectuel plus profond. William Burroughs avait donc raison de dire que « l’homme occidental [sic] s’externalise sous la forme de gadgets ». Il eût pu ajouter que cette externalisation – de la créativité humaine, de l’émotion, des pulsions de base – a pour but l’extraction efficace des revenus d’une masse docile, facilement apaisée.
Il est vrai qu’il existe une poignée de cinéastes avec des styles singuliers qui travaillent au sein de ces structures (David Lynch, pour en citer un exemple proéminent), mais leur assimilation dans les services de streaming sert à réifier, et non à subvertir la standardisation du style. De tels cinéastes sont inclus symboliquement comme artistes « bizarres », « surréels » ou d’autres qualitatifs réducteurs qui, en tant qu’incarnations d’un style « marginal », renforcent les productions conformistes majoritaires.
Alors que les salles de cinéma ont souffert en raison des mesures sanitaires contre le Covid-19, et que les services de streaming sont devenus en conséquence plus répandus, on peut supposer que l’avenir du divertissement de masse reposera sur les produits de Netflix, Disney et d’autres, qui recourent à l’intelligence artificielle. Les géants du streaming et les entreprises de médias multinationales continueront à subjuguer le contenu et la forme – le style donc – à des technologies impersonnelles dont le seul but est de calculer la profitabilité de chaque investissement potentiel. Le style est réduit en poussière dans l’engrenage d’une technocratie médiatique autoritaire. Il est armé pour apaiser et non pour défier ; il est rendu totalement servile à de nouvelles formes de reproduction mécanique (ou peut-être plus justement, de reproduction algorithmique).
L’École de Francfort
L’École de Francfort a compris que la logique du capital fait inévitablement disparaître tout élément de style non commercialisable. Adorno déplore cette standardisation du style, honnie par de grands artistes comme Samuel Beckett et Franz Kafka ; dans les livres de ces derniers, Adorno voit une mimesis singulière et non reproductible de la condition humaine, à l’opposé d’un gabarit de rentabilité. Lui et Horkheimer notent que, dans beaucoup de sociétés précapitalistes, « l’œuvre d’art accomplit encore la duplication par laquelle la chose acquérait une dimension spirituelle, devenait l’expression du mana (3) » ; dans l’industrie du cinéma, cependant, toutes les qualités indéfinissables de l’art ont été éradiquées. Pour les deux philosophes, l’industrie du cinéma imprime ses conventions dans la conscience des spectateurs d’une façon qui reproduit, mais qui n’étend pas leur esprit : « [les films] sont objectivement constitués de telle sorte qu’ils paralysent ces mécanismes [psychologiques]. Leur agencement est tel qu’il faut un esprit rapide, des dons d’observation, de la compétence pour les comprendre parfaitement, mais qu’ils interdisent toute activité mentale au spectateur s’il ne veut rien perdre des faits défilant à toute allure sous ses yeux. […] Les producteurs de l’industrie culturelle peuvent compter sur le fait que même le consommateur distrait absorbera alertement tout ce qui lui est proposé (4). »
Les formes de production où on considère que les films doivent être aisément consommables récompensent une certaine uniformité qui n’est pas simplement un calcul visant à la maximisation des profits, mais est aussi le moyen par lequel le système capitaliste se reproduit. « Dans le capitalisme avancé, l’amusement est la prolongation du travail. Il est recherché par celui qui veut échapper au processus du travail automatisé pour être de nouveau en mesure de l’affronter », affirment Horkheimer et Adorno (5). Dans les sociétés dominées par l’industrie culturelle, le film représente donc la reproduction des rapports de travail capitalistes à travers la négation de la conscience critique. « C’est effectivement une fuite, écrivent-ils, mais pas, comme on le prétend, une fuite devant la triste réalité ; c’est au contraire une fuite devant la dernière volonté de résistance que cette réalité peut encore avoir laissé subsister en chacun (6). »
Pasolini
Pier Paolo Pasolini (1922-75) était, par nature, un résistant. Ouvertement homosexuel dans une Italie imprégnée du catholicisme, il a fait face pendant sa vie à trente-trois procès pour blasphème, obscénité et « insulte à la religion ». Dans un environnement où la violence politique, particulièrement à droite, était fréquente, il a été un intellectuel communiste de conviction, un critique majeur de la société consumériste qui a émergé dans le sillage du « miracle économique » des années 1950.
Pasolini était connu nationalement et internationalement pour ses critiques incisives de la culture consumériste à l’italienne, et pour son opinion résolue que le « néo-capitalisme » d’après-guerre était plus nocif pour le caractère national que la période mussolinienne. Il pensait que le mode de production néocapitaliste dévaluait le corps et l’esprit plus que des modes précédents, et que cette dépréciation s’étendait aussi au monde du cinéma.
Vers la fin de sa vie, Pasolini devient convaincu que la télévision, de plus en plus omniprésente, est l’appareil principal du consumérisme d’après-guerre. Si elle est si nocive, c’est parce qu’elle infiltre le cadre domestique. Elle peut être allumée à n’importe quelle heure. Elle allait graduellement acculturer – Pasolini en était certain – le peuple italien à une existence fragmentée, purement axée sur la consommation, où toute impulsion à l’action collective est supplantée par l’assouvissement privé des désirs de base.
Les premiers travaux de Pasolini traitent principalement le « sous-prolétariat » de Rome : une population jeune et oubliée dont la misère persistait même après l’accroissement dramatique de la production nationale et la disponibilité accrue des biens de consommation pour la population urbaine. Alors que la proportion des ménages qui pouvaient s’offrir une voiture ou un téléviseur est montée en flèche, la pauvreté du sous-prolétariat restait inchangée. Certains intellectuels italiens réfèrent à cette période non comme un « miracle économique », mais comme « l’âge d’aliénation », mettant l’accent sur la misère continue et le sens d’éloignement culturel résultant de la dissolution rurale, de l’expansion urbaine et du travail d’usine usant, ce qui a dramatiquement modifié les habitudes collectives. Pasolini était d’avis que cette aliénation culturelle répandue – du travail, de la famille, des projets collectifs – venait de l’effondrement de la société préconsumériste. Avec d’autres écrivains de l’époque, il voulait que l’art se déploie à des fins consciemment politiques, qu’il se transforme en une arme qui pourrait représenter avec justesse l’aliénation de la vie contemporaine.
Le dégoût de Pasolini pour le capitalisme d’après-guerre va au-delà de l’aliénation sociale qu’il génère. Il avait l’impression qu’une forme de génocide était en train d’avoir lieu : un génocide impulsé par le « nouveau fascisme » qui détruisait les anciens modes de vie en faveur d’une hégémonie exploiteuse et dégradante. Pour lui, ce système émergent est plus dangereux que le fascisme du début du 20e siècle : « je considère que le consumérisme est pire que le fascisme classique, car le fascisme clérical n’a pas transformé les Italiens. […] Ce dernier était totalitaire, mais non totalisant (7). » Pasolini croit donc que la nouvelle culture de la consommation et ses productions artistiques sont une force aliénante d’une puissance sans précédente qui séduit des individus matériellement, tout en manipulant leurs corps et leurs esprits au bénéfice d’une petite minorité. L’industrie culturelle d’après-guerre, la télévision en particulier, ne représente pas simplement un déclin dans la qualité de la production artistique en Italie. De par sa négation de la conscience critique des spectateurs, elle est aussi activement complice d’un système économique autoritaire.
Dans l’immédiat, Pasolini ne voit pas d’alternative viable à ce « nouveau fascisme ». Il a notoirement déclenché un scandale au sein de la gauche italienne avec le poème « Le PCI s’adresse aux jeunes », où il critique les mouvements étudiants en 1968 pour ne pas avoir reconnu les policiers comme des prolétaires malavisés, ou eux-mêmes comme des bourgeois aveugles à l’idéologie. C’est une position paradoxale qui a incité beaucoup de débats et de condamnations : essentiellement, il affirme que la police appartient à la classe ouvrière, mais qu’elle est dans l’incapacité à être solidaire au-delà de l’investissement dans une institution réactionnaire (de même que les syndicats policiers aujourd’hui existent principalement pour protéger leurs membres de la critique venue de l’extérieur), alors que les étudiants ne peuvent mettre en œuvre un changement radical à cause de leur origine bourgeoise. Pour lui, le libéralisme croissant concernant les questions sexuelles est largement compromis. Les idées révolutionnaires entourant la libération sexuelle sont influencées par la logique dominante de la consommation, et soutiennent donc le statu quo socioéconomique.
Ainsi, pour Pasolini, les promesses matérielles et psychiques des biens de consommation et de l’industrie culturelle sont si séduisantes que toute opposition est facilement cooptée. L’opposition au nouveau fascisme manque d’énergie authentique et engagée. C’est ce qu’il cherchait à introduire dans ses films : une authenticité non soumise aux structures cinématographiques qui reproduisent une hégémonie néo-capitaliste. Afin de combattre l’ascendance de ce « nouveau fascisme », Pasolini voulait trouver de nouvelles représentations de la critique marxiste dans son art et mettre en question les idées des spectateurs.
Les films post-boom de Pasolini résistent à la dynamique de consommation artistique en défiant les structures existantes de l’industrie culturelle, et en créant des œuvres « non consommables ». Dans une interview, il énonce son intention de « fabriquer des produits qui sont assez non consommables que possible. […] Je sais qu’il y a quelque chose de non consommable dans l’art, et nous devons mettre l’accent sur cet aspect (8). » À cette fin, il voulait créer « un cinéma poétique » qui pourrait servir d’instrument de résistance contre la marchandisation de la culture décrite par Horkheimer et Adorno. Pour ce faire, sa technique la plus importante est le « sens suspendu » (Roland Barthes).
Le sens suspendu

Pasolini était un admirateur documenté de Barthes. Il le cite explicitement dans son essai « La fin de l’avant-garde », et dans la « bibliographie essentielle » qui ouvre le film Salò. Barthes décrit le « sens suspendu » comme une pratique au théâtre de « signifiants hétérogènes » et de « signes décrochés », et affirme que « l’art du metteur en scène ne consiste pas seulement ici [il parle du film Le Beau Serge (Chabrol, 1958)] dans la correction des signifiants [par rapport aux signifiés], mais dans la façon élégante dont ils échappent à la rhétorique, sans cesser cependant d’être intelligibles (9). »
Cette technique ne cherche pas à supprimer le sens, mais à créer une certaine ambiguïté où celui-ci n’est pas directement signifié ; il est donc suspendu, refusant de donner au spectateur des symboles faciles à digérer. Le sens suspendu se comprend en opposition aux formules manipulatrices de la production culturelle, que ce soit l’industrie du cinéma de l’époque, ou les technocraties du streaming d’aujourd’hui. Plutôt que de manipuler les consommateurs à travers des types d’émotions prévisibles, le sens suspendu introduit à dessein des éléments non intelligibles dans l’œuvre. En adoptant cette tactique, Pasolini crée un cinéma qui cherche à réintroduire l’aspect « non consommable » de l’art – le mana –, et à éveiller les spectateurs aux conventions totalisantes dans lesquelles ils sont immergés.
Cette stratégie est présente dans plusieurs de ses films tardifs, en particulier Théorème (1968), Porcherie (1969) et Salò ou les 120 jours de Sodome (1975). La série qui intervient entre les deux derniers – La Trilogie de la Vie (Le Décameron (1971) ; Les Contes de Canterbury (1972) et Les Mille et Une Nuits (1974) – est moins pertinente, car elle s’intéresse à la célébration du corps et non à sa dégradation. De plus, Pasolini a notoirement désavoué cette trilogie avant de tourner Salò, qui explore en profondeur le vide bourgeois, le sadisme aristocratique et la violence du consumérisme, thèmes qu’il avait déjà traités dans Théorème et Porcherie. Ces trois films, considérés comme un triptyque, nous permettent de voir la vision pasolinienne du néo-capitalisme et de l’industrie culturelle, et les tactiques utilisées pour combattre leur hégémonie.

Les concepts d’industrie culturelle et de sens suspendu font partie intégrante des buts artistiques de Théorème, un film qui raconte la chute morale d’une famille bourgeoise à la suite de l’arrivée d’un visiteur mystérieux (joué par Terence Stamp). Selon Pasolini, « un jeune homme, peut-être Dieu, peut-être le Diable, c’est-à-dire l’authenticité, débarque dans cette famille et tous les personnages entrent en crise. La démonstration n’est pas résolue (10). » La démonstration en question est la séduction de tous les membres du ménage par le visiteur qui s’en va ensuite, déclenchant l’effondrement psychologique de tous. La nature sexuelle des rencontres ne veut pas dire que les crises sont purement sexuelles ; l’effondrement est plus holistique que cela. La famille occupe au début une position socioéconomique agréable où domine une hiérarchie rationnelle ; à la fin, elle a été séduite par « l’authenticité » que le rationalisme bourgeois cherche à supprimer, de même que les mécanismes de l’industrie culturelle essaient de détruire le mana de l’art en canalisant tout produit créatif dans une structure reproductible. Que l’effondrement collectif de la famille soit non résolu indique le recours au sens suspendu, qui sert ici à renforcer l’argument en faveur du pouvoir transformateur de « l’authenticité ».
Le rôle du visiteur n’est pas d’offrir une solution aux problèmes de la famille ; il incarne l’authenticité non digérable, et son but est de précipiter l’échec du corps social bourgeois. Autrement dit, le sens symbolique de cet effondrement est suspendu, et bien que les effets de celui-ci soient montrés, ils ne sont jamais unifiés en un message singulier portant sur la rééducation de la bourgeoisie. Pasolini ne pointe pas les personnages ou les spectateurs vers un nouveau système de croyances. L’ambiguïté indique son désir de reformuler les conventions narratives de l’industrie du cinéma italienne, qui a toujours pour résultat la destruction du potentiel transformateur de l’art. Horkheimer et Adorno notent que la finalité du « processus de reproduction industrielle » est de standardiser le style, créant « les ornières usées des associations habituelles » où se fait écraser le mystère des œuvres (11). Le visiteur est donc une représentation puissante de l’authenticité à laquelle Pasolini lui-même aspire, et à laquelle il oppose la rationalité de la famille bourgeoise, et par extension la rationalité de l’industrie culturelle.
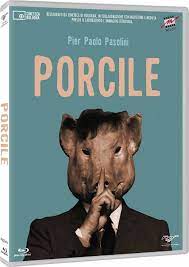
Ce conflit entre rationalité et authenticité apparaît aussi dans Porcherie, où le sens suspendu est une stratégie artistique. Le film décrit la montée du capitalisme monopolistique et l’incapacité d’une force authentique à la combattre. Il contient deux histoires en parallèle. L’une suit une famille d’industriels dans l’Allemagne de l’après-guerre. Le patriarche de la famille, Klotz, essaie de faire chanter son rival, un autre industriel nommé Herdhitze, qui à son tour oblige Klotz à accepter une fusion en menaçant de dévoiler l’obsession sexuelle de son fils, Julian Klotz (joué par Jean-Pierre Léaud), pour les cochons. Il est clair dès le début que la famille Klotz est d’un autre milieu que la famille dans Théorème. Klotz appartient à l’aristocratie industrielle, et son statut n’est pas altéré par l’indifférence de son fils pour les affaires, ou de la participation de la petite amie de celui-ci dans le mouvement étudiant de 1968. Pasolini avait déjà rendu publique sa mauvaise opinion du mouvement étudiant et du libéralisme sexuel avant de tourner le film. L’authenticité comme force de changement y est donc absente. La petite amie de Julian est politiquement inepte, et c’est Julian qui exemplifie la libération sexuelle ; son désir d’avoir des rapports avec des cochons est symbolique de la consommation débridée. Pasolini dépeint le vide du radicalisme estudiantin et la marchandisation de la libération sexuelle, faisant montre l’absence d’espoir : les puissants ont écrasé l’authenticité à travers la rationalisation de la production, tandis que les jeunes ne peuvent échapper aux schémas de consommation promus par l’industrie culturelle.
L’histoire parallèle du cannibale (joué par Pierre Clementi) ouvre le sens suspendu à de nouveaux chemins d’analyse. Deux histoires de consommation sont placées côte à côte, demandant aux spectateurs de faire leurs propres connexions. Il s’agit d’un homme sans nom qui erre dans un désert volcanique, consommant quasiment tout ce qu’il trouve – plantes, papillons, humains – jusqu’au moment où il est capturé et exécuté. Ses dernières paroles sont : « J’ai tué mon père, j’ai mangé de la chair humaine, et je tremble de joie ». Le promeneur-cannibale est clairement aligné sur Julian Klotz, autre figure de la consommation hédoniste, mais la nature littérale de sa consommation renvoie aux discours de production industrielle qui traversent le film. À plusieurs reprises, l’excrément dénote l’industrie. « L’Allemagne, dit le père Klotz à Herdhitze, quelle capacité pour la digestion, quelle capacité pour la défécation. » Comme le promeneur-cannibale, la société de consommation absorbe les êtres humains et les défèque en tant que produits pour d’autres à consommer. Il n’importe pas à Pasolini qu’on soit conscient de sa propre complicité, qu’on « tremble de joie », ou qu’on se pense radical ; on est également coupable de se goinfrer avec l’excrément du néo-capitalisme. C’est le jumelage des deux intrigues qui permettent aux spectateurs de faire le lien. Mais la condamnation la plus notoire du capitalisme consumériste de la part de Pasolini devait venir six années plus tard avec Salò, où il démontre brutalement la façon dont la culture de la consommation viole les corps et les esprits afin d’assouvir sa propre cupidité.
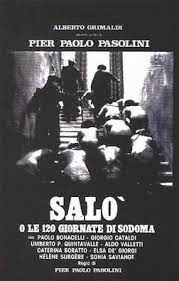
Salò est l’accusation finale, résolue, portée par Pasolini contre cette culture. Le film met en scène quatre aristocrates italiens fascistes en 1945 qui, au moment où tout s’effondre autour d’eux, se retirent dans un manoir à la compagne, où ils font soumettre un groupe de jeunes hommes et femmes à la torture, souvent sexuelle. Cette violence sexuelle est métaphorique. Comme le dit Pasolini : « dans [Salò] … le sexe n’est rien d’autre qu’une allégorie de la marchandisation des corps aux mains du pouvoir. Je pense que le consumérisme manipule et viole les corps autant que l’a fait le nazisme (12). » Sa décision de représenter cette marchandisation de la manière la plus horripilante possible rappelle l’argument d’Adorno sur la représentation du fascisme « classique ». Adorno a critiqué les portraits satiriques de dictateurs fascistes, car « la véritable horreur du fascisme est escamotée ; il n’est plus le fruit de la concentration du pouvoir social, mais du hasard, comme les accidents et les crimes (13). »
La violence de Salò traduit l’antipathie totale de Pasolini envers les effets mentaux et physiques d’une industrie culturelle de plus en plus monolithique, et le « fruit » de la standardisation du style. Il s’agit d’un abattement profond. Il n’y a pas la moindre suggestion d’une authenticité transformatrice, et la seule fois qu’un personnage lève les bras en opposition, il est aussitôt descendu. Comme l’écrit Thomas Peterson, le film « est organisé d’une façon atomisée et fragmentée, [et] une série continue d’outrages contre la nature réprime son unité et sa cohérence mentale (14). »
Dans sa représentation de la violence fasciste, Pasolini refuse donc de rester dans les « ornières usées » de l’industrie culturelle ; c’est la cruauté elle-même qui semble guider le film. Sa focalisation impassible sur la torture traduit la venue d’une « société hyperconsommatrice qui réifie tous les êtres humains comme des marchandises dans leurs propres corps (15). » C’est une société régie par les structures et les conventions de l’industrie culturelle, un monde où des idées, des produits et des gens deviennent, aux yeux du sujet capitaliste, « des choses dont il peut « posséder » ou « se débarrasser » » (Georg Lukacs) (16). C’est à travers cet accent sur la consommation luxuriante, sans cœur, que Pasolini rattache son film à l’Italie contemporaine, utilisant le sens suspendu pour pousser les spectateurs vers la prise de conscience.
La dimension barthésienne de Salò dépend d’une transposition de son cadre historique dans le présent. À de multiples reprises, Pasolini subvertit à dessein la véracité historique en faisant citer aux personnages des textes non contemporains, incluant même une longue séquence où des femmes raconteuses jouent une scène d’un film de 1974 Femmes femmes (Paul Vecchiali). Comme la juxtaposition de la famille Klotz et du promeneur-cannibale dans Porcherie, Salò présente un certain nombre de similarités entre le cadre historique et la société italienne de 1975, mais cette relation n’est jamais pleinement explicitée. Les aristocrates fascistes qui forcent leurs captifs à manger des matières fécales rappellent la comparaison faite par Klotz entre la production industrielle et l’excrément ; le spectateur moderne, comme les captifs de 1945, est piégé par une industrie culturelle de plus en plus monopolistique qui extrait de la valeur des citoyens en « déféquant » des produits manquant de qualités édifiantes, et en poussant à leur consommation.
Conclusion
Pasolini a vécu la transformation de la société italienne après la guerre comme une continuation du fascisme, et à son grand regret, il ne voyait pas ses concitoyens résister à la privatisation de leurs vies. Qui plus est, l’émergence de l’industrie culturelle a transformé le cinéma en une extension des processus froidement rationalistes qui régissent une économie monopolistique. Pasolini a déployé son talent artistique pour combattre la standardisation du style. En affûtant son style filmique non consommable, il cherchait à accroître la prise de conscience d’un monde néocapitaliste, où la rationalité est plus prisée que l’authenticité, et la maximisation des profits mène à la standardisation du style dans l’art populaire.
Il ne serait pas trop pessimiste de voir les productions technocrates de Netflix, Disney et les autres comme des incarnations modernes de la peur ressentie par Pasolini d’un art manquant d’authenticité, totalement captif du capitalisme contemporain. Ses tentatives d’insérer une esthétique non consommable dans ses films relevaient d’un projet politique conscient, mais la manipulation sordide des corps et des esprits qu’il essayait de représenter se passe désormais sur une échelle beaucoup plus grande. À travers un processus de production de plus en plus automatisé, on cherche à subjuguer les derniers vestiges du style personnel aux résultats financiers. L’équivalent moderne des horreurs de Salò se met en scène dans le monde entier. Pour commencer, la gauche devrait s’en débrancher, ou tout au moins regarder avec un œil plus critique.
Notes
1. Zach Baron, « Cary Fukunaga Doesn’t Mind Taking Notes from Neflix’s Algorithm », GQ Magazine, 27 août 2018.
2. Disney Research, « A Good Read: AI Evaluates Quality of Short Stories », EurekAlert, 21 août 2017.
3. Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, La dialectique de la Raison (Gallimard, 1974) (1944), p. 36 (traduit par Éliane Kaufholz).
4. Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, Kulturindustrie (Allia, 2011) (1974) (chapitre du livre ci-dessus), p. 20.
5. ibid, p. 41.
6. ibid, p. 57.
7. Celluloid Liberation Front, « The Lost Pasolini Interview », MUBI, 17 janvier 2017.
8. Simone Bondavalli, « Lost in the Pig House: Vision and Consumption in Pier Paolo Pasolini’s « Porcile » », Italica, 87, no. 3 (2010), p. 408.
9. Roland Barthes, « Un problème de signification au cinéma » (1960), Œuvres complètes, tome 1, 1942-61 (Seuil, 2002), p. 1044.
10. « Pasolini Introduction », Special Features: Teorema, Criterion Collection, 1975.
11. Horkheimer et Adorno, ibid, p. 19, 42.
12. Celluloid Liberation Front, art. cit.
13. Theodor Adorno, « Engagement », Notes sur la Littérature (Flammarion, 1984) (1958), p. 293.
14. Thomas E. Peterson, « The Allegory of Repression in Teorema and Salò », Italica, 73, no. 2, 1996, p. 224, 228.
15. ibid, p. 217.
16. ibid, p. 216.


Owen Schalk est né à Winnipeg (Canada) en 1998. Il est écrivain indépendant de fiction et d’essais politiques. Son livre « Canadian Imperialism » (Sublation Press) paraîtra prochainement.



