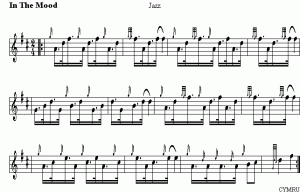La Motown : une fabrique de tubes – Marc HIVER
Motown. Comment le jazz « authentique » a donné naissance à un jazz « populaire » (notamment par la médiation du rhythm and blues) puis à une variété jazzy et au rock and roll, bref, à la nouvelle musique populaire américaine ? Et cette musique s’étant exportée, devenant celle de l’américanisation, comment le jazz « populaire » est-il devenu la bande-son de nos sociétés industrielles ? Poser ces questions n’est pas sans intérêt musical, psychologique, sociologique, politique et pas seulement économique dans notre champ interdisciplinaire des industries culturelles.
Interdit à la reproduction payante
Contenu
La Motown et le devenir du jazz : un exemple de transition vers la variété par le rhythm and blues


Sur la musique populaire il existe une position radicale où il faut révolutionner le statu quo et même le ciment social induit par cette musique recouvrant en fait un jeu de pouvoir et de domination. Et pourtant le rapprochement entre Noirs et Blancs, via le devenir de la production et de la réception du jazz, ne serait-il pas à porter au crédit de celui-ci, à partir du moment où on l’envisage du point de vue de l’évolution d’un processus médiatique et d’une logique culturelle ?
C’est dans ce sens que j’analyse l’intérêt d’une position critique qui, d’un côté, repose sur la pertinence de sa défense de la nouvelle musique « européenne » contre la déferlante de l’américanisation et de la mondialisation qui ne laisserait de place à aucune alternative ; mais d’un autre côté, et c’est ce qui nous concerne le plus dans notre champ interdisciplinaire des industries culturelles, un prolongement de certaines de ces analyses sur les mécanismes des industries culturelles. À une certaine conception de l’art qui en fait l’égal des sciences et de la philosophie, échoit la fonction critique du statu quo, des modes de pensée et des logiques de communication ; aux industries culturelles les fonctions, entre autres, de ciment social et de défense des « lieux communs ».

Ces arrangeurs — sans doute les musiciens les plus compétents des États-Unis — restent dans l’ombre, comme les auteurs de scénario au cinéma. […] il importe qu’on ne puisse soupçonner que la musique n’est pas vraiment improvisée…
Une pulsation idéologique
Il comprend aussi que pour ceux qui promeuvent cette musique, plus que pour ceux qui la font d’ailleurs, l’enjeu est encore plus caché qu’au cinéma. Ces musiciens, ces arrangeurs qui organisent les sons, le rythme et le climat, « the mood », de la bande-son accompagnant notre vie sociale et psychologique, font que le beat ne peut se réduire comme dans les glossaires techniques à un simple synonyme de tempo ; que le swing à distinguer du Swing comme courant des années 1935-1945 ne renvoie pas seulement à des figures ou des jeux rythmiques présents dans le très vieux jazz comme dans le free jazz ; que la quête du groove n’est pas seulement musicale. En définitive, toute cette ingénierie esthétique, psychologique et sociale crée une pulsation idéologique autrement plus redoutable que l’écran de fumée et le fantasme de la toute-puissance visuelle d’un pseudo-monde des images.
L’exemple Motown
À intervalles réguliers, le jazz authentique se détacherait du jazz populaire, cherchant à s’émanciper de cette « pulsation insistante » (Malson), dansante (car une pulsation « non insistante » existe dans toutes les formes de jazz), ce beat, ce swing, ce groove qui en font justement la popularité chez le public noir et peu à peu chez le public blanc. Mais dans le même temps, le jazz y perdrait sinon son âme, du moins ce corps, le corps de la négritude dans son plaisir sauvage et orgastique aux racines africaines, donc ce qui garantit son authenticité par opposition à la musique européenne savante, sérieuse.
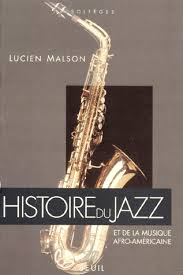
Alors qu’une partie du jazz allait se priver bientôt de cette pulsation insistante, le « rhythm and blues » allait grandir comme une compensation, exister pour nous comme un viatique.
Lucien Malson cite aussi Boris Vian :
On commence à s’apercevoir aux États-Unis, disait-il, que le rhythm and blues peut se vendre et qu’il possède quelque chose que les autres musiques n’ont pas. Tout cela signifie que l’on va presser de plus en plus de disques de jazz [sic] et c’est une bien bonne idée.
Ike Turner et Ray Charles vont dans ce sens dès 1951 avant même la vogue du rock and roll.
En 1959, le compositeur noir Berry Gordy fonde à Détroit dans le Michigan avec Smokey Robinson une maison de disques, Tamla Motown, dont les patrons sont noirs avec pour objectif de s’adresser au prolétariat noir en pratiquant « un jazz d’une grande simplicité et d’une grande efficacité sensualiste : le “rhythm and blues” » (Malson) dont le rock est une variante. Et cette musique rencontrera aussi le public blanc.

Ces musiciens de studio, ces « requins » comme on les appelle dans le jargon, les Funk Brothers pour ceux qui en connaissaient l’existence, et au premier rang James Jamerson qui avait créé une ligne de basse, faisaient, sous la coordination d’un arrangeur comme Paul Riser, l’identité sonore du label, le son Motown. Et quand les gens écoutaient les juke-box ou la radio, car Motown est devenue une des plus grandes machines à tubes, ils reconnaissaient la ligne de basse, la grosse caisse, le tambourin, le jeu des guitares, bref tout le dispositif sonore Motown.

Ainsi, ils expliquent comment avec un groove pareil, l’effet subliminal faisait que l’on se « sentait bien » à l’écoute de cette musique.
Bien sûr ces musiciens, s’ils rêvaient tous d’être Miles Davis, Charlie Parker ou Coltrane, même s’ils travaillaient à la Motown en partie pour des raisons alimentaires, étaient d’abord des musiciens de jazz. Et dans la perspective qui est la nôtre, ne pas tout réduire à l’exploitation, voire l’auto-exploitation du jazz, il est intéressant de dégager les passages, les transitions, les médiations vers un jazz populaire pour reprendre l’expression de Malson. La recherche du son Motown peut donc être envisagée comme une recherche appliquée où le jazz authentique serait la recherche fondamentale.
L’un d’entre eux, dans le DVD, raconte :
On aimait beaucoup jouer du jazz à l’époque [dans les clubs] et ce qu’on jouait, on le réutilisait en studio. On utilisait des accords joués la veille dans un morceau de jazz et on le plaçait dans les accords de la chanson. La chanson prenait une coloration imprévue. Mais les producteurs aimaient et c’était un tube.
Dans cet ensemble, l’arrangeur, interviewé, précise : « N’étant ni bassistes, ni guitaristes, ni batteurs, les arrangeurs apportaient juste une idée générale, un concept, ensuite ils laissaient faire les pros. » Les valeurs musicales attachées au son Motown sont l’énergie et la puissance. Et ce son évolue avec le progrès technique et l’arrivée régulière de nouveaux arrangeurs et compositeurs qui, par exemple en 1966, transforment sa qualité et le rendent plus sophistiqué. 1967 révéla la guitare et la pédale wah-wah de Jimi Hendrix. Également en 1967, c’est au funk de Sly Stone de conquérir le public. Fasciné par ces nouveaux sons, Norman Whitfield, producteur de Motown, associe à ses musiciens de studio (les Funk Brothers) des nouveaux venus : Wah-Wah Watson et Denis Coffey, renouvelant ainsi le son Motown, comme toute industrie doit se renouveler et faire évoluer ses recettes.
Motown c’est aussi à l’intérieur d’une maison de disque « noire » la collaboration de musiciens blancs. Il est rappelé dans le film que lors de la mort de Martin Luther King et des émeutes qui suivirent, alors qu’ailleurs d’autres musiciens de jazz noirs refusèrent de travailler avec des Blancs, Blancs et Noirs partagèrent le même deuil et restèrent amis chez Motown.

Pour un « amateur » de jazz, Motown, c’est une trahison par des Noirs américains eux-mêmes dans le sens d’une marchandisation et d’une commercialisation vers un renouvellement de la musique pop. Par ailleurs, on y apprend que certains des musiciens noirs de jazz avaient fait du piano classique, que Noirs et Blancs américains pouvaient collaborer étroitement, qu’en tout cas il y a avait eu une évolution. Qu’on ne pouvait s’en tenir au mythe simpliste de l’exploitation blanche de la musique noire sans pour autant nier les luttes, les souffrances. Nos collègues de civilisation américaines nous le rappellent : « l’Amérique » est plurielle.
L’exemple Motown peut sembler abonder dans le sens de ceux qui pensent en termes d’essence du jazz et de dévoiement par l’industrie du disque. Cependant, en complexifiant les choses, cet exemple oblige à repenser ces termes.
J’ai donc essayé d’éclairer les questions suivantes : comment le jazz « authentique » a donné naissance à un jazz « populaire » (notamment par la médiation du rhythm and blues) puis à une variété jazzy et au rock and roll, bref, à la nouvelle musique populaire américaine ? Et cette musique s’étant exportée, devenant celle de l’américanisation, comment le jazz « populaire » est-il devenu la bande-son de nos sociétés industrielles ? Poser ces questions n’est pas sans intérêt musical, psychologique, sociologique, politique et pas seulement économique dans notre champ interdisciplinaire. Et c’est pourquoi j’ai privilégié l’analyse du devenir du jazz pour ne pas tomber dans le piège de son essence, des racines et de l’origine.
Le nègre blanc
Réfléchir sur le devenir du jazz permet à nouveau d’interroger l’entrée par le son et non par l’image proposée pour aborder les industries culturelles, une entrée que nous avons déjà testée dans d’autres articles publiés dans la Web-revue. Et avancer que cette approche dégage le paradigme musical et formel de cette industrialisation ne va pas sans conséquences dont j’ai traité dans ces articles. L’analyse étant interminable, je ne conclurai pas, mais terminerai par une figure de rhétorique, déjà ancienne, caractéristique de ce devenir du jazz, une cristallisation de sa double dimension esthétique et politique. C’est aussi une manière d’expliquer qu’on peut aimer — ou non — le jazz tout en acceptant d’expérimenter les propositions théoriques d’un auteur critique qui donnent accès à des connaissances plus générales sur les industries culturelles.
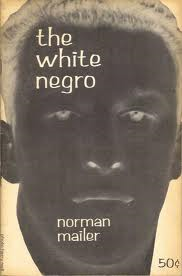
RÉFÉRENCES Pour fixer les idées sur cette variété jazzy, transposons en France avec Michel Legrand, Claude Nougaro du jazz et la java ou Michel Jonasz, au Je voudrais être noir de Nino Ferrer. T. W. Adorno avec la collaboration de George Simpson, « Sur la musique populaire », in Revue d’esthétique n° 19, Jazz (traduction française Marie-Noëlle Ryan, Peter Carrier et Marc Jimenez), 1991. T. W. Adorno : Philosophie de la nouvelle musique, Paris, Gallimard, « Tel » (traduction française Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg), 1962. Sur le free jazz, lire : P. Carles, J. L. Comolli, Free Jazz, Black Power, Paris, Gallimard, « Folio », 2000. Marc Hiver : « Le devenir du jazz comme paradigme musical et formel des industries culturelles » in Adorno et les industries culturelles -communication, musique et cinéma, Paris, L’Harmattan, collection « Communication et civilisation », 2010. Norman Mailer, « Le Nègre blanc », texte de 1957, in Publicité pour moi-même, Paris, Arléa (traduction française Gérald Arnaud), 1989. Lucien Malson, Histoire du jazz et de la musique afro-américaine, Paris, Seuil, 1994. Lire d’autres articles de Marc Hiver Philosophe, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, d’Adorno et des industries culturelles Dernier livre : « Adorno et les industries culturelles – communication, musique et cinéma »,
L’Harmattan, collection « communication et civilisation »