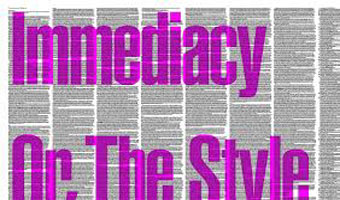L’obsession avec l’expérience individuelle – Un entretien avec Anna KORNBLUH
À l’occasion de la publication de son dernier livre, Immediacy: Or, The Style of Too Late Capitalism (Verso, London, 2024), très remarqué dans le monde universitaire anglophone, Anna Kornbluh a été interviewée par Daniel Zamora en mars 2024 pour la revue new-yorkaise Jacobin. Le titre fait écho au célèbre livre de Fredric Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (1991, traduit en français chez ENSBA, 2007). Cette fois-ci, cependant, le capitalisme tardif – concept qui s’applique à l’étape « fordiste » d’après-guerre, repris du classique Der Spätkapitalismus (1972) d’Ernest Mandel (traduit sous le titre Le Troisième Âge du Capitalisme, 10/18, 1976) – est « too late » (surtardif). Le terme « capitalisme tardif » se trouve aussi, avec un sens différent, dans les écrits d’Adorno et de Habermas. L’interview a été traduite par moi (DB).
Daniel Zamora : Votre livre commence par une discussion de la prolifération des expositions de tableaux supposément « immersives ». Que ce soit Vincent van Gogh, Frida Kahlo ou Claude Monet, de telles « expériences » surgissent partout dans le monde. On peut très bien aborder ce développement à partir d’une perspective économique. Ce genre de spectacle est moins cher et plus facilement reproductible qu’une exposition traditionnelle. Mais pour vous il y a autre chose qui se passe. Pourriez-vous l’élaborer ?
Anna Kornbluh : Mon livre essaie d’expliquer pourquoi il est devenu si difficile de représenter le présent. Il y a un sentiment général que les gens n’ont pas de temps pour l’art, qu’ils ne peuvent s’offrir le ralentissement de la pensée qu’exige la représentation. Si vous vous placez devant un tableau de Van Gogh, la signification de celui-ci ne va pas de soi : faut-il privilégier les chaussures sur le sol, l’angle de la perspective ou même le marché à l’époque pour la pigmentation jaune ? Ainsi, on est obligé d’analyser ce qui se trouve devant ses yeux.
Si vous prenez le cours Van Gogh du yoga immersif, le but recherché est la fusion sensorielle totale, et non la simple contemplation. On vend ce déplacement, de la contemplation à l’expérience intense, comme une libération, mais d’autres déplacements comparables sur les plans sociaux et économiques sont moins jubilatoires.
Dans ce genre d’exposition, l’accent est mis sur l’expérience, incarnée, sensorielle, submergeante. L’accent n’est pas mis sur l’œuvre d’art en tant que telle, ni sur les techniques par lesquelles elle est médiatisée, ni sur l’effet de contemplation qu’elle sollicite. La montée en importance de ce genre d’art s’explique, comme vous le dites, par le fait qu’il est peu onéreux. Vu d’un certain angle, cela fait partie du processus de démocratisation. Mais il faut aussi comprendre qu’on élimine ainsi l’appréciation du travail de l’artiste, et qu’il s’agit en fait d’un rejet profond de l’art lui-même.
Il ne faut pas oublier la dimension économique : l’élimination de l’intermédiaire est partie intégrante du modèle d’affaires qui prévaut au 21e siècle, du covoiturage au courtage en ligne. Les profits viennent davantage de l’échange que de la fabrication. Quand le style esthétique dominant embrasse les messages directs et l’accès instantané, il intègre de la sorte les rapports capitalistes au lieu de les critiquer.
DZ : Vous affirmez qu’aujourd’hui nous nous trouvons face à une crise, non de l’historicité, mais de la futuricité. Que voulez-vous dire par cela ?
AK : « Crise de l’historicité » est le terme employé par Fredric Jameson pour définir l’esthétique du postmodernisme. C’est une esthétique qui sort de leur contexte historique les techniques et les styles, et qui les mélange dans une forme de pastiche que Jameson voit comme une réponse au temps unifié de l’économie mondialisée. Je propose le terme « crise de la futuricité » pour un aspect de notre situation esthétique que le postmodernisme ne parvient pas tout à fait à décrire, à savoir la perte du futur – l’humanité se trouve face à la possibilité de son extinction forcée –, et au lieu de jouer avec le passé, le style esthétique dominant magnifie le présent et la présence.
La perte du futur est bien sûr inégalement répartie, mais elle implique néanmoins l’espèce dans l’ensemble. C’est une façon d’expliquer comment notre culture intensifie l’expérience émotionnelle ; dans l’art, le cinéma et la littérature, les expressions du chagrin, de la colère et du désespoir s’accentuent.
DZ : Votre livre essaie de relier un ensemble de développements économiques et esthétiques. De façon surprenante, vous faites une connexion entre les romans de Karl Ove Knausgaard, le film Uncut Gems (Joshua et Ben Safdie, 2019) et la performance de Marina Abramović, The Artist is Present. Qu’est-ce qu’ils ont en commun ?
AK : Ce qui se fait sentir dans ces créations, c’est la répudiation de l’épaisseur de la représentation, l’intolérance envers les messages indirects, et le refus de la médiation. La médiation, c’est l’activité sociale qui crée du sens, qui organise quelque chose dans un médium, et qui construit des liens entre objets, personnes et lieux, sans quoi l’art se défait, le monde devient incompréhensible, et tout mouvement collectif devient non viable. Dans ces exemples, la médiation est expressément rejetée.
DZ : La narration à la première personne est devenue le style littéraire dominant dans notre âge d’immédiateté. C’est un déplacement important. Pour la plupart de ses 300 ans d’existence, le roman a été généralement écrit à la troisième personne. Que signifie ce changement et comment l’expliquer ?
AK : Mon livre a ses origines dans la tentative d’examiner les changements dans le style littéraire, et comment ceux-ci semblaient répondre à un déplacement culturel plus large. Dans l’histoire du roman anglophone, la fiction est majoritairement écrite à la troisième personne. Celle-ci est le mode grammatical non seulement de l’expérience spéculative de l’omniscience, mais aussi d’un sens de fictionnalité elle-même ; ce, parce qu’elle construit des perspectives contre-factuelles à travers des temps et des espaces divers, ce à quoi l’expérience individuelle est totalement incapable.
La troisième personne rend possible le discours indirect libre, une façon de mélanger les pensées d’esprits différents qui est unique au roman. Nulle part ailleurs ne peut-on accéder à des pensées collectivement partagées (c’est ce qui les rend « libres », car elles n’appartiennent à personne).
C’est cette troisième personne, ce mode magique, qui semble s’éteindre : les romans anglophones au 21e siècle sont majoritairement écrits à la première personne. C’est un évènement radical dans l’histoire de la littérature qu’il faut expliquer. Pourquoi rejeter la capacité unique de la conscience fictive ? Pourquoi, en démantelant explicitement la narrativité en tant que telle, tant de romanciers contemporains rejettent-ils explicitement les notions de personnage, d’intrigue ou de durée, associées à la forme du roman ?
DZ : Cela explique aussi la prolifération des mémoires et des essais personnels.
AK : J’essaie d’aborder cette question dans un chapitre où je me penche sur les transformations dans les industries médiatiques comme le journalisme, l’édition littéraire et les réseaux sociaux, aussi bien que dans l’université. Dans ces domaines, j’examine les conditions économiques derrière la créativité.
D’après le New York Times, les ventes des mémoires ont augmenté de 400 % dans ce siècle par rapport au précédent. En même temps, l’essai personnel prédomine en tant que mode peu cher et déqualifié de journalisme et de génération des contenus. En plus, il y a eu une dynamique connexe : l’hégémonie d’une perspective épistémologique affaiblie. Cette théorie, qui privilégie un savoir façonné par la perspective du sujet, a été développée initialement pour faire avancer la cause des travailleurs, des féministes, des queers et d’autres minorités. Dans la culture actuelle, cependant, elle fournit une justification pour l’hostilité envers l’abstraction et l’idée d’un savoir universel.
DZ : Vous êtes assez critique de ceux qui voient la montée de l’autofiction et des essais personnels comme une sorte d’« épidémie de narcissisme » alimentée par les réseaux sociaux.
AK : Certains critiques culturels et certains professionnels de la santé mentale expliquent cet agrandissement du moi comme une épidémie de narcissisme. Certes, des tendances antisociales dans notre société sont manifestes. Mais expliquer la production culturelle contemporaine à travers un prisme psychologique ou moralisateur n’est pas suffisant.
D’abord, la psychologie n’est pas isolée du reste de la société ; la culture, l’économie et la technologie jouent un rôle important en structurant les symptômes et les désordres. S’il existe réellement une inflation du moi et de l’image de soi-même, il faudrait néanmoins le relier à l’écologie des médias, et à l’idéologie dominante du capital humain et de l’entrepreneuriat (bootstrapping), ainsi qu’au démantèlement des institutions sociales nécessaires à la vie quotidienne, comme l’éducation publique.
Ensuite, il ne suffit pas de décrire notre culture comme narcissique, car les formes de priorisation du soi qu’on peut remarquer dans les œuvres d’art s’accompagnent de l’évidement de la médiation. Quand on attaque le sens collectif, le sens donné par l’individu émerge à sa place. Et si la médiation est perturbée, surgit ce qui semble immédiat – l’expérience, la vie personnelle, le corps. Mais c’est l’attaque, la perturbation – ce qu’on appelle dans le monde des affaires la « désintermédiation » – qui est le facteur déclencheur.
DZ : Vous semblez relier ce développement esthétique avec celui, plus large, de l’évolution de la sphère politique pendant les dernières décennies. Le « moment populiste » s’accompagne du désir croissant d’éliminer l’intermédiaire. Le présent est moins caractérisé par la médiation des partis de masse et des syndicats que par des soulèvements spontanés et des mouvements. La conséquence est la désintermédiation du politique, avec des formes d’appartenance moins structurées et moins durables. Diriez-vous que ces deux tendances sont liées ?
AK : Absolument. Identifier l’immédiateté comme style culturel implique de relier les arts au savoir et à l’économie aussi bien qu’au politique. Les arts sont habituellement l’arène par excellence de la médiation. C’est sans aucun doute le fait que les « œuvres » particulières ont des contours définis et des limites qui facilitent l’analyse. Par contraste, il est plus difficile de construire un objet d’étude rigoureux dans la sphère politique.
C’est probablement ma formation en esthétique qui parle ici. Il est peut-être plus facile d’analyser le rejet de la médiation dans un poème ou dans une série télévisée que dans le mouvement général vers le populisme. Cela dit, mon livre essaie de montrer que le style d’immédiateté gouverne la préférence tactique (et idéologique) de la gauche pour des structures horizontales, du localisme, de la spontanéité anarchiste, de l’antisyndicalisme, et de l’absence d’organisation disciplinée, remplacés souvent par des cultes charismatiques, des opinions virulentes et de l’anti-institutionnalisme. Ces tendances se manifestent et à gauche et à droite. Des analyses importantes de ce phénomène ont été produites ces dernières années ; j’espère que quelqu’un écrira une étude compréhensive de l’immédiateté dans la sphère politique.