Actualités des industries culturelles et numériques #50, février 2017
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et numériques du côté des acteurs professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante.
Vous êtes entre 80 et 90 (parfois un peu plus, parfois un peu moins) à lire les Actualités tous les mois, chiffre modeste, mais appréciable, même si – et c’est frustrant – je ne sais pas qui vous êtes (étudiant, professionnel, collègue), quelles études vous faites ou avez faites. Est-ce suffisant pour justifier l’effort consenti chaque mois pour alimenter une rubrique qui ne compte pas dans les bilans de recherche universitaire ? Écrivez-moi donc (drbuxton@yahoo.com) pour donner votre avis sur ses insuffisances, ou pour me rassurer quant à ses aspects utiles ou, encore mieux, me proposer une idée d’article, éventuellement tirée d’un mémoire ou d’une thèse. De mon côté, le but a toujours été de résumer l’actualité des industries culturelles (y compris l’Internet et les réseaux sociaux, « industries numériques ») sous la forme d’articles courts, rationalisés par rapport à la source, qui privilégient d’une part, les données factuelles d’un secteur en évolution (autant que faire se peut en chiffres), et d’autre part, les points de vue parfois contradictoires des acteurs sociaux, qu’ils soient économiques ou politiques. Autrement dit, un bouillon de culture en la matière.
Je tiens à suivre l’évolution des industries culturelles sans idées préconçues, en dehors de l’approche critique au sens large de l’École du Francfort. La Web-revue voudrait actualiser celle-ci, et la remettre à l’épreuve d’un capitalisme (très) « tardif », dans un premier temps par un travail empirique. La partie documentée des articles de la rubrique s’appuie en grande partie sur la lecture des pages économiques du Monde, et des Échos, bien faites si on fait abstraction du néolibéralisme bien trempé des éditorialistes. Dans le cas des Échos, je bénéficie de l’assistance de mon ami Adrian Ponze, enseignant-chercheur en lettres à l’université de Trelew (Argentine), qui m’envoie régulièrement des liens aux articles mis en ligne, organisés en catégories. De façon régulière, je résume des articles publiés dans des revues professionnelles américaines comme Advertising Age. Autant que possible, j’essaie d’apporter une plus-value informationnelle, en rajoutant des détails économiques ou sociologiques trouvés dans d’autres sources.
Détachés par un cadrage, les commentaires critiques, qui n’engagent que moi, et qui ne sont pas systématiques, se veulent aussi être une plus-value apportée à l’information de base, une mise en lumière de la dimension sociale et politique de celle-ci. Bref, il s’agit de donner un point de vue universitaire, qui n’est pas neutre (loin de là !), mais qui a la possibilité de prendre de la distance. Le but implicite est de transformer un compte-rendu factuel en débat d’idées. Pour marquer son 50e numéro, cette rubrique, inaugurée en novembre 2012, prendra exceptionnellement une forme différente : une sélection (best of) des commentaires critiques anciens, traitant des sujets variés, que je remets en jeu*.
*Les mots placés entre parenthèses carrées représentent des petites corrections par rapport à l’original. J’ai aussi rajouté des liens pour les noms propres.
Contenu
Le cinéma des blockbusters (mai 2013), Actualités #9
La référence en termes de rentabilité (recettes de 1,5 milliard $ pour un coût de 220 millions $) pour les blockbusters action hero reste The Avengers (2012), qui a également fait figurer les héros des comic books Marvel. Le budget initial d’Iron Man 3 (140 millions $) a été porté à 200 millions $ dans l’espoir de capitaliser sur ce succès (en fait les recettes mondiales du film ont atteint 1 milliard $ vers mi-mai). [Suit un tableau détaillé des recettes des blockbusters historiques sur la page originale].
Le coût de production moyen pour ce genre de film se situe désormais – augmentation sensible depuis lé début de la décennie 2000 – dans une fourchette de 150 à 200 millions $, ce qui ne garantit pas son succès. Celui-ci tient à un facteur indéfinissable : non seulement faut-il atteindre une masse critique de recettes aux États-Unis (au moins deux fois les coûts initiaux), mais doubler ensuite ce chiffre sur le marché « international », avec des variantes de partage. Bref, à partir d’une mise de 200 millions $, le but est d’atteindre des recettes globales d’un milliard $. (Remarquons en passant le remarquable tir groupé de la saga Seigneur des Anneaux entre 2001 et 2003, doublant presque ce rapport « magique » de 1:5). Peu de films atteignent ce jackpot, mais même en deçà le blockbuster est un produit assez rentable (malgré un « navet authentique » dans le lot, Green Lantern (2011)) ; en plus des recettes provenant des entrées en salle, il y a les marchés de télévision, de DVD, et de produits dérivés. Contre cela, il faut compter les frais de promotion, qui peuvent monter jusqu’à la moitié des frais initiaux. Le problème pour les producteurs peut se résumer ainsi : comment faire un produit qui plaît d’abord (massivement) à un public américain, mais encore plus à un public non américain, étant donné que le premier public n’est plus de taille suffisante pour en assurer (vraiment) la rentabilité ?

Finalement, il faut noter que l’expansion « horizontale » du blockbuster (dans les marchés internationaux) se fait au prix d’une pénétration « verticale » relativement étroite : le cœur de cible est le jeune mâle de vingt ans.
Tagger des marques et des personnalités sur Instagram (Facebook), juin 2013, Actualités #10
Le business model d’Instagram commence à prendre forme, et dépendra massivement de l’utilisation de célébrités sous contrat à des marques. Le lien entre les industries culturelles et l’industrie publicitaire est de plus en plus étroit. Les industries culturelles (auxquelles il faut ajouter celle du sport professionnel) deviennent un filon illimité d’où l’on peut puiser de futurs supports publicitaires incarnés ; autrement dit, les industries culturelles tendent à devenir un simple tremplin qui permet aux stars d’exploiter dans le marché plus lucratif de la publicité des marques une célébrité déjà acquise en tant que comédien ou chanteur. Pour Yves Citton, professeur de littérature à l’université de Grenoble-3, « Toute œuvre d’art dépend en effet pour sa circulation d’une économie d’attention, qu’elle contribue à reconditionner en retour. Si l’économie « classique » (celle qui optimise les choix en fonction de la rareté des marchandises matérielles et de la production de services) a toujours régi le destin des œuvres, celles-ci ont de tout temps inventé des façons innovantes de traiter cette rareté qu’est l’attention – rareté perpétuelle de l’attention, puisque la vie humaine a toujours été trop courte, mais rareté nouvelle dans la mesure où la multiplication des ressources culturelles disponibles grâce aux réseaux numériques accroît de façon exponentielle le « coût d’opportunité » de tout choix attentionnel » (« L’Économie de l’Attention », La Revue des Livres, 11, mai-juin 2013, p. 74, site ici). La célébrité, désormais fabriquée industriellement et à de multiples échelles, devient un moyen non seulement de structurer l’intervention publicitaire sur les réseaux sociaux, mais aussi d’optimiser cette rareté qu’est « le choix attentionnel » du consommateur, sollicité maintenant en permanence. La mesure marchande d’une célébrité, dorénavant, c’est le nombre de followers, et non les ventes ou les entrées.

À ce propos, il faudrait parler de Kim Kardashian [14,2 millions de followers, 7ème au monde derrière Lady Gaga, 21,3 millions] ; nulle part au monde peut-on y échapper, même si l’on ne lit pas la presse people. Toutes proportions en silicone respectées, l’équivalent français serait quelqu’un comme Nabilla (Les Anges de la téléréalité sur NRJ12), dont la carrière, semble-t-il, soit déjà grillée après des révélations sur son passé (300 000 followers actuellement, loin derrière le champion français, le DJ David Guetta avec 8,4 millions). En attendant une éventuelle suite, une séquence culte, détournée par Ikea, Oasis et Dia dans des spots publicitaires, mais elle-même le simple calque d’un idiome américain usuel depuis au moins dix ans (ce qui n’a pas empêché mademoiselle de le déposer à l’Institut national de la propriété industrielle le 11 mars), a déjà été vue par 2,1 millions d’internautes. Son père, Algérien, qui l’a reniée et vice versa, est fonctionnaire de l’ONU à Genève. Kim Kardashian (née en 1980), fille de l’avocat Robert Kardashian qui a défendu avec succès le footballeur et acteur O.J. Simpson, accusé du meurtre de sa femme et de l’amant de celle-ci, apparaît depuis 2007 dans un reality show, Keeping Up with the Kardashians, où les membres de la famille élargie jouent leurs propres rôles [de shoppers acharnés], sur la chaîne câblée E!, renouvelé en 2012 pour 40 millions $. Elle a eu des relations avec le producteur de musique Damon Thomas (2000-04), le rappeur Ray J. (2006) avec qui elle réalise une sex video, et le footballeur Reggie Bush, 2007-10. Son mariage avec le basketteur Kris Humphries en 2011, hystériquement couvert par tous les médias américains, n’a duré que 72 jours (les mauvaises langues affirment qu’il s’agissait d’un coup de publicité) ; en 2012, elle annonce qu’elle est enceinte du rappeur Kanye West. Nouvelle hystérie médiatique.

Entre-temps, elle a lancé avec ses deux sœurs la Kardashian Kollection, une marque de vêtements pour la grande société de distribution Sears, ainsi que cinq parfums et une ligne de cosmétiques. Ses atouts ? Une physique avantageuse, un égocentrisme hors du commun, et un parcours bien calculé. Force est de reconnaître que le phénomène Kim Kardashian pose problème pour l’analyse critique, qui aurait tendance à n’y voir que de la décadence, du vide existentiel du capitalisme tardif et de ses images du rêve américain faisandées. Remarquons simplement qu’elle représente le prototype de célébrité qui a réussi à s’imposer dans le commerce des marques personnelles, sans avoir eu à faire des preuves artistiques réclamées, du moins en principe, par les industries culturelles (voir aussi Actualités #2»). Il est vrai que de réelles compétences créatives demandent un investissement en temps démesuré, sans le moindre garanti de retour. Déjà, le talent réellement artistique de célébrités musicales « fabriquées » sur mesure comme Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears ou, dans un autre registre, David Guetta est extrêmement discutable, pour ne pas en dire plus.

L’incarnation à l’excès d’une vie entièrement consacrée au narcissisme consumériste (mais avec un sens aigu des affaires) fait que Kim Kardashian et d’autres revendiquant avec fierté leur inculture totale soient souvent plus en phase avec le consommateur ordinaire qu’un « vrai » chanteur ou acteur (voir la réception mitigée de la vidéo de Nicole Richie, fille du grand chanteur des variétés des années 1970, Lionel Richie). Il faudrait faire une étude dans plusieurs pays de l’origine sociale de ce genre de célébrité, qui joue un rôle important dans la reproduction idéologique (et même économique) du capitalisme tardif. On pourrait avancer l’hypothèse (à confirmer, à infléchir ou à infirmer) que le « personnage-marque » soit le prolongement de l’animateur de télévision analysé par Sabine Chalvon-Demersay et Dominique Pasquier dans leur livre classique, Drôles de stars, la télévision des animateurs (Aubier, 1990), qui fait le constat d’un grand écart chez cette catégorie entre les origines sociales relativement aisées (voire bourgeoises) et le niveau d’études (très) médiocre, le prototype français étant Michel Drucker.
Débat entre producteurs, [scénaristes] et chaînes de télévision (janvier 2014), Actualités #16

L’incapacité supposée des Français à faire aussi bien que les Américains (ou les Britanniques) en matière de télévision est un vieux serpent de mer. Il est intéressant de noter que Canal+ et la Guilde des scénaristes s’accordent pour louer le modèle américain, qui manifestement n’a pas le même sens pour tout le monde. Ce qui est nouveau, c’est la charge explicite contre les scénaristes, accusés de déficit d’esprit collectif, ce qui est fort de café venant d’un diplômé d’HEC. [Le discours] de Rodolphe Belmer [à l’époque, directeur-général du groupe Canal+, avant d’être viré en janvier 2015], qui brasse des clichés, rejoint les attaques historiques des élites contre le prétendu passéisme des Français, critique « culturaliste » (« les Français sont ainsi ») qui prétend pointer l’origine sociale et historique des tares, souvent contradictoires, de la mentalité française (tantôt trop attachée à l’État, tantôt trop individualiste). À vrai dire, ce type de discours moraliste […] a une visée purement stratégique ; il s’agit de mettre sur le défensif les scénaristes afin d’affaiblir le statut dont ils bénéficient actuellement. Un des arguments de Belmer est déloyal : personne ne songerait à demander à un seul scénariste d’écrire une saison entière. La réaction de la Guilde pointe un autre problème, plus sérieux : l’absence de coopération en France entre scénaristes, réalisateurs et producteurs.

Le travail en équipe à l’américaine, tant vanté par Belmer, est une collaboration hiérarchisée où les membres de l’équipe ont des statuts différenciés : certains jouissent des droits d’auteur, d’autres sont pigistes et corvéables à merci (voir le livre très riche de l’ethnologue et ancien professionnel de la télévision John T. Caldwell, Production Culture, Duke University Press, 2008). Les scénaristes « font équipe » aux États-Unis comme les managers et les ouvriers « font équipe » dans une usine en France ; en ce sens, la charge de Belmer vise plutôt à faire soumettre davantage un corps de métier à la discipline hiérarchique et aux impératifs économiques. Cela dit, il y a beaucoup à dire sur les faiblesses objectives de la production télévisuelle française. Selon Jean Bianchi, déjà en 2000 (CinemAction, 57, p. 100), « ce qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles,
Le streaming, c’est la radio du XXIe siècle, mars 2014, Actualités #18
Sommes-nous condamnés à la musique « au kilomètre », sans valeur ? Il y a beaucoup à dire sur la lente agonie de l’industrie musicale. Comment valoriser la production musicale dans l’ère de la technologie numérique qui dématérialise les anciens supports, et rend tout son patrimoine accessible en ligne, légalement ou non ? L’industrie n’a pas à ce jour trouvé de réponse. Jean-Michel Jarre va jusqu’à entériner l’idée que l’accès à la musique en ligne sera gratuit, et qu’il faut en chercher d’autres formes de valorisation. Si le consommateur ne veut plus payer pour pouvoir écouter tel morceau de musique choisi, force est de conclure que sa valeur (en termes monétaires) est devenue faible ou nulle. Même si l’on ne cherche plus à imputer les difficultés de l’industrie aux seules nouvelles technologies, la recherche de solutions reste confinée à une approche purement économique. Dans le constat de l’effondrement de la valeur de la musique enregistrée, on n’évitera pas la question d’une perte de « qualité », terme qui semble a priori condamné à l’affirmation subjective. On peut, cependant, objectiver cette perte, en comprenant la valeur d’usage de la marchandise culturelle comme un facteur variable (voir « Le rock, chapitre 1 » dans la web-revue).

Le déclin dans la valeur d’usage du support musical se manifeste formellement par l’épuisement de la musique rock et ses dérivés, comme peuvent en témoigner des analyses musicologiques qui mettent en évidence son adhérence continue à une tonalité classique et pauvre, son absence de liens créatifs avec une avant-garde, elle-même exsangue ; sociologiquement par le déclin parallèle de la presse spécialisée, et des « contre-cultures » organisées autour d’une forme musicale ; et techniquement par le remplacement du CD par le format MP3, fortement compressé et manquant de dynamique (typiquement, une différence de 6 décibels entre les sons les plus forts et les plus faibles, par rapport à 17 décibels dans le cas (testé devant moi par le compositeur Jean-Baptiste Favory) de l’album vinyle Harvest (1972) de Neil Young, qui milite aujourd’hui pour une nouvelle norme numérique). Le niveau de compression actuelle flatte les oreilles dans un premier temps, mais rend monotone et lassant l’écoute d’un album en entier (voir l’article de Florent Aupetit dans la web-revue). On pourrait ajouter aussi dans cette perte de valeur l’importance prise du « capital mort », représenté par des programmes d’assemblage de sons (pre-sets) et par des échantillonnages, qui remplacent 
Schématiquement, on voit deux « solutions » proposées au sein de l’industrie. D’abord, la mise en place de plateformes de streaming payantes plus équitables dans l’espoir qu’on changera radicalement son comportement vis à vis de la musique en ligne. Mais même dans un scénario optimiste, les sommes qui en seraient issues, monopolisées comme à présent par quelques artistes, risquent de rester négligeables pour la plupart des titres, malgré l’égalité d’accès promise. La solution préconisée par Jean-Michel Jarre, plus ambitieuse, revendique une part de la valeur boursière des plateformes et des technologies numériques. Mais la centralité de la musique populaire de nos jours dans le succès de celles-ci est très contestable ; est-ce vrai qu’un smartphone ne vaudrait que 100 euros sans accès aux plateformes musicales ? Le second problème, plus grave, est que cette valeur boursière, complètement détachée du chiffre d’affaires dans l’économie réelle, est « virtuelle », et ne sera en toute probabilité jamais réalisée (voir « Actualités #15 »).
A lire : Fabien Granjon, Clément Combes, « La numérimorphose des pratiques de consommation musicale », Réseaux, no. 145-46, 2007.
L’overdose des super-héros, juin 2014, Actualités #21


Au cours d’une interview sur Canal+ le mois dernier, Michel Gondry, qui a tout de même réalisé Le Frelon vert, a qualifié le film de super-héros de fasciste. La Lanterne verte pourrait bien mériter ce qualificatif avec ses références visuelles aux rallyes de Nuremberg (voir ci-dessous), immortalisés par la cinéaste nazie Leni Riefenstahl dans son ignoble mais brillant Le Triomphe de la volonté, dont l’esthétique fournit toujours la tonalité en la matière. Mais même-là, ce serait oublier à quel point ces films, déjà (ré-) interprétés d’avance dans un sens parodique, [s’arrangent pour ne pas être pris] au premier degré. Gondry va discutablement un peu trop vite en besogne, même si on peut admettre que les films de justicier (genre auquel appartiennent les super-héros) ont un aspect a priori régressif. Mais d’un point de vue idéologique, les produits culturels de masse, d’autant plus qu’ils soient internationaux, sont complexes, ambigus et ouverts à plusieurs lectures. Dans le cas des films de super-héros, cette complexité vient d’abord du fait qu’il s’agit de personnages de comic books datant de l’époque 1938-70 (avec une deuxième génération plutôt décalée), transposés dans les années 2000 dans un contexte différent, mais où les valeurs victorieuses de la Guerre de 1939-45 sont conservées. Certains d’entre eux comme Captain America et Wonder Woman sont nés dans un décor explicitement antinazi, qui a été reproduit dans les adaptations ultérieures. Objet d’une série télévisée kitschissime des années 1970, Wonder Woman est même devenue, contre toute attente, une icône gay. Autant dire qu’une analyse du phénomène des super-héros n’est pas si facile à faire que cela, et que ce serait tomber dans la facilité de les voir comme un simple reflet des années 2000.

On ne peut analyser la charge idéologique de ce genre de film sans prendre en compte sa dimension formelle, qui pour Adorno relève du contenu sédimenté (voir l’article dans la Web-revue de Marc Hiver), autrement dit de l’idéologie figée. Le recours massif aux images de synthèse dans le film blockbuster est aussi une contrainte en termes de développement thématique (il faut que ça pète et que ça bastonne), et aussi d’approfondissement psychologique (généralement exclu, en dehors de scènes assez navrantes dédiées à cet effet) ; le mariage entre super-héros et images de synthèse semble donc tout indiqué pour accommoder la faiblesse narrative qui en découle. Sans prétendre faire une vraie analyse de ce genre de film, faute d’avoir effectué des recherches approfondies, je vois au moins deux pistes à suivre (en intégrant les discours médiatiques qui s’y attachent comme des coquillages à un rocher, et qui font donc partie de l’objet d’étude).

a) les ressorts psychologiques de ce genre de personnage sont a priori simples : dans le schéma de base, un homme chétif (et doté probablement d’un micro-pénis) se transforme en être sur-musclé (Captain America). Dans des variantes, il s’agit de timidité maladive (Superman), d’expériences scientifiques avec des conséquences malheureuses ou inattendues (Spiderman, Hulk), de traumatismes d’enfance (Batman), ou de sur-reconstructions artificielles de grands blessés (Iron Man). On est bien dans un fantasme primitif d’impuissance et de sur-puissance déplacé sur un terrain non sexuel, la présence des femmes confinant logiquement à la mièvrerie. Mais à la différence de la science-fiction classique, et même des sagas comme Le Seigneur des anneaux, où la dimension fantasmatique est davantage sublimé, celle-ci est désormais à nu, à peine habillée. Quelle est la signification de la ré-inscription de ce genre de fantasme à ciel ouvert dans le contexte socio-politique d’aujourd’hui, où la prétention d’un super-héros d’adresser par la force physique les problèmes que doit affronter l’humanité (le réchauffement de la planète par exemple) est dérisoire ?
b) ces films sont populaires non seulement chez les adolescents aux États-Unis, mais aussi chez les Chinois, jeunes et moins jeunes. On peut voir en les super-héros du cinéma une étape de plus dans l’avatarisation à l’échelle internationale des personnages. Qu’y voit le public chinois ? Sûrement pas la preuve de la supériorité de la culture américaine. Autrement dit, le soft power (l’influence géopolitique acquise par la séduction culturelle et non par la force ou la menace implicite), si important dans les cas du cinéma hollywoodien, du jazz et du rock, s’opèrerait moins qu’avant. L’industrie de cinéma américaine ne risque-elle pas de devenir l’amuseur attitré d’une planète en perdition, voire son bouffon ? Ne faut-il pas voir dans le manque de dimension psychologique dans ces films désormais internationaux, la traduction effective de la tendance dans le capitalisme tardif à la marchandisation de tous les rapports sociaux ?
Je parle du phénomène des blockbusters en général (avec résultats au box office) dans « Actualités #9 ». À lire pour le fondement théorique de ce commentaire (chercheurs confirmés et doctorants) : Fredric Jameson, « Méta-commentaire » (1971) dans L’inconscient politique, Questions théoriques, 2012 (publication originale 1981). Voir http://www.contretemps.eu/culture/fredric-jameson-mode-demploi-0, et l’article de Thierry Labica ici dans la web-revue.
La montée en puissance des bases de données, et la mort de la politique, sept. 2014, Actualités #23

La dystopie dont parle Evgeny Morozov n’est pas pour l’avenir, elle frappe déjà à la porte. À l’université, qui existe de moins en moins comme lieu de débat et de critique sociale, on vit déjà l’alignement au marché à travers la généralisation de la recherche par projets fléchés (qui relèvent de l’expertise positiviste), la réorganisation en « machins » pour améliorer la « performance » dans d’absurdes classements internationaux (où ce sont toujours les Américains qui gagnent), et le financement conditionné par des indicateurs chiffrés (partenariats avec le secteur privé, insertion professionnelle, cours numériques disponibles en ligne, etc.). Bref, la gouvernance par la mesure, déjà aliénante, et qui n’est qu’à ses débuts.
Reste une question qui resurgit chaque fois que je lis Morozov. La force de sa critique ne fait aucun doute, mais d’où parle-t-il ? La cible n’est pas convenue – les partisans de l’open data – et il faut savoir gré à lui pour cela ; le danger pour la démocratie viendrait des capitalistes new age dans la tradition californienne, où le néolibéralisme, marqué par la pensée libertaire, a historiquement assimilé la contre-culture des années 1960. [Le gourou du monde d’informatique] Tim O’Reilly [fondateur d’O’Reilly Media], qui a grandi à San Francisco, n’est pas une exception ; manifestement influencé par McLuhan et par le mystique catholique Teilhard de Chardin, il croit que l’Internet deviendra une espèce de « cerveau mondial », le système nerveux de la Terre.

À un moment, en passant, Morozov fait référence aux « critiques de gauche de l’État providence – notamment Michel Foucault – [qui] avaient raison de mettre en question ses tendances disciplinaires ». Ailleurs, il reconnaît que « même les gouvernements de gauche n’ont qu’un espace limité pour des manœuvres fiscaux, car les dépenses discrétionnaires requises pour moderniser l’État providence ne seraient jamais approuvées par des marchés financiers globaux. Et c’est les agences de notations et les marchés d’obligations – pas les électeurs – qui décident de nos jours ». La référence favorable à Michel Foucault semble situer Morozov dans le courant des « critiques de gauche de l’État providence ». Mais à quoi pourrait ressembler une critique de gauche de l’État providence lui-même (et non simplement la bureaucratisation de celui-ci) ? Comme Foucault, Morozov est hostile au socialisme traditionnel (il a grandi dans la Biélorussie, pays autoritaire qui a gardé beaucoup de traits de l’économie soviétique, même après la chute de cette dernière), et dans son livre To save everything, click here [1], il assimile les régimes communistes au « solutionnisme » technologique. Mais le côté « totalisant » de son discours (qui constate la domination écrasante des marchés sur les processus démocratiques), et le ton implacable relèvent bien d’une critique classique du néolibéralisme. Pour cette raison, un intellectuel affilié à la tradition libérale « régulationniste » comme Tim Wu a traité Morozov de « réactionnaire ».

L’analyse par Foucault de l’État providence dans le séminaire Naissance de la biopolitique (1978-79), publié en 2004, est de toute évidence controversée. L’exposé du néolibéralisme, présenté comme une pensée qui accompagne une étape de capitalisme qualitativement différent, est d’une acuité remarquable, mais nulle part s’agit-il d’une critique de celui-ci. Au contraire, ce qui constitue l’objet de la critique, c’est plutôt le socialisme (même démocratique), qui est sommé à choisir entre gouvernementalité libérale et régime hyper administratif. Si on peut parler ici d’une critique de gauche, c’est par pur nominalisme. Comme le démontre Isabelle Garo (Foucault, Deleuze, Althusser & Marx, Demopolis, 2011, pp. 150-79), le contexte politique du séminaire de Foucault, c’est son rapprochement avec Michel Rocard et la CFDT (la deuxième gauche), et le constat des « effets pervers » de la Sécurité sociale, institution qui « augmente la dépendance », et qui est de toute façon en « déclin ». L’analyse est prolongée par l’ouvrage classique de son assistant et disciple François Éwald, L’État providence (Grasset, 1986), qui a théorisé la société assurantialiste décrite ci-dessus, et dont l’orientation néolibérale ne fait pas de doute. Il s’agit d’une critique qui prépare en somme le tournant socio-libéral des partis socialistes européens qui, au nom du réalisme économique, ont pratiquement capitulé aux forces du marché.

Contre tout cela, Geoffroy de Lagasnerie, venant de la gauche libertaire, propose une défense subtile et stimulante de Foucault (La dernière leçon de Michel Foucault, Fayard, 2012) dans laquelle il nous invite à lire l’analyse de Foucault comme une expérience dans la pensée ouvrant à d’autres perspectives pour une approche radicale qu’à celle de la déploration impuissante pratiquée par les critiques du néolibéralisme, prisonniers eux aussi de l’économisme qu’ils décrient. Mais une analyse des rapports de force économiques propres au capitalisme financier brille par son absence dans l’argumentaire de de Lagasnerie. La référence de Morozov – qui semble penser plutôt à Surveillir et Punir – à Foucault fonctionne comme un point de tension touchant à la pensée libertaire elle-même, qui se présente comme une force d’émancipation et d’oppression en même temps ; le néolibéralisme de la Silicon Valley, qui n’a que faire des entraves sociales et morales à la libre entreprise, s’annonce libertaire (anti-raciste, anti-sexiste, anti-homophobe, favorable à l’immigration libre et à la légalisation du cannabis, et … pro-open data). Alors est-ce que la sortie du capitalisme passe par la voie des rapports sociaux ou des rapports économiques ? Par la réforme ou par la révolution ? Par une critique de l’État ou du capital ? Par l’analyse d’un système, ou des micro-pouvoirs partiels ?
Les deux évidemment, dans une synthèse qui sera difficile à faire dans la conjoncture actuelle ; toute pensée qui jouerait systématiquement un pôle contre l’autre serait non dialectique, et ne pourrait saisir la complexité d’un objet d’étude en sciences sociales. Car, en parlant de totalité, il ne s’agit pas de cerner un système en bloc, mais de comprendre une logique (du capital) à l’œuvre partout, de manière contradictoire et avec des intensités différentes, non seulement dans une société donnée, mais dans un système-monde. Quelques phrases de Morozov dans un article publié dans Le Monde diplomatique (août 2014) semblent passer outre le faux choix entre changement partiel et total : « Pour concevoir l’information autrement, il faudrait commencer par l’extraire de la sphère économique. Peut-être en la considérant comme un « commun », notion chère à une certaine gauche radicale. Mais il serait auparavant fort utile de se demander pourquoi l’on accepte comme une évidence la marchandisation de l’information ».
L’article de Morozov vise explicitement un certain type de discours « critique » qui réalise l’alliance indue de culturalisme et de cognitivisme :
Critiquer la Silicon Valley revient à passer pour un technophobe, un benêt nostalgique du bon vieux temps d’avant l’iPhone. De même, toute critique politique et économique formulée à l’encontre du secteur des technologies de l’information et de ses liens avec l’idéologie est instantanément galvaudé en critique culturelle de la modernité. […] A cet égard, les lamentations incessantes de la culture engendrée par Twitter et les livres électroniques sont calamiteux. Au début du XXè siècle, le philosophe Walter Benjamin et le sociologue Siegfried Kracauer considéraient les problèmes posés par les nouveaux médias à travers un prisme socio-économique. Aujourd’hui, il faut se contenter des réflexions d’un Nicolas Carr, obsédé par les neurosciences, ou d’un Douglas Rushkoff, avec la critique biophysiologique de l’accélération. Quelle que soit la pertinence de leur contribution, leur mode d’analyse finit par découpler la technologie de l’économie.
[1] Traduction française qui vient de paraître : Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, éditions FYP, Limoges.
De la réalité virtuelle ou le paradis des geeks, oct. 2014, Actualités #24
Écartons d’emblée la polémique naissante concernant les effets sur la santé de la réalité virtuelle ; sauf épidémie de crises cardiaques, celle-ci ne fera pas long feu, et au pire sera résolue par un avertissement, comme sur les paquets de cigarettes. Plus intéressant est le débat sur la question de l’empathie sociale ou du manque de celle-ci, car les deux camps sont ici représentés par la même génération. Ce genre de discussion, qui postule, pour le meilleur ou pour le pire, une transformation de la condition humaine, a toujours accompagné l’émergence d’une nouvelle technologie de masse dans le domaine culturel. La démocratisation de la télévision aux États-Unis pendant les années 1950 suscita chez l’élite des prévisions hystériques sur la baisse du niveau scolaire, la montée de la délinquance et de la décadence morale, et d’autres effets néfastes comme l’évasion de la réalité ! Contre cela, dans la décennie suivante, Marshall McLuhan tordit le bâton radicalement dans l’autre sens en prétendant que la télévision serait, par ses propriétés formelles indépendamment des contenus, une force progressiste qui œuvrait dans le sens d’une culture mondiale commune. On retombe sur les même débats, à quelques nuances près, dans le cas de la musique rock, et une génération plus tard, dans le cas de l’Internet, à propos duquel se sont exprimés des enthousiasmes débridés et des paniques morales comparables.
Si l’on peut avoir l’impression que ce genre de débat tourne en rond, et que les deux côtés ont tort, c’est parce qu’il s’agit d’une erreur épistémologique fondamentale : le déterminisme technologique, où l’on réduit l’explication des phénomènes sociaux à des facteurs purement techniques, dans un sens positif ou négatif. Plus généralement se pose le problème de la causalité en sciences sociales ; pour aller vite, la difficulté de celles-ci, c’est que toute analyse sérieuse a l’obligation d’être multi-causale, intégrant des facteurs sociaux, économiques, techniques, culturels et psychologiques à des pondérations différentes (d’où débat légitime). Une chose est sûre, cependant. On ne pourra pas « perdre son temps » dans la réalité virtuelle, qui fera partie intégrante d’une économie hyper capitaliste. Pas plus qu’on échappait autrefois à Coca Cola devant son téléviseur.

Dans ce recadrage, la question d’une perte d’empathie sociale ne doit pas être écartée, à condition de ne pas la réduire à la simple émergence de nouvelles technologies numériques ou virtuelles. Car cette question s’est déjà posée dans deux ouvrages importants de psychanalyse appliquée extrapolant l’expérience clinique à l’analyse sociale ; il s’agit de L’Homme sans gravité (Denoël, 2002) et de La Nouvelle économie psychique (Erès, 2009) de Charles Melman (dans les deux livres, en conversation avec Jean-Pierre Lebrun). Selon Melman, ce qui est nouveau par rapport aux analyses historiques de Freud, c’est qu’il n’y a plus tellement d’interdits, ce qui nous expose à la dictature de la jouissance normée, à la consommation « consomptive » et fétichiste des objets, et donc à des formes de névrose originales. Cette « nouvelle économie psychique » est liée non pas au progrès technologique, mais à l’évolution du capitalisme lui-même ; il faudrait envisager ce changement comme une forme « d’adaptation existentielle » à un système caractérisé par l’alignement de pratiquement tous les domaines d’existence aux valeurs marchandes. Celles-ci finissent par pénétrer les relations sociales les plus intimes, sujettes à la même logique de calcul par rapport à l’investissement fait. Pour survivre dans un monde pareil, chacun est obligé de devenir vendeur de lui-même avec l’empathie feinte nécessaire. Il faut, bien entendu, avancer avec précaution ici, car le lien entre la clinique individuelle et les traits anthropologiques ne va pas de soi sur les plans épistémologique et méthodologique, y compris chez Freud. Posons cependant le principe qu’un engouement social pour les technologies de réalité virtuelle sera plutôt le symptôme révélateur d’un nouveau rapport au monde des personnes et des objets, et non la cause de celui-ci.

Deuxième piste à explorer vis à vis du monde virtuel qui s’annonce : Simulacres et simulation du philosophe iconoclaste Jean Baudrillard (Galilée, 1981). Pour lui, il y a trois ordres de simulacres (apparence qui ne renvoie à aucune réalité sous-jacente) : naturels, fondés sur l’image (imaginaire de l’utopie) ; productifs, fondés sur l’énergie, sa matérialisation par la machine (imaginaire de la science-fiction) ; de simulation, fondés sur l’information, le modèle, le jeu cybernétique (sans imaginaire). Même si le terme « réalité virtuelle » n’est pas utilisé par Baudrillard (en 1981, on parle d’hologrammes, et de « hyperréalité »), c’est à elle que le « simulacre de simulation » correspond. Ce qui caractérise celui-ci, c’est la résorption totale de la distance entre imaginaire et réel ; les modèles ne constituent plus un imaginaire par rapport au réel, « et ne laissent aucune sorte d’anticipation fictionnelle – ils sont immanents, et ne laissent donc place à aucune transcendance imaginaire« . Autrement dit, en termes un peu moins abstraits :
Peut-être la science-fiction de l’ère cybernétique et hyperréelle ne peut-elle que s’épuiser dans la résurrection « artificielle » de mondes « historiques », essayer de reconstituer in vitro, jusque dans les moindres détails, les péripéties d’un monde antérieur, les événements, les personnages, les idéologies révolues, vidées de leur sens, de leur processus originel, mais hallucinants de vérité rétrospectif. [1]
Baudrillard cite le roman Simulacres de Philip K. Dick, où la Guerre civile américaine est rejouée dans un gigantesque hologramme en trois dimensions. Vingt ans après, il aurait sûrement pris comme exemple le film Matrix, où les mondes « réel » (apparemment) et virtuel se confondent, comme la carte si détaillée qu’elle couvre tout le territoire dans la courte fable (1935) de Jorge Luis Borges (« De la rigueur de la science » in L’histoire universelle de l’infamie, 10/18, 1951, 1994). (Pour la petite histoire, l’expression « le désert du réel » dans le film vient de Baudrillard, reprenant Borges). Là où les simulacres sont condamnés à reprendre les couleurs du réel, présent ou passé, ils sont « vidées de leur sens ». Car justement, quel est le sens « culturel » (et idéologique) d’un jeu en VR où on plonge dans un bassin de requins (image ci-dessus), ou dans un monde médiéval pimenté du fantastique, genre Game of Thrones ? Quel est la « valeur » autre que marchande d’un rapport sexuel en VR ? Et quelle disposition psychique faudra-t-il pour évoluer dans un tel monde ?
[1] Simulacres et simulation, Galilée, 1981, pp. 181-2. Pour une autre discussion de Matrix, voir l’article d’Imane Sefiane dans la web-revue.
Les zombies postapocalytiques « mangent » la télévision, déc. 2014, Actualités #26
De quoi les zombies sont-ils le nom ? Poser cette question, c’est déjà pointer les limites d’une approche des produits culturels uniquement en termes d’économie politique. [Mais] si les contenus ne peuvent pas être directement reliés à la logique du capital, ils ne sont pas complètement arbitraires par rapport à l’évolution de celle-ci. Précisons d’emblée que la question est difficile, d’autant qu’une analyse vraiment satisfaisante des ressorts idéologiques du fantastique devrait tenir compte des montées et des reflux de ses figures diverses : les fantômes, les extraterrestres, les loups-garous, les vampires, et les zombies, figures pour la plupart fort anciennes et préscientifiques, dont la signification est loin d’être fixe. Mais avant d’entrer dans de telles nuances, une analyse convaincante doit aussi expliquer ce que ces figures du fantastique ont en commun. Pendant les vingt dernières années, les extraterrestres, les vampires et les morts-vivants se sont succédé sur les écrans américains ; de façon décisive, les nouvelles séries fantastiques font coexister (et même collaborer !) vivants, morts-vivants et fantômes dans le même assemblage.


Qu’il s’agisse d’un monde préapocalyptique (The X-Files dans les années 1990), ou postapocalyptique (The Walking Dead), les ressorts sont similaires : le plus-de-jouir (concept du psychanalyste Jacques Lacan calqué sur celui de la plus-value chez Marx) apporté par l’idée même d’apocalypse, le désir de celle-ci. « La manière la plus facile de dégager le plus-de-jouir idéologique dans une formation idéologique, écrit le philosophe slovène Slavoj Zizek, c’est de lire celle-ci comme un rêve afin d’analyser le déplacement qui y travaille » [3]. Zizek en cite deux exemples : un patient de Freud qui, dans un rêve, rencontre avec bonheur une ancienne amante à l’enterrement de son père ; un film de science-fiction des années 1950, similaire aux séries traitées ici, dans lequel un virus à fait disparaître la population de la Californie, ce qui offre la possibilité aux quelques survivants de redécouvrir le bonheur d’une vie simple fondée sur la solidarité organique. Dans les deux cas, la mort ou la catastrophe, c’est le prix à payer pour la réalisation d’un désir qui est en même temps sadique (survivant) et masochiste (victime).
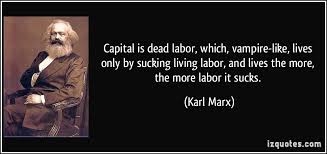

[1] David Buxton, Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production, L’Harmattan, 2010, pp. 67-8.
[2] ibid., pp. 5, 90-2, 96, 145-9.
[3] Slavoj Zizek, « Repeating Lenin » [1997], pp. 11-12 (je traduis). Jacques Lacan, « De la plus-value au plus-de-jouir », séminaire du 13 nov. 1968, in Cités, 16, 2003, pp. 129-44.
[4] Marx, Le Capital, tome 1, passim [1867]. Voir l’article de Mark Neocleous, « The Political Economy of the Dead : Marx’s vampires », 2003.
[5] Franco Moretti, Signs taken for wonders : essays in the sociology of literary forms, Verso (London), 1983, p. 91.
[6] Brian Steinberg, « Have AMC’s zombies already eaten TV ? », Advertising Age, oct 11, 2014 (lien ci-dessus).
[7] Anne-Christine Diaz, « 6 Tips for being a good zombie », Advertising Age, oct. 11, 2013.
L’humanité augmentée (H+) : le transhumanisme arrive en France, février 2015, Actualités #28
Le transhumanisme est le développement logique du déterminisme technologique, où toute dimension politique est gommée en faveur d’une mise en avant des possibilités déclenchées par l’innovation scientifique, agent fétichiste. Le mot « capitalisme » est banni. Comme le suggère [le journaliste de Libération] Jean-Christophe Féraud, le transhumanisme est le discours d’escorte de « l’ère numérique », qui a abouti à la domination inouïe des « Gafa », ou des « Gafam » en rajoutant Microsoft. Cette foi démesurée en le progrès technologique comme unique salut de l’humanité, qui bénéficie déjà de relais officiels en France 
Bas les masques. Le transhumanisme se passe généralement d’alibis sociaux et éthiques dans une extension fuite-en-avantiste du domaine de l’exploitation. En fait, ce débat n’est pas nouveau ; il faut lire l’essai tranchant d’Adorno, « Capitalisme tardif ou société industrielle ? » [3], écrit sur fond du mouvement de contestation étudiant en 1968.
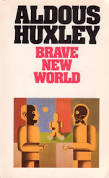
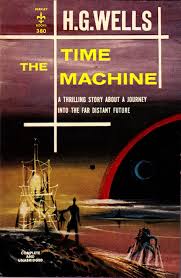
L’autre référence est le roman de spéculation d’H. G. Wells, La machine à remonter le temps (1895), où dans l’an 802 701, les descendants de l’humanité sont divisés en deux espèces : les Éloïs, androgynes, hédonistes et oisifs, et les souterrains Morlocks, dégénérés et bestiaux. La recherche génétique du « génie » Zhao Bowen part d’une conception bien réductionniste et tendanciellement discriminatoire (pour ne pas dire raciste) de « l’intelligence » conçue comme un objet unitaire, et s’appuie sur des mesures de celle-ci (les fameux QI) discréditées dans les années 1960, mais qui reviennent en force dans le climat conservateur, voire réactionnaire d’aujourd’hui.

Le plan B est encore plus indicible, et encore plus discutable d’un point de vue scientifique : la numérisation du cerveau humain qui ouvrirait la voie vers une forme d’immortalité pour ceux qui en auront les moyens. Cela ou la migration physique sur un autre monde. C’est le transhumaniste Marc Roux qui vend la mèche, sans le dire explicitement : il s’agira d’assurer la survie d’une élite très sélective quand la Terre deviendra inhabitable. Libertaire affiché (dans le sens américain), multimilliardaire, cofondateur de PayPal et actuel président de Telsa (voitures électriques) et de SpaceX (fabricant de fusées, sous contrat à la Nasa), Elon Musk (Californien d’origine sud-africaine, cool) projette, comptant sur sa propre fortune, d’établir une colonie sur Mars avant 2040, qui devrait atteindre un million d’habitants dans un siècle. Cela, si par miracle elle réussit à survivre dans un environnement aussi hostile (à côté duquel le Pôle Sud ou la pire prison serait un paradis), et si l’on trouve les moyens financiers gigantesques pour faire échapper autant de personnes de la gravitation terrestre, avec le consentement du moins passif des Terriens. Car la question est bien là : s’agissant de son avenir, est-ce que l’humanité aura son mot à dire sur ces dépenses colossales envisagées qui proviendront de quelques individus fortunés ?

L’un des précurseurs de ce projet fut l’apôtre sulfureux des substances psychédéliques Timothy Leary, brillant psychologue viré de l’université de Harvard pour ses expériences sur le LSD (légal à l’époque), et littéralement hors-la-loi à la fin des années 1960 (article dans la web-revue ici), mais qui a adopté un agenda transhumaniste dans les années 1980, résumé dans l’acronyme SMI²LE (Space migration + Intelligence increase + Life extension). Dans son projet initial, qui affirme que la transcendance spirituelle se réalisera désormais dans la conquête de l’espace, un vaisseau spatial luxueux (« Starseed 1 ») équipé de 5000 personnes supérieurement « viriles et intelligentes » aura pour mission la colonisation d’autres planètes. Le mot « viril » trahit l’aspect misogyne du projet (y faudra-t-il donc des femmes supérieurement fécondables ?).
Sans tomber aussi bas, les croisés de l’intelligence artificielle comme Marvin Minsky ont longtemps été critiqués pour leur misogynie et leur misanthropie, 
Notes :
[1] Chiffres de l’ONG humanitaire britannique, Oxfam. Selon la même source, les 1 % les plus riches possèdent en patrimoine cumulé plus que les 99 % restants de la population mondiale. La « valeur » des produits financiers dérivés s’élève à 800 000 milliards de dollars (Banque des règlements internationaux), ce qui met en perspective la dette des États comme la France. Le temps moyen de possession d’une action est de 12 secondes ; la spéculation boursière est déjà « gérée » par des algorithmes (Libération, 26 déc. 2014, p. 5).
[2] Immanuel Wallenstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, Le capitalisme a-t-il un avenir ?, La Découverte, 2014.
[3] T. W. Adorno, Société : Intégration, Désintégration, Payot, 2011, pp. 85-107.
[4] Joseph Weizenbaum, Puissance de l’ordinateur et Raison de l’homme. Du jugement au calcul, Ed. d’informatique, 1981 (édition américaine en 1976).
Lire l’article d’Imane Sefiane sur le cyberpunk dans la web-revue. Lire Ross Andersen, « Exodus » (sur Elon Musk, en anglais), Aeon, mise en ligne 30 sept. 2014. Chanson Timothy Leary’s Dead (Legend of a Mind), The Moody Blues (1969).
Investissements records dans les start-up de la Silicon Valley, juin 2015, Actualités #32
Il faudra mobiliser [ici] le concept de « capital fictif », avancé par Marx dans le chapitre 29 du troisième tome du Capital. Il s’agit du système qui permet au capital de se multiplier en échangeant des valeurs n’existant que sur le papier, sans réserves monétaires ou actifs convertibles pour les appuyer (on peut en distinguer trois formes : le crédit, les dettes publiques, et les actions ou obligations échangées sur les marchés financiers). C’est la base de la spéculation financière, où l’on s’endette « fictivement », c’est-à-dire qu’on achète avec de l’argent qu’on n’a pas, pour mieux accumuler des bénéfices futurs. Tout repose sur la confiance que ces valeurs « fictives » seront convertibles en valeurs « réelles » (valeurs d’usage) à l’avenir. Autrement dit, sauf miracle, le destin ultime du capital fictif est d’être effacé (de subir une « coupe de cheveux » dans le jargon actuel) une fois la masse critique atteinte, parfois dramatiquement comme lors de la Grande Dépression des années 1930, et dans une moindre mesure lors de la crise des subprimes en 2008.
Le poids moyen du capital fictif dans les onze pays les plus riches est passé de 145% du PIB en 1980 à 340% en 2012, ce qui montre que l’accumulation financière n’a cessé de progresser par rapport à l’accumulation réelle (les richesses effectivement produites). Actuellement, 98% des transactions monétaires dans le monde relèvent de la spéculation, seulement 2% concernent des valeurs « réelles ». À priori, cette fantasmagorie ne peut continuer en l’état indéfiniment, en dépit des outils financiers de plus en plus sophistiqués.

Le crédit et la spéculation ont toujours existé, mais jamais à ce point-là ; il s’agit d’une évolution structurelle du capitalisme dans un stade qu’on peut qualifier de « financier » ou de « tardif ». La valeur du dollar, principale monnaie de réserve, est totalement flottante, et n’est plus indexée sur les réserves de l’or depuis 1971. Comme le montre le géographe social David Harvey, le capitalisme, qui est un processus continu de création de plus-value, dépend non pas de la croissance simple, mais de la croissance composée, avec une norme historique de 3%. En termes concrets, cela veut dire qu’alors que l’économie mondiale devait trouver le moyen de réinvestir 6 milliards $ en 1970 pour se reproduire, il en faudra 2 billions $ (2 millions de millions) actuellement, et 3 billions $ en 2030, avant de devenir exponentiel et au-delà de l’entendement. Voilà qui n’implique pas en soi la fin du capitalisme, mais qui pose la question des conditions sociales, politiques et environnementales de sa survie, et le prix éventuel à payer (inégalités extrêmes, régions inhabitables, régimes autoritaires, classe rentière, déchirement du tissu social, populations « superflues »). Quelques individus ont déjà les moyens de décider l’avenir de l’humanité (voir Actualités #28), et les aspects d’un monde dystopique à venir sont présents sur les plans réel (la surveillance massive par la NSA) et imaginaire (la franchise Hunger Games, où la question de survie est déplacée sur l’individu).
C’est dans ce contexte, où la part des investissements en capital fixe (productif) n’a cessé à se réduire, qu’on peut mieux comprendre comment on en arrive « rationnellement » à éponger le surplus de capital fictif dans des start-up sans modèle d’affaires viable, sans rentrée d’argent, sans valeur d’usage affirmée, et parfois même sans produit…
À lire : Cédric Durand, Le capital fictif, Les Prairies ordinaires, 2014 ; David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism, Profile Books (London), 2014, surtout p. 222-45 ; http://clementsenechal.com/2014/11/24/lessor-du-capital-fictif-comment-la-finance-sapproprie-notre-avenir-collectif/, blog de Clément Sénéchal.
La série CSI (Les Experts) tire sa révérence, nov. 2015, Actualités #36
Les mots de [l’acteur] William Petersen (Grissom), et [du producteur] Anthony Zuicker, complaisamment relayés par l’article du Monde, relèvent plutôt de l’autopromotion (qui s’appelle plus familièrement « la com »). Il ne faut pas s’attendre à autre chose de la part de personnes aussi impliquées, mais les analyses universitaires et journalistiques peuvent être lénifiantes à leur manière. Les discours d’escorte de [cette] série ont toujours insisté sur sa dimension scientifique, voire pédagogique et humaniste, alors que la science en question comporte des scènes d’autopsie macabres, qui n’épargnent aucunement le téléspectateur quant à la réalité biochimique de la décomposition des cadavres. Clairement, la série renvoie plus à une forme de pornographie morbide qu’à un engouement pour la méthode scientifique, qui n’influe pas ici sur la société des vivants. Nul meilleur monde en devenir. Quant au producteur Zuiker, enclin à des justificatifs pseudo-philosophiques, le lien (mystérieux) qu’il avance entre les attaques terroristes du « 9/11 » (le 11 septembre 2001), et le « décollage » de CSI ne résiste pas à un regard un tant soit peu critique. La première saison de CSI (2000-01), diffusée intégralement avant « 9/11 », a attiré 20,8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode ; la deuxième saison, qui a débuté quelques semaines après les attaques, 23,7 millions. L’audience de la série a donc été largement réalisée dès sa première saison.
Cela dit, la série a fait preuve d’une longévité exceptionnelle, cinquième de tous les temps aux États-Unis (si l’on exclut quelques dessins animés), après Gunsmoke (635 épisodes, 1955-75), Law and Order (New York District en français) (456, 1990-2010), Lassie (pour enfants, le personnage principal étant un chien, 591, 1954-73), Law and Order : Special Victims Unit (New York Unité spéciale) (368, série en cours, depuis 1999). Ce que ces séries ont en commun, c’est une formule exceptionnellement stable et prévisible. Si Gunsmoke et Lassie relèvent de la série classique avec un minimum de personnages récurrents, les autres font partie de la série moderne avec de multiples personnages, et des éléments feuilletonnants, ici relativement faibles. Les arrivées et les disparitions de personnages récurrents ne déstabilisent pas l’assemblage de base. Dans CSI, l’expression (minime) de la personnalité est limitée sauf exception à la sphère professionnelle, ce qui va de pair avec des intrigues squelettiques (au moins deux enquêtes par épisode de 42 minutes), sans intensité émotionnelle.
Le précurseur des séries médico-légales fut la britannique Silent Witness (Autopsie en vf), diffusée depuis 1996 sur la BBC, et toujours en production à un rythme de 4 à 6 épisodes de deux heures par an. Comme sa longueur l’indique, elle est plus conséquente d’un point de vue dramatique. Diffusée aux États-Unis sur BBC America, elle a dû influencer CSI, notamment dans sa conception du cadavre comme un témoin privilégié (« qui ne ment pas »), même si Zuiker attribue son inspiration à un documentaire sur la chaîne Discovery. En dehors de ses propres franchises, CSI a mené à la création d’autres séries comportant des autopsies, notamment Bones (212 épisodes depuis 2005), Rizzoli & Isles (86 épisodes depuis 2010), Body of Proof (42 épisodes, 2011-13), et dans une certaine mesure NCIS (285 épisodes depuis 2003). Il est probable que le cycle de séries médico-légales touche à sa fin, en même temps que celui des émissions de télé-réalité.
Pour une analyse critique de CSI, voir mon livre Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan, 2010), pp. 103-19.
Les musiciens ne supportent plus les portables dans les salles de concert (juillet-août, 2016), Actualités #44
Quelle est la différence entre l’universitaire et le chanteur de rock ? Aucune : les deux sont condamnés à s’époumoner dans le vide, devant un public autrement occupé à envoyer des textos, à surfer sur Facebook ou Tinder… Pour l’universitaire, l’affaire est entendue : son discours est jugé trop « théorique » par des étudiants confrontés à un déclassement structurel qui ne dit pas son nom. Mais le chanteur de rock ? Après tout, si on paie pour aller le voir, c’est pour s’éclater…
L’interdiction de filmer ou d’enregistrer les concerts date de l’époque où le document piraté (bootleg) pourrait concurrencer la production légale, menant à une perte théorique de revenus pour l’artiste, et (surtout) pour sa maison de disques. (En réalité, il était très difficile d’enregistrer un concert dans de bonnes conditions sans être aperçu ; la plupart des documents piratés de qualité potable étaient le fait des techniciens indélicats qui ont eu accès à la table de mixage, le plus souvent avec la complicité des musiciens). La généralisation des smartphones, et l’effondrement du marché du disque ont changé la donne : ce genre de document « volé », de faible qualité visuelle et sonore, n’a aucune valeur marchande, et l’artiste et sa maison de disque n’ont généralement rien à redire quand il est posté sur YouTube, à condition que ce ne soit pas le concert en entier. De toute évidence, ce n’est pas la peur de se faire pirater qui tracasse les artistes.
Dans son essai célèbre « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), Walter Benjamin développe la notion d’aura, qui se définit comme ce qui est unique dans l’œuvre d’art, ce qui relie celle-ci à un temps et un espace singuliers. Pour Benjamin, avec la perte de l’aura (qu’il voyait comme un processus positif), l’œuvre perd sa qualité sacrée ; dans sa reproduction industrielle, la copie de celle-ci sort de son contexte original, s’ouvre à d’autres interprétations, et devient produit de consommation disponible (démocratiquement) à la masse. Par tradition, le concert, fût-ce de rock, garde quelque chose de son lointain caractère sacré par rapport à la consommation d’une copie industrielle, mais qu’en est-il vraiment ? Loin d’être une expérience singulière, le concert (du moins dans son pôle commercial) s’inscrit depuis longtemps dans la stratégie commerciale des ayants droit de l’artiste sous contrat : une tournée à l’échelle nationale, puis éventuellement continentale, et mondiale (nécessitant des capitaux importants, et dans certains cas, une centaine de salariés, des infrastructures lourdes et un convoi de camions pour les transporter). Sur scène, l’artiste reproduit une « copie » d’un répertoire déjà connu, recourant même à l’occasion à des subterfuges techniques (bandes préenregistrées) [1]. Ainsi, toutes proportions conceptuelles gardées, les arguments de Benjamin peuvent aussi s’appliquer au concert dans sa reproduction technique, mais pas dans un sens aussi positif (c’est là le débat).
Le cri de cœur de l’artiste, qui se retrouve sur scène face à une marée de portables – fait anecdotique en lui-même -, traduit une profonde blessure narcissique face à la perte manifeste de tout aspect sacré du concert, bref, la perte de son aura. Il est intéressant que Jules Frutos, promoteur de concerts, avance l’idée d’un désir chez les jeunes de « devenir individuellement un média ». En d’autres termes, il s’agit moins de consommer une expérience qu’on sait « industrielle », mais de se positionner, un narcissisme pour un autre, sur les réseaux sociaux par rapport à un événement qui garde une dimension (plus ou moins) identitaire, et qui se valorise (plutôt) par la présence signalée. Le concert organisé devient alors un vecteur événementiel parmi d’autres, et la star de rock prend sa place parmi d’autres célébrités, rangées désormais en divisions comme les championnats de football.
[1] Il est à noter qu’informellement la question du caractère industriel des concerts pop/rock fait l’objet d’un débat contradictoire à l’intérieur de la tradition française de l’économie politique de la communication (ladite École de Grenoble). Ce débat latent, important sur le plan théorique, mérite d’être repris au grand jour.
Précédemment sur la culture des célébrités : Actualités #10, juin 2013
Lire les autres articles de la rubrique.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)




