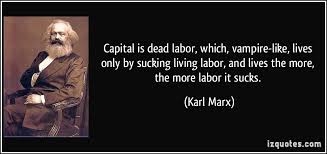Actualités des industries culturelles et de communication, #68, février 2019, spécial séries télévisées
Interdit à la reproduction payante
Contenu
Les séries les plus commentées sur les réseaux sociaux (#61, février 2018)
Le nombre de citations d’une série sur les réseaux sociaux est devenu une mesure essentielle pour compléter celle de l’audimat. En effet, il existe aujourd’hui de multiples manières de regarder une série (DVD, streaming légal et illégal, téléchargement, replay), sans se donner rendez-vous à l’heure de diffusion devant son téléviseur, pratique plutôt réservée aux plus âgés. Dans ces conditions, la mesure traditionnelle d’audience est de moins en moins pertinente. Les commentaires que postent fans et amateurs sur Facebook ou sur Twitter dressent un portrait très détaillé de la réception d’une série, à même de donner des indications précieuses aux scénaristes et producteurs. Avant l’existence des réseaux sociaux, quand les audiences d’une série commençaient à baisser, on mettait en place un panel, ce qui prenait facilement six mois. Maintenant, on sait déjà que si l’horrible Cersei n’est pas cruellement mise à mort dans l’ultime saison, les fans de Game of Thrones seront très déçus (voir tweet typique ci-dessus).
Désormais, les millions de commentaires postés sur les réseaux sociaux agissent comme un sondage qualitatif en directe, qui aide les scénaristes (pour savoir si tel ou tel personnage est apprécié ou non), les producteurs (pour mieux cibler les annonceurs), et les annonceurs (pour décider d’acheter du temps d’antenne ou non). Voici le top 10 des séries les plus commentées sur les réseaux sociaux américains en 2017, selon Business Insider (avec des données provenant de la société de mesure Nielsen) :
- Game of Thrones (HBO) : pour le premier épisode de la septième saison, 2,4 millions de tweets ont été échangés.
- The Walking Dead (AMC) : série postapocalyptique avec zombies.
- Empire (Fox) : série « soap » sur le monde du hip-hop.
- 13 Reasons Why (Netflix) : série dramatique sur les suicides des adolescents dus au harcèlement. La série la plus suivie sur TV Time, une application mobile permettant aux fans de réagir.
- Riverdale (The CW) : la vie d’un groupe d’adolescents dans une petite ville avec une trame policière, inspirée par la bande dessinée Archie, créée en 1939, et qui continue à ce jour.
- Grey’s Anatomy (ABC) : série dramatique située dans le monde hospitalier.
- The Flash (The CW) : série de super-héros inspirée par la bande dessinée du même nom, spin off de Arrow.
- Arrow (The CW) : série de super-héros inspirée par la bande dessinée Green Arrow, spin off de Smallville.
- Shadowhunters (Freeform) : série d’horreur surnaturel.
- The Big Bang Theory (CBS) : sitcom sur la vie de jeunes geeks lamentables et attachants.
Sources : « Quelles sont les séries les plus commentées sur les réseaux sociaux ? » (Enrique Moreira), Les Échos, 16 déc. 2017 ; https://www.businessinsider.com/most-talked-about-tv-shows-of-year-2017-12?IR=T/#game-of-thrones-hbo-1

La transformation des fans des séries en auxiliaires de marketing bénévoles ne date pas d’hier. On pourrait remonter jusqu’au milieu des années 1990 quand la série X Files fut l’objet de discussions passionnées sur les forums en ligne naissants, stimulées par une mythologie ésotérique savamment distillée, des titres d’épisodes énigmatiques et des indices cachés. Depuis 2006, Nielsen IAG mesure « le taux d’engagement » avec les séries, c’est-à-dire la qualité du suivi (remémoration de détails narratifs). La série Lost, classée première pour « l’engagement » en 2010, a donc pu demander des tarifs publicitaires nettement plus élevés que NCIS, malgré l’audience très supérieure de cette dernière série [1]. Dans le cas de Lost, série qui attirait davantage les 18-34 ans, audience prisée, le diffuseur ABC a décidé de collaborer avec des sites web amateurs consacrés à la série, et de participer à l’élaboration d’une « communauté » de fans. Selon le producteur emblématique de Lost J. J. Abrams, « Internet a profondément modifié la manière dont nous regardons la télévision. Instantanément, des millions de gens réagissent, et il se dégage très vite un consensus sur ce qu’ils aiment, ou n’aiment pas. Un examen attentif de ces réactions est très éclairant, et il faudrait être fou pour ne pas écouter l’avis des fans » [2]. Prototype du consommateur « actif », le fan est celui qui est le plus soumis au dispositif de marketing, et potentiellement le plus réceptif aux spots publicitaires qui accompagnent sa série « culte » [3].
À défaut d’une prise de distance par rapport à ce nouveau sens commun, une curieuse convergence autour de la notion de « récepteur actif » s’est opérée entre la recherche dite universitaire et les demandes de la recherche administrative en provenance de l’industrie du marketing. L’héroïsation néopopuliste du récepteur résistant a rejoint l’apologie néolibérale sur la souveraineté absolue du consommateur atomisé. Le glissement vers le « populisme culturel » a d’ailleurs suscité dans les milieux anglo-saxons des polémiques acerbes autour du dévoiement des cultural studies. Une vision irénique, voire religieuse, du statut actif des audiences : telle est bien l’image que renvoient bon nombre d’études sur le lien transnational, et plus particulièrement celles qui ont pris pour objet l’interaction avec les séries de télévision […]. La notion de « culture américaine » est assumée sans fard comme un « opérateur d’universalisation », au motif que chaque culture peut parfaitement s’y retrouver et se redéfinir sans y perdre son âme en la faisant sienne. Feu l’impérialisme culturel. Vive la globalisation ! Adieu aux politiques publiques vis-à-vis des industries de la culture [4].

Réduite à sept épisodes, la saison 7, diffusée en juillet-août 2017, sera l’avant-dernière de la saga. Les deux showrunners, D. B. Weiss et David Benioff, travaillent sur cinq séries dérivées en préparation, ce qui explique le retard pris sur la saison 7, et en toute probabilité sur la saison 8, qui pourrait n’être diffusée qu’en 2019. Selon le directeur de la programmation de HBO, Casey Bloys, « la période de diffusion sera donnée quand l’avancée de l’écriture sera suffisante ».
Le budget de la saison 7 a été plus important que celui des saisons précédentes. Les chiffres sont confidentiels, mais on prétend de bonne source qu’il a augmenté de 40 %, alors que le prix d’un épisode était déjà de 10 millions de dollars, ce qui le ramène désormais à 14 millions. « Cette inflation de moyens se verra à l’écran, dit Robert McLachlan, directeur de la photographie. Avant , nous avions une ou deux séquences vraiment folles par saison, un ou deux épisodes majeurs. Cette année, environ la moitié d’entre eux sont énormes ». On en jugera…
L’augmentation du budget s’explique aussi par une renégociation du salaire des stars pour les saisons 7 et 8, habituelle vers la fin d’une série quand l’engagement des acteurs principaux devient primordial (le contre-exemple à cet égard, c’est la fin lamentable des X-Files en l’absence de David Duchovny (Fox Mulder) après une dispute à propos du montant de son salaire). Ainsi, les salaires des acteurs « principaux » de Game of Thrones sont passés de 300 000 dollars par épisode à environ 500 000 (plus ou moins selon les contrats). Or dans Game of Thrones, ceux-ci sont nombreux. À titre de comparaison, les deux acteurs principaux de The Walking Dead viennent de renégocier leur contrat pour les saisons 6, 7, et 8, passant à 650 000 dollars l’épisode.
Cela veut dire que les acteurs principaux de GOT seront désormais plus présents à l’écran, aux dépens des personnages secondaires pléthoriques qui font partie de l’ADN de la série. « Les scénarios se concentrent sur eux, explique Kit Harington (Jon Snow), et il y a moins de nouveaux personnages. Par ailleurs, et c’est ce que les fans attendaient depuis longtemps, ils vont se croiser davantage ». Les dernières saisons feront jurisprudence quant à une fin satisfaisante d’une série à personnages multiples, après le ratage partiel (aux yeux des fans) de The Sopranos, et total de Lost.
Source : « »Game of Thrones », la fin approche » (Cédric Melon), Télécâblesat Hebdo, #1419, 10 juillet 2017, pp. 8-9.
Séries télévisées : la lente émergence des showrunners en France (#51, mars 2017)

La fonction du showrunner – assurer en même temps la cohérence d’une série et le respect des budgets financiers – émerge en France lentement. Bien qu’il n’existe pour l’instant qu’un seul professionnel qui s’affiche comme tel (Éric Rochant du Bureau des Légendes, Canal+), on observe de plus en plus de passerelles entre les métiers, avec par exemple des auteurs-producteurs qui supervisent une partie du tournage. À mi-chemin entre auteur principal et producteur, le showrunner dirige le bureau d’écriture, décide du casting, des décors, chapeaute le tournage et le montage. « Le showrunner est le principal interlocuteur des différents intervenants. Le responsable en quelque sorte », dit Clothilde Jamin, scénariste et coauteur d’un rapport sur la question.

« Avoir un showrunner n’a de sens que dans la logique industrielle d’une série longue d’au moins 8 ou 10 épisodes par an. Or, elles sont rares en France, où le métier reste très artisanal », prétend Frédéric Krivine (Un village français), considéré comme l’un des premiers showrunners en France, mais qui a toujours récusé le terme. Rappelle Éric Rochant, « Il n’est pas dans la culture française que les auteurs [scénaristes] soient les maîtres à bord. La « Nouvelle Vague » a eu tendance à mettre en avant le réalisateur ». Rochant aurait pu citer également l’influence de la cinéphilie française, notamment la « politique des auteurs [réalisateurs] » défendue historiquement par Les Cahiers du cinéma, influence qui s’est étendue à la télévision.
Ce qui favorise l’émergence d’un showrunner, même s’il n’apparaît pas comme tel au générique, ce sont plutôt des facteurs économiques. « Cela permet de garder des délais serrés, mais aussi de rester dans un budget défini, pour une qualité définie. C’est le showrunner qui en est le garant », dit Rochant. Frédéric Krivine abonde tout de même dans le même sens : « On se donne une marge avec le producteur et on se débrouille pour y parvenir. Quand il n’y a pas de showrunner, le scénariste seul n’est pas toujours très bien briefé sur le budget, d’où souvent des réécritures, des changements qui allongent le temps de production et les coûts. Or, on sait bien que plus un contrôle qualité intervient tôt, moins ça coûte cher ».
La fiction télévisée européenne a le vent en poupe. Le volume de production de séries en France devrait grimper, ce qui implique, selon certains professionnels intéressés, de nouveaux modes de production impliquant entre autres choses la présence d’un showrunner. « Netflix, Amazon arrivent en France avec leurs standards. Or, si on ne change pas nos habitudes, on ne sera jamais concurrentiel », conclut Éric Rochant en guise d’avertissement implicite aux corporatismes existants, notamment ceux des réalisateurs et des scénaristes. On pourrait commencer par trouver un terme français pour ce nouveau rôle.
Source : « Séries télé : la montée en puissance des « showrunners » » (Marina Alcaraz), Les Échos, 5 fév. 2017.
Les scénaristes de télévision français deviennent plus ambitieux (#48, décembre 2016)

Les scénaristes de télévision estiment qu’ils devraient être plus impliqués dans la fabrication de séries en France. Écoutons Fanny Herrero, créatrice de Dix pour cent (France 2) :
« Progressivement, le milieu change. Ce métier attire de plus en plus d’auteurs qui ont une psyché de leader, un égo plus affirmé, et parfois la capacité de diriger eux-mêmes une équipe autour de leurs projets de séries. Il existe en fait plusieurs profils de scénaristes, autour de moi. Certains ne demandent rien d’autre que d’écrire, mais ils sont rares. La plupart veulent être impliqués dans la réalisation de leur histoire : être présents aux lectures avec les comédiens, participer au choix du casting, des décors, etc. Ils veulent que leur avis compte autant que celui des autres. Et puis certains d’entre nous souhaitent même devenir directeur artistique ou a minima conseiller artistique […] Il est assez insensé, absurde, et même improductif d’exclure celui qui a impulsé l’histoire et la manière dont elle sera traitée. Alors que le cœur, l’âme, la vision du monde de la série viennent de l’auteur. Il a fallu pas mal de temps pour que ce soit admis et compris ».
Diffuseurs et producteurs se sont aperçus qu’aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Israël, c’est bien l’auteur qui est le pilier d’une série ; à ce titre, la qualité des séries scandinaves et israéliennes, avec des budgets bien plus réduits qu’en France, a été ressentie comme un choc. Beaucoup se sont entichés de deux « clés magiques » venues des États-Unis : le showrunner (créateur-producteur), et la writers’ room (salle de rédaction).

Le seul exemple de showrunner en France pour le moment, c’est le cinéaste Éric Rochant pour Le Bureau des Légendes (Canal +), même si par ailleurs ce rôle peut être assuré collectivement ; dans Un village français (France 3), un trio – auteur, réalisateur, producteur – remplit le même office. Quant à la salle de rédaction, le passage d’une culture du téléfilm de 90 minutes à la production en série (10 x 52 minutes) avait déjà conduit à la création des « pools » de scénaristes. En 1997, pour la série PJ (146 épisodes en 13 saisons sur France 2), Frédéric Krivine avait eu recours à plusieurs scénaristes développant son concept sous sa direction. « On crée un atelier pour que la série soit meilleure, plus dense, plus complexe, plus addictive. Dans un véritable atelier d’écriture, les gens sont là pour vous contredire, pour pointer votre névrose d’auteur-créateur. […] [Or], il n’existe pas, ici, d’atelier au long cours comme aux États-Unis. En France, celui qui porte le projet est généralement un directeur d’écriture qui explique aux auteurs ce dont la saison traitera, ce qu’il attend d’eux ; après quoi les scénaristes repartent travailler chez eux, et auront de temps en temps des rencontres avec le créateur ».

Ces propos sont confirmés par Camille de Castelnau, adjointe d’Éric Rochant pour Le Bureau des Légendes : « Dans notre cas, les auteurs nous rendaient une première version d’épisode écrite chez eux, qu’Éric Rochant et moi reprenions ensuite pour de nouvelles versions. Pour les saisons 2 et 3, les auteurs se sont peu réunis. Il y avait en revanche un dialogue continu entre eux et Éric Rochant. C’était un travail très collaboratif, mais on ne peut pas vraiment parler d’atelier d’écriture ». Un changement réel, qui n’existait pas il y a dix ans, c’est l’éclosion de collectifs de scénaristes qui se rencontrent régulièrement, pour analyser des séries, parler « cuisine » et projets d’écriture. « Ces scénaristes qui échangent, se soutiennent, s’accompagnent, font évoluer notre paysage audiovisuel », affirme Virginie Sauveur (Virage Nord, sur Arte).

L’aspect collaboratif en France intervient donc en aval d’une production, ou lorsque celle-ci est déjà bien entamée sous l’impulsion d’un auteur-créateur. Dan Franck, qui supervise l’écriture de la série Marseille sur Netflix : « J’ai fait une tentative, une fois, de mettre sur la table une seule idée, un conducteur très mince, pour qu’à partir de là, chacun intervient de manière démocratique. Ça a été un échec. Coopter des auteurs, c’est bien, mais il faut proposer au préalable une histoire déjà bien plantée, une base solide, et ensuite, il faut quelqu’un qui puisse trancher, qui coordonne et harmonise l’écriture ».
Frédéric Krivine opine à sa manière : « La compétence principale d’un auteur, c’est la gestion de son angoisse quant à sa capacité à mener un travail à bien et dans les temps. C’est aussi une question des enjeux psychiques qu’on entretient avec les personnages. Ce savoir-faire-là n’est pas transmissible et ne s’apprend pas en groupe ».
On n’envisage plus le modèle américain d’une équipe de scénaristes comme la seule option pour faire évoluer les pratiques ; est aussi cité le modèle britannique d’auteur unique œuvrant dans le format de la minisérie (6 épisodes, éventuellement renouvelables). Pour Krivine, tout tient au traitement, à l’ambition créative, quel que soit le format. Dans ce domaine, selon lui, l’évolution est inégale : « Beaucoup de sujets que l’on ne pouvait pas aborder dans les années 1990 peuvent l’être aujourd’hui. Mais la manière de les traiter, elle, n’a guère changé. Les Candice Renoir, Caïn, Chérif, etc. reposent sur le vieux modèle des années 1990 et visent toujours « le plaisir modeste mais irréfutable » du spectateur, pour reprendre l’expression d’Umberto Eco. Depuis trente ans, en France, on parie sur la sympathie avec le personnage principal, sur sa capacité de séduction, pas sur l’empathie qui développe la conscience de soi-même et du monde ».
S’opposent à cela, selon Krivine, des séries qu’il désigne « à prétention d’auteur » : « Il existe deux types de personnages dans une série télé. Ceux de la famille Howard Hawks, qui aboutissent à des séries non castrées sur le plan analytique : le héros y résout tous les problèmes qu’il rencontre. Et puis il y a ceux de la famille John Huston, qui donnent lieu à des séries castrées : le héros se grandit, et éventuellement nous grandit, en prenant conscience qu’on ne peut pas changer le monde. La richesse et la diversité des fictions dans les grands pays tiennent à la cohabitation des deux, avec Castle ou Columbo pour le plaisir, et The Wire pour un engagement du spectateur à l’égard de personnages vivant un conflit. En France, on n’a quasiment pas de séries castrées… En ce sens, nous faisons exception en Europe ».
Source : « Les scénaristes français sortent de l’ombre » (Martine Delahaye), Le Monde, 30-31 décembre 2016, pp. 22-3.
On essaie à la Web-revue d’être attentif aux avis des professionnels, surtout s’il s’agit d’un vrai effort de réflexivité, comme c’est le cas ici. Cela n’empêche pas la distance critique, et on peut très bien lire les commentaires de Franck et de Krivine, scénaristes chevronnés, comme des plaidoyers pro domo. À ce titre, l’expérience racontée par Franck doit être prise avec une graine de sel : pourquoi les « cooptés » devraient-ils faire le travail pour lequel Franck serait sensiblement mieux rémunéré ?
Mais à tort ou à raison, Krivine et Franck sont bien placés pour insister que le modèle américain d’équipes de scénaristes ne peut être importé tel quel en France. Le principe d’équipe, sous la férule d’un showrunner, a émergé aux États-Unis dans un contexte particulier : le tournant à partir de la fin des années 1970 vers des « séries feuilletonnantes » aux personnages multiples, et le lent déclin de la série « classique » aux épisodes autonomes. Hiérarchisées, et marquées par une division du travail (spécialisations dans les types de personnage, dans les formes de dialogue, etc.), les équipes ont pris la place des écrivains free-lance, plus ou moins organisés en pools. Cette nouvelle forme d’organisation n’est pas spécialement adaptée à la minisérie qui était jusque-là l’apanage des Européens. Qui plus est, la division du travail pratiquée par les Américains suppose une structuration en amont qui permet de prendre du galon, de faire carrière, bref une véritable industrie.
Fils d’un chirurgien très engagé contre la guerre du Vietnam, et neveu d’Alain Krivine (ancien dirigeant trotskyste et député européen), Frédéric Krivine a écrit quelques romans policiers avant de devenir scénariste de télévision. Manifestement, il a tiré profit du temps passé en psychanalyse au point où, dans ses propos, la gestion des névroses semble faire partie des qualités d’un bon scénariste. (Fanny Herrero a également une appréciation assez psychologisante du métier). Mais la distinction opérée par Krivine entre séries « castrées » et « non castrées », et entre les réalisateurs Hawks et Huston, citée en vrac par Le Monde, laisse perplexe ; on en fait état ici seulement comme exemple d’une conceptualisation issue du monde professionnel, qui probablement n’engage que lui. On ne comprend pas bien Krivine ici, à moins qu’il ne s’agisse d’un lointain écho déformé de la période marxiste-lacanienne des Cahiers du Cinéma dans le sillage de mai 1968*. Mais quid alors du quiétisme implicite des séries « castrées », caractérisées selon lui par la prise de conscience qu’on « ne peut pas changer le monde »?
Il se peut que Krivine pense à des séries où le protagoniste ne maîtrise pas la situation dans laquelle il se trouve (Breaking Bad, par exemple), ce que j’ai caractérisé ailleurs comme la conséquence d’une passivité structurelle, à savoir l’absence d’un projet social viable à incarner**.
*Cf l’analyse célèbre du film de John Ford, Young Mr Lincoln, écrit par un collectif des Cahiers du Cinéma (#223, août 1970, pp. 29-47), où il est question (entre autres choses) du héros (symboliquement) castré qui exerce une action castratrice, en tant qu’agent de la Loi. (Seule la traduction anglaise de ce texte se trouve en ligne).
**David Buxton, Les séries télévisées. Forme, idéologie, et mode de production, L’Harmattan, 2010.
« Le Bureau des Légendes » est la série française la plus exportée (#46, octobre 2016)
Le Bureau des Légendes a déjà rapporté 3,7 millions d’euros à l’international (3 millions d’euros pour les saisons 1 et 2, et 700 000 euros en préachats de la saison 3, notamment par Prime Video (Amazon) en Grande-Bretagne). Diffusée aux États-Unis sur iTunes sous le titre The Bureau, la série a été plutôt bien reçue par la critique américaine : le New York Times (8 juin 2016) l’a qualifiée d’« intelligente » (smart) et de « subtile » (understated), bien que la cinématographie et le montage soient jugés parfois un peu « prétentieux » (self-consciously arty). La précédente série française la plus exportée était Les Revenants (2,7 millions d’euros), qui n’a pas réussi à maintenir sa dynamique initiale. Elle s’est arrêtée après deux saisons, chacune composée de huit épisodes, tournés sur une période de trois ans (2012-15). Ce rythme est insuffisant pour le marché international.
C’est pour accélérer le rythme qu’Alex Berger, fondateur de The Oligarchs Productions (TOP) qui produit la série pour Canal +, reprend les méthodes de production qu’il a apprises aux États-Unis auprès de Todd Kessler (Damages, The Sopranos) : « Nous formons la chaîne à une nouvelle façon de faire : un processus industriel réglé au millimètre permettant de faire une saison par an. […] Chaque minute compte, c’est un compte à rebours. Pendant ses trente minutes de trajet en voiture le matin, [le showrunner] Éric Rochant va regarder les rushs de ce qui a été tourné la veille pour choisir ce qu’il faut retenir ». L’organisation spatiale du travail est calquée sur le modèle américain : la salle d’écriture à l’étage, les plateaux en bas.
Le tournage de la saison 3 a commencé fin septembre pour une diffusion en mai 2017, pile un an après le début de la saison 2. Chacun des huit épisodes de la première saison a coûté 1,4 million d’euros, et ceux de la deuxième saison, 1,7 million. Le défi pour Berger, c’est de faire aussi bien qu’aux États-Unis avec nettement moins de moyens (le coût moyen d’un épisode de série aux États-Unis est de 3,5 millions de dollars, et pour une série de prestige comme Game of Thrones, 6 millions). Selon lui, pour que les séries françaises s’exportent, il faut qu’elles soient identifiables culturellement, comme les séries scandinaves. « La marque de fabrique d’Éric [Rochant], c’est le côté auteur et le réalisme, comme dans le cinéma français des années 1960 ».
Sources : « Le Bureau des Légendes, la série française la plus exportée » (Nicolas Madelaine), Les Échos, 5 sept. 2016 ; https://www.nytimes.com/2016/06/09/arts/television/tv-review-occupied-netflix-the-bureau-itunes.html
Voir aussi « Actualités #42 » (sur Le Bureau des Légendes), et « Actualités #26″ (sur Engrenages)
Bande-annonce de la saison 2
« Game of Thrones » : la fin vient ? (#42, mai 2016)
Selon Entertainment Weekly (en premier), les deux showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss envisagent deux saisons supplémentaires (7 et 8) plus courtes (7 et 6 épisodes respectivement au lieu de 10), avant de boucler la série définitivement à 73 épisodes, nombre juste suffisant pour le marché des rediffusions (syndication). HBO a refusé de confirmer cette « spéculation », sans la démentir formellement. Cependant, de nombreux cast members sont d’avis que la série touche à sa fin, et que la saison 6 mettra de l’ordre dans certaines intrigues parallèles. Cette saison, dont la diffusion a commencé le 24 avril, devance le sixième livre dans la saga de George R. R. Martin (The Winds of Winter), qui ne sera publié qu’après. Désormais, le fil conducteur passe par la série, et non plus par l’adaptation du livre. Invité à l’université d’Oxford en 2015, Benioff déclara : « ça fait un moment qu’on discute avec George [R. R. Martin] et on sait où on va. Finalement, on terminera au même endroit que lui, peut-être avec quelques déviations en cours de route, mais on se dirige vers la même fin ». Une série dérivée par la suite, écrite par Martin, n’est pas exclue.
De nombreuses critiques féministes ont fait remarquer que trois femmes ont été « gratuitement » violées dans la série, dans des scènes brutales qui ne figurent pas dans le livre ; plus généralement, ces critiques voient les séries de la chaîne HBO comme étant « mâlecentriques », car les personnages féminins sont souvent au service d’un protagoniste masculin, du point de vue du scénario. En 2014, Maureen Ryan a écrit dans Huffington Post qu’en quatre décennies, HBO n’a diffusé qu’une seule série dramatique créée par une femme. En défense de Game of Thrones, Benioff et Weiss reprennent l’argument de l’auteur George R. R. Martin que la série est ancrée dans le Moyen Âge, et qu’elle reflète logiquement le sexisme et la violence de l’époque. Dont acte, mais Porn Hub prétend que les visites au site ont baissé de 4% lors de la diffusion aux États-Unis du premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones, et que les recherches de vidéos pornographiques liées à la série ont augmenté de 370% juste après la diffusion.
Gain financier ou gain créatif, lequel prévaudra ? La décision de terminer la série sera de toute évidence difficile pour HBO, d’autant que l’audience continue à progresser (20,2 millions par épisode pour la saison 5 aux États-Unis). Contre cela s’y joue la réputation de la chaîne câblée, et le risque d’une saison de trop, à même de gâcher sa postérité critique. Série complexe, et comparable à bien d’égards, Lost (2004-10) se présente comme l’exemple même de fin complètement ratée. Par contre, on juge que The Sopranos (1999-2007) et Breaking Bad (2008-13) ont réussi leur « mort », après six et cinq saisons respectivement.
C’est dire qu’un prolongement après six saisons devient problématique pour n’importe quelle série. D’après les idées reçues en vigueur, même la série la plus formulaïque (Les Experts) a besoin alors d’un reboot, ne serait-ce que pour ralentir son déclin inévitable. Traditionnellement, le reboot implique l’introduction de nouveaux personnages, parfois de la famille des protagonistes (stratégie risquée (24 heures chrono)), sinon la sexualisation des relations entre personnages existants (stratégie très risquée (Les Experts), mais rentable en cas de succès (Bones)). Pour une série radicalement feuilletonnante comme Game of Thrones, cela devient encore plus difficile en raison du nombre de personnages et de trames narratives en jeu. Benioff et Weiss ont déjà déclaré qu’ils veulent terminer Game of Thrones sur « la note la plus épique possible ». Ils sont conscients que sa production exige pour tous un travail épuisant, et estiment qu’ils ne pourront plus produire 10 épisodes dans un délai de 12 mois, car la série sort du cadre télévisuel pour rejoindre celui d’un film à moyen budget (en moyenne 6 millions $ par épisode). « On veut terminer debout, on aime trop cette série », dit Benioff. Beaucoup de personnages de Game of Thrones n’ont pas eu ce privilège.
Sources : « Game of Thrones’ stars weigh in on fantasy drama’s looming end« , The Hollywood Reporter, avril 15, 2016 ; « Game of Thrones considers shortened final seasons« , Entertainment Weekly, avril 14, 2016 ; « Game of Thrones will spoil the ending of George R.R. Martin’s books« , Cinema Blend, avril 2015 ; « Game of Thrones’ creators mull shorter final seasons« , Variety, avril 14, 2016 ; https://mic.com/articles/87169/here-s-how-much-it-costs-to-make-a-game-of-thrones-episode#.lXHvcbHyq ; « Why is HBO flailing ? Because its shows turn women into sex objects » (Maria Teresa Hart), Washington Post (syndication) ; « How Game of Thrones affects porn consumption » (Simone Mitchell), news.com.au (syndication).
La série « X-Files » est de retour (#40, mars 2016)
X-Files est revenu sur la chaîne Fox en janvier, dans une minisérie de six épisodes (« event series »), actuellement diffusée sur M6. Le premier et le sixième épisodes revisitent le grand thème d’une conspiration extraterrestre, alors que les autres proposent des intrigues autonomes (stand alone). Déjà, en 2008, les deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, s’étaient réunis dans un deuxième film, X-Files : Régénération (Chris Carter), qui avait pris le parti de ne pas renouer avec la mythologie extraterrestre. L’échec commercial du film, jugé faible par les fans et par les critiques, a laissé penser que la page était définitivement tournée. Deux facteurs ont contribué à la réanimation de la série. D’abord, on estime que le climat politique aux États-Unis est de nouveau compatible avec l’ambiance paranoïaque de la série, après les révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage des citoyens pratiqué sur une grande échelle par la National Security Agency (NSA), avec la complicité de Google entre autres (Actualités #29) ; Snowden est explicitement mentionné dans le premier épisode. Ensuite, surpris au forum Comic-Con 2013 à San Diego par l’enthousiasme des fans de la bande dessinée inspirée par la série, David Duchovny (Mulder) a su convaincre la Fox de se lancer de nouveau sous forme de minisérie, qui laisse les options ouvertes pour Fox et pour les deux comédiens principaux (à noter que Gillian Anderson a dû se battre pour obtenir la même rémunération que son partenaire).
D’évidence, ce qui est visé en premier lieu, c’est le marché de la nostalgie, vu comme tremplin pour se lancer à la conquête de nouvelles audiences, car contrairement à d’autres relances anecdotiques (Dallas 2012-14, 40 épisodes à faible audience sur TNT ; Le Prisonnier, 2009, 6 épisodes sur AMC), on retrouve les comédiens d’origine, vieillis : Duchovny a 55 ans, et Gillian Anderson (Scully), 47 ans. Le besoin de nostalgie est évoqué par Anderson : « Je me rends compte que, même si certains s’attendaient à quelque chose d’aussi révolutionnaire qu’à l’époque, ce n’est pas vraiment ce que le public désire. Ils veulent que ce soit comme avant… Il ne faut pas essayer de réparer ce qui n’est pas cassé » (Variety). Dans la foulée, on apprend que cette année, le réalisateur David Lynch commencera le tournage (pour la chaîne de câble Showtime) d’une troisième saison de neuf épisodes de Twin Peaks, toujours avec l’acteur de la série originale d’il y a 26 ans, Kyle MacLachlan. CBS prépare le tournage du pilote d’un reboot de MacGyver (1985-92), situé sept ans avant la série originale (prequel), et la Fox a annoncé une nouvelle event series réunissant les acteurs originaux de Prison Break (2005-09).
La réaction critique à la reprise de X-Files a été plus que mitigée ; le blogueur Pierre Sérisier sur le site du Monde est particulièrement cinglant (« ce retour est avant tout une exploitation sans fard de la nostalgie et pas grand-chose de plus »). Écrivant dans la revue professionnelle américaine Variety (lien ci-dessous), la critique Maureen Ryan a parlé d’une saison « inexplicablement bâclée » : « c’était comme si quelqu’un avait mis un assortiment d’éléments provenant de la série originale dans un mixeur et avait servi la bouillie résultante en de grands tas d’exposés lourdingues ». Le premier épisode (« My Struggle ») a tout de même été regardé par 16,2 millions (21,4 millions en incluant le visionnage en différé), un bon score dans l’écosystème télévisuel actuel ; le sixième est tombé à 7,6 millions, ce qui fait une moyenne honorable de 9,53 millions. (Par comparaison, une autre event series de la Fox, 24 : live another day (2014), n’a eu qu’une audience de 8,08 millions pour le premier épisode, et 6,47 millions pour le douzième et dernier ; il n’empêche, une nouvelle saison, sans Kieffer Sutherland, est en préparation).
En attendant l’annonce officielle de la Fox, Chris Carter se dit convaincu qu’il y aura une onzième saison, plus étoffée. Écrivant dans Variety (lien ci-dessous), le journaliste Brian Lowry affirme qu’un renouvellement n’est pas gagné d’avance, et que l’absence d’annonce à cet effet suggère que la Fox hésite. Le problème, selon lui, est que, contrairement à des séries comme 24 qui peuvent intégrer assez facilement de nouveaux personnages, un prolongement convaincant de X-Files risque d’être difficile, compte tenu de sa structure complexe, et de sa dépendance des deux comédiens principaux. Selon Maureen Ryan, également dans Variety, « il faudrait reprendre sérieusement en main la série, laissée maladroitement dans un état désordonné ». Quoi qu’il en soit, la résurrection des séries anciennes, parfois sous forme de reboot, est devenue une tendance lourde de la télévision américaine.
Mise à jour, janvier 2019. La saison 11 de X-Files (10 épisodes), mieux reçue par les fans et les critiques que la saison précédente, a finalement été diffusée aux États-Unis entre janvier et mars 2018. Les audiences ont été toutefois relativement modestes : 5,15 millions aux États-Unis pour l’épisode 1, 3,43 millions pour l’épisode 10. Une éventuelle douzième saison n’a toujours pas été confirmée. Quant à 24, une dixième saison spinoff de 12 épisodes (24 Legacy), où seul le personnage de Tony Almeida restait de l’original, a été diffusée entre février et avril 2017, avant l’annulation de la série en juin 2017 (audience moyenne 5,12 millions, tombant de 17,57 millions pour l’épisode 1 à 3,42 millions pour l’épisode 12). Un nouveau spinoff, avec un éventuel retour de Jack Bauer (Keifer Sutherland), mais se passant cette fois-ci dans le monde juridique et avec un personnage principal féminin, est en discussion ; autrement dit, seule la forme « anthologique » subsisterait. Un autre spinoff sur la vie antérieure de Jack Bauer (prequel) est également en discussion (annonce de la Fox, 30 juillet 2018). Sauf exception et donc erreur de ma part, les séries « ressuscitées » n’ont jamais réussi jusqu’ici à reprendre vie de manière convaincante.
Voir : https://www.denofgeek.com/us/tv/the-x-files/271879/the-x-files-season-12-status-in-question ; https://deadline.com/2017/11/24-series-comeback-female-lead-fox-franchise-1202199024/ ; https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a858935/24-kiefer-sutherland-jack-bauer-return-lorraine/.
Sources : « X-Files, les affaires reprennent » (Alexandre Hervaud), Libération, 23/24 janv. 2016 ; « The X-Files : How Fox revived Mulder and Scully’s search for truth » (Geoff Berkshire), Variety, jan. 19, 2016 ; « The X-Files – un retour bien laborieux » (Pierre Sérisier), site du Monde, posté 25 janv. 2016 ; « The X-Files (season 10)« , entrée wikipedia ; « 24 : live another day« , entrée wikipedia ; site « TV series finale » (le reboot de « MacGyver« ), posté le 24 fév. 2016 ; https://tvline.com/2016/02/22/x-files-season-11-spoilers-william-chris-carter-interview/ ; https://variety.com/2016/tv/columns/x-files-revival-finale-renewal-prison-break-24-1201712314/ (Brian Lowry) ; https://variety.com/2016/tv/features/the-x-files-season-finale-review-my-struggle-ii-1201712181/(Maureen Ryan).
« CSI » (« Les Experts ») tire sa révérence (#36, novembre 2015)
La chaîne américaine CBS a annoncé l’arrêt de la CSI : Crime Scene Investigation, après 15 saisons et 337 épisodes. La série a pris fin avec la diffusion d’un téléfilm de deux heures le 27 septembre intitulé Immortality, qui voit le retour de trois acteurs ayant quitté la série : William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows) et Paul Guilfoyle (le capitaine Jim Brass). Il se termine – spoiler faible – avec la reprise de l’idylle entre Grissom, devenu écologiste de mer, et Sarah Sidle, qui décline une promotion pour partir en bateau avec lui. Lancée en octobre 2000, CSI a été pendant quelques années (2002-04) la série la plus regardée aux États-Unis avec 26 millions de téléspectateurs réguliers par épisode, et la plus regardée au monde avec 73,8 millions de téléspectateurs dans environ 150 pays en 2009. Elle a commencé son lent déclin aux États-Unis en 2007 (20,34 millions), tombant à 11,2 millions en 2015. En France, TF1 l’a retransmise depuis novembre 2001 (d’abord le dimanche après-midi, et depuis 2005, en prime time) : à son apogée, elle a drainé 11,1 millions de téléspectateurs et n’est jamais tombée en dessous de 4 millions.
« Quand on a présenté la série à CBS, expliquait William Petersen, acteur principal et l’un des producteurs exécutifs, dans une interview en 2009 lors de son départ, elle était un peu sceptique : « vous voulez faire une série mettant en scène des gens qui analysent des empreintes digitales ? ». Mais l’intérêt était de montrer à l’image ce qu’ils voyaient à travers les microscopes, leurs diverses expériences de laboratoire, et de vulgariser la science médico-légale. Les gens aiment résoudre les énigmes. On savait qu’il y aurait de l’audience, mais personne ne s’attendait à un tel succès. » Dans un documentaire consacré à la série en 2007, le producteur Anthony Zuiker prétendait : « On a commencé en 2000, et ce fut un succès, mais le taux d’audimat a vraiment décollé après les attaques du 11 septembre [2001]. Les gens se sont précipités vers nous pour leur nourriture de confort. Dans CSI, il y avait un sens de justice ; c’était bien de savoir qu’il y avait des gens comme nos personnages qui aidaient à résoudre des crimes. Et bien sûr, 9/11 était la plus importante scène de crime au monde ».
CSI a donné naissance à trois séries dérivées : CSI : Miami (2002-10, 232 épisodes), CSI : NY (2004-13, 197 épisodes) et CSI : Cyber (2015-16, 31 épisodes [précision ajoutée, janvier 2019]). Cette dernière série s’est focalisée sur des enquêtes dans le monde virtuel plutôt que de la science médico-légale.
Sources : Le Monde, 27-28 septembre 2015, p. 24 ; entrées Wikipedia « CSI », « CSI franchise » (anglais).
Les mots de Petersen, et de Zuicker, complaisamment relayés par l’article du Monde, relèvent plutôt de l’autopromotion (qui s’appelle plus familièrement « la com »). Il ne faut pas s’attendre à autre chose de la part de personnes aussi impliquées, mais les analyses universitaires et journalistiques peuvent être aussi lénifiantes à leur manière. Les discours d’escorte de cette série ont toujours insisté sur sa dimension scientifique, voire pédagogique et humaniste, alors que la science en question comporte des scènes d’autopsie macabres, qui n’épargnent aucunement le téléspectateur quant à la réalité biochimique de la décomposition des cadavres. Clairement, la série renvoie plus à une forme de pornographie morbide qu’à un engouement pour la méthode scientifique, qui n’influe pas ici sur la société des vivants. Nul meilleur monde en devenir. Quant au producteur Zuiker, enclin à des justificatifs pseudo-philosophiques, le lien (mystérieux) qu’il avance entre les attaques terroristes du « 9/11 » (le 11 septembre 2001), et le « décollage » de CSI ne résiste pas à un regard un tant soit peu critique. La première saison de CSI (2000-01), diffusée intégralement avant « 9/11 », a attiré 20,8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode ; la deuxième saison, qui a débuté quelques semaines après les attaques, 23,7 millions. L’audience de la série a donc été largement réalisée dès sa première saison.
Cela dit, la série a fait preuve d’une longévité exceptionnelle, cinquième de tous les temps aux États-Unis (si l’on exclut quelques dessins animés), après Gunsmoke (635 épisodes, 1955-75), Law and Order (New York District en français) (456, 1990-2010), Lassie (pour enfants, le personnage principal étant un chien, 591, 1954-73), Law and Order : Special Victims Unit (New York Unité spéciale) (368, série en cours, depuis 1999). Ce que ces séries ont en commun, c’est une formule exceptionnellement stable et prévisible. Si Gunsmoke et Lassie relèvent de la série classique avec un minimum de personnages récurrents, les autres font partie de la série moderne avec de multiples personnages, et des éléments feuilletonnants, ici relativement faibles. Les arrivées et les disparitions de personnages récurrents ne déstabilisent pas l’assemblage de base. Dans CSI, l’expression (minime) de la personnalité est limitée sauf exception à la sphère professionnelle, ce qui va de pair avec des intrigues squelettiques (au moins deux enquêtes par épisode de 42 minutes), sans intensité émotionnelle.
Le précurseur des séries médico-légales fut la britannique Silent Witness (Autopsie en vf), diffusée depuis 1996 sur la BBC, et toujours en production à un rythme de 4 à 6 épisodes de deux heures par an. Comme sa longueur l’indique, elle est plus conséquente d’un point de vue dramatique. Diffusée aux États-Unis sur BBC America, elle a dû influencer CSI, notamment dans sa conception du cadavre comme un témoin privilégié (« qui ne ment pas »), même si Zuiker attribue son inspiration à un documentaire sur la chaîne Discovery. En dehors de ses propres franchises, CSI a mené à la création d’autres séries comportant des autopsies, notamment Bones (212 épisodes depuis 2005), Rizzoli & Isles (86 épisodes depuis 2010), Body of Proof (42 épisodes, 2011-13), et dans une certaine mesure NCIS (285 épisodes depuis 2003). Il est probable que le cycle de séries médico-légales touche à sa fin, en même temps que celui des émissions de télé-réalité.
Pour une analyse critique de CSI, voir mon livre Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan, 2010), pp. 103-19.
Les séries françaises (#35, septembre 2015)

Delphine Ernotte-Cunci, nouvelle présidente de France Télévisions, a confirmé, lors d’un déjeuner organisé par l’Association des journalistes médias le 31 août, qu’elle souhaitait mettre en place de nouvelles règles pour la production des séries, notamment la commande de pilotes (premiers épisodes tests). La courbe des audiences des fictions françaises, particulièrement sur France 2 (une moyenne de 4 millions de téléspectateurs en 2015), est en forte hausse face aux séries américaines. Avec le système du pilote de 52 minutes, qui demanderait une mise de 700 000 euros (éventuellement cofinancée par le producteur), on pourrait vérifier la viabilité du projet avant de s’engager pour une saison entière (qui coûte autour de 5 millions d’euros). Emmanuel Daucé, codirecteur du département création de séries à la Fémis et coproducteur de nombreuses séries (dont Un village français), y voit un signe très encourageant : « Cette mesure permettrait à tous les auteurs et producteurs de sortir de cette pyramide de la peur et, surtout, de stopper cette machine infernale de négociations sans fin qui tuent le désir d’écriture et de création. Les responsables des unités de fiction ne peuvent plus se contenter de s’appuyer sur quelques lignes écrites sur du papier. Le texte est une démarche intellectuelle alors que l’image fabrique de l’émotion. »

Jean-François Boyer, producteur (Un village français, Les hommes de l’ombre) et président du groupe Tetra Media est, lui aussi, très enthousiaste : « Ce dispositif de « recherche-développement » pourrait concerner une partie des 250 millions d’euros que le groupe public consacre chaque année à la fiction. Mais l’investissement dans un pilote développé ferait gagner du temps – et donc de l’argent – à France Télévisions. Il investirait d’emblée dans des séries de qualité qui s’exporteraient mieux à l’étranger et donc lui rapporteraient plus d’argent. Surtout, ce dispositif attirera les meilleurs auteurs : ils auront la garantie que leur projet devienne un film à court terme. France Télévisions deviendrait « la maison des auteurs ». Enfin, cela permettrait de sortir de la dictature de l’Audimat, qui freine tout le système de production. »

Sortir de la dictature de l’Audimat ? Bigre ! On peut avoir l’impression que l’on exagère les bienfaits des pilotes à l’américaine. Bien entendu, il faut faire la part des intérêts corporatistes (Boyer parle de producteurs bien adaptés au système actuel qui ne veulent surtout rien changer), mais d’autres ont tout de même des arguments à faire valoir. Fabrice de la Patellière, directeur de la fiction sur Canal+, est sceptique par rapport aux pilotes : « À la différence des États-Unis […], ce marché n’existe pas en France. L’investissement financier dans un pilote sous la forme d’un épisode est économiquement impossible pour Canal, où l’on produit essentiellement des séries feuilletonnantes avec des épisodes qui avoisinent le million d’euros. » Pour sa part, justifiant le refus des pilotes, Olivier Wotling, directeur de l’unité fiction d’Arte, pense que cette politique est prématurée. Selon lui, la diversité et la structure du tissu de producteurs en France ne permettent pas une grande réactivité dans la mise en production rapide de séries.

Tout n’est pas donc si simple. Même s’il se réjouit de l’engagement de France Télévisions, Guilhem Cottet, délégué général de la Guilde des scénaristes, se sent obligé de nuancer : « Tout ce qui peut favoriser une prise de décision plus rapide est le bienvenu. Il y a toutefois un modèle économique à trouver autour du pilote, qui passe, en premier lieu, par la mise en place de véritables ateliers d’écriture qui font défaut sur les séries. » L’autre bémol vient de l’entourage de Delphine Ernotte : « Ce système [de commandes de pilotes] ne s’appliquerait que pour quelques projets et dans les limites des finances de France Télévisions. » La dotation d’État à l’audiovisuel public doit être supprimée en 2017, afin que celui-ci ne dépende plus que de ses ressources propres (en dehors de la redevance et des taxes sur les fournisseurs d’Internet), ce qui n’est pas réaliste de l’avis de beaucoup de professionnels concernés. Affaire donc à suivre.
En attendant, les séries Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, Deux flics sur les docks, Cherif, Candice Renoir, Nina, Accusé ont été reconduites sur France 2 ; Dix pour cent (Cédric Klapisch) et Malaterra (adaptation française de Broadchurch) débutent.
Sources : « Y aurait-il un pilote dans les séries », Le Monde, 7 septembre 2015, p. 24 ; entretien avec Jean-François Boyer, idem.
L’Europe des séries : passage en revue (#34, septembre 2015)
Pendant la période estivale, Martine Delahaye du journal Le Monde a passé en revue la situation dans diverses télévisions européennes par rapport à la production de séries, en publiant pendant six semaines un entretien avec un(e) professionnel(le) fortement impliqué(e) dans l’avenir de la télévision de son pays. Le Royaume-Uni, producteur historique de séries pour le marché international, et à ce titre un cas à part, n’a pas été traité. La Web-revue résume ici les points marquants des propos tenus, d’autant plus passionnants qu’ils sont sujets à débat.
La France

Marc Nicolas, directeur de la prestigieuse École française de cinéma (la Fémis), estime que le sous-développement de la télévision par rapport au cinéma en France est en train d’évoluer rapidement, et que la phase historique qui a privilégié la production de téléfilms unitaires de 90 minutes (plutôt que de séries) s’achève. Il faut préciser que son optimisme (stratégique, car c’est lui qui a lancé un cursus de formation au scénario de séries en 2013, voir Actualités #8) n’est pas partagé par tous les acteurs du secteur, qui insistent sur la frilosité créative de la télévision française (surtout France 2, on ne parle même pas de TF1), et sur son mode de fonctionnement en crise. Symptomatiquement, Canal+, où la fonction de showrunner existe déjà depuis peu, est la seule chaîne évoquée par Nicolas, dont on peut difficilement contester le diagnostic. (Certaines de ses préconisations ont déjà été adoptées en Belgique francophone, voir ci-dessous).
« La télévision va être dominée par les séries […] Il y a quelques années encore, on pouvait croire que les séries étaient des objets typiquement anglo-saxons. Mais on a vu qu’Israël, le Danemark ou la Suède, avec des budgets modestes, réussissaient à créer des séries de grande qualité. Du coup, la France a commencé à pâlir et à prendre cela au sérieux. […] Toutes les industries de la planète réalisent un premier épisode, un « pilote » avant de se lancer dans la production d’une série, sauf nous ! […] On a déjà aligné toutes les erreurs possibles, ça ne peut que s’améliorer […] [À] l’horizon de cinq ans, nous aurons en France des séries d’une qualité incontestable, le temps que les mécanismes se mettent en place.
« Ce qui manque encore en France, outre les pilotes, c’est de créer des séries en quantité. À réaliser beaucoup plus de séries, on mettra fin à la crainte de l’échec de la part des décideurs […] [U]ne politique ambitieuse amènera à faire disparaître cette absurdité que vit encore la France, celle de n’avoir aucun laboratoire, alors que là encore, il en existe par nécessité dans toutes les industries. Nous nous devons de disposer d’un lieu qui soit à la fois un terrain d’expérimentations et une poubelle géante, pour que les créateurs puissent s’essayer à toutes sortes d’expériences et même se planter […]
« Avec la sérialité, pour diriger et unifier toutes les équipes, il faut absolument un auteur, à l’image du réalisateur au cinéma. Il ne s’agit donc plus de se demander si, oui ou non, nous aurons des showrunners en France, mais plutôt quand. Cela dit, il n’existe pas de pureté du genre, pas de procédé-type, avec une manière idéale et unique de travailler ; ni aux États-Unis, ni en France. »
L’Italie


Luca Milano est directeur adjoint de la fiction au sein de la RAI, le groupe de chaînes publiques italiennes. D’après lui, l’arrivée il y a trois ans d’Eleonora Andreatta à la tête de la fiction a renouvelé le genre. Elle a demandé des thèmes plus contemporaines, et a aussi favorisé des séries plus longues au lieu des miniséries, après une période de réductions budgétaires qui a pris fin en 2015. Les séries policières, dont on crée quatre ou cinq par an, s’ouvrent davantage aux problèmes actuels comme l’influence de la mafia, et la corruption politique. Milano cite le festival « Série Séries » de Fontainebleau comme une influence déterminante ; c’est là qu’il a rencontré les producteurs scandinaves et appris la façon dont ils travaillent pour créer des séries. La série italienne la plus populaire reste la très classique Commissaire Montalbano (RAI1) qui cartonne depuis 1999 ; sur cette base, le titre phare proposé à la rentrée sera Le jeune Montalbano qui revient sur les débuts du commissaire sicilien. À noter aussi la production par le bouquet payant Sky Italia de 1992 (10 x 50 minutes), qui raconte l’ascension de Berlusconi vue par un publicitaire, avec un mode de production à l’américaine ; les trois jeunes auteurs ont été présents du début à la fin de celle-ci, chose rare en Italie. Une suite 1993 est en cours d’élaboration.
« Nous avons une grande tradition de production de fiction télévisée. Les Italiens préfèrent de loin les séries italiennes aux séries étrangères, contrairement aux Français, qui regardent énormément de séries américaines. C’est simple : en Italie, aucune des deux chaînes principales, RAI1 et Canal 5 (du groupe privé Mediaset) ne diffuse de série américaine en début de soirée. […] Nous [le RAI] produisons les deux-tiers de la fiction du pays, et les séries marchent très bien à condition d’avoir une forte identité italienne […] Nous ancrons nos séries dans notre culture, nos particularismes, notre terroir.
« Nous avons déjà collaboré avec des chaînes privées espagnoles comme Tele 5 ou Antena 3, mais seulement pour des mini-séries […] En fait, il est difficile de trouver des sujets européens qui parlent très directement au grand public italien […] Il est plus facile de coproduire avec des pays étrangers pour les chaînes payantes, de type Canal +, car leurs abonnés sont plus jeunes et moins traditionnels. »
L’Allemagne

Anna Katharina Brehm a travaillé pour la chaîne publique ZDF en tant que directrice de production. Elle a fait partie pendant l’année 2013-14 de la première promotion très sélective d’une formation à l’écriture de séries à Berlin (Serial Eyes), proposé par l’Académie allemande du film et de la télévision. Elle vient de monter sa propre structure de production à Munich. Selon elle, l’avenir des séries en Europe réside dans des coproductions entre pays, et entre chaînes publiques et privées, la télévision allemande étant restée trop longtemps centrée sur le marché interne. Toujours selon elle, les jeunes producteurs allemands veulent rattraper le retard par rapport aux États-Unis et, ce qui pourrait surprendre, par rapport à la France.
« Les séries allemandes les plus populaires sont des policiers très traditionnels comme Tatort (Sur les lieux du crime) crée en 1970 et toujours diffusée sur la chaîne publique ARD, le dimanche à 20h15. Cela dit, nous regardons aussi pas mal de séries américaines, surtout sur des chaînes privées […] Les quelques séries d’envergure réalisées en Allemagne jusqu’ici, Heimat, Generation War, ou encore Deutschland 83 dont la diffusion est prévue pour la rentrée, s’exportent très bien ; mais elles ne s’intéressent qu’à l’histoire, au passé de notre pays. J’ai cependant le sentiment que se préparent en ce moment de très bonnes séries allemandes sur le temps présent, sur notre société, nos problèmes et notre identité […] Or, on sent bien, actuellement, un grand désir de produire des choses de plus grande qualité, de raconter des histoires d’intérêt international, afin de répondre à l’engouement des jeunes pour un nouveau type de série et de nous mesurer aux autres, à l’intérieur du marché européen… Voilà vingt ans que les États-Unis ont fait évoluer leurs séries vers de la grande qualité ; la France s’y est mise il y a dix ans, et nous venons tout juste de commencer.
« Je ne ressens pas de confiance envers nos auteurs en Allemagne. Leur statut en Grande-Bretagne ou en Scandinavie est reconnu et respecté […] Un auteur, c’est quelqu’un qui a une histoire en tête, et qu’il est le seul à pouvoir raconter. Nous, nous concentrons toute notre attention sur les réalisateurs, comme au cinéma […] À mes yeux, les mieux à même de créer de bonnes séries à l’avenir ne sont pas ceux qui, jusqu’ici, avaient l’habitude d’écrire des films, de cinéma ou de télévision. Dans les maisons de production, beaucoup considèrent que films et séries ne sont pas très différents […] Pas moi.
« Il m’est apparu évident que, à créer autant de séries, et pour autant de canaux différents, les États-Unis sont à la recherche de concepts originaux, à l’affût d’idées étrangères novatrices qu’ils pourraient adapter à leur pays et à leur langue […] C’est une fantastique opportunité, car nombre d’histoires ne peuvent être racontées que par nous : pensez à Borgen par exemple, à la fois si danoise et si universelle ! Je suis maintenant persuadée que les échanges entre l’Europe et l’Amérique vont s’intensifier. »
L’Espagne
L’Espagne produisait beaucoup de téléfilms unitaires jusqu’en 2006. Dorénavant, elle en achète pas mal à la France ou à l’Allemagne, mais ceux-ci n’ont jamais fait une très bonne audience. La Télévision de Catalogne a souvent été pionnière pour de nouveaux formats de séries, mais depuis trois ans son budget fiction s’est sensiblement diminué. Aujourd’hui, l’Espagne produit surtout des miniséries de quatre à six épisodes, et lorgne vers les coproductions de prestige. Mais la crise (et le chômage massif des jeunes, à plus de 50%) sévit…

Jaume Banacolocha est PDG de Diagonal TV (groupe Endemol), une des plus grandes boîtes de production de fiction en Espagne, et travaille tantôt pour la télévision publique (TVE), tantôt pour la chaîne commerciale Antena 3. À son actif, des séries historiques comme Isabel (trois saisons diffusées, dont la première à perte), et surtout Charles, Rey Emperador (saison unique de 17 épisodes coproduite par la TVE, la chaîne de Catalogne et le ministère catalan de la culture) qui vise aussi les marchés allemand, français et flamand. Prochainement, pour la chaîne privée Antena 3, il coproduira avec des partenaires espagnols, allemands (et peut-être français et italiens) La Cathédrale de la Mer, une mini-série de huit épisodes qui racontera la construction de la basilique Sainte-Marie-de-la-Mer au XIVe siècle à Barcelone.
« [A]vant la crise, la chaîne Antena 3 s’adressait avant tout aux jeunes, ceux qui regardent Les Simpsons par exemple […] À cette époque, les jeunes regardaient la télévision et disposaient d’argent qu’ils dépensaient facilement. Aujourd’hui qu’ils sont sur leurs tablettes et n’intéressent plus les publicitaires, il faut plutôt concevoir des séries pour les 45 ans et plus, qui ont remboursé leur maison et ont, donc, un vrai pouvoir d’achat ; des adultes qui cherchent des séries plus difficiles que les très jeunes. […]
« De manière générale, coproduire est très difficile en Espagne, parce que la tradition veut que les chaînes espagnoles assument seules le coût des programmes et en gardent tous les droits d’exploitation. »
La Belgique

La Belgique a deux télévisions distinctes : celle de la Flandre et celle de la Wallonie. Depuis quinze ans, la télévision flamande produit beaucoup de téléfilms et de miniséries, fortement identitaires, mais qui réussissent à s’exporter. Par contre, la télévision belge francophone a produit très peu de fiction par le passé, car la télévision française est disponible dans tous les foyers (la Belgique est câblée à 98%). En 2013, la RBTF (Radiotélévision belge francophone) et le gouvernement de la Communauté française (la Wallonie et Bruxelles) ont décidé de développer une « industrie » de production de séries à partir de zéro, se donnant l’objectif ambitieux de produire quatre séries de 10 épisodes chaque année dès 2019. François Tron est directeur de la télévision à la RTBF, qui comprend trois chaînes plus Arte Belgique. Sa devise : « make local, think global », c’est-à-dire évoquer des sujets universels dans un cadre culturel national.
« [U]n mouvement de fond s’est généralisé en Europe : la fiction « locale » attire de plus en plus de public, dépassant même les séries américaines, longtemps hégémoniques. À quelques exceptions près, dont la France, les fictions nationales font désormais partie des cinq ou dix meilleures audiences annuelles sur les chaînes publiques européennes. Quant aux séries américaines, elles n’ont pas perdu leur potentiel d’audience, mais sont de plus en plus suivies sur Internet, parfois même quelques heures après leur diffusion aux États-Unis […] Ce qui amène nécessairement à se demander si – et jusqu’à quand – les chaînes de télévision resteront le modèle dominant pour consommer des images. […]
« Pour favoriser l’émergence d’une autre offre, nous devions donc nous appuyer sur la créativité d’un tissu de production déjà existant et très développé : celui du cinéma. Pour autant, nous travaillons avec des budgets bien sûr modestes : l’épisode belge [d’une série] de 52 minutes coûte environ 240 000 €, quand celui de la France tourne autour de 1,3 million € et celui du Royaume-Uni autour de 560 000 € en moyenne.
« Nous avons un mot d’ordre : [chaque projet] doit entrer en résonance avec l’identité belge, être ancrée dans le contemporain ou la société […] Peu importe le genre. Cela dit, les thématiques peuvent être transgressives, car en Belgique, le rapport à la création s’avère plus libre qu’en France. [Il citera plus loin l’exemple d’Ennemi public, prévu en 2016, où il s’agit d’un assassin d’enfants sorti de prison qui est recueilli dans un monastère…]
« Une fois un projet retenu et lancé en développement, nous finançons un pilote de dix à quinze minutes […] Présents sur le tournage, les auteurs sont très impliqués dans la réalisation de leur scénario. En un mot, nous expérimentons. Tout ne fonctionnera pas, mais j’espère que nous allons irriguer le tissu créatif belge : avec les professionnels du cinéma, mais aussi en jouant le rôle de pépinière d’auteurs, de réalisateurs, de producteurs, certains se formant sans filet, d’autres recevant une formation prévue à cet effet. »
La Suède

Ne comptant que 9 millions d’habitants et condamnée à des budgets réduits, la Suède achète beaucoup de séries américaines et britanniques que, par tradition, elle diffuse en version originale sous-titrée. Ses propres séries sont souvent cofinancées avec la Norvège et le Danemark, avec qui elle partage une forte affinité culturelle. Les sous-titres s’imposent lorsque l’intrigue se déroule dans plusieurs pays scandinaves, même si les langues de ceux-ci appartiennent au même groupe linguistique. Depuis quinze ans, la chaîne publique allemande ZDF coproduit ou préachète ses séries policières, grande spécialité scandinave. La chaîne publique suédoise SVT tourne actuellement, en coproduction avec Canal +, la minisérie policière Jour polaire (8 épisodes de 52 minutes), dans laquelle une équipe mixte suédoise et française mène l’enquête dans la ville minière de Kiruna, au-delà du cercle polaire, la victime étant française. Trois langues y sont utilisées : le suédois et le français pour que chacun s’exprime avec ses compatriotes, et l’anglais entre personnages n’ayant pas de langue commune. Ce réalisme décomplexé quant au pluralisme linguistique qu’impliquent logiquement les coproductions entre partenaires non anglophones « égaux » semble être l’apport principal au renouveau des séries européennes de la Suède, plus habituée au sous-titrage.
Stefan Baron, producteur de la série remarquée Real Humans, est actuellement responsable des coproductions internationales au sein du groupe privé suédois Nice Entertainment Group, qui coproduit la série Jour polaire. Jusqu’au début 2014, il était directeur de la fiction au sein de la télévision publique suédoise SVT.
« Même les Britanniques qui, auparavant, n’auraient jamais supporté des fictions sous-titrées, [les] acceptent désormais pour pouvoir découvrir les séries de qualité produites un peu partout dans le monde. Et certaines compagnies américaines, comme HBO ou Netflix, se sont également mises aux sous-titres […] Il nous semble que les jeunes, aujourd’hui, veulent voir les bonnes séries en version originale : cela fait partie de la qualité et de la « couleur » d’une fiction ambitieuse. […]
« C’est compréhensible que des productions internationales soient tournées en anglais, et encore, en anglais américain pour ce qui concerne les États-Unis. Mais les créations en langue originale représentent un grand potentiel, même à l’international. L’idéal, pour un diffuseur, consiste à offrir un choix, comme le fait Canal + : le doublage en français pour ceux qui ne supportent pas les sous-titres et la langue originale pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus « vrai ». »
Difficile de tirer immédiatement des conclusions globales de ce passage en revue de la production des séries en Europe, tant les situations nationales diffèrent. Tous les propos sont dignes d’intérêt ; il faut, bien entendu, faire la part aussi de ce qu’ils contiennent de promotion ou de défense des intérêts professionnels. Mais indéniablement, il y a un regain de qualité dans les séries européennes depuis quelques années, comme en atteste la dernière édition du festival Séries Mania, tenue en avril 2015 au Forum des Halles, où j’ai pu voir le premier épisode de quelques séries primées : Blue Eyes (Suède), Strikers (Belgique flamande), False Flag (Israël), Le Bureau des Légendes (France) et Deutschland 83, toutes recommandées. Il est intéressant que, indépendamment, Marc Nicolas, Luca Milano et Anna Brehm citent l’influence des séries scandinaves dans ce renouveau, notamment Borgen (Danemark), et Real Humans (Suède). Très originale, souvent citée comme modèle et exportée dans 50 pays, cette dernière a néanmoins eu un taux d’audience un petit peu décevant en Suède elle-même. (Une adaptation en langue anglaise, Humans, a été diffusée en 2015 par l’américaine AMC et la britannique Channel 4). À noter également que pour une nouvelle génération de professionnels, la distinction entre chaînes privées et publiques s’opère beaucoup moins, et n’empêche pas de partenariats mixtes. Cette distinction historique, pertinente dans un cadre national, l’est beaucoup moins dans un marché international où la coproduction est la règle du jeu.
Un des facteurs qui ont permis aux séries européennes de se refaire une santé sur le marché international a été l’émergence de nouvelles normes établies par les séries câblées américaines vers la fin des années 1990 : entre 10 et 13 épisodes par saison au lieu des 24 exigés par les chaînes hertziennes (déjà moins que les 34 à 36 épisodes pour les séries westerns au début des années 1960), niveau d’industrialisation inatteignable en Europe. La tendance actuelle des chaînes hertziennes américaines est aux saisons courtes (16 épisodes), et symptomatiquement, la saison 9 (2014) de l’emblématique 24 heures chrono s’arrête à 12 épisodes.
Les nouvelles séries diffusées sur les chaînes câblées comme HBO tendaient vers la série feuilletonnante, synthèse instable de deux formes de sérialité dans une narration complexe qui mettait en avant les scénaristes et surtout le premier d’entre eux, le showrunner. Autrement dit, l’émergence de ce dernier est étroitement liée à un certain développement historique de la sérialité aux États-Unis. Lucide à cet égard, Marc Nicolas fait observer que les chaînes européennes ne sont pas obligées d’adopter le modèle américain de showrunner. Il y a en effet danger qu’à trop insister sur l’importance du scénariste (en réalité, dans le modèle américain, une équipe fortement hiérarchisée), on minore l’apport créatif, notamment esthétique, du réalisateur, traditionnellement vu comme un auteur en Europe, du moins pour le cinéma.

Il est surprenant qu’on n’aborde qu’indirectement la question de la vidéo à la demande, lente à démarrer en Europe, mais déjà conséquente aux États-Unis. Cela changera sûrement la donne en libérant des grilles programmées le consommateur (qui ne sera plus un téléspectateur), mais aussi en infléchissant la notion de sérialité. Sur le site d’un serveur vidéo, films et séries se proposent à titre égal, et la minisérie deviendra de fait un film prolongé et découpé en plusieurs parties, toutes disponibles d’avance. La question est abordée en creux par Jaume Banacolocha, qui entérine la migration des jeunes Espagnols vers l’internet, réservant la série télévisée à un public plus âgé, d’où des miniséries historiques (qui comportent le danger d’une « stéphanebernisation » de la fiction européenne). Plus inquiétante à moyen terme, selon la professionnelle néerlandaise Marina Blok, responsable de la diffusion de la fiction du service public NTR, sera la force de frappe internationale représentée par les géants de la vidéo à la demande, Netflix et Amazon, rejoints progressivement par les grands réseaux de téléphonie, qui commencent à produire des séries avec des moyens beaucoup plus importants que ceux dont disposent les petits pays européens. Propos confirmés par la nouvelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte-Cunci, dans un entretien (passablement langue de bois) publié dans Le Monde (25 août) : « Il faut aider à la production de contenus exportables et être moteur dans la coproduction européenne. […] Si vous me demandez si France Télévisions est prêt à affronter les concurrences d’Amazon et de Netflix, la réponse est : pas encore. C’est ça, mon enjeu ». (Le service public norvégien (NRK) s’est allié avec Netflix pour tourner les trois saisons de huit épisodes de la série remarquée Lilyhammer).

L’Allemagne et la Belgique s’affichent comme les pays le plus volontaristes à cet égard, avec des stratégies différentes. Alors que la Belgique joue le cadre national, l’Allemagne cherche à délaisser celui-ci en faveur de « séries d’intérêt international », c’est à dire adaptables au marché anglophone. À cette fin, elle a lancé des formations internationales dédiées à la scénarisation des séries : outre l’Académie allemande du film et de la télévision à Berlin (ci-mentionnée), on peut citer l’École internationale du film de Cologne, qui a inauguré en 2013 un master consacré au serial storytelling. En France, quant aux formations majoritairement dédiées à la scénarisation télévisuelle, le Conservatoire européen de l’Écriture audiovisuelle (CEEA, Paris), une école privée qui existe depuis 1996, a une longueur d’avance sur le cursus spécialisé de la Fémis, lancé en 2013 (voir ci-dessus). À l’université de Paris Nanterre, un master scénario et écritures audiovisuelles existe depuis 2008, et un DU consacré à l’écriture de la comédie (c’est-à-dire des sitcoms) va démarrer prochainement, les deux sous la houlette de Fabien Boully. En raison de l’étroitesse des débouchés dans un marché imprévisible, il va de soi que toutes ces formations sont fortement sélectives.
L’acceptation du plurilinguisme « à la suédoise » faciliterait le développement de séries européennes coproduites. Mais pour que celles-ci aient un intérêt réel, il faudrait qu’elles affrontent avec plus d’imagination les dérives morales et sociales de l’époque, et qu’elles anticipent les débats politiques à venir, la télévision britannique des années 1960 en constituant un exemple historique marquant, mais évidemment dépassé. On devrait se demander si le genre policier sous sa forme actuelle (où la couleur locale serait plutôt un vernis pour des intrigues par trop stéréotypées, et même surannées) n’y fait pas écran. La Web-revue est demandeuse de mémoires et de thèses critiques sur ce sujet « émergent ».
« Face à Netflix, enfin une réponse européenne », éditorial, Le Monde, 26 août 2015.
Sur Netflix, voir Actualités #25, nov. 2014, #30, avril 2015 ; sur Amazon, #28, fév. 2015.
Vidéos des tables rondes sur la coproduction des séries en Europe, organisées lors du festival « Séries Mania » 2015.
Patrick Macnee (« Chapeau melon et Bottes de Cuir ») est mort (#33, juillet 2015)


Alors que le fond idéologique (distillé dans des histoires loufoques, surréalistes) de Chapeau melon et Bottes de Cuir (1961-9) est résolument libéral (rétrospectivement, encore trop social-démocrate pour être néolibéral), du côté de la mode, et de la consommation démocratique et individualiste, prenant pour cibles tantôt la vieille garde réactionnaire (aristocrates, colonels à la retraite), tantôt les nouveaux riches vulgaires alliés aux scientifiques naïfs ou indélicats. Patrick Macnee lui-même était plutôt vieux jeu, son hobby fut l’observation des oiseaux, activité pas exactement dans le vent. Il n’aimait pas les films James Bond en raison de leur « sadisme horripilant », mais il trouvait « fascinant » les romans originaux d’Ian Fleming, où l’aspect réactionnaire du personnage est plus affirmé (un clubman très marqué à droite).

Dans son manque d’estime pour les films James Bond, il rejoignait son confrère Patrick McGoohan, dont Le Prisonnier (1967) est un exemple classique de l’esthétique pop à la télévision. Pour la petite histoire, McGoohan, très catholique, a refusé le rôle de James Bond car il n’y aimait pas « le sexe facile et la violence gratuite » : « Enlevez à Bond ses femmes et son talent avec un menu, et il ne reste pas grande chose » (TV Times, 26 sept. 1965, p. 2-3). Pour ces deux protagonistes d’une nouvelle approche de la télévision dans les années 1960, la ligne de fracture subjective passait par la franchise James Bond, un pont moderniste trop loin. On n’ose pas imaginer ce qu’ils auraient pensé de Game of Thrones.
Sources : Associated Press, consulté dans The New Zealand Herald, juin 25, 2015 ; livre cité.
C’est le consommateur qui serait responsable du taux de mortalité élevé des séries télévisées (#31, mai 2015)
Pour les publicitaires, quand on annule une série aux États-Unis, c’est en grande partie la faute du téléspectateur. Non pas en raison du téléchargement illégal (crime inqualifiable), mais du visionnage légal en dehors des clous, autrement dit, en dehors des procédures de mesure. Seule la consommation dite « C3 » (en première diffusion, ou en rediffusion (hertzienne, VOD) dans les trois jours qui suivent) est prise en compte par les indices Nielsen (ratings), qui sont à la base d’un marché publicitaire qui s’élève à 14 milliards $ annuellement.

Le visionnage d’une série sur un appareil mobile n’est pas pris en compte non plus par les indices, ce qui est doublement fâcheux, car il s’agit là d’un public jeune convoité qui regarde de moins en moins la télévision « en linéaire » (baisse annuelle de -14% le dimanche soir pour la démographique 18-34 ans depuis quelques années). « Une grande part du déclin des indices en prime time peut s’expliquer par l’incapacité de Nielsen de mesurer les nouveaux modes de consommation des contenus. […] À mon avis, entre 15% et 40% de l’audience de certains programmes selon le genre n’est pas mesurée », dit Alan Wurtzel, président de recherche et de développement chez NBC Universal.
Pour les quatre saisons 2011, 2012, 2013, 2014, 42 % des séries (scripted shows) ont été annulés (119, soit quasiment 30 par saison). 69 % des nouvelles séries ont été annulés (contre 65 % pour la période 2009-12*). En général, sauf exception, passe à la trappe toute série avec un indice de moins de 1,5 (soit une audience d’environ 2 millions, un point Nielsen représentant 1% des 127 millions d’Américains entre 18-49 ans).
Source : « Your favorite show is going to be cancelled and it’s all your fault » (Anthony Crupi), Advertising Age, avril 3, 2015.
Le taux de mortalité des séries américaines augmente graduellement chaque année, alors que l’audience se fragmente entre diffuseurs et entre supports. Il s’agit d’une contradiction forte entre deux branches du capital, entre l’industrie de produits électroniques, et l’industrie publicitaire, doublée d’une opposition entre entreprises asiatiques (Japon, Corée, Chine) et américaines. L’émergence d’un autre modèle de financement, celui de l’abonnement (HBO, et maintenant Netflix), est un facteur aggravant. Il est grand temps de parler de l’immense gâchis en temps et en ressources créatives qu’est devenu le modèle économique financé uniquement par la publicité, de toute façon en perte de vitesse, surtout chez les jeunes. L’article en question, qui parle officieusement au nom de l’industrie publicitaire, a quelque chose au fond de désespéré.
Il est difficile, compte tenu du nombre sensiblement inférieur de séries diffusées, de faire une comparaison avec les années 1960, mais à titre indicatif, en 1967, 5 sur 13 des séries westerns en prime time furent annulées, soit 38,5 %*. En 1964, quand le système d’indices était encore purement quantitatif, quand il n’y avait que trois networks (donc un choix entre trois programmes commerciaux en prime time), et quand il n’y avait qu’un téléviseur par ménage, une série diffusée le soir devait atteindre un indice de 20 (20% de tous les ménages équipés), et une part de 30 (30% de l’audience) pour survivre, soit au moins 10 millions des 52,8 millions de ménages équipés (92%)**. Autant dire qu’une série à succès de nos jours est beaucoup moins « massifiée » sur le marché américain, et plus dépendante du marché international.
*https://www.tvparty.com/fall67.html ; ** Jon Heitland, The Man from U.N.C.L.E. Book (St Martin’s Press, New York, 1987, p. 43.
Voir dans la web-revue l’analyse de l’écosystème télévisuel américain par Jérôme David, « La logique de spécialisation des chaînes américaines« .
« The Walking Dead » : les zombies postapocalyptiques mangent la télévision (#26, décembre 2014)
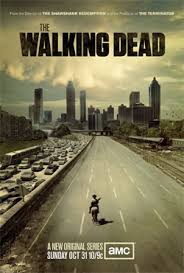


CW, une (petite) chaîne network qui vise les 18-34 ans, prépare pour 2015 une adaptation de la bande dessinée iZOMBIE (DC-Vertigo), mélange de Veronica Mars (dont le créateur Rob Thomas est aussi producteur de la nouvelle série), Ghost Whisperer et Vampire Diaries. Lors d’une soirée qui tourne mal, une étudiante (Gwen dans la bande dessinée, Liv dans la série) se transforme en morte-vivante. Afin d’épargner les humains, elle travaille dans une morgue pour se nourrir des morts. En mangeant leur cervelle, elle accède à leurs (mauvais) souvenirs, et par respect envers eux, se consacre à résoudre les crimes à l’origine de leurs morts violentes. La bande dessinée originale contient même des éléments « philosophiques » : la « surâme » (pensées, souvenirs) située dans le cerveau (oversoul, dérivée du concept éponyme de Ralph Waldo Emerson, fondateur du transcendantalisme), et la « sous-âme » (émotions, désirs) située dans le cœur (undersoul). Par jeu de combinaisons, les fantômes sont des surâmes sans corps, les esprits frappeurs des sous-âmes sans corps, les vampires des corps sans sous-âme, les zombies des corps sans surâme, et les morts-vivants la synthèse de la surâme et de la sous-âme. Comme les vivants ? Il reste à voir dans quelle mesure ces éléments seront intégrés dans la série télévisée.
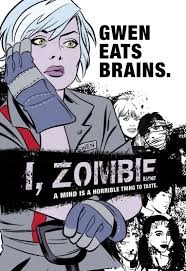
Les nouvelles séries de zombies cherchent à se démarquer entre elles en intégrant à des dosages divers des éléments de science-fiction, d’horreur, de policier et de teen culture. Si le cœur de cible reste les 18-34 ans, il est jugé important de grignoter sur la catégorie 12-17 ans. Pour ce faire, les producteurs d’iZombie (notez l’orthographe différente) ont choisi d’adoucir les éléments pure gore de la bande dessinée en faveur d’un style plus romantique qui correspond mieux aux goûts des adolescents. Une autre tactique, qui profite de l’armée de geeks érudits qui sévissent sur la web, consiste à multiplier les références « intertextuelles » à d’autres séries (Lost, Heroes, Vampire Diaries, etc.) en faisant appel à des acteurs issus de celles-ci.


Brian Steinberg, responsable de la rubrique télévision à Advertising Age, pense que les autres chaînes seront condamnées à terme à s’inspirer des séries comme The Walking Dead, même si la trame de celle-ci, déprimante et pessimiste, va radicalement à l’encontre de l’ambiance positive et vivifiante réclamée par les annonceurs depuis toujours. En cela, la série marque, selon lui, un déplacement de ton à la télévision américaine. Une série comme Revolution (NBC, 2012-14), qui est partie d’un groupe de survivants vivant dans un monde postapocalyptique sans électricité, a été une tentative d’adapter cette trame pour une audience plus mainstream. Steinberg a demandé déjà en 2012 : « Si The Walking Dead peut avoir cet effet en 2012, qui pourrait dire quel type de programme fera fureur en 2020 ? ».
Sources : « Le Monde », 19-20 oct. 2014 (Pauline Croquet, « Les zombies contaminent les écrans de télévision ») ; entrée wikipédia (en anglais) « iZOMBIE » ; « Advertising Age », déc 5, 2012 (Brian Steinberg, « Have AMC’s Zombies already eaten TV ? ») ; « Advertising Age », oct. 11, 2013 (Jeanine Poggi, « How AMC’s Walking Dead Zombies reinvented TV »).



Qu’il s’agisse d’un monde préapocalyptique (The X-Files dans les années 1990), ou postapocalyptique (The Walking Dead), les ressorts sont similaires : le plus-de-jouir (concept du psychanalyste Jacques Lacan calqué sur celui de la plus-value chez Marx) apporté par l’idée même d’apocalypse, le désir de celle-ci. « La manière la plus facile de dégager le plus-de-jouir idéologique dans une formation idéologique, écrit le philosophe slovène Slavoj Zizek, c’est de lire celle-ci comme un rêve afin d’analyser le déplacement qui y travaille » [3]. Zizek en cite deux exemples : un patient de Freud qui, dans un rêve, rencontre avec bonheur une ancienne amante à l’enterrement de son père ; un film de science-fiction des années 1950, similaire aux séries traitées ici, dans lequel un virus à fait disparaître la population de la Californie, ce qui offre la possibilité aux quelques survivants de redécouvrir le bonheur d’une vie simple fondée sur la solidarité organique. Dans les deux cas, la mort ou la catastrophe, c’est le prix à payer pour la réalisation d’un désir qui est en même temps sadique (survivant) et masochiste (victime).
La figure du vampire ou du mort-vivant dans ces séries est donc surdéterminée : métaphore du capitalisme, et expression d’un au-delà de celui-ci, certes sous une forme « survivaliste », et profondément pessimiste. Plus encore que le fantôme ou le vampire, le zombie représente le degré zéro du lien social, le point limite du rapport avec l’autre dans une société qui se dévore. Nul échange possible avec lui ! Le Capital contient plusieurs passages mémorables où Marx fait référence aux vampires pour caractériser les capitalistes, et le processus du capitalisme lui-même [4]. Pour le critique littéraire italien Franco Moretti, le désir du sang de Dracula est une métaphore pour le désir d’accumulation du capital, désir qui n’a pas honte de lui-même : « comme le capital, Dracula est poussé vers une croissance perpétuelle, une expansion illimitée de son domaine ; l’accumulation est inhérente dans sa nature » [5]. La figure du vampire se renforce singulièrement aujourd’hui, qui voit la domination outrancière du capitalisme financier, du « capital mort » qui ne cesse de demander son tribut sacrificiel aux vivants.

Faisant preuve de perspicacité, le journaliste Brian Steinberg se demande si « les morts qui marchent » sont les morts-vivants, ou les pauvres survivants qui doivent coexister avec eux [6]. Il est possible de lire la figure du zombie dans ce sens comme une métaphore – mi-parodique, mi-protestataire – de la vie elle-même sous le capitalisme tardif. On a vu ces dernières années des marches des zombies (zombie walks) partout dans le monde, y compris en France. Le responsable des effets spéciaux de The Walking Dead, Greg Nicotero, a donné des conseils pour bien se ressembler à un zombie [7] : marcher comme un ivrogne, ne pas cligner les yeux, manger comme un animal, ce qui reste largement dans les cordes de n’importe quel adolescent.
[1] David Buxton, Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production, L’Harmattan, 2010, pp. 67-8.
[2] ibid., pp. 5, 90-2, 96, 145-9.
[3] Slavoj Zizek, « Repeating Lenin » [1997], pp. 11-12 (je traduis). Jacques Lacan, « De la plus-value au plus-de-jouir », séminaire du 13 nov. 1968, in Cités, 16, 2003, pp. 129-44.
[4] Marx, Le Capital, tome 1, passim [1867]. Voir l’article de Mark Neocleous, « The Political Economy of the Dead : Marx’s vampires », 2003.
[5] Franco Moretti, Signs taken for wonders : essays in the sociology of literary forms, Verso (London), 1983, p. 91.
[6] Brian Steinberg, « Have AMC’s zombies already eaten TV ? », Advertising Age, oct 11, 2014 (lien ci-dessus).
[7] Anne-Christine Diaz, « 6 Tips for being a good zombie », Advertising Age, oct. 11, 2013.
« Game of Thrones » détrône « The Sopranos » pour les séries produites par les chaînes de câble (#22, juillet 2014)

Sources : « Les Echos », 6 avril 2014 ; 6 juin 2014 ; « Libération », 18 juin 2014, p. 31.
« NCIS » est la série la plus vue dans le monde (#22, juillet 2014)

Selon une nouvelle étude d’Eurodata TV Worldwide (créée au début des années 1990 par la société française Médiamétrie), c’est NCIS (CBS) qui arrive en première place pour les séries les plus regardées dans le monde, dépassant désormais Mentalist. Pas moins de 57,6 millions de téléspectateurs l’ont suivi en moyenne (par épisode) en 2013 dans les 66 pays étudiés qui représentent les marchés télévisuels les plus importants. Aux États-Unis, NCIS a été regardée par 18,5 millions en moyenne cette année (les chiffres concernent la seule télédiffusion, sans prendre en compte les supports numériques). Dans sa position de série leader, elle succède à CSI (Les Experts) et à Dr House. Dans la catégorie des sitcoms, Modern Family détrône The Big Bang Theory. Commentaire : l’intérêt de ces chiffres réside dans le ratio, toujours de manière indicative, entre l’audience américaine et l’audience mondiale pour la diffusion hertzienne d’une série à succès international. La recherche universitaire est parfois obligée de « faire avec » des bribes d’information rendues publiques, souvent « intéressées ».
Source : « Le Monde », supplément « Télévisions », 22-23 juin 2014, p. 3.
Lire les autres articles de la rubrique.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)