Lisibilité filmique et industrie cinématographique – Marc HIVER
Insert sur l’argent volé, Psychose, Hitchcock
Article interdit à la reproduction payante.
Contenu
Lisibilité, langage et industrie cinématographiques
La lisibilité d’un film participe dans l’industrie culturelle cinématographique, et a fortiori à l’époque des grands studios hollywoodiens, à dissiper l’angoisse commerciale qui taraude tout producteur. Est-ce que les informations verbales, gestuelles, scénographiques, sonores seront bien compréhensibles pour le spectateur ? Lui communiqueront-elles des émotions, la valeur d’usage de ce produit culturel que ce spectateur est venu chercher en achetant son billet ? Mon hypothèse : la notion de langage, ancrée au cœur d’une certaine sémiotique appliquée et même du débat général sur l’industrie cinématographique, ne serait-elle pas une réponse à cette angoisse commerciale ?
Langue, langage, grammaire seront replacés ici dans le contexte de la Théorie critique des industries culturelles. En effet, ce langage est le corrélat du caractère industriel de la logique de production et de réception. Le caractère énigmatique de l’œuvre d’art en tant que forme y est donc proscrit de facto. Ne peut être énigmatique que l’énigme de l’histoire racontée. Ce qui ne veut pas dire qu’un artiste authentique se moque du matériau cinématographique dont il a hérité. Lui aussi met en place un jeu de repères pour entraîner le spectateur dans une dérive spectatorielle. Car il y a donc la lisibilité de base, sans laquelle aucun discours ne tiendrait. Mais dans l’industrie vient s’ajouter une sorte de sur-lisibilité vis-à-vis d’un consommateur qui en veut pour son argent et qui peut décrocher son attention à tout instant.
Le studio, une machine sémiotique
Ainsi, le mariage du langage et de l’industrie, à Hollywood, s’incarnait dans l’existence et le fonctionnement des grands studios. Ceux-ci étaient d’abord, par leur force de frappe financière, de formidables machines à tirer le cinéma vers des productions toujours plus coûteuses. Leurs budgets devenaient intouchables pour des économies plus fragiles.

Ces studios étaient des machines à superviser les codes et les signes, quasiment des machines sémiotiques. Un exemple entre mille : longtemps, l’usage des transparences a permis de filmer les acteurs en studio face au « cyclo » sur lequel on rétroprojetait le décor fixe ou en mouvement. Et ce cyclo servait, outre la maîtrise du plan de travail et la gestion des intempéries, à faciliter les signes émis par les acteurs dans leur jeu. Et on peut faire autant de prises que l’on veut si l’on n’est pas soumis aux aléas des extérieurs.
La cinématique hollywoodienne
Les grues, rails qui équipaient à demeure les studios, permettaient ces mouvements d’appareil totalement maîtrisés. Une domination de l’espace qui constituait un véritable dispositif pour simuler un regard quasiment divin, doué d’ubiquité.

La mise en place et la systématisation de grandes figures cinématographiques comme le champ-contrechamp pour filmer une communication frontale entre deux personnages, et dont l’enchaînement des plans soit compréhensible par le spectateur en est un exemple flagrant. Jean-Luc Godard, entre autres, essaiera de casser cette systématisation par un mouvement de va-et-vient d’un personnage vers l’autre. La caméra, une Éclair 16 mm des actualités, portée par Raoul Coutard, d’abord caméraman de guerre, visualise ce trou, ce raccord constitutif du champ-contrechamp. Aujourd’hui, les séries télévisées font leur miel avec le walk and talk en longs plans séquences.

La figure ou la forme du champ-contrechamp était souvent associée dans sa phase finale, après les deux premières étapes — plan moyen englobant les deux acteurs, puis alternances de plans rapprochés : trois quarts face pour l’un, un quart dos en amorce pour l’autre —, au choc en gros plans des vedettes du film avec le raccord sur les jeux de regard. Cette figure qui préparait l’écrin des têtes d’affiche était donc liée au star-system. Mais on oublie trop souvent que ce star-system, outre son importance économique pour attirer le public, joue un rôle majeur dans la stratégie de communication du film.
Le contrôle des signes et de l’argent
Le premier producteur venu sait qu’il est difficile de contrôler tous les signes qui seront l’aboutissement de la mise en œuvre d’un projet de production et de réalisation filmique. Le premier publicitaire venu se souvient aussi de l’échec de la campagne de lancement, en 1976, de la Renault R14, la voiture « en forme de poire ». Un petit paramètre narcissique, « être une poire », était resté hors contrôle. Bien sûr, économiquement, la politique des majors consistait à ne pas « mettre tous les œufs dans le même panier ». Une diversification des projets pour qu’une seule réussite suffise à établir un bilan positif pour l’année constituait un garde-fou. Aujourd’hui encore, Joël Augros le rappelle, un seul blockbuster qui réussit suffit à garantir l’année.
Le producteur exécutif
Sur le plateau, le producteur exécutif, à l’instar des grands producteurs d’Hollywood d’avant l’avènement des multinationales financières comme David O. Selznick (King Kong, Autant en emporte le vent, Rebecca, Duel au soleil), veille au grain par-dessus l’épaule du réalisateur. Il n’hésite pas, s’il le faut, à faire retourner des plans de coupe quand il lui semble que tel détail trop rapide et indispensable à la compréhension de la scène pourrait échapper à l’attention du spectateur et donc perturber la réception de l’ensemble.

On sait aussi que les previews permettent de juger de l’effet d’un film en salle et de le remanier au montage. Elles ouvrent la possibilité de retourner certains plans ou des séquences entières. Frank Capra, dans sa biographie Hollywood Story (voir mon article sur Capra), raconte qu’il raffinait la pratique. Il apportait le jour de la preview un magnétophone pour enregistrer sur la même bande le son du film et les réactions des spectateurs. On enregistrait ainsi les rires, silences, bruits de fesses ennuyées, etc. afin de finaliser le montage pour la sortie définitive. Et cette méthode semble artisanale à côté des enquêtes préalables systématiques qui président au lancement d’un produit.
Mais ce qui vaut pour chaque projet prend toute sa dimension au niveau collectif et participe à l’acculturation du récepteur, à son instrumentalisation. La mise en œuvre d’un langage cinématographique, qui d’ailleurs évolue dans l’histoire du cinéma au travers des produits et de leurs créatifs, est peut-être l’élément le plus décisif du point de vue esthétique qui est le mien.
La star, valeur communicationnelle
La star tient son rôle de valeur économique et de valeur sociale. On retrouve le physique et la voix qu’on connaît déjà et la valeur symbolique de la star, comme l’a expliqué Edgar Morin. Mais, et c’est l’objet de cet article, la tête d’affiche est aussi un élément clef dans la compréhension immédiate du film, donc de sa lisibilité. Elle fait partie intégrante des connaissances acquises du spectateur quand il découvre un nouveau film. Cela permet très rapidement de caractériser un personnage.
Ainsi, Humphrey Bogart a traversé les générations, fait partie d’une mythologie, comme Marilyn ou James Dean dans les produits dérivés rétros vendus dans les gadgetéries. Bogart est donc reconnu par les jeunes entre quinze et vingt-cinq ans, cœur de cible du cinéma d’aujourd’hui. Mais il ne l’est pas forcément pour les films qu’ils n’ont généralement pas vus ! Leur cinéphilie ne remonte souvent au mieux qu’à Steven Spielberg et George Lucas pour les grands ancêtres, et les références dans le cinéma de Quentin Tarentino.
Par contre, si on leur présente un film avec George Raft, autre grande figure du cinéma noir américain (au sens policier), alors c’est le trouble dans la compréhension. Raft, star oubliée, mais traitée à l’époque dans la caractérisation de ses personnages sur le critère essentiel de sa notoriété, devient l’égal des autres personnages secondaires un peu vieillots et gominés. N’ayant pas subi le travail de discrimination qui constitue toute la stratégie du casting pour les seconds rôles, il ne fonctionne plus dans sa reconnaissance immédiate et perturbe la lisibilité de l’ensemble.
On peut identifier d’autres mécanismes liés à cette notion trop générale de casting. Ainsi, le casting joue toujours un rôle aussi fondamental dans le langage cinématographique envisagé sous l’angle de l’industrie dans sa détermination esthétique.
The Birds – Les screen tests de Tippi Hedren
Une typologie hollywoodienne des personnages
L’industrie culturelle cinématographique s’inscrit dans une double logique de production et de réception industrialisée. Celle-ci est matérialisée par une stratégie de communication globale, cinématographique et pas seulement filmique. Cette stratégie s’adjoint une typologie des rôles qui rappelle la Commedia dell’arte, dans laquelle des personnages récurrents étaient investis par différents acteurs. Arlequin, Pierrot, Colombine, Pantalon… les spectateurs les reconnaissaient à chaque nouvelle représentation. On pourrait citer aussi la tradition du Guignol lyonnais… et le théâtre classique.
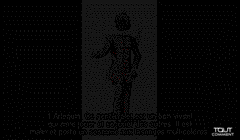
Les détracteurs d’Hollywood dans sa version « entertainment », les mêmes qui défendent, comme le disait Adorno, un Hollywood des films à thèse, plus sociaux, plus « haut de gamme », oublient un élément qui n’a pas échappé aux deux co-inventeurs du concept de Kulturindustrie. Les produits moins respectables et moins prétentieux remplissent souvent mieux leur contrat social et psychologique de sublimation — il y a un équivalent « Commedia dell’arte » à cette création de grands types de personnages.
Pensons à l’archétype hollywoodien de la blonde écervelée et cynique. Si Marilyn Monroe, dans Les Hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, en est une incarnation éclatante et Jayne Mansfield, dans La Blonde et moi de Frank Tashlin, la caricature assumée, elles ne sont ni les premières ni les dernières à habiter le rôle.
Se maquiller comme Marilyn Monroe ?
Elles renouent avec La Blonde platine, en 1931, de Frank Capra avec Jean Harlow, au début du parlant. Plus près de nous, Une vraie Blonde de Tom DiCillo, le réalisateur de Ça tourne à Manhattan, reprend le flambeau. Et que dire d’Alfred Hitchcock avec Grace Kelly ou son clone Tippi Hedren ?
Les clowns repentis : le mirage du film haut de gamme
Dans les biographies autorisées ou non de Marilyn Monroe, un des rares clowns géniaux féminins, on est surpris par la volonté de la star de se cultiver et de tourner des « films sérieux ». On retrouve souvent, à un moment charnière de leur carrière et l’âge avançant, cette revendication de vedettes internationales ayant commis des œuvres légères, jubilatoires. Et peut-être sublimatoires au sens freudien. Bref des produits culturels de divertissement sans prétention et assumant leur ancrage dans l’industrie.
Pensons d’abord à Jane Fonda devenue passionaria. Julia Roberts délaissant les comédies romantiques pour un film de « critique sociale ». La profession lui donne l’Oscar de la meilleure actrice en 2000 pour Erin Brockovich. Le formidable grimacier Jim Carrey, seul à réincarner les personnages de clowns infantiles (Ace Ventura, Dumb & Dumber) tenus par cet autre Auguste, Jerry Lewis. Il cherche ses quartiers d’acteur dans la critique médiatique de The Truman show (1998). Marilyn Monroe épouse Arthur Miller, l’auteur de la pièce de théâtre classique Les Sorcières de Salem (1953), et prend des cours à l’Actor’s Studio. Elle essaie, en partie, d’échapper à son emploi pour une chimère psychologisante et sociologisante en pleine méconnaissance de son génie comique. Or cette aspiration montre toute l’incompréhension de l’actrice et le défaut de reconnaissance par son entourage sur son propre travail.
Une question qui fâche
Pour les détracteurs des premiers théoriciens de l’École de Francfort, il existe deux pommes de discorde : le jazz et le cinéma. A la question : le cinéma, art ou industrie ? ils répondent par la réconciliation possible de l’art et de l’industrie, l’avènement de grands films populaires de qualité. Le cinéma serait donc un art (le septième) et une industrie. Comme preuve, les cinéphiles de la vieille école mobilisent toute l’histoire du cinéma, et leur cinéphilie pourtant délaissée par la jeune génération.
Le devenir d’une industrie
Mon hypothèse, c’est qu’il y aurait deux périodes dans l’histoire du cinéma
La première, c’est la constitution d’un langage en construction qui permet à des cinéastes d’innover dans une industrie naissante qui a besoin de créateurs pour surprendre le spectateur par des trouvailles formelles. Mais rapidement, comme l’écrit Deleuze, l’histoire du cinéma devient un long martyrologe : Eisenstein, Stroheim, Welles, etc. Ils sont remplacés par des créatifs comme dans la publicité qui reste le modèle des industries culturelles. Alors s’opère un lent fondu enchaîné vers la deuxième période où le curseur entre art et industrie se déporte vers ce dernier pôle. C’est peut-être aussi dans ce sens que Jean-Luc Godard parlait de la mort du cinéma.
Bien sûr, il y a eu l’avènement de la télévision et la fin des cinémas de quartier où on enchaînait, d’une semaine l’autre, Maciste, l’homme le plus fort du monde, un péplum, et Le Mépris de Godard. Le public populaire captif de la salle dans sa rue se précipitait pour voir les fesses de Brigitte Bardot, s’attendant à la suite de Et Dieu créa la femme !
Bien entendu, la technique évolue, son et image. Mais pas forcément la technique esthétique dont parle Adorno quand il développe les quatre concepts majeurs de sa Théorie esthétique : matériau, forme, technique, industrie. L’industrie, elle, met en avant une révolution technique avec les images de synthèse qui soutiennent souvent des scénarios indigents et des remakes tous azimuts ; avec le son qui entoure la salle ; et avec la 3D pour les nouveaux films d’animation. On réactive le cinéma en relief, vieille arlésienne du cinéma, avec de nouvelles lunettes, mais qui se heurte, une fois encore, aux limites d’un imaginaire emprisonné paradoxalement entre les quatre murs d’une espèce de scène de théâtre. Où sont les Abel Gance d’aujourd’hui qui sauraient expérimenter de nouvelles formes dans leurs œuvres plutôt que d’innover industriellement pour renouveler un produit ? Et d’ailleurs l’industrie telle qu’elle devenue — ce qu’avaient anticipé Horkheimer et Adorno — leur laisserait-t-elle les mains libres ?
L’exemple Hitchcock
Il n’a pas échappé aux lecteurs de cet article que bon nombre des illustrations sont extraites des films d’Alfred Hitchcock et pour cause !
- Alfred Hitchcock qui à la fois avait le nez sur le box office et jouait avec les attentes de ses spectateurs
- Un réalisateur qui maîtrisait à plein le langage cinématographique hollywoodien des studios, un sémioticien pratique, mais qui a expérimenté au plan formel.
- Un roi de la communication publicitaire dans ses bandes annonces.
J’ouvre le débat auprès de nos lecteurs cinéphiles qui peuvent commenter cet article :
- Hitchcock, simple agent de l’industrie culturelle hollywoodienne ou artiste au Panthéon du Septième Art ?
- Peut-on devenir Hitchcock aujourd’hui ?
Cet « effet » enrichit la séquence et n’est pas gratuit.
Il a été mis au point par le caméraman Irmin Roberts pour Hitchcock, et est réalisé grâce à la combinaison de deux mouvements : un traveling de la caméra compensé par un zoom (d’où le nom « travelling compensé »). L’un des mouvement est donc compensé par l’autre : si on choisi le travelling arrière, on fera un zoom avant pour que notre personnage principal garde la même taille à l’écran. Cela aura pour effet de compresser la perspective. Dans le cas d’un travelling avant, on compensera avec un zoom arrière ce qui allongera la perspective.

BIBLIOGRAPHIE
ADORNO, T. W., Théorie esthétique, Paris, Klincksieck (traduction française Marc Jimenez), 1982.
ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M., La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, « Tel » (traduction française Eliane Kaufholz), 1974.
AUGROS, Joël, L’argent d’Hollywood, Paris, L’Harmattan, collection « Champs visuels », 1996.
BAZIN, André, Qu’est-ce que le cinéma ? I.Ontologie et langage, Paris, Éditions du Cerf, collection « 7e art », 1958.
BURCH, Noël, La Lucarne de l’infini, naissance du langage cinématographique, Nathan, collection « Cinéma et image », 1991.
CAPRA, Frank, Hollywood story, Paris, Stock (traduction française Ronald Blunden), 1976.
DELEUZE, Gilles, L’Image-mouvement, Paris, Éditions de Minuit, collection « Critique », 1983.
HIVER, Marc, Adorno et les industries culturelles — communication, musique et cinéma, Paris, L’Harmattan, collection « Communication et civilisation », 2010.
KASPI, A., BERTRAND, C.J., HEFFER, J., La Civilisation américaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1979.
LANGE, Eric, À la recherche du son, « Les premiers pas du cinéma », DVD 52’, Lobster.
METZ, Christian, Langage et cinéma, Paris, Larousse, collection « Langue et langage », 1971.
MORIN, Edgar, Les Stars, Éditions de Minuit, 1957.
SADOUL, Georges, Histoire du cinéma mondial des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1949.
Lire les articles de Marc Hiver


Philosophe, spécialiste des sciences de l’information et de la communication, d’Adorno et des industries culturelles
Dernier livre : « Adorno et les industries culturelles – communication, musique et cinéma »,
L’Harmattan, collection « communication et civilisation »




