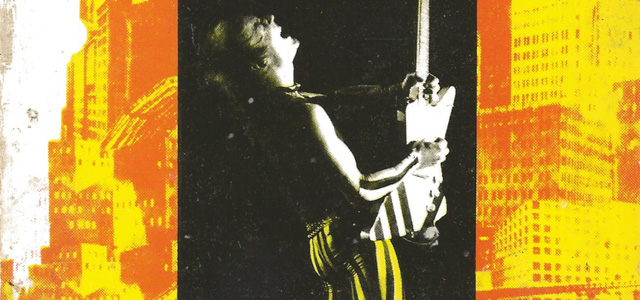Le rock – chapitre 2 : Les débuts d’une culture de la consommation – David BUXTON
Le rock, star-system et société de consommation, livre de David Buxton adapté d’une thèse de doctorat soutenue en 1983, fut publié par La Pensée sauvage, petit éditeur grenoblois, en 1985 ; il est devenu introuvable, sauf dans quelques bibliothèques universitaires et encore. À l’initiative du webmaster, la Web-revue a décidé d’en assurer une nouvelle édition numérique au rythme d’un chapitre par mois. Ce livre se voulait une approche conceptuelle et critique de l’impact idéologique du rock. Des débuts de l’industrie du disque microsillon aux punks et aux vidéo-clips, en passant par l’invention du teenager et l’impact capital de la contre-culture et des nouveaux médias de l’époque, le rock sert de point d’entrée dans la société afin de mieux comprendre d’autres phénomènes sociaux comme la consommation de biens culturels et la technologie. Comme prévu, après le chapitre 1 en janvier 2014, voici le chapitre 2 en février 2014.
Interdit à la publication payante
Contenu

Dans un contexte où la valeur dérive directement de la terre ou de l’appropriation directe de la nature, la consommation, c’est le suicide. Cela consiste à utiliser ce qui doit être main — tenu et renforcé afin de survivre [1].
Pour la population non urbaine ou nouvellement urbanisée, pour la plupart des immigrés d’Europe, le salariat représentait une violation intrinsèque de l’hypothèse de base. La première réaction fut une violente tendance à l’économie, à s’approprier l’argent comme si c’était de la terre. Ce n’était pas la seule réaction, face à la consommation. Prenons l’exemple d’une communauté minière anglaise étudiée par trois sociologues. Il s’agissait d’une ville à la frontière des mines de charbon du Yorkshire, isolée géographiquement et, de plus, historiquement par la nature particulière de son activité : presque tous les hommes vivaient de la mine. Les salaires variaient selon la nature des tâches entreprises, mais la consommation des ménages était limitée au niveau des plus bas salaires. Le surplus de ceux qui gagnaient les meilleurs salaires se devait d’être consacré aux activités sociales comme la descente des verres entre amis, le pari et la charité. Ce nivellement résulte du fait que la solidarité ouvrière s’impose pour la négociation des salaires dans une situation de différence claire entre patrons et ouvriers. Réduire le niveau de consommation domestique par la consommation, par exemple, d’alcool en groupe est une façon de maintenir la stabilité et la solidarité du groupe. Les mineurs considéraient, donc, un surplus d’argent comme devant être dépensé en activité de groupe plutôt qu’en délectation privée. Les mineurs se surveillaient les uns les autres d’un œil de lynx pour repérer toute déviation des normes : « Quelqu’un utilisait une marque de tabac plutôt chère, immédiatement quelqu’un criait, “Qu’est-ce qu’on est rupin”, et le mineur empochait le tabac avec gêne » [2].
Ces exemples, qui sont cités en tant qu’attitudes idéales ou typiques, mais non exclusives, nous montrent qu’il existait une discipline de consommation qui se manifestait soit dans la renonciation individuelle, soit dans l’approbation sociale de la délectation privée. Avec l’apparition de la production en série, il fallait une consommation de masse. Les mentalités que nous avons citées, étroitement liées aux exigences d’une discipline du travail, elle-même le produit de la révolution industrielle, étaient devenues des entraves. Il fallait une nouvelle discipline de consommation qui pourrait encourager, voire obliger les dépenses individuelles et celles du ménage. En somme, il ne fallait rien de moins que la création d’une « nouvelle personne ».
Les idéologues de la consommation
L’économie américaine des années 1920 avait besoin de se développer et de créer de nouveaux besoins chez les consommateurs, autrement dit, « d’éduquer » les masses à la culture de consommation. La production toujours croissante de marchandises réclamait un marché de masse pour les absorber. Précédemment, le capitaliste considérait le travailleur comme une bête de somme, dont les loisirs, le peu de loisirs, n’offraient guère d’intérêt, pourvu qu’ils restent à l’intérieur de certaines limites morales. Seule une poignée d’employeurs comprenait qu’une production de masse nécessitait l’organisation de la consommation. Edward Filene, un magnat de Boston, déclarait en 1919 :
La production de masse exige l’éducation des masses, les masses doivent apprendre à se conduire comme des êtres humains dans un monde de production de masse…[3]
Cette attitude « éclairée », trop minoritaire, ne put cependant empêcher la Grande Dépression de 1929, qui fut essentiellement une crise de la circulation du capital, un problème « de consommation inefficace ». Les thèmes du consumérisme ne commencèrent à être consacrés par la pratique sociale qu’avec la stabilité et la croissance des années 1950. Ils étaient cependant bien établis. Dès 1892, Simon Patten, apôtre infatigable du consumérisme industriel, affirmait que la reproduction mécanique des images serait le centre décisif du nouvel ordre de consommation, percevant ainsi, sous une forme embryonnaire, le rôle important que devaient jouer les industries culturelles dans la diffusion d’une éthique de consommation [4].
Le capitalisme avait besoin d’augmenter le nombre de consommateurs potentiels. Les marchés devaient croître horizontalement (nationalement), verticalement (dans les classes populaires) et idéologiquement (par l’accroissement de la valeur d’usage). Comme nous l’avons vu, ce processus n’était pas automatique. Le capitalisme savait discipliner les gens dans le travail, mais ignorait comment les faire consommer. Pour les idéologues du nouveau consumérisme dont l’histoire est brillamment documentée par Stuart Ewen dans Consciences sous influence, les gens ne devaient plus perdre leur temps en loisirs hors du circuit des marchandises.

La production de masse impliquait aussi un coût initial élevé et si l’on voulait éviter des pertes paralysantes, il fallait s’employer à superviser soigneusement et à préparer les exigences des consommateurs. Autrement dit, le consommateur devait être fabriqué en même temps que le produit. Les publicistes souhaitaient des caractères vierges, non contaminés par la résistance puritaine devant la consommation. La jeunesse constituait donc leur cible logique.
Les publicistes des années 1920 présentaient un monde où les petits groupes ne constituaient plus les royaumes adaptés à la communication de valeurs, mais plutôt le lieu du marché où la marchandise promettait la communauté, une communauté de « masses ». La consommation devait devenir le rapport social de base ; le « moi », « libéré » des formes traditionnelles de la famille ou de la communauté régionale, devait être la forme la plus haute d’existence. Dans la marchandise gisait la promesse de la libération…
Il est difficile d’apprécier aujourd’hui à quel point, dans les années 1920, les publicistes ont dû persuader les industriels de l’importance, voire la nécessité de la publicité, qui était loin d’être universellement acceptée. Entre 1918 et 1923, on a consacré un plus grand pourcentage d’articles dans la revue spécialisée de publicité Printer’s Ink aux façons de persuader les corporations « démodées » que la publicité était une exigence de l’industrialisme moderne, qu’aux techniques de publicité. Les publicistes affirmaient que leur produit était une forme d’assurance pour les corporations, car il assurait une distribution efficace et rentable. À travers leurs revues spécialisées, les publicistes ont développé une idéologie cohérente que nous allons examiner plus en détail.
Mais pourquoi y avait-il une soudaine montée de la publicité ? Dans leur Monopoly Capital, Baran et Sweezy affirment :
Il y a un siècle, avant la vague de concentration et de trustification qui annonçait la phase monopolistique du capitalisme, la publicité avait peu d’importance dans la distribution de produits et l’influence sur les consommateurs. La publicité, telle qu’elle existait, était l’affaire des commerçants qui ne tentaient pas de promouvoir des marques particulières. À l’époque, les fabricants n’ont pas encore commencé à exploiter la publicité comme moyen d’obtenir la demande pour leurs produits. À partir de 1890, cependant, le volume et la nature de la publicité ont changé. Les dépenses publicitaires ont atteint 360 millions $ en 1890, sept fois plus qu’en 1867. Pour 1929, le chiffre de 1890 a été multiplié par presque dix (3426 millions $) [5].
Au fur et à mesure que le capitalisme mûrit, la publicité devient « persuasive » plutôt que seulement « proclamative ». Cette phase nouvelle est évidente dès 1905 :
Notre époque est un âge d’or de marques déposées… Partout, il existe les possibilités de prendre le devant en matière de publicité, de remplacer les produits bâtards et inconnus par… une marque déposée standardisée, soutenue par la publicité au niveau national qui est devenue en elle-même une garantie de valeur pour le public. [6]
Dans les conditions précédentes de concurrence atomiste, caractérisées par de nombreux vendeurs fournissant une petite fraction d’un marché hétérogène, il y avait peu de besoins pour la publicité de la part des sociétés industrielles. Cette situation change lorsqu’il s’agit d’un petit nombre de vendeurs, chacun avec une grande production dans une situation d’oligopole. Ces sociétés cherchent à imposer et à maintenir une différenciation entre leurs produits et ceux de leurs concurrents. Si cet effort de différenciation réussit, les mêmes produits cessent d’être interchangeables aux yeux des consommateurs.
Esquissons maintenant les éléments essentiels de l’idéologie consumériste, telle qu’elle a été formulée dès 1920.
La jeunesse
Alors que des tentatives sont faites afin d’éliminer le travail des jeunes par voie de législation, le rôle symbolique de la jeunesse est devenu central pour les idéologues de la consommation. C’est dire que l’enfance et l’adolescence sont devenues plus importantes dans la consommation des biens et des services. De plus, la jeunesse est venue symboliser, pour les publicistes, le renouvellement et le changement face aux vieilles mentalités productivistes et ascètes qui sont devenues, une entrave à la consommation de masse. La montée d’une valeur de jeunesse (un exemple du concept de « valeur d’usage accrue » exposé au premier chapitre) fournissait une arme idéologique contre la sphère traditionnelle d’autorité parentale, telle qu’elle s’exerçait dans la famille et la communauté avant l’arrivée de la production de masse.
La publicité s’appuyait énormément sur cette idéalisation de la jeunesse, symbole d’innocence et de malléabilité. Le behavioriste John B. Watson a appelé à l’enseignement de la « vie moderne » aux enfants afin de pouvoir circonscrire l’autorité parentale démodée par rapport aux exigences du processus industriel. Ewen mentionne que les publicités du genre, « est-ce que vos enfants souffriront de la plaque dentaire comme vous » étaient très fréquentes, impliquant que l’industrie comprenait mieux les besoins de l’enfant que les parents.
On demandait aux adultes de regarder vers la jeunesse afin de comprendre ce qui était « correct » dans « l’ère nouvelle ». Souvent, les publicités ridiculisaient l’incompétence des adultes dans leurs efforts pour s’adapter à la modernité. La jeunesse est devenue un modèle de bonne consommation. Une publicité de la société de cinéma, Paramount, en 1922 affirmait l’importance de « suivre les jeunes » et déclarait que « les jeunes font autant de bien à leurs parents que leurs parents leur en font… Sans les jeunes, quelques-uns parmi vous parents ne sauraient même pas aujourd’hui quels énormes progrès la Paramount a fait faire au cinéma ».

Il y avait une idéologie de jeunesse à l’époque qui, sans rapport direct avec la publicité des années 1920, est néanmoins importante pour nos arguments à venir. Cela concerne l’idée de la jeunesse en tant que force sociale en dehors des classes. Surtout après la Première Guerre mondiale, on a vu la jeunesse en tant que force pour la reconstruction et le renouvellement, ce qui se lie avec la vision des publicistes d’une « nouvelle ère » dominée par les jeunes. La jeunesse pourrait changer, espérait — on, la société, faire disparaître les classes, sans révolution, sans lutte de classes et sans l’idéologie socialiste. Un éditorial anglais affirma en 1919 : « Cette révolution sociale que nous lançons n’est pas une affaire de classes. Elle a des racines plus profondes. Il s’agit de la révolte des jeunes contre les vieux« [8].
L’espoir que la jeunesse pourrait transcender la lutte des classes était analogue à l’espoir de vaincre les inégalités de classe par la production et la consommation de masse. Mais ce qu’il est important de réaliser, c’est que la jeunesse est devenue un espace central pour la reproduction de la société, impliquant ainsi la possibilité de dégénération et de décadence aussi bien que le renouvellement. En 1904, un réformateur anglais, Stanley Hall, affirma que le passage de l’enfance à la maturité correspondait au passage de la barbarie à la civilisation. Le futur de la civilisation, donc, dépendait de l’étape cruciale de l’adolescence. Le comportement de la jeunesse devenait une mesure pour la santé de l’ensemble de la société, faisant ainsi du concept de jeunesse un espace idéologique par excellence, un espace investi de nombreux discours contradictoires.
La consommation en tant que forme de conformité

Pour Edward Bernays, pionnier de l’industrie des relations publiques (et neveu de Freud), le contrôle du marché sur le comportement populaire fut le signe d’une démocratie avancée par rapport aux formes plus primitives de démocratie. La concurrence des idées sur le marché fut l’expression « moderne » de la liberté, car, selon Bernays, seul le marché permettait le libre échange des idées. Mais cette rhétorique démocratique masquait les efforts pour imposer le contrôle. « La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique », déclarait-il.
Selon le pionnier du marketing moderne Paul Nystrom, la production de masse permettait aux valeurs de la classe dominante d’être assimilées par les ouvriers de par leur participation dans le cycle de la mode. Cette participation a été présentée comme un devoir. Nystrom menaçait ceux qui auraient été susceptibles de ne pas consommer selon les normes :
Il y aura des regards perplexes, des évaluations critiques. On le jugera bizarre. On le jugera comme manquant d’intelligence et parfois même, indésirable. S’il persiste (à violer les normes de la consommation), s’il est employé, il perdra son boulot. S’il est vendeur, il perdra ses clients, s’il est homme politique, il perdra des votes… il perdra tous ses amis. [10]

Les liens sociaux de l’âge moderne, déclarait Nystrom, devaient être fournis par le marché. Toute autre voie mènerait inévitablement à l’ostracisme, à la perte d’estime sociale et à l’insécurité de l’emploi.
L’économiste Élisabeth Hoyte remarque que l’animosité envers les communautés ethniques était clairement liée à leur violation des normes de la consommation. Elle cite une ménagère américaine à propos de ses « voisins étrangers » : « Je les aimerais mieux s’ils ne portaient pas de vêtements si bizarres ». Elle conclut qu’il y avait très peu de différence entre « la consommation douteuse » et « les consommateurs douteux ». Il existait donc une notion de consommation correcte et homogène. Ewen cite le magazine de mode Harper’s Bazaar :
Pour le (mâle américain bien trempé) toute forme de règlement est symptôme de tyrannie bolchevique. Mais
le grand moment où il est terrifié par sa liberté, c’est quand il s’achète des vêtements. Il a plus peur de porter une cravate orange vif au bureau que de porter un drapeau rouge pendant un défilé communiste. [12]
Cette homogénéité se doublait d’une massification de la vie sociale. Le publiciste Robert Updegraff a conseillé : « Les hommes et les femmes doivent se rendre compte qu’il est futile de tenter de s’exprimer en petits groupes... » Selon lui, c’était seulement dans le cadre de « millions de gens » que se réalisait la communication moderne.
La consommation en tant que libération
L’idée que la consommation puisse être une alternative aux autres modalités de changement social s’est répandue dans les milieux d’affaires américains dès les années 1920. Une des rédactrices publicitaires la plus connue à l’étranger, Helen Woodward, est allée jusqu’à affirmer franchement que la consommation peut être une sublimation de pulsions qui pourraient être dangereuses sous d’autres formes. Tout en acceptant que le changement soit « le meilleur médecin du monde pour la plupart des gens », elle voyait la consommation de masse comme un moyen de satisfaire le besoin de changements dans un contexte socialement acceptable. « Pour celles qui ne peuvent changer leur vie ou leur profession, Woodward conseillait, même une nouvelle robe crée un soulagement ». Selon elle, la plupart des gens n’avaient pas le courage ou l’intelligence de faire des changements plus profonds.
On présentait le marché comme une solution plus favorable que d’autres conceptions, plus radicales, du changement. Le magnat Edward Filene a dit : « Ce que proposent les réformateurs théoriques ou les gauchistes irrationnels dans l’espoir d’améliorer la vie des hommes par des moyens révolutionnaires peut être accompli par la production de masse » [14]. Selon Filene, pour vivre avec succès dans « l’âge des machines », il fallait s’appuyer sur le marché et « abandonner une pensée de classe ». Pour Frances Kellor, directrice de l’Association américaine des journaux en langue étrangère, la publicité, « est la réponse au bolchevisme, un processus fondamental d’américanisation ». Paul Nystrom a prévenu le monde des affaires que s’ils ne pouvaient fournir un modèle commercial de loisir, la socialisation (euphémisme pour le socialisme) ferait figure de seul substitut pratique.
La publicité est donc devenue une figure de proue de « la société libre ». L’absence de la publicité, affirma le banquier new-yorkais Paul Mazur (Lehman Brothers), mènerait à une situation affreuse…
…où les vêtements seraient achetés pour leur valeur d’utilité ; la nourriture serait achetée pour sa valeur économique et nutritionnelle ; les automobiles seraient réduites à l’essentiel et gardées par les mêmes propriétaires pendant les dix à quinze ans de leur vie utile ; les maisons seraient construites et entretenues seulement comme des abris, sans prendre en compte le style… Et que deviendra un marché dépendant des nouveaux modèles, des nouveaux styles, des nouvelles idées ? [16]
La consommation des biens est devenue synonyme de liberté politique. Les idéologues comme Filene sont allés jusqu’à suggérer que le vote n’était qu’un moyen très imparfait pour la réalisation de la démocratie. Comme alternative à ce système « arbitraire », Filene déclarait que la consommation en elle-même fournit une arène effective à la participation démocratique. En achetant des biens, et donc en participant à la solvabilité des entreprises, continuait-il, on « élisait un gouvernement » qui satisfaisait les besoins et les désirs d’une façon constante. Autrement dit, la consommation des biens n’était pas seulement un processus de participation populaire dans « le gouvernement industriel », mais de plus, une façon d’y continuellement participer.
Il est évident que ces propos ne représentent qu’un idéal, d’autant plus important qu’il nous permet de voir la logique d’une stratégie capitaliste de consommation dans sa forme pure. Il est inconcevable qu’une pareille stratégie de manipulation et de menace ait pu accompagner une véritable consommation de masse telle que la connaît la société occidentale aujourd’hui. Comme la révolution industrielle n’aurait pas pu s’accomplir avec une armée d’agents disciplinaires dans chaque usine, il fallait une intériorisation de la discipline de travail, la consommation de masse exigeait également une intériorisation d’une discipline de consommation. L’idéologie de la consommation, tout comme l’idéologie du travail antérieurement, devait se matérialiser dans le corps même.
Dans Surveillir et Punir, Michel Foucault détaille le développement, l’élaboration et le raffinement d’une nouvelle série de techniques disciplinaires qui ont émergé dans l’armée, les écoles et les ateliers vers la fin du XVIIIe siècle. On a découvert le corps en tant qu’objet et cible de ces mesures.

Au début du XVIIe siècle, on considérait le soldat idéal comme « naturel » : sa vigueur physique, il était né avec elle. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, après l’invention de la carabine remplaçant le mousquet inefficace et rendant nécessaire le déploiement stratégique de soldats, plutôt que leur nombre, le soldat fut usiné. On enseignait et on manipulait le corps pour qu’il réponde aux ordres. Le corps était une machine, un automate qui devait être construit suivant un certain modèle. On apprenait aux nouvelles recrues à se tenir droites, la tête levée, le dos dressé, le ventre rentré, la poitrine et les épaules rejetées en arrière. Il fallait rester immobile jusqu’à ce que soit donné l’ordre de bouger. Foucault avance que ce qui était nouveau dans cette manipulation du corps était le fait qu’elle soit étendue aux écoles, aux prisons, aux ateliers aussi bien qu’aux casernes. Le but n’était plus d’obtenir une acceptation extérieure de l’autorité, mais d’intérioriser le contrôle et les contraintes. Ceci marque la différence entre les formes de contrôle féodales et capitalistes. Le féodalisme réclame une soumission extérieure à l’autorité – le paysan produisait encore pour lui-même – tandis que le capitalisme exigeait aussi la capacité physique et psychologique de maximiser la production. Il fallait donc briser les rythmes de travail naturels et les remplacer par les rythmes de la machinerie. Le corps aussi devait être éduqué à être une machine et à travailler comme une extension de la machine. D’où l’extension des processus de discipline déjà existants dans les casernes et les couvents aux écoles, aux hôpitaux et aux familles.
Dans les écoles par exemple, le plus petit mouvement pouvait être mal interprété et puni. Le corps était une extension du bureau (comme une extension de la machine dans les usines) — rigide, droit et enraciné au sol. Dans ce contexte, le corps confortable et détendu était subversif. Des concepts similaires existaient dans toute la société, la famille et les différents stades de l’école se conformaient tous à la norme sociale de docilité. Se tenir mal était une preuve de moralité douteuse. Les idéologies religieuses à base puritaine influencèrent largement cette transformation.
Ce qu’il faut retenir dans l’émergence d’une stratégie sociale de discipline, c’est que le corps est devenu un lieu pour la réalisation matérielle, aussi bien que l’intériorisation, des idéologies. Dans la mesure où le corps, construit selon les exigences d’une discipline du travail — un corps rigide, ascétique – est devenu une entrave aux besoins de la consommation de masse, il fallait développer un autre corps socialement acceptable. Comme la révolution industrielle avait exigé un corps discipliné à suivre les rythmes du travail, l’apparition de la consommation de masse exigeait un corps discipliné à consommer. Le plaisir personnel à travers les marchandises était non seulement acceptable, mais souhaitable ; il fallait donc aussi un corps, détendu, désirant et à la limite libidinal.
Avec l’avènement de la production de masse, il était devenu insuffisant de discipliner l’ouvrier aux horaires et au rythme du travail. Il convenait aussi de fabriquer le consommateur. La consommation devait être efficace, son allure correspondre à celle du cycle de production et à ses besoins de renouveau. En d’autres termes, il fallait élaborer « une discipline de consommation », non seulement pour confiner les formes de repos psychique à la sphère des loisirs, mais aussi, à un plus haut niveau, pour encourager la culture d’un style individuel. Tandis que la discipline de travail engendrait un appareil disciplinaire répressif (maîtres d’école, directeurs d’usine, juges, etc.), la discipline du consommateur ne pouvait pas être répressive : tout d’abord, la liberté individuelle de choisir des marchandises était l’un des principes fondamentaux de la démocratie de marché, ensuite, il y avait toujours eu dans l’idéologie bourgeoise une antinomie fondamentale entre travail et loisir. Comme la consommation faisait partie du domaine du loisir, la discipline du consommateur prend logiquement une forme qui est directement opposée à la discipline du travail, en d’autres termes, devient « libération » de la discipline du travail.
On peut maintenant comprendre pourquoi les moralistes publics se sont toujours sentis menacés par la « moralité relâchée » inévitablement liée à la musique populaire et à la danse. Celle — ci évidemment, impose au corps des mouvements qui vont directement à l’encontre de ceux exigés par la discipline du travail. Étant donné le lien direct et fonctionnel entre la musique populaire et la danse, il n’était pas du tout surprenant que les stars de la musique populaire aient dû jouer un rôle clé dans le façonnement du consommateur « relax et cool ». Ce processus s’est, bien sûr, accéléré avec le rock and roll.

Les chanteurs populaires des années 1930 présentaient une image détendue qui impliquait que dépenser de l’argent pour s’amuser était plus normal et plus social que de s’incarner en bête de somme ascétique et disciplinée comme autrefois. Bing Crosby en était l’archétype : détendu, gentil, facile à vivre, il aimait le golf, le football et présentait une image de conformiste, aimant la vie de famille. « Tout homme qui m’aime bien, disait-il, me voit comme une image de lui-même ». Kate Smith présentait l’image d’une Américaine moderne, matérialiste, sincère et ayant les pieds sur terre : Ce double aspect de détente et conformisme n’est guère surprenant : premièrement, il fallait persuader la classe moyenne américaine que la consommation des biens de ménage était positive et socialement acceptable ; deuxièmement, la consommation elle-même était encore marquée par la conformité sociale. À ses débuts, la production de masse fut caractérisée, pour des raisons à la fois économiques et techniques, par la standardisation d’une ligne de produits. Pendant la période 1930-60, la consommation aussi correspond à cette standardisation, relevant d’une norme homogène, où toute déviation de la norme engendre le soupçon.
Les stars participaient directement à la publicité. Comme la production de masse impliquait un coût initial élevé et comme l’on voulait éviter des pertes paralysantes, les fabricants ont essayé d’associer leur produit à certaines stars qui avaient déjà conquis un grand public.
La majorité des spectacles musicaux radiophoniques étaient supervisés par les publicitaires. Des leaders de big bands comme Paul Whiteman, Ted Weems et Ben Bernie vantaient respectivement les mérites du fromage Kraft, de la cire Johnson’s et de la bière Pabst. Benny Goodman, Bob Crosby et Vaughan Monroe promotionnaient les cigarettes Camel ; Hal Kemp, Glenn Miller et Harry James la marque Chesterfield ; les cigarettes Raleigh Kool furent représentées par Tommy Dorsey et les cigarettes Philip Morris par Horace Heidt ; finalement la marque Old Gold fut promotionnée par Paul Whiteman, Artie Shaw et Woody Hermann. Quant à la marque Lucky Strike, elle dotait un « hit-parade », tandis que Coca Cola avait sa propre émission de concerts en direct intitulée « Spotlight Series »[17]. La personnalité incarnée par ces stars était supposée se communiquer au produit. « Ces cigares sont réellement moelleux et pleins de joie », écrivait un fan à Kate Smith à propos des cigares qu’elle promotionnait. Les stars de l’époque présentaient l’image d’une vie moderne et sophistiquée, on les photographiait pour les magazines, faisant des salades dans des cuisines bien équipées ou se relaxant sur des pelouses parfaitement tondues.

Certaines stars prirent leur rôle très au sérieux. En 1932, Joan Crawford, la star de cinéma, publia dans Photoplay un manifeste intitulé « Dépensez ». Répondant aux nombreuses critiques qui se plaignaient de ce que les stars soient outrageusement payées, Crawford répliquait qu’il était du devoir de la star de garder le style de vie que le public lui attribuait. Elle affirmait qu’elle devait vivre dans le luxe afin que ses fans l’imitent : « Moi, Joan Crawford, je crois dans le dollar. Tout ce que je gagne, je le dépense » [19].
Alors que la Grande Dépression se termine, les spectacles prospèrent et la société Edison affiche : « Roosevelt a joué son rôle. Maintenant, c’est à vous d’agir. Donnez une soirée, allez voir un spectacle. Achetez quelque chose. Construisez une maison, faites un voyage, chantez une chanson, mariez-vous. Ce vieux monde commence à bouger »[20]. On demandait « pourquoi les professeurs ne peuvent-ils pas être comme Benny Goodman ?« [21] L’accent était mis sur la nouvelle personnalité « relax et détendue » véhiculée par les rois du swing, la musique de danse par excellence.

Cette situation a continué après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, Kate Smith prouvait sa qualité d’ « Américaine à 100% « (all American) par sa promotion des bons de guerre émis par le gouvernement. Dans le cas de Frank Sinatra, l’accent était encore mis sur la conformité. Il y avait des jeux-concours où il fallait compléter en moins de cinquante mots la phrase : « Frank (Sinatra) est un Américain moyen parce que... ». Sponsorisé pour une série de conférences radiophoniques par les chapeaux Lee, Sinatra avait un style vestimentaire ardemment copié par ses fans.
Sinatra est un des porteurs de nœuds papillon le plus célèbre du pays. Il aime bien les pois sur tissu et la vitesse avec laquelle les nœuds papillon avec ce motif se sont vendus ces dernières années est un hommage à son influence… Les ventes de nœuds papillon en général ont augmenté de 400% depuis 1944. [22]
Le centre social du comportement « normal » s’est déplacé. Un contemporain de Sinatra l’a décrit en 1947 :
Sinatra collectionne les meubles, occasionnellement il mange des « banana splits » (des bananes à la glace) et il rit beaucoup… mais généralement, ses habitudes sont assez adultes. Il aime bien les boums et les clubs de nuit. On sait qu’il ne refuse pas un verre. Il se couche tard la nuit… [23]
On est maintenant en position d’apprécier le rôle de la star de musique populaire. L’écroulement des rapports sociaux traditionnels dû à l’urbanisation et à la production de masse laisse en suspens le lieu de l’identité personnelle. La stratégie sous-jacente du capitalisme, via les publicistes, était de faire du consumérisme la base théorique des futurs rapports sociaux. Un individu bombardé par un assortiment de marchandises qui vont souvent au-delà des nécessités du confort et des besoins fonctionnels évidents et à travers lesquels il doit établir son identité individuelle, tend à prendre des décisions qui vont dans la logique d’un certain style de vie. Les styles de vie deviennent visibles parce qu’ils sont simplifiés et unifiés à différents degrés de spécificité à travers les célébrités populaires qui servent ainsi de modèles conceptuels, constituant des « diagrammes abstraits ». Accepter l’un de ces modèles, ou simplement l’un de ses aspects comme c’est plus souvent le cas, vous sauve de la nécessité de prendre des centaines de menues décisions de consommation. L’épanouissement des styles de vie devait advenir plus tard, dans les années 1960. Pour l’instant, pendant les années 1930-50, il était nécessaire de rassurer un public de classe moyenne, de lui expliquer qu’il agissait correctement. Comme l’a écrit le magazine Harper’s Bazaar déjà cité : « Le grand moment où (le mâle américain) est terrifié par sa liberté, c’est quand il s’achète des vêtements… ».

Dans une étude des biographies dans les magazines populaires entre 1901 et 1941, le sociologue allemand exilé (et ancien membre de l’École de Francfort), Léo Lowenthal, a remarqué un changement net dans le type de personnalité traité. D’abord, il s’agit d’ « idoles de production », des gens qui ont réussi dans le monde des affaires, des inventeurs, des banquiers, etc. Puis on se tourne vers « des idoles de consommation ». Ces idoles viennent de la sphère de la consommation et de plus, leur vie privée est une vie de consommation. Pour Lowenthal, les stars sont des modèles de consommation pour tout le monde. Elles dépensent plus, mais, sur une plus petite échelle, on peut les imiter. Les héros, d’après Lowenthal, sont « beaucoup de gens qui aiment ou qui n’aiment pas les cocktails, les cigarettes, le jus de tomate, le golf et les soirées » [24].
Lire/imprimer le chapitre 2 au format PDF :
[himage]
Notes
[1] Stuart et Elisabeth Ewen, « Americanisation and Consumption »,Telos (St. Louis, Missouri), 37, automne 1978, p. 45. [2] N. Dennis, F. Henriques, C. Slaughter, Coal is our Life, Tavistock, London, 1969, p. 153n (cité par Simon Frith, The Sociology of Rock, Constable, London, 1978. [3] Stuart Ewen, Consciences sous influence, Aubier-Montaigne, 1983, p. 66 (traduction de Captains of Consciousness, New York, 1976). [4] Simon Patten, The Consumption of Wealth, New York, 1892, cité in Ewen et Ewen, art. cit., p. 47. [5] Paul Baran et Paul Sweezy, Le Capitalisme monopoliste, Maspero, 1970, p. 115 (traduction de Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York, 1966). [6] cité in ibid., p. 123. [7] Ewen, op. cit., p. 147. [8] cité par G. Murdock et R. McCron in Stuart Hall et Tony Jefferson (dirs), Resistance through Rituals, Hutchinson/CCCP, London, 1975, p. 195. [9] Stanley Hall, Adolescence ; its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education, Appleton, London, p. viii, cité par Simon Frith, op. cit. [10] cité in Ewen, op. cit., p. 101. [11] ibid., p. 102. [12] ibid. [13] ibid., p. 93. [14] ibid., p. 94. [15] ibid., p. 95 [16] Paul Mazur, The Standards we raise, New York, 1953, p. 32. [17] Voir Ian Whitcomb, After the Ball, Penguin, 1972, p. 115 ; George T. Simon, The Big Bands, Collier, New York, 1974, p. 56. [18] Whitcomb, op. cit., p. 114. [19] Kenneth Anger, Hollywood Babylon, Delta, New York, 1975, p. 155. [20] Whitcomb, op. cit., p. 147. [21] ibid. [22] E. J. Kahn, The Voice, Harper, New York, 1947, p. 22. [23] ibid., pp. 16-17. [24] Leo Lowenthal, « The triumph of Mass Idols », chapitre 4 de son Literature, Popular Culture and Society, Prentice-Hall, Eaglewood Cliffs (New Jersey), 1961, p. 135, première publication dans Radio Research, 1942-3.


Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)