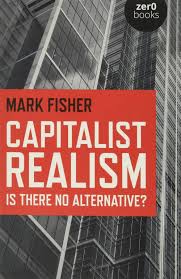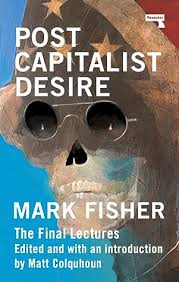La raison psychédélique : Mark Fisher et les spectres de la rareté – Devin Thomas O’SHEA
Cet article, traduit par moi, a été posté sur le site de Jacobin magazine, le 4 janvier 2025 (DB).
On croit apercevoir une figure dans le miroir de l’autre côté de la salle, mais quand on revient sur ses pas pour vérifier, il n’y a personne. Les spectres s’attardent dans des espaces vides, où règne une ambiance austère, comme les couloirs d’un vieux manoir, le chemin désolé d’un cimetière abandonné, ou l’aspect creux d’un village Potemkine, autant de lieux hantés classiques.
Il est bizarre de savoir, quand on regarde la ligne des toits d’une grande ville américaine, que certains de ces gratte-ciels chatoyants sont totalement vides, des apparitions hantées réduites à n’être que des actifs financiers dans des portefeuilles immobiliers. De même, les fantômes sont notoirement connus pour leur doublement sinistre, comme les jumeaux dans The Shining, et pour leurs excès déconcertants : des essaims de mouches noires, des volées de corbeaux, des voix provenant de nulle part. De façon similaire, il est étrange de s’égarer derrière un supermarché au-delà des docks de déchargement pour retrouver des bennes pleines de nourriture encore consommable, ou des produits non déballés, victimes de la mévente et destinés à la décharge.
Dans The Weird and the Eerie, Mark Fisher parle de ces sentiments inquiétants qui pointent vers des choses en dehors de notre perception – quelque chose de fantomatique, qui résiste à la description. Voilés, hors de ce monde, ces phénomènes évoquent ce que Fisher appelle « le spectre d’un monde qui pourrait être libre ».
Fisher a combattu la dépression clinique toute sa vie jusqu’à son suicide en 2017, mais son œuvre reste comme un antidote au désespoir, surtout son dernier projet inachevé, intitulé, en guise de plaisanterie, Acid Communism.

Au-delà du miroir du réalisme capitaliste
Le livre de Fisher le plus célèbre est Le Réalisme capitaliste, qui décrit le morne système sans avenir dont nous sommes prisonniers. C’est une période de stagnation culturelle et d’austérité, renforcée par le soupçon toujours présent que ce sera bientôt la fin du monde.
Fisher décrit le réalisme capitaliste comme une vision du monde artificielle qui nous piège dans un cycle dépressif. Ce cycle se maintient à travers un paradoxe : un sens répandu de catastrophe et de prémonition qui renforce le statu quo. Selon Fisher, cette façon pessimiste de voir le monde est un développement stratégique du capitalisme néolibéral. C’est un système qui assure qu’on ne peut penser en dehors de ses limites, quels que soient les efforts consacrés. Même si on pense s’échapper du Matrix en prenant la pilule rouge, on ne fait que transiter vers une autre pièce du Matrix : « le monde réel ». Ce doublement sinistre fait partie de la présence spectrale ; par la force des choses, il faut recourir à la fiction, ne serait-ce que pour en parler.
Tandis que les générations précédentes croyaient plus ou moins en un projet idéologique visant à la construction d’un meilleur avenir, le réalisme capitaliste est pleinement défini par un système qui met le court terme à l’avant, effaçant l’idée même d’un autre avenir. Soit c’est la continuation du capitalisme, soit c’est la fin du monde. Il n’y a pas d’alternative.
Le réalisme capitaliste s’est développé pendant plusieurs décennies, profitant de l’atomisation croissante. Dans Acid Communism, cependant, Fisher cherche à inverser le pouvoir du système, mettant Goliath sur sa tête. « Au lieu de vouloir surmonter le capital, nous devons nous focaliser sur ce que le capital doit toujours entraver : la capacité collective à produire, à prendre soin et à prendre plaisir […] ; loin de se soucier de « la création de la richesse », le capital bloque toujours par nécessité la production des richesses en commun. »
Pour Fisher et ses héros intellectuels comme Fredric Jameson, la distance entre un monde qui pourrait être libre, et le monde réellement existant devient un terrain mesurable, si on se sert des métaphores provenant de la fiction, surtout de la science-fiction. Dans Acid Communism, cependant, Fisher pointe aussi vers des façons de voir historiques : la prolifération d’expériences du socialisme démocratique et du communisme libertaire qui ont fleuri dans les années 1960.
La contreculture des années 1960 était le résultat des conditions matérielles nouvelles ; Fisher s’appuie sur un exemple tiré de l’autobiographie de Danny Baker, un animateur radiophonique issu de la classe ouvrière, se souvenant des vacances en famille en Angleterre en 1966. Sa famille s’est rendue au bord de la mer dans une voiture personnelle devenue abordable, profitant du temps libre gagné de haute lutte par la génération précédente. Sur la plage, la technologie de la radio transistor a permis l’écoute des groupes comme les Beatles et les Kinks, qui chantaient le rêve, la perception nouvelle, et comment les règles du jeu se présentaient faussement comme immuables. La réalité était psychédélique, malléable, en état de flux ; si tout le monde décidait que quelque chose devait s’arrêter, ou qu’autre chose devait commencer, alors le désir collectif d’un autre avenir serait une force irrésistible pour toute l’humanité.
Pour Fisher, ces rêveries n’étaient pas de pure perte, mais la reconnaissance logique d’un simple fait : cette capacité collective fut démontrée matériellement dans les deux guerres mondiales.
Hanté par la rareté
Fisher cite la carrière de Baker dans la radiodiffusion comme un exemple de l’évolution de l’espace public après la Guerre. À la radio et à la télévision, des perspectives populaires ont proliféré, surtout quand le financement public de la culture produisait les armes à même d’ébranler le communisme soviétique.
Les programmes comme le New Deal, le financement public des études supérieures et des formations professionnelles pour les vétérans de la Guerre (G.I. Bill), et en Grande-Bretagne, la construction massive de logements à loyer modéré étaient des vitrines démontrant que les gouvernements occidentaux n’étaient pas simplement des soutiens des valeurs capitalistes, mais aussi des architectes des structures quasi socialistes. Des initiatives comme les grands projets de travaux publics aux États-Unis (Works Progress Administration ou WPA) démontraient la capacité étatique à s’organiser collectivement sur une grande échelle.
Le boom après la Guerre a permis à des millions d’Américains de condition modeste (certes, plutôt blancs) d’intégrer la classe moyenne, caractérisée par la sécurité, la dignité sociale, la consommation, les perspectives créatives et le temps libre. Des avancées dans l’automatisation, des matériaux de construction et de l’agriculture ont soutenu cette transformation, qui révélait que l’État était capable de créer des systèmes puissants pour le bien-être des citoyens en peu de temps. Dans les années 1960, les enfants de ceux qui avaient participé à ce pouvoir collectif rêvaient d’appliquer cette capacité à l’échelle mondiale, sans égard de la race, du genre, et de la nationalité. Au lieu de cela, nous n’avons eu que de la rareté.
Dans Acid Communism – le titre est un clin d’œil à la nécessité d’esthétiser la vie quotidienne, élever les consciences, et voir à travers le tigre en papier du réalisme capitaliste – Fisher pointe vers la rareté et la restriction artificielle comme les générateurs principaux de la richesse pour les responsables du régime d’après-guerre.
L’inflation a fait le buzz lors de l’élection présidentielle aux États-Unis en 2024. Cela était dû en partie à la rareté réelle, à savoir la crise des filières logistiques pendant la pandémie, qui a résulté en une augmentation de 40% des fortunes des Américains les plus riches. Les entreprises ont pratiqué le gonflement des prix sans retenue, créant une forme de rareté artificielle qui érode par l’inflation la valeur des salaires. Fisher identifie cela comme le trait définissant du capitalisme néolibéral. « Un système qui génère de la rareté artificielle afin de produire de la rareté réelle ; un système qui produit de la rareté réelle afin de générer de la rareté artificielle. »
Prenons le fonds d’investissement Blackstone, qui possède un tiers du stock d’immobilier aux États-Unis : en conséquence, il peut créer de la rareté et fixer les loyers à sa guise. Considérons la dégradation des sols par des pesticides, qui profite aux entreprises comme Monsanto ; non seulement elle vend les pesticides, mais elle peut aussi commercialiser des aliments génétiquement modifiés comme solution aux dégâts dont elle-même est responsable. Cette logique pérennise un système ostensiblement dessiné pour la création des richesses, mais qui, en réalité, entrave la production des richesses en commun. Certaines ressources sont retenues et la valeur du travail est siphonnée. Un système (Red Plenty (1)) capable de satisfaire les besoins de tout le monde – logement, nourriture, soins médicaux, une vie où le travail n’est pas dénué de sens – est délibérément contrarié.
Pour Fisher, les débris de la contreculture – les symboles de la paix, les vestes à franges, la musique psychédélique – sont des vestiges d’un potentiel plus profond, non réalisé. Fisher méprisait les hippies et leur fétichisation de la drogue, critiquant leur « infantilisme hédoniste » comme un renforcement du réalisme capitalisme et non une rébellion contre lui. Mais malgré cela, il adhérait au rêve « psychédélique » d’émancipation, une vision des possibilités collectives.
Quand nous affrontons la présence hantée du réalisme capitalisme – pointant au travail avec Donald Trump au timonier, subissant des canicules et des catastrophes naturelles alors que le réchauffement de la planète semble inarrêtable, écoutant le dernier récit de cruauté incompétente commise par la classe dominante –, il est important de reconnaître que la fin du monde est brandie comme une menace constante afin de maintenir le statu quo. La répétition sans fin de termes comme « températures record » ou « pluies qui arrivent une fois par siècle » inspire de l’effroi ; il n’est pas fatal que ce monde soit ainsi.
À quoi ressemblerait « la raison psychédélique » ? Comment pourrait-on faire converger la conscience psychédélique et la conscience de classe afin d’imaginer un monde au-delà du réalisme capitaliste ?
Quitter le désert du réel
Comme David Graeber l’a documenté dans Bullshit Jobs, tous les jours, le système du travail inflige une « cicatrice » morale et spirituelle sur l’« âme collective ». En 1930, l’économiste John Maynard Keynes a prédit que les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient une semaine de travail de 15 heures en 2000. « Au lieu de cela, dit Graeber, la technologie a été mobilisée pour trouver des façons de nous faire travailleur plus. Afin de le faire, des emplois ont dû être créés qui sont effectivement inutiles. »
Graeber cite le secteur administratif, les services financiers, le marketing, le droit commercial, les ressources humaines, les relations publiques et les cabinets de conseil comme autant d’exemples de professions en pleine croissance qui n’apportent rien au bien-être de la société, de l’avis même de leurs praticiens. Beaucoup d’entre nous travaillons uniquement pour toucher un salaire, en comptant les heures, puis utilisons notre temps libre limité pour se reposer afin de recommencer le cycle le lendemain.
Ça a été mon expérience de la plupart des emplois : un cycle quotidien de « se fouetter et se soulager » (lash and balm), faisant répandre une épidémie de dépression, de toxicomanie, et de sentiments d’une vie dénuée de sens, malgré une compensation financière adéquate ou même avantageuse. C’est le résultat d’une vision d’abondance remise ; nous sommes hantés par des rêves du Red Plenty, des possibilités collectives hors d’atteinte. Mais des bribes d’un autre monde peuvent se trouver chez Fisher dans Acid Communism, où il capte ce malaise en se mettant en dehors de la corvée de la vie moderne.
C’est la vie quotidienne vue d’à côté, d’au-dessus et d’au-delà : la rue bondée perçue de la fenêtre de celui qui fait la grasse matinée, dont le lit se transforme en canot ; le brouillard et la gèle d’un lundi matin renoncés en faveur d’un dimanche après-midi ensoleillé qui n’en finit pas ; les commissions urgentes délaissées avec désinvolture depuis une aire aristocrate, occupée désormais par des rêveurs de la classe ouvrière qui ne pointeront plus jamais au travail.
Le travail de Fisher, y compris son blog k-punk, était typique de la blogosphère des années 2000, avant que cet espace ne soit subsumé par les enclosures mises en place par le secteur privé. Internet, qui aurait pu devenir un vaste espace d’information publique, a été détourné par de tristes et stupides sires, qui n’y voyaient qu’un outil pour faire des bénéfices sans fin. L’intelligence artificielle est en train de « merdifier » (shittify) le langage, l’art et la compréhension générale du monde, alors que les avancées technologiques sont de plus en plus synonymes avec le chômage de masse, la surveillance et l’exploitation du travail. Entre-temps, la Floride coule, et de nouvelles épidémies couvent.
Dans un monde post-1,5°, ne faudrait-il pas que les usines désaffectées soient mieux utilisées ? Un espace public médiatique ? Des galeries d’art, des lieux de concert, des théâtres, des stades, des terrains de sports ? Et si davantage de gens passaient le temps en apprenant des rôles dans des pièces dramatiques, dessinant les costumes, ou simplement assistant à la représentation ? Ou s’ils ne faisaient rien assez longtemps pour redécouvrir un travail qui les satisfaisait ?
La pensée utopique va souvent de pair avec un manque de sérieux, surtout à gauche, où domine la crainte de paraître naïf. Mais Acid Communism nous rappelle qu’imaginer ce qui pourrait être est une tonique vitale contre le désespoir : « Des images de gratification […] détruiraient la société qui les supprime. »
Fisher s’appuie sur les idées de Herbert Marcuse sur pourquoi l’art n’a pas le pouvoir de dépeindre l’utopie ou « la gratification réelle ». L’art ne peut que « mesurer la distance » entre aujourd’hui et la possibilité de Red Plenty ; dans le désert du réalisme capitaliste, décrire l’utopie inonderait le terrain vague dans lequel l’image a été supprimée. Ce processus ne résulterait pas de la violence, mais de la gratification, de la sécurité, de la prospérité, de la croissance réelle ; un torrent de biens publics.
Dans Le Réalisme capitaliste, Fisher a notoirement analysé Les fils de l’homme (2006), un film de science-fiction (d’après le roman de P. D. James) qui raconte un monde qui se retrouve face à une épidémie de stérilité. L’incapacité à avoir des enfants met l’humanité au bord de l’extinction ; les écoles primaires, sans les voix des enfants, sont comme hantées. Le film suit la mère et le gardien d’un nouveau-né, le premier depuis des décennies ; c’est un récit messianique puissant, qui nous donne la vision d’un renouvellement spirituel dans une dystopie qui ressemble de plus en plus au nôtre.
Fisher était à l’avance de son temps, et a subi plus que sa part de la douleur du monde. Lui-même a cherché à se renouveler dans Acid Communism, et dans ses dernières conférences recueillies dans Postcapitalist Desire (sous la direction de Matt Colquhoun). Beaucoup d’entre nous aurions aimé qu’il achève son nouveau projet. Mais c’est à nous de le faire. Le flambeau est désormais porté par Alex Williams et Nick Srnicek (Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, Verso, 2015) et par Helen Hester et Nick Srnicek (After Work: A History of the Home and the Fight for Free Time, Verso, 2023).
L’un des thèmes clés de l’Acid Communism porte sur « l’esthétisation de la vie quotidienne », une façon de regarder la banalité du monde du coin de l’œil, comme étant radicalement autre. Il ne s’agit pas de la pensée magique, mais d’un outil pour combattre le défaitisme. En réenchantant le quotidien, on peut apercevoir furtivement l’utopie – le Red Plenty – et résister à l’inévitabilité suffocante du présent. Fisher nous a défiés de voir dans la dignité humaine une force qui, pour que le système soit maintenu, doit être restreinte, ligotée et mise sous sédation. Comment progresser davantage dans le royaume de la raison psychédélique ? Fisher a commencé en demandant : « Et si le succès du néolibéralisme n’indiquait pas l’inéluctabilité du capitalisme, mais témoignait plutôt de l’ampleur de la menace posée par le spectre d’une société libre ? »
Lire également dans la Web-revue : Mark Fisher, « Le présent éternel : est-il toujours possible d’oublier ? », mars 2020.
Note :
1. Red Plenty : référence au livre de Francis Spufford (voir bibliographie ci-dessous) qui raconte la fiction alternative d’une Union soviétique qui réussit son pari cybernétique de pourvoir aux besoins de tous les citoyens dans les années 1960 (NdT).
Bibliographie :
Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste. N’y a-t-il pas d’alternative, Entremonde, Genève, 2018 (2009).
Mark Fisher, The Weird and the Eerie, Repeater Books, London, 2017.
Mark Fisher (manuscrit inachevé avec une introduction par Matt Colquhoun, disponible en ligne), Acid Communism, Anti-Copyright, 2020.
Mark Fisher, Désirs postcapitalistes, Audimat éditions, 2022.
Francis Spufford, Capital rouge. Un conte soviétique (Red Plenty), L’Aube, 2016 (2010).


.