Les jeux vidéo : du logiciel dans l’art – Pierre LOUIS
Premier constat sur les relations esthétiques entretenues par les deux médias, cinéma et jeu vidéo : l’émergence progressive d’un phénomène d’hybridation. Au même titre que le cinéma de la fin du XIXe siècle s’inspira du théâtre et de la littérature, le médium vidéoludique s’inspira du cinéma. Cependant, ce phénomène s’inscrit dans une relation bilatérale, car le cinéma s’est également présenté comme porteur de discours face à l’émergence de ce nouvel objet. En effet, il faut souligner que les relations entre cinéma et jeu vidéo témoignent également d’une tension entre une volonté de collaboration et une idée de concurrence.
Article interdit à la reproduction payante.
Contenu
Relations esthétiques

Les capacités techniques des jeux évoluant dans les années 1970, il devient alors possible de simuler des mouvements de caméra. C’est à ce moment que se noue un véritable dialogue avec la grammaire du cinéma. La question du travelling par exemple trouve son équivalent vidéoludique avec le scrolling, effet visuel devenu peu à peu un mécanisme essentiel permettant de donner un réel dynamisme à l’action de jeu. Pour illustrer cela, le chercheur espagnol Manuel Garin a effectué un parallèle intéressant entre des séquences de Seven Chances de Buster Keaton (1925) et des captations de Super Mario Bros [1]. En juxtaposant les extraits sur un seul écran, Garin met en évidence le processus de remédiatisation du corps burlesque propre au cinéma muet (sauts, chocs, course) par le jeu vidéo de Nintendo. Ce réinvestissement des codes laissés à l’abandon par le cinéma au fil de son évolution pourrait se lire comme l’une des plus belles manifestations de l’art vidéoludique des origines.


Dès lors, on peut effectuer un premier constat sur ces relations esthétiques entretenues par les deux médias : l’émergence progressive d’un phénomène d’hybridation. Au même titre que le cinéma du début du XXe siècle s’inspira du théâtre et de la littérature, le médium vidéoludique s’inspira du cinéma. Cependant, ce phénomène s’inscrit dans une relation bilatérale, car le cinéma s’est également présenté comme porteur de discours face à l’émergence de ce nouvel objet. En effet, il faut souligner que les relations entre cinéma et jeu vidéo témoignent également d’une tension entre une volonté de collaboration et une idée de concurrence.
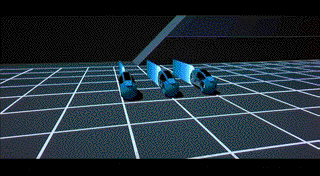
Dans les années 1970, le cinéma hollywoodien, conscient de certaines difficultés, développe des stratégies pour séduire une tranche du public désormais plus intéressée par les nouveaux espaces de loisirs que constituent les salles d’arcades. La thématique du jeu vidéo s’impose très vite comme porteuse pour les studios, et bon nombre de films tentent de rendre compte de cette pratique sociale en mettant au centre de leurs scénarios ses codes esthétiques, son univers, et parfois même des représentations de son industrie. Le film le plus emblématique de cette série de productions est Tron (Steven Lisberger, 1982), un projet porté par la firme Disney au moment où elle essaye de rajeunir son image. En mettant en scène l’histoire d’un concepteur aspiré dans les méandres de sa création, Tron développe une esthétique qui va longuement marquer les imaginaires, imposant une représentation cinégénique du jeu vidéo composée d’un patchwork de prises de vue réelles et d’images de synthèses. Tron est d’ailleurs l’un des tous premiers films à avoir largement fait usage de ces dernières, ouvrant la voie à ce type d’effets visuels.


Il faut attendre le milieu des années 2000 pour voir apparaître dans le cinéma de divertissement des œuvres qui rendent compte, d’un point de vue non stigmatisant, de la pratique du jeu vidéo. En ce sens, le film d’animation japonais Summer Wars (Mamoru Hosodo, 2009) fait montre d’une belle réflexion sur les possibilités offertes par les interfaces vidéoludiques, tandis qu’une comédie dramatique comme Reign Over Me (Mike Binder, 2007) intègre des séquences où les deux personnages principaux ont une forme d’échange et de rapprochement autour d’un jeu vidéo, Shadow of the Colossus. Néanmoins, il aura fallu attendre deux décennies pour que ce type de discours apparaisse, par le biais d’une nouvelle génération de réalisateurs qui ont grandi aux cotés des jeux vidéo.
Du fait de la multiplicité des formes de représentations que le cinéma entretient avec le jeu vidéo, on peut établir trois types de discours en observant les différentes stratégies que les studios mettent en œuvre. L’effet de citation intègre l’objet de manière physique à l’écran, que ce soit en termes de placement de produit, ou plus simplement comme justification d’un élément de l’intrigue. À cela s’ajoute presque systématiquement un effet de commentaire qui porte un regard critique, négatif ou non, en questionnant les pratiques, les enjeux, les thématiques, voire l’esthétique visuelle du jeu vidéo. Enfin, il y a un troisième type de discours, probablement le plus répandu : l’adaptation.

Par ailleurs, il faut préciser que les jeux adaptés sont très souvent déjà porteurs d’enjeux cinématographiques dans leur esthétique ou leur mécanisme ludique, ce qui facilite le travail d’adaptation pour les studios, tout en leur offrant un déjà constitué ainsi qu’un univers visuel et narratif clés en main. Ces jeux, qui empruntaient leurs matières au cinéma d’horreur, de science-fiction, d’art martiaux ou d’aventure témoignent d’un processus d’une remédiatisation qu’ils ont eux-mêmes contribué à engendrer. Toutefois, ces types de portages sont loin de faire l’unanimité chez les joueurs, qui y voient régulièrement une occasion de réaffirmer les valeurs de leur culture d’origine, en prétextant par exemple que l’expérience vidéoludique ne peut avoir d’équivalent cinématographique. En effet, le questionnement principal que pose la démarche d’adaptation est celui du récit. Une trame narrative extrêmement simple comme celle de Super Mario Bros, parfaitement adapté à un environnement de jeu, impose aux scénaristes un travail d’étoffement qui dénature l’objet d’origine, en le replaçant dans un genre cinématographique préexistant.

Le récit vidéoludique

Les histoires sont essentielles dans la façon de représenter la vie quotidienne et la réalité de tous les jours. À cet égard, les technologies numériques sont désormais perçues comme une révolution dans l’art de les raconter, car elles imposent des caractéristiques particulières à la narration. À la fin des années 1990, le CD-Rom, support envisagé comme l’avenir du médium vidéoludique, s’est massifié au sein des jeux vidéo. Ce nouveau support, à la capacité de stockage sans précédent, permet d’employer des images de synthèse quasi photo-réalistes, et surtout d’utiliser de véritables environnements de jeu parfaitement modélisés. Dès lors, on constate un véritable tournant narratif dans l’industrie, où de nombreux jeux vont tenter de raconter des histoires en mobilisant des éléments photo-réalistes. Myst (Sunsoft, 1993) est aujourd’hui reconnu comme le modèle absolu de ce bouleversement. Le jeu est d’ailleurs régulièrement cité par la sociologue Janet Murray pour illustrer les nouvelles potentialités offertes par le numérique pour raconter des histoires de façon particulière [3].

Dès lors, une question s’impose : qu’est-ce qui ferait du jeu vidéo une forme de narration particulière ? Pour Janet Murray, les jeux vidéo mettent en œuvre une forme de narration très spécifique : la narration spatialisée. Selon elle, c’est en découvrant différents lieux et espaces que le joueur va être à même de prendre connaissance des évènements qui composent une histoire et en découvrir l’intrigue. Dans Myst, le joueur est systématiquement amené à explorer de nouveaux lieux qui vont lui donner accès à une énigme pour le faire progresser dans l’intrigue. De nombreux auteurs considèrent que la structure d’un jeu vidéo peut être analysée de manière narrative. Dyer- Witheford, Kline et De Peuter, par exemple, font référence à la narration dans leur ouvrage Digital Play, en employant le terme de scénario à maintes reprises pour qualifier le récit déployé dans un jeu. Leur idée principale consiste à déterminer la place de l’interactivité, comme « allocation d’ouverture et de fermeture à différents degrés d’un scénario donné ». Le jeu vidéo, à l’instar de la quasi-totalité des productions de cinéma de divertissement, relève d’une structure narrative constituée comme une succession d’épreuves. Pour Sebastien Genvo, spécialiste des jeux vidéo : « l’analyse ludologique permet de ne pas considérer uniquement la structure comme un récit de fiction, mais bien comme un système de simulation […] L’approche narratologique permet de pouvoir aborder ce que le joueur est incité à faire pour que les mécanismes du système se délivrent dans l’action et entrent en jeu » [2]. Ce qu’appuie Genvo à travers cette analyse relève de la spécificité narrative du jeu vidéo par rapport au cinéma : les formes de récits vidéoludiques sont marquées par une dimension d’incertitude, une marge qui permet au joueur de produire par ses choix et ses actions l’évolution du récit proposé par le contenu vidéoludique. Le jeu vidéo est un objet narratif potentiel qui est mis en expression par le joueur face à sa partie de jeu. Aussi simpliste qu’il puisse paraître, on peut considérer que chaque partie de Super Mario Bros est une expression d’un récit singulier en fonction de chaque joueur qui s’y adonne. L’incertitude constitue en substance le choix des possibles.


Les jeux vidéo mettent en place une forme de narration particulière, la narration spatialisée. Lorsque le joueur a le choix dans la suite des événements, cela se traduit concrètement par les types de lieux qu’il ira explorer. Prenons par exemple l’introduction de The Elder Scrolls v. Skyrim, l’un des jeux de rôles (role playing game ou RPG) les plus populaires de ces dernières années. Dans ce jeu, le joueur commence l’aventure dans une bien mauvaise posture : il est prisonnier d’une bande de malfrats et il est amené vers son exécution. Très vite, il réussira à se libérer, sauvé par un dragon qui dérange de manière inopinée cette scène d’exécution. Il faut noter que durant les premiers moments du jeu, le joueur est dirigé de manière linéaire sans choix possible, il suit un chemin prédéfini pour s’échapper de sa captivité. Par la suite, il aura le choix de s’engager avec un garde de l’empire ou du côté des rebelles, un choix initial qui se traduira par le fait d’avoir accès ou non à certains espaces ou événements au fil du développement de l’intrigue. De même, lors de sa fuite, le joueur s’engouffre dans un dédale caverneux et confiné avec le choix entre plusieurs embranchements. À la sortie du tunnel, un paysage immense s’offre à lui. Cette ouverture de l’espace est une traduction littérale d’une ouverture des possibles narratifs dans le jeu, puisque le joueur aura le choix d’accompagner le personnage qu’il a aidé à s’échapper, et ainsi suivre un élément de l’intrigue principale, ou partir seul à l’aventure pour vivre sa propre histoire, sa propre expérience de jeu. On voit bien que dans Skyrim la forme de la topographie de l’espace traduit la possibilité narrative de l’œuvre.

Le récit vidéoludique moderne est donc une suite d’évènements préétablis par les concepteurs, mais la charge de la narration est laissée au joueur. Toutefois, de nombreux jeux vidéo s’affranchissent des contraintes narratives. En effet, ils se proposent désormais de générer à chaque nouvelle partie une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire, une nouvelle suite d’événements : c’est ce que l’on appelle une narration autogénérative. Ces jeux sont communément appelés les jeux « bac à sable » (sandbox) faisant référence à l’enfant dans son bac à sable, qui se raconte une multitude d’histoires en fonction des outils qui sont mis à sa disposition. Dans le plus célèbre d’entre eux, Minecraft (Mojang, 2011), le joueur incarne une sorte de Robinson Crusoé perdu sur une île déserte, et en proie à l’attaque de créatures à la tombée de la nuit. Le joueur, n’ayant pas d’objectif qui lui soit conféré, peut en revanche personnaliser son île, développer ses propres constructions, son propre paysage, ce qui fait qu’il sera à même de produire une suite d’événements particuliers à chaque partie en fonction de la façon dont il agira dans l’espace. Ici l’exploration spatiale sert donc avant tout à générer une histoire, une série d’événements singuliers propres à chaque partie. Même si les modalités narratives particulières d’un jeu comme Minecraft semblent rendre opaque toute tentative d’analyse narratologique, on pourra recourir aux cadres théoriques éprouvés sur d’autres médias.

Le schéma narratif canonique, tel qu’il a été élaboré par les sémiologues A. J. Greimas et Joseph Courtès, permet de décrire l’arrangement logique, temporel et sémantique des éléments d’une action : un modèle adapté à l’analyse vidéoludique, dès lors que l’on considère qu’il s’accorde avec les actions du joueur et l’actualisation des mécanismes composant le système de jeu. Selon Greimas, le projet narratif peut se diviser en quatre phases bien distinctes : la manipulation, où un contrat est passé entre le sujet et le destinataire pour accomplir une mission (récupérer un objet, sauver la princesse) ; la qualification, c’est à dire l’acquisition des compétences par le sujet pour avancer dans la quête ; la performance qui constitue la phase d’affrontement après acquisition des compétences pour obtenir l’objet de la quête et enfin la sanction, qu’elle soit positive ou négative, pour parachever le récit. Ce programme narratif, hérité des contes et de la tradition orale s’applique communément à la majeure partie du cinéma de divertissement et aux jeux vidéo. L’idée centrale de ce schéma, quand on l’applique à l’objet vidéoludique, réside dans un postulat simple : persuader le joueur d’accomplir une action en vue d’obtenir une récompense. C’est cette idée qui est au fondement de l’art du game design, une promesse faite au joueur d’expérimenter des modalités d’action totalement étrangères à son quotidien pour l’inciter à agir. En somme, lui proposer de faire dans l’univers du jeu ce qu’il n’est pas en mesure de réaliser dans la vie courante, mais également dans d’autres types de médiations fictionnelles.
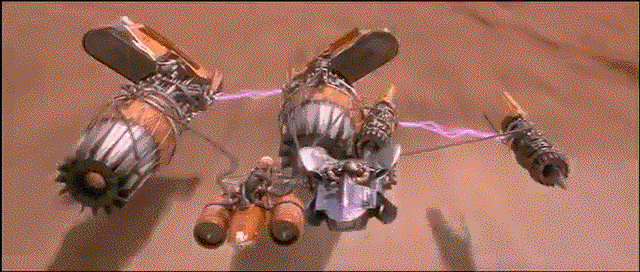
Dans un numéro spécial des Cahiers du cinéma consacré aux relations entre cinéma et jeu vidéo, Charles Tesson analyse la spectaculaire séquence de la course de modules dans l’épisode 1 de Star Wars, The Phantom Menace (Lucas, 1999), équivalent SF de la séquence des chars de Ben Hur, à la lumière de l’action vidéoludique : « le plaisir pris à y assister vient de son exécution, même si la course, avec toutes ses péripéties suscite autre chose : elle donne envie de jouer (…) Il s’agit dans sa forme même d’une promesse d’action dont le jeu vidéo sera l’aboutissement. Elle est surtout là en tant que morceau de bravoure, pour mettre en valeur la potentialité de jeu contenu en elle » [3]. Le jeu vidéo Star Wars Pod Racer (LucasArts, 1999), permet de concrétiser cette potentialité, puisqu’il se présente à la fois comme une retranscription fidèle de la course de modules, de son esthétique et sa mise en scène, et comme une extension narratologique de cette dernière, puisqu’elle développe les potentialités offertes par son univers (environnement varié, bestiaires, pilotes inédits…).

Toutefois, pour agir en tant qu’acteur dans le monde fictionnel, le joueur doit en premier lieu se familiariser avec l’interface proposé. Bien souvent, le jeu vidéo intègre à sa structure narrative une phase didactique, où le joueur s’assure d’avoir acquis les compétences pour évoluer convenablement au sein de cet univers virtuel. La structure du jeu doit donc assurer l’apparente incertitude du résultat de l’action pour qu’elle puisse se développer, au même titre qu’un film s’attarde sur de longues séquences d’exposition ; ce, pour mettre le spectateur dans une zone de confort, avant de déployer les bouleversements propres à sa structure narrative. En revanche, l’évidente différence entre narration cinématographique et narration vidéoludique réside dans le positionnement de leurs destinataires. Pour Sébastien Genvo, c’est le « vouloir-faire » du joueur qui dicte le déploiement du récit : « Le jeu est une activité librement consentie et volontaire, elle ne peut donc être imposée par la structure de jeu. Alors que certains programmes narratifs peuvent être ordonnés à un sujet opérateur par obligation, le jeu ne permet pas cette option, les contraintes de la structure étant librement adoptées. Le vouloir-faire est la condition sine qua non de tout jeu, car ce n’est qu’au moment où le joueur a décidé de s’engager que la situation se développe en tant qu’activité ludique » [4]. Genvo souligne que si les règles du jeu influent ou non sur la possibilité de réaliser certaines actions, la volonté du joueur est le moteur qui permet à cette dernière de se déployer.
Les théories narratives propres à l’espace vidéoludique permettent de représenter l’une des caractéristiques particulières du jeu vidéo comme forme d’expression : le gameplay, qui est la dynamique d’appréhension des règles par l’action que mettent en œuvre les jeux vidéo. Certaines théories narratives permettent de représenter cette dynamique. Pour Greimas : « la narration est la réalisation d’un projet où un sujet passe par un conflit parce qu’il désire quelque chose pouvant être concret ou abstrait ». Cette définition peut s’appliquer à la posture qu’adopte un joueur par rapport à un jeu. Il doit passer par une série de conflits pour réaliser un projet ludique, et la question centrale est celle de sa motivation : l’élément qui va l’inciter à aller affronter l’ensemble de ces conflits. Or, selon chacun, cela peut dépendre des goûts personnels en termes de jeu, du contexte, du moment où l’on va être amené à jouer, mais c’est aussi à la charge du game designer de donner envie au joueur d’aller affronter ces conflits, en somme de lui donner envie de jouer. Ce qu’il y a d’intéressant dans la théorie narrative de Greimas, c’est que pour que le sujet puisse réaliser son projet, surpasser les conflits, il doit obtenir différents types de compétences. Il doit devenir un sujet qualifié. Dans le cadre d’un jeu vidéo, l’obtention des compétences est liée à ce que Greimas qualifie de « pouvoir-faire ».
Il faut toutefois souligner que cette analogie faite entre jeu vidéo et narration est loin d’avoir fait consensus au départ, et en premier lieu chez les joueurs. En effet, bon nombre d’entre eux considéraient à l’époque que s’ils jouaient, ce n’était en aucun cas pour une quelconque notion de récit. On pourrait encore aujourd’hui se demander de manière purement théorique s’il n’y a pas une réelle incompatibilité entre le fait d’exécuter une action et de se voir raconter une histoire. En effet, un certain type de jeux qui a fait long feu dans les années 1980 a été qualifié de film interactif. Le principe ? Proposer un enchaînement de séquences filmées ou animées où le joueur se doit d’appuyer sur les bons boutons au bon moment s’il veut avoir accès à la séquence suivante. L’échec de ce genre est lié au rejet des joueurs, qui ont déploré que le résultat de leurs actions dans l’espace vidéoludique n’eût que trop peu d’incidence dans la suite des évènements à venir.

Dans ce cadre, de nombreux théoriciens ont avancé que le modèle narratif est inadapté pour comprendre ce qui faisait du jeu vidéo une forme d’expression à part entière. C’est notamment le cas de Gonzalo Frasca, ludologue et game designer qui prétend qu’il fallait trouver un autre cadre théorique pour penser les jeux vidéo : « Jusqu’à présent, l’approche de recherche traditionnelle la plus populaire de l’industrie et de l’académie a été de considérer les jeux vidéo comme des extensions de la narration et des arts dramatiques. Mon but est de contribuer à la discussion en offrant davantage de raisons qui montrent non seulement que le modèle narratif est un modèle inapproprié, mais aussi que celui-ci limite notre compréhension du médium et notre capacité à créer des jeux encore plus efficaces […] À la différence des autres arts, les jeux vidéo ne sont pas uniquement basés sur la représentation, mais sur une structure sémiotique alternative connue sous le nom de simulation » [5].
En somme, pour Gonzalo Frasca, les jeux ne sont pas une forme de narration, mais une forme de simulation. Il est évident qu’il faut de nouveaux concepts pour comprendre ce qui fait du jeu vidéo une forme d’expression artistique à l’image du cinéma, mais il semble essentiel de ne pas totalement exclure le modèle narratif, ne serait-ce que dans la capacité qu’il détient à déployer du récit pour impliquer le joueur dans une attitude ludique. Les jeux vidéo emploient désormais des procédés de mise en scène tels que les cinématiques pour pouvoir présenter au joueur ses objectifs, l’impliquer dans l’histoire, ou tout simplement pour lui donner envie de jouer. Si le cinéma est reconnu comme une forme d’expression, c’est qu’il a su s’émanciper de ses premiers modèles, notamment à travers l’art du montage. Les jeux vidéo ne devraient-ils donc ne pas s’émanciper de leurs premiers modèles pour pouvoir s’affirmer comme moyen d’expression à part entière ? On peut constater que le cinéma fait encore aujourd’hui usage de conventions instaurées à partir des modèles initiaux de ses origines. Par exemple, l’usage que le septième art fait de la musique s’inspire encore très fortement des opéras. Les leitmotiv musicaux, hérités de Richard Wagner, existent encore pour alerter le spectateur sur le ressenti d’un personnage ou sur son rôle dans l’intrigue (l’inquiétante marche impériale dans Star Wars, utilisée pour signifier l’arrivée de Dark Vador en est l’un des meilleurs exemples). De la même façon, il est essentiel de savoir comment les jeux vidéo font un usage particulier de conventions issues d’autres médias.
Les cinématiques
Si le phénomène de convergence entre cinéma et jeu vidéo se confirme à différents niveaux tels que les emprunts esthétiques et techniques ou à travers des partenariats économiques de plus en plus soutenus, on peut également souligner l’évolution même du contenu des programmes vidéoludiques au regard du cinéma par l’émergence d’un nouveau mode d’hybridation : les séquences spectatorielles ou « cinématiques ».

Depuis la généralisation du support CD au début des années 1990, qui a eu pour effet d’augmenter considérablement les capacités de stockage, et donc d’offrir la possibilité d’intégrer des séquences vidéo enrichissant les ressorts narratifs de ce nouveau type d’œuvres vidéoludiques. Plusieurs séries de jeux ont fait usage de ce procédé pour constituer, à certains moments de la partie, le joueur en spectateur, et de concurrencer le cinéma dans le domaine de l’imagerie de synthèse. Le terme « cinématique » (cut scene en anglais), contraction de cinéma et informatique, sera employé pour décrire des séquences non jouables insérées entre les phases de jeux, en usant de procédés issus des grammaires cinématographique et télévisuelle. On peut les envisager comme de petits films non interactifs à fonction purement narrative, qui introduisent ou concluent des séquences de jeu. Pour Alexis Blanchet : « La cinématique peut se définir dans un premier temps comme un segment visuel de l’œuvre vidéoludique qui privilégie momentanément la posture de spectateur à celle de joueur : elle est un instant purement spectatoriel au sein d’une œuvre interactive. Ces séquences cinématiques permettent aussi d’envisager de façons multiples le statut de l’intéracteur, à la fois joueur et spectateur. L’autonomisation du jeu vidéo par rapport au cinéma peut pleinement s’observer à travers l’étude des évolutions esthétiques des séquences cinématiques et du rôle qui leur est assigné dans la syntaxe propre au média vidéoludique » [6]. Quelles soient en prise de vue réelle, en animation traditionnelle, en images de synthèse précalculées ou en 3D temps réel, les variétés des cinématiques et leur évolution est un indicateur des échanges techniques et esthétiques entre les secteurs de l’audiovisuel et de jeu vidéo.

Les séquences en prise de vue réelle ont amené les développeurs à collaborer avec les studios de l’industrie cinématographique. L’exemple du jeu Wing Commander est à ce titre éloquent. Cette série de jeux inaugurée en 1990 par Origin Systems est une simulation de bataille spatiale sur micro-ordinateur, qui avait pour ambition de devenir l’équivalent d’un Star Wars vidéoludique, à mi-chemin entre le jeu et le cinéma. Ainsi l’acteur Mark Hamill (Luke Skywalker dans la saga Star Wars) fut engagé pour apparaître dans des séquences intercalées entre deux phases de jeux. Le succès fut tel que le casting s’étoffa dans les épisodes suivants (Malcolm McDowell, John Rhys-Davies, Tom Wilson), et que la série devint un objet de diversification audiovisuelle unique pour l’époque : elle donna naissance à un film, une série animée, et une série de livres. Même si son projet de faire du film interactif (le FMV ou full motion video) un genre vidéoludique à part entière a échoué dans les grandes largeurs, Wing Commander a ouvert la voie aux collaborations artistiques entre cinéma et jeu vidéo. Dans les années 2000, poursuivant ces rapprochements et les échanges, les cinématiques en images de synthèse emploient des réalisateurs de cinéma comme Florent Emilio Siri pour la mise en scène de certains segments spectaculaires (Splinter Cell Pandora’s Tomorrow, Ubisoft, 2003), des compositeurs réputés à l’image de Danny Elfman (Fable, Microsoft, 2004) et des acteurs et artistes de renom comme David Bowie (Nomad Soul, Quantic Dream, 2004).


Effet surprenant de l’évolution de l’objet vidéoludique, la cinématique, procédé déjà vieux d’une vingtaine d’années, est aujourd’hui la constante absolue, réinvestie et pérennisée par le jeu vidéo contemporain. Alexis Blanchet peut ainsi constater que le jeu vidéo prétend désormais au même statut que le cinéma. « Les créateurs manifestent la volonté de fonder le jeu vidéo comme divertissement culturel, voire comme art au même titre que le cinéma, expression artistique moderne, contemporaine et légitime, d’une certaine façon le plus proche parent. En incorporant au jeu vidéo, évolutions technologiques aidant, des « petits bouts de cinéma », les créateurs de jeux veulent copier le septième art, manifestent leur désir de concurrencer l’illustre aîné ou du moins de s’affirmer comme son égal » [7]. Cela se voit aujourd’hui dans des jeux du studio français Quantic Dream, avec à leur tête le concepteur David Cage. En effet, les récents Heavy Rain (2010) et Beyond Two Souls (2014) sont des tentatives quasi terminales d’hybridation entre cinéma et jeu vidéo fondées sur le principe du quick time event, c’est-à-dire en mettant en place des cinématiques dans lesquelles le joueur peut agir en réalisant la combinaison de commandes qui apparaît à l’écran, un procédé inauguré en son temps par l’avant-gardiste Shenmue (SEGA, 2000). À ces éléments, on peut ajouter l’utilisation des techniques de motion capture à partir du visage d’un acteur pour modéliser les expressions des personnages des jeux, ainsi que le choix d’espace restreint, plutôt qu’un monde ouvert à la GTA ou Skyrim, pour réintroduire le jeu dans un espace cinégénique codifié comme une chambre de motel lugubre, ou une scène de crime délimitée par les forces de l’ordre. Les jeux du studio Quantic Dream représentent actuellement l’exemple le plus tangible de la porosité des frontières entre les deux régimes de visibilité qu’occupent respectivement les images du cinéma et du jeu vidéo.


C’est précisément ce manque que ces séquences essayent de combler ; au-delà de leur rôle utilitaire qui consiste à laisser du temps au joueur pour se reposer, et de leur rôle informatif permettant de sublimer ou révéler quelques moments clés de l’intrigue principale, voire d’en développer des à-côtés, elles sont désormais partie prenante de l’activité ludique. « Les cinématiques libèrent le joueur de l’obligation volontaire, elles restaurent sa capacité à arrêter de jouer sans que le jeu ne s’arrête, la marge de manœuvre qui lui permet de conserver intact le plaisir de jeu » [9]. Ce postulat du sémioticien Patrick Mpondo-Dicka est à mettre en relation avec la façon dont l’ethnologue Roger Caillois appréhende le plaisir ludique, c’est à dire à travers la nécessité de trouver pour le joueur une réponse, un accès, voire un espace de liberté dans les limites des règles établies par le jeu. Cette sorte de marge accordée en parallèle de l’action expliquerait, en partie selon lui, le plaisir que le jeu suscite.
La particularité des cinématiques réside donc dans leurs capacités à prodiguer à l’objet vidéoludique une double identité de récit et de spectacle, tout en procurant au joueur un sentiment d’accomplissement. Elles font désormais partie intégrante de la grammaire vidéoludique en maintenant un équilibre pour le joueur, celui de son identité : il est à la fois acteur volontaire de l’expérience de jeu, et spectateur consentant de son déploiement cinégénique. De ce fait, la cinématique devient le point de tension entre la représentation cinématographique et la jouabilité. Elle joue un rôle primordial dans l’insertion dans le jeu des schémas fictionnels établis qui placent le joueur en position de sujet singulier d’un monde spécifique. Dès lors, la cinématique fournit une manière d’aborder le jeu vidéo dans un contexte transmédiatique, puisqu’elle fait le lien entre deux médias, autant à travers de la forme que du contenu.
Notes
[1] http://www.foxylounge.com/MANUEL-GARIN-Buster-Keaton-VS Voir aussi de Manuel Garin, en langue espagnol, El Gag Visual. De Buster Keaton a Super Mario, ed. Cátedra (Madrid), 2014.
[2] Digital & Analogue, The Art and Science of Rockstar Games, Steidl Publishing, novembre 2010, p. 189.
[3] MURRAY, Janet, Hamlet on the Holodeck, MIT Press (Boston), 1998.
[4] GENVO, Sébastien, Le jeu vidéo à son ère numérique, L’Harmattan, 2006, p. 147.
[5] TESSON, Charles, « Des souris et des hommes », Cahiers du cinéma, hors-série, avril 2000, p. 40.
[6] GENVO, Sébastien, op. cit., p. 153.
[7] FRASCA Gonzalo, « Simulation versus Narrative« , Ludology.org
[8] BLANCHET, Alexis. Des Pixels à Hollywood, Pix’n’ Love, 2010, p. 291.
[9] Ibid, p. 293.
[10] LE DIBERDER, Alain et Frédéric, L’univers des jeux vidéo, La Découverte, 1998, p. 56.
[11] MPONDA-DICKA, Patrick, Les scènes cinématiques dans les jeux vidéo, mémoire de DEA, Université de Toulouse 2, 2002, p. 75.
Bibliographie additionnelle
BENJAMIN, Walter, Œuvres, tome III. Traduit par Maurice de Gandillac, Rainer Roschlitz et Pierre Rush, Gallimard, 2000.
BLANCHET, Alexis, Les jeux vidéo au cinéma, Armand Colin, 2012.
CAILLOIS, Roger, Les jeux et les hommes, Gallimard, 1967.
DYER-WITHEFORD, Nick ; KLINE, Stephen ; DE PEUTER, Greig, Digital Play. The Interaction of Technology, Culture and Marketing, McGill-Queen’s University Press (Montréal), 2003.
DYER-WITHEFORD, Nick ; DE PEUTER, Greig, Games of Empire : Global Capitalism and Video Games, University of Minnesota Press, 2009.
GENVO, Sébastien, Introduction aux enjeux artistiques et culturels des jeux vidéo, L’Harmattan, 2003.
GENVO, Sébastien, Le game design de jeux vidéo. Approches de l’expression vidéoludique, L’Harmattan, 2006.
GREIMAS, A. J. (avec COURTÈS, Joseph), Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, 1979.
Extrait d’un chapitre d’un mémoire de recherche (M2 ICEN) soutenu à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense en juin 2015 sous la direction de David Buxton.

Etudiant en Master 2 recherche (M2 ICEN) du Département des Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.





