« Il n’y a rien pour porter le son » : défamiliarisation et réalisme signalé dans « Gravity » – Stuart BENDER
Cet article sur le traitement du son dans le cinéma de science-fiction à partir d’une réflexion sur le film Gravity, et qui s’appuie sur le concept néoformaliste de défamiliarisation, est originalement paru dans la revue en ligne (basée à Melbourne, Australie) Senses of Cinema, #71, juillet 2014 (recommandé). Nous remercions le directeur de la publication Rolando Caputo, et l’auteur de nous avoir autorisés à publier une version française. La traduction de l’anglais a été assurée par David Buxton.
Article interdit à la reproduction payante
Fiche technique
|
Gravity. 91 minutes, 2013. Réalisateur et producteur : Alfonso Cuarón. Production : Warner Bros, Esperanto filmoj, Reality Media, Heyday Films. Budget :100 millions $. Recettes mondiales : 716,4 millions $ (dont 274,1 millions $ aux États-Unis). Scénario : Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón. Photographie : Emmanuel Lubezki. Montage : Alfonso Cuarón, Mark Sanger. Musique : Steven Price. Design sonore : Glenn Freemantle. Mix sonore : Skip Lievsay. Avec Sandra Bullock, George Clooney. |
Une des conventions du cinéma de science-fiction, c’est la présence « irréaliste » du son dans le vide de l’espace : le bourdonnement à fréquence basse souvent utilisé pour accompagner le passage devant la caméra d’un énorme vaisseau spatial, ou la plainte stridente apparemment émise par un petit avion de combat alors qu’il file à toute vitesse. D’après William Whittington, la décision prise par les producteurs de La Guerre des Étoiles (1977) de « sonoriser l’espace devait influencer les bandes sonores de presque tous les films de science-fiction ultérieurs de Star Trek (1979) à Matrix Revolutions (2003) » [1]. Cette observation est certainement vraie pour quelques films plus récents situés dans l’espace, comme Moon (Duncan Jones, 2009), qui sonorise les moissonneuses lunaires recrachant des rochers, et Oblivion (Joseph Kasinsky, 2013) avec ses bips numériques et ses bourdonnements tourbillonnants qui accompagnent les drones tournant autour de la capsule lorsqu’elle entre dans la station spatiale géante.

Par rapport à cet héritage, Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) se démarque par son rendu apparemment réaliste du son dans l’espace. Après le carton du début qui annonce qu’« à 600 kilomètres au-dessus de la Terre, il n’y a rien pour porter le son », le film fait plonger le public dans le silence absolu sur fond de la Terre vue de l’espace dans un plan éloigné. Le silence semble exagéré par son aspect soudain, après la musique perçante et de plus en plus aiguë pendant les cartons précédents.
Les sons entendus lors du plan-séquence d’ouverture qui dure 13 minutes sont clairsemés : bavardage technique de la NASA, dialogues des personnages principaux filtrés à travers leurs émetteurs radio, et sons en sourdine représentant les vibrations des objets qu’ils touchent. À un moment, la caméra passe à l’intérieur du casque de Ryan Stone (jouée par Sandra Bullock) et la bande sonore s’épaissit de manière sensible : la voix est plus claire, la respiration plus forte. Selon le designer sonore du film, Glenn Freemantle, « on a décidé de faire le design sonore à partir des vibrations déclenchées par le toucher…, on entend de l’intérieur » [2]. Rompre avec une convention de la science-fiction si fortement établie risque de désorienter l’audience, quel que soit le fondement scientifique pour justifier la nouvelle technique. Comme l’affirme Whittington, le public est généralement prêt à accepter les sons « artificiels » associés au genre de science-fiction, car il en est familier :
[dans « La Guerre des Étoiles »], les images d’un vaisseau spatial réalisées avec des appareils de contrôle de mouvement (motion control) sont fusionnées avec des sons multi-pistes de grondements à fréquence basse, qui sont en fait des bruits de ventilateurs (manipulés en termes de vitesses et lissés avec de la surimpression sonore). On accepte cette juxtaposition dans le contexte narratif de « La Guerre des Étoiles », qui nous offre un futur construit avec de la matière sonore, essentiellement familière, bien que fortement traitée [3].
À l’exception de quelques voix sur l’Internet qui ont critiqué la véracité de certains moments clés de l’intrigue, le film a généralement reçu des louanges pour son pouvoir d’immersion et pour son réalisme [4]. Un critique de cinéma a écrit :
Je dois dire que c’était spectaculaire. J’étais comme aspiré dans l’environnement du film et pendant une heure et demie, j’ai été transporté dans l’espace sur une navette en orbite. Je n’aurais jamais imaginé qu’un film puisse être aussi réel que cela [5].




Un exemple extrême d’effet sonore « défamiliarisant » survient lorsque le champ de débris heurte la navette. Alors que l’astronaute Shariff (ci-dessus) est frappé par un objet métallique volant au fond du plan, le seul son diégétique entendu est un grognement sur l’émetteur radio du personnage. L’impact mortel est inaudible, et cette dissociation choquante entre son et image renforce l’émotion ressentie.

Tous ces effets, qui défamiliarisent la bande sonore, sont très efficaces pour déranger, voire choquer le spectateur [17]. L’absence de son accompagnant l’explosion de la navette, par exemple, choque moins par son aspect non conventionnel que par son incitation de se focaliser davantage sur l’effet visuel du débris désintégrant. Dans un film « ordinaire », ce genre d’effet prendrait place dans une mise en scène globale, et pourrait, de ce fait, échapper à l’attention du spectateur. Gravity permet une appréhension plus décisive du détail visuel, de même que le son assourdi dans la séquence d’ouverture des outils de Stone, rendu par des microphones de contact, focalise l’attention sur le photoréalisme exceptionnel de l’environnement spatial.
Dans une perspective cognitiviste, le spectateur comprend un film en se servant de sa capacité d’exécuter « une simulation mentale hors ligne » des événements narratifs dépeints [18]. Je ne dis pas que l’espèce humaine soit naturellement portée vers le visionnement de films. Les cognitivistes diraient plutôt que la capacité humaine à imaginer a évolué pour diverses raisons qui, de façon purement contingente, facilitent le visionnement de films [19]. Henry Bacon, par exemple, affirme que l’imagination humaine a donné « un avantage évolutionniste énorme » en ce qu’elle permet la répétition dans l’esprit de situations potentielles (en commençant par la chasse primitive) [20]. Comme je l’ai démontré dans une étude des films de combat de la Seconde Guerre mondiale, on perçoit les films ayant une plus grande densité de détail audiovisuel comme étant plus réalistes [21]. Cela s’explique par le fait qu’un haut niveau de détail filmique permet aux spectateurs d’exécuter des simulations mentales plus vives, ce qui donne un sens plus fort d’immersion, de présence et donc de réalisme. Dans le cas de Gravity, la quasi-totalité du public n’a aucune expérience du maniement d’outils en état d’apesanteur, ou du silence du vide pour pouvoir évaluer la véracité de la représentation, ce qui n’empêche pas de nombreux critiques d’affirmer que le film donne une forte impression de réalisme. S’appuyant sur l’école cognitiviste du cinéma, on peut affirmer que le recours aux effets sonores défamiliarisants focalise l’attention sur la diégésis riche du film, créant une simulation mentale forte chez le spectateur [22].
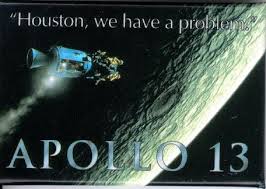
Il n’est pas nécessaire que ces effets soient objectivement véridiques pour paraître réalistes. Après tout, combien de spectateurs savent d’expérience que le vide ne porte pas de son ? En fait, l’équipe technique de Gravity avoue qu’elle n’a pas respecté intégralement « la science » du son dans l’espace, surtout la distorsion (futzing) des voix des personnages entendues sur leurs émetteurs radio. Comme l’explique l’ingénieur du son Skip Lievsay :
C’est là qu’on a coupé la poire en deux en ce qui concerne la science […] Plus les voix sont déformées (futzed), plus ça fait réaliste. Mais moins on transmet de l’émotion à l’audience. Certains sons sont décisifs pour transmettre la profondeur de l’émotion ; donc, on a dû tripoter constamment le futz, essayant de faire des voix plus ou moins déformées selon ce qui se passait à l’écran [27].
Ce futz audio est un détail textuel qui apporte de l’information supplémentaire à l’expérience faite par le spectateur en termes de simulation mentale. Les qualités émotionnelles de la voix décrites par Lievsay y contribuent certainement. La voix de Sandra Bullock (Ryan Stone) se caractérise par un manque de souffle et par un bégaiement occasionnel, alors qu’elle essaie désespérément d’établir un contact avec les autres astronautes ou avec le siège à Houston :
« Explorer », confirmez… confirmez-vous ? Houston, confirmez-vous ? Houston, ici… spécialiste de mission Dr Ryan Stone. Je suis… hors support, et je dérive. Confirmez-vous ? Quelqu’un ? N’importe qui ? Confirmez-vous ? S’il vous plaît, confirmez ? S’il vous plaît ?
Gravity problématise le concept de réalisme cinématographique de manière intéressante. Quelques astronautes avec une expérience vécue de l’espace ont loué la véracité des images, mais le public n’a que d’autres « textes » pour évaluer le réalisme de celles-ci. Beaucoup de critiques de Gravity affirment que le film donne une impression de réalisme, alors que des geeks avoués se sont élevés contre certains détails du scénario, comme la proximité absurde des stations spatiales [28]. Une approche néoformaliste dirait que la « motivation réaliste » d’un choix cinématographique comme l’absence de son dans l’espace est, en fait, un appel aux idées concernant la réalité, qu’elles soient une « imitation » valide de celle-ci, ou non [29]. En conséquence, il n’est pas surprenant que même ceux qui trouvent le scénario critiquable en termes scientifiques avouent en général que la représentation de l’espace semble très réaliste [30].

Stuart Bender est « lecturer » (maître de conférences) au département de Film, Télévision et Arts de l’Écran à Curtin University, Perth, Australie. Il est aussi cinéaste, et a réalisé plusieurs courts-métrages primés internationalement. On peut voir son site (avec vidéos de ses films) ici. Contact : Stuart.Bender@curtin.edu.au
Notes
[1] William Whittington, Sound Design & Science Fiction, University of Texas Press (Austin, Texas), 2007, p. 108.
[2] Bryan Bishop, « How the Sound Masters of Gravity broke the rules to make noise in a vacuum », oct. 10, 2013.
[3] Whittington, op. cit., p. 120.
[4] BBC News Magazine, « Can Science ever get the Science right ? », oct. 14, 2013 ; Marsha Ivins, « Astronaut : Gravity gets me down », oct. 2, 2013 ; Jeffrey Kluger, « Gravity fact check : what the season’s big movie gets wrong », oct. 1, 2013.
[5] Michael Morgenstern, « Gravity review : in space, nobody can hear your one-liners », oct. 11, 2013.
[6] Chris Knight, « One small step for a critic ; one giant leap in critical thinking : Astronauts weigh in on Gravity », oct. 16, 2013.
[7] Mike Seymour, « Gravity : Vfx that’s anything but down to earth », oct. 8, 2013.
[8] Jean Baudrillard, Simulacres et simulations, Galilée, 1981.
[9] Scott Mendelson, « Review and Box-Office Outlook : Gravity is the movie experience of the year », sept. 9, 2013.
[10] Stuart M. Bender, Film Style and the World War II Combat Genre, Cambridge Scholars Publishing (Newcastle, Royaume Uni), 2013.
[11] Interview avec Skip Lievsay, « The Sound of Gravity », Soundworks Collection, oct. 2013.
[12] Kristin Thompson, Eisenstein’s « Ivan the Terrible » : A Neoformalist Analysis, Princeton University Press (New Jersey), 1981 ; Kristin Thompson, Breaking the Glass Armour : Neoformalist Film Analysis, Princeton University Press (New Jersey), 1988.
[13] ibid.
[14] Kristin Thompson, Eisenstein’s « Ivan…. », op. cit. ; Viktor Chklovski, L’art comme procédé, editions Allia, 2008 (1917).
[15] Mike Seymour, Matt Wallin, Jason Diamond, « The vfx show #174 : Gravity », fx guide, (podcast), oct. 17, 2013.
[16] Bryan Bishop, art. cit. (voir note 2).
[17] Stuart M. Bender, op. cit. (voir note 10).
[18] Gregory Currie, Image and Mind : Film, Philosophy and Cognitive Science, university of Cambridge Press (Cambridge, Royaume Uni), 1995, pp. 147-50.
[19] Torben Grodal, Moving Pictures : A new theory of Film Genres, Feelings and Cognition, Oxford University Press (New York), 1997.
[20] Henry Bacon, « Blendings of Real, Fictional, and other Imaginary People », Projections, 3 : 1, 2009, pp. 77-99.
[21] Bender, op. cit. (voir note 10).
[22] Henry Bacon, art. cit. (voir note 20) ; Henry Bacon, « The Extent of Mental Completion of Films », Projections, 5 : 1, 2011, pp. 31-50 ; Torben Grodal, Embodied Visions : Evolution, Emotion, Culture and Film, Oxford University Press (New York), 2009.
[23] David Bordwell, Poetics of Cinema, Routledge (New York), 2008.
[24] David Bordwell cité par Chuck Stephens, « School’s Out ? Never ! David Bordwell keeps working the room », Cinema Scope, no. 26 (printemps 2006), p. 22.
[25] Roger Ebert, « Apollo 13 movie review », rogerebert.com, juin 30, 1995 ; Stephen Hunter, « Apollo 13 celebrates the nerds’ finest hours », Baltimore Sun, juin 30, 1995.
[26] Mark Bowden, « Zero Gravity : Take One. Apollo 13 space scenes weren’t Hollywood magic. And there’s no such thing as a weightless chamber. So how did Tom Hanks, Bill Paxton and Kevin Bacon float ? They filmed aboard NASA’s « Vomit Comet » », Philly.com, juillet 25, 1995.
[27] Skip Livesay, interview citée (voir note 11).
[28] Chris Knight, art. cit. (voir note 6).
[29] Kristin Thompson, Breaking the Glass Armour, op. cit. (voir note 12).
[30] Corey S. Powell, « The real stories and real science behind Gravity », oct. 7, 2013.
[31] Tom Jones, cité in Chris Knight, art. cit. (voir note 6).
Liens ci-dessus actifs au 1 oct. 2014.

Stuart Bender est lecturer au département de Film, Télévision et Arts de l’Écran à Curtin University, Perth, Australie. Il est aussi cinéaste, et a réalisé plusieurs courts-métrages primés internationalement. Voir son site : http://www.stuartbenderfilms.com/. Contact : Stuart.Bender@curtin.edu.au



