Les créances financières sur l’économie mondiale (le capital fictif) – Tony NORFIELD
Interdit à la reproduction payante.
Contenu
Présentation (David Buxton)
Cette critique du livre de François Chesnais, Finance Capital Today: Corporation and Banks in the Lasting Global Slump*, a été postée par Tony Norfield sur son blog The Economics of Imperialism, le 24 novembre 2016. Le texte est publié dans la Web-revue avec sa permission. La traduction de l’anglais est assurée par moi, ainsi que l’iconographie et les sous-titres.

Malgré quelques termes techniques qui demanderont un petit effort de familiarisation pour le lecteur profane, le texte expose de manière claire et concise les principales contradictions du capitalisme contemporain, notamment celles du système financier. Tony Norfield a soutenu sa thèse en économie (School of Oriental and African Studies, University of London) en 2014 sur le sujet de l’impérialisme britannique et la finance. Il a publié The City: London and the Global Power of Finance (Verso, London) en 2016 (résumé ici). Dans une autre vie, il a été financier à la City pendant presque 20 ans, y compris une période comme l’un des directeurs de la banque commerciale néerlandaise ABN AMRO. Drôle de parcours pour un économiste indépendant d’orientation (néo)marxiste, du coup exceptionnellement bien placé pour parler du monde de la finance !
Pourquoi une analyse de l’économie mondiale dans une revue consacrée aux industries culturelles et à la communication ? C’est parce que je suis convaincu que les recherches dans ces deux domaines (caractérisés par la consommation accélérée, éphémère, et de plus en plus instantanée) ne peuvent se passer du concept clé à l’œuvre ici, à savoir celui du « capital fictif ». Comment expliquer autrement les injections massives de capital spéculatif dans des start-up exploitant la technologie numérique (notamment dans la Silicon Valley), souvent sans modèle d’affaires viable, et parfois même sans rentrée d’argent ni valeur d’usage affirmée, ni dans les cas extrêmes de produit ? On se souvient de MySpace, vendu à 35 millions de dollars en 2011 après une valorisation de 12 milliards en 2007. Spotify, le leader des plates-formes de streaming musical, n’a jamais fait de bénéfices (581 millions de dollars de pertes en 2017, contre une valorisation récente de 23 milliards) ; Snapchat (dernière valorisation, 21 milliards), et jusqu’à très récemment Twitter (24,3 milliards), non plus. Les fonds divulgués de Facebook**, non négligeables (12,8 milliards de dollars, 2017), sont quand même dérisoires par rapport à sa valeur boursière (437 milliards en février 2018, mais il a perdu 83 milliards le mois dernier). Mais comme l’article l’indique, ce phénomène est loin d’être limité à la « nouvelle économie ».
C’est dans le chapitre 29 du troisième tome de Capital que Marx avance le concept de « capital fictif ». Il s’agit du système de crédit, faiblement développé à l’époque, qui permet au capital de se multiplier en échangeant des valeurs n’existant que sur le papier, sans réserves monétaires ou actifs convertibles pour les appuyer. Tout repose sur la confiance que ces valeurs « fictives » seront convertibles en valeurs « réelles » dans l’avenir. Autrement dit, sauf miracle, le destin ultime du capital fictif serait de perdre la grosse part de sa valeur, une fois la confiance rompue devant une masse critique de dette (la bulle qui éclate). C’est dans ce contexte, où la part des investissements en capital fixe (capital productif) ne cesse de décliner, qu’on peut comprendre comment on en arrive « rationnellement » à éponger la « pléthore de capital sous la forme de capital-argent » (Marx) dans des start-up à la valeur future très incertaine.
Les livres 2 et 3 du Capital furent préparés par Engels à partir des brouillons plus ou moins inachevés, et publiés après la mort de Marx. Comme le remarque Tony Norfield, la section du tome 3 sur le capital fictif coïncide à l’endroit où la qualité de la rédaction se dégrade sensiblement, au point où il est parfois difficile d’en saisir la cohérence. Pour cette raison, il reste une certaine ambiguïté quant aux paramètres du capital fictif, et c’est sur ce point que se situe l’un des points de désaccord entre Norfield et Chesnais. Alors que ce genre de débat « technique » entre spécialistes est normal, il est important pour le lecteur non économiste qu’il existe des points de convergence ; à ce titre, le livre de Chesnais, et sa critique par Norfield et d’autres ont indéniablement fait avancer la discussion***. On ne peut plus parler du capital financier comme si Hilferding et Lénine ont eu le dernier mot au début du siècle dernier, encore moins Marx au 19e siècle. La cible implicite ici, outre le marxisme figé et dogmatique, ce sont des arguments réformistes qui critiquent les excès de la finance et non le capitalisme lui-même, car les deux ont toujours été inséparables.
*Haymarket Books, Chicago, 2018 ; édition original, Brill, Leiden, 2016. Pour quelques articles de Chesnais en français qui résument l’essentiel de ses arguments, voir « Les dimensions financières de l’impasse du capitalisme »(Contretemps, 21 déc. 2017 ; « Le capitalisme a-t-il rencontré des limites infranchissables ? » (Contretemps, 6 févr. 2017) ; « Le cours actuel du capitalisme et les perspectives de la société humaine civilisée », Inprecor n° 631-632, septembre-novembre 2016.
**Les exemples de Facebook et de WhatsApp sont cités par Tony Norfield dans The City, p. 91.
***Pour d’autres critiques (plutôt positives) du livre de Chesnais, voir Louis Gill, « À propos de Finance Capital Today de François Chesnais » (Contretemps, 11 mars 2017) ; Michel Husson, « Le capital financier et ses limites. Autour du livre de François Chesnais », (À l’encontre, 15 févr. 2017).
D’autres lectures sur le capital fictif : Cédric Durand, Le capital fictif, Les Prairies ordinaires, 2014 (extrait publié dans Contretemps, 3 déc. 2014) ; https://clementsenechal.com/2014/11/24/lessor-du-capital-fictif-comment-la-finance-sapproprie-notre-avenir-collectif/, blog de Clément Sénéchal ; Alain Bihr, « Le capital financier », ¿ Interrogations ?, 13 déc. 2011. Dans la Web-revue, Actualités #32, juin 2015 ; Actualités #40, mars 2016 ; Actualités #41, avril 2016.
Une crise du capitalisme tout court
Ce livre [de François Chesnais] en vaut la peine. Il est écrit dans un style clair et accessible, et il aborde les points décisifs concernant les limites du capital, et le rôle de la finance contemporaine. Son argument le plus important est que le système financier a accumulé des créances substantielles par rapport à la production actuelle et future de l’économie mondiale sous la forme de reversements d’intérêts sur des prêts et des obligations, de dividendes provenant des actions, etc. Ces créances ont accru plus vite que la capacité du système capitaliste à les couvrir, mais les gouvernements ont jusqu’ici réussi à empêcher un effondrement des marchés financiers avec des politiques de taux d’intérêt zéro, d’assouplissement quantitatif (quantitative easing), et des déficits publics énormes par rapport au niveau de taxation, etc. Il en résulte une crise non résolue, une récession mondiale durable dans laquelle la croissance économique reste très faible, et un important niveau de dette perdure.

Sur deux points liés, l’approche de Chesnais le démarque de la plupart d’économistes, et pour cela il mérite nos remerciements. D’abord, il dit clairement que nous sommes dans une crise du capitalisme tout court, et non dans une crise du capitalisme financiarisé qui pourrait être régulé si un gouvernement réformiste prenait des mesures contre les méchants financiers. Ensuite, son analyse a pour point de départ l’économie mondiale, en reconnaissant que c’est plus facile à dire qu’à faire. Alors qu’il démontre le rôle central joué par les États-Unis, il ne centre pas son analyse entièrement sur l’économie américaine (ce qui est fréquent chez les critiques de gauche), et souligne le rôle important joué par les autres puissances dans le fonctionnement de la machine impériale.
Le livre de Chesnais aide le lecteur à mieux comprendre les réalités du capitalisme mondialisé, en fournissant une abondance de preuves empiriques. Il aide aussi à clarifier les diverses opinions avec une discussion de leur contexte théorique. Dans cette critique, je parlerai des points importants soulevés par le livre, et aussi de quelques points de désaccord. Ceux-ci impliquent parfois une simple question d’accentuation, ou une autre définition d’un terme courant, mais une formulation erronée peut mener à de réels problèmes théoriques.
Chesnais commence son livre en exposant les origines de la crise de 2008. Il affirme que celle-ci a été retardée depuis 1998 par l’accroissement de la dette aux États-Unis et ailleurs, et par l’essor de l’économie chinoise. En 2008, « la brutalité de la crise financière s’expliquait par l’accumulation du capital fictif, et la vulnérabilité du système de crédit après titrisation », ce qui a mondialisé la crise à un degré jusqu’alors inconnu. Cela a impliqué une économie mondiale beaucoup plus intégrée après la décomposition de l’Union soviétique, et l’incorporation de beaucoup plus de pays dans le système mondial de commerce et de finance. La crise fut caractérisée par « la double suraccumulation du capital provenant d’une part d’une capacité productive engendrant la surproduction, et de l‘autre, d’une « pléthore de capital » sous les formes de capital fictif et de capital potentiellement porteur d’intérêt ». Les gouvernements des grands pays ont beaucoup fait pour empêcher la crise de suivre la même course que dans les années 1930.
Chesnais a un point de vue intéressant sur la Chine, qui n’est pas dominée, selon lui, par les grandes puissances. Il note sa position subordonnée dans la division mondiale du travail avec sa main-d’œuvre peu chère ; il comprend cela comme un facteur du développement du marché mondial, et non comme un signe d’oppression au sens léniniste. C’est le reflet de l’ambiguïté du statut économique et politique de la Chine. Pour ma part, je dirais que la Chine est en transition vers le premier rang des grandes puissances (elle est actuellement troisième dans mon classement des pays en termes de puissance mondiale) [1].
Le chapitre 3 s’intitule « La notion de capital porteur d’intérêt dans le contexte actuel de la centralisation et de la concentration du capital ». C’est un sujet important, mais ici l’exposition de Chesnais déçoit un peu, quand bien même l’approche est louable. Il commence en affirmant que « la canalisation de la plus-value dans le capitalisme contemporain, à travers la possession de prêts aux gouvernements et d’actions, par un petit groupe de sociétés hautement concentrées, financières et non financières, et d’actionnaires individuels à hauts revenus demande que plusieurs aspects du capital porteur d’intérêt, traités de manière partielle et séparée par Marx, soient désormais abordés in toto ». Je suis entièrement d’accord, d’autant que la section correspondante dans Capital est dans un désordre épouvantable, et qu’Engels a eu beaucoup de mal à la corriger pour la publication posthume. Chesnais, cependant, a tendance à maintenir la focalisation sur les banques. Ce n’est que plus loin qu’il explique que le capital porteur d’intérêt est un phénomène beaucoup plus répandu dans le capitalisme moderne. Même là, je dirais que les formes prises par ce phénomène, surtout dans les opérations pour compte propre, ne sont pas pleinement expliquées en considérant l’intérêt comme la source des revenus, ou suivant Hilferding, en considérant le gain d’un spéculateur comme la perte d’un autre [2].
Le capital fictif
Ce chapitre comprend aussi une discussion de deux problèmes concernant la théorie marxiste de la finance. L’un relève de la différence d’opinions entre Costas Lapavitsas et moi-même (et d’autres) sur la question de « l’exploitation » des salariés par les banques, à travers l’application d’un taux d’intérêt sur les prêts, etc. Chesnais note correctement que cet intérêt n’est, de toute façon, qu’une petite part des bénéfices des banques, et n’a pas l’importance que lui attribue l’école de « l’exploitation ». Citant Rosa Luxembourg, cependant, il s’aligne sur l’idée que ces déductions représentent une réduction de la valeur de la force de travail. Je ne suis pas d’accord, non seulement parce que les jugements de Luxembourg en matière de théorie économique (sans parler de stratégie politique) laissent beaucoup à désirer. Mon argument, cité par Chesnais, est que l’application des taux d’intérêt n’implique pas en elle-même la baisse de la valeur de la force de travail. Si cette déduction d’intérêt devient une part importante des revenus des travailleurs, alors les salaires auront tendance à augmenter par compensation. Il ne s’agit pas d’exclure la possibilité que la valeur de la force de travail ne puisse être rabaissée, mais ce n’est que dans l’imagination des populistes que ce processus serait le résultat de la facturation de l’intérêt sur les prêts aux salariés.
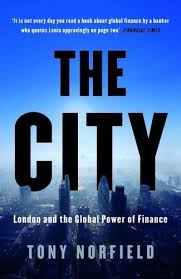
Le chapitre 4 est celui que j’apprécie le plus. Son titre « Les modes de réalisation organisationnelle du capital financier et le partage entre sociétés commerciales de la plus-value* » est tout sauf concis, mais il contient des analyses et des informations extrêmement valables. Chesnais passe en revue les différentes formes prises par l’évolution du capitalisme dans les grandes puissances économiques d’aujourd’hui, focalisant sur les États-Unis, l’Allemagne, La Grande-Bretagne et la France. Il examine les relations entre l’État, les sociétés privées, les banques et la puissance impériale. Bien que remarquant l’importance des fonds de pension comme actionnaires des grandes entreprises à partir des années 1990, il affirme que « plutôt que les banquiers, ce sont les industriels avec des connexions financières qui constituent le noyau de la communauté des entreprises européenne ». Même si certains pensent qu’il existe une classe capitaliste internationale, Chesnais est de l’avis (et je suis d’accord) que des groupes principaux de « capitalistes financiers » appartiennent à des pays particuliers.
Un argument important avancé par Chesnais (qui aurait pu être développé davantage) est que, dans le capitalisme contemporain, contrairement aux analyses de Marx et de Hilferding, le capital marchand (essentiellement du capital commercial et de la finance) n’est pas subordonné à l’industrie, même s’il est dépendant des bénéfices industriels. Chesnais analyse, tout de même, le rôle joué par les grands négociants en matières premières et les détaillants. À mon avis, cela reflète la façon dont les grandes puissances se sont servies du système commercial et financier pour consolider leurs privilèges économiques, ce qui était déjà le cas dans le Royaume-Uni au 19e siècle. Aujourd’hui, comme tout le monde devrait le savoir, ce sont les pays subordonnés, plus pauvres, qui sont principalement responsables de la production, du moins là où celle-ci ne fait pas l’objet d’un monopole.
La mondialisation des marchés financiers
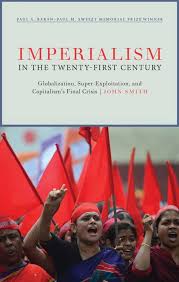
Le chapitre 7 aborde la mondialisation des marchés financiers, et les nouvelles formes de capital fictif. Il s’agit d’un résumé utile de la croissance des marchés financiers, qui dépend cependant des sources secondaires, et des données un peu datées. Les dérivées financières sont caractérisées par des « créances sur des créances », ce qui pourrait induire en erreur ; elles seraient mieux décrites comme des contrats différentiels fondés sur les prix des titres de référence. L’argument fondamental ici est que le déplacement apparent des investissements vers les marchés financiers résulte du déclin des perspectives rentables dans les autres marchés. Le chapitre se termine avec une analyse des développements financiers (marqués par la dette étrangère) en Équateur, au Brésil, en Argentine et en Afrique du Sud, y compris du rôle des « fonds vautours » dans le traitement de la cessation de paiements par l’Argentine.
Les développements actuels dans les marchés financiers
Les chapitres 8 et 9 abordent les développements actuels dans les marchés financiers, focalisant sur les opérations bancaires et le crédit. C’est un sujet déjà bien couvert, mais le chapitre est utile pour les lecteurs moins familiers avec l’histoire récente, surtout pour l’explication du développement des créances hypothécaires, des « banques universelles » en Europe, de la monopolisation des opérations bancaires, et du secteur bancaire parallèle (shadow banking). On explique aussi comment « l’effet de levier » – emprunter à crédit pour financer l’achat des actifs – a crû à des niveaux extrêmes, en raison du déclin des bénéfices dans les sociétés financières.
Le chapitre 10 met en lumière « l’instabilité financière mondiale endémique », et indique qu’il existe « une pléthore de capital sous la forme de capital-argent centralisé dans des fonds mutuels et des fonds spéculatifs (hedge funds). Ceux-ci sont dédiés à la valorisation par le commerce du capital fictif sous la forme d’actifs de plus en plus éloignés des processus de production de plus-value, où il devient de plus en plus difficile de faire des bénéfices ». J’irais plus loin en faisant observer que les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension et les sociétés d’assurance (beaucoup plus importants sur les marchés financiers d’aujourd’hui que les fonds mutuels ou les fonds spéculatifs) trouvent désormais que leur montagne d’actifs ne peut générer le retour qu’ils ont – implicitement ou explicitement – promis. Il est vrai que Chesnais parle de cela plus loin dans le chapitre.
« La pléthore de capital sous la forme de capital-argent » est reliée à la profitabilité déclinante de l’investissement capitaliste. Chesnais fait remarquer que les rapports officiels, de la Banque des règlements internationaux par exemple, font allusion à ce problème dans le contexte d’une description de la faible augmentation de la productivité, et de la faiblesse de la croissance économique en général. Il observe correctement que la baisse des taux d’intérêt a commencé bien avant les politiques d’assouplissement quantitatif après 2008 [4].
Il est difficile de préciser empiriquement ces liens avec les données disponibles, et Chesnais ne cherche pas à le faire. Il est important de distinguer entre le taux d’intérêt, et le taux de retour sur investissement, qui sont bien différents. Je pense qu’il serait possible, cependant, de mesurer l’accumulation des actifs financiers mondiaux – principalement des actions cotées, des obligations et des prêts bancaires – contre la mesure, même approximative, de la profitabilité mondiale absolue dans la durée. Cela démonterait à quel point les créances sur les ressources sociales ont augmenté, sous la forme de dividendes et d’intérêts, par rapport aux revenus disponibles pour rembourser ces créances. Mes recherches préliminaires suggèrent un déclin dans le taux de retour sur investissement entre 2007 et 2014, contre les chiffres faussés de la profitabilité disponibles pour les seuls États-Unis (données utilisées par ceux qui veulent faire un calcul rapide du « taux de profit »). Ce « taux de retour » n’est pas un « taux de profit marxiste » comme celui-ci est traditionnellement compris, mais il refléterait mieux, a mon avis, le malaise du système capitaliste mondial, surtout de la perspective des créanciers majeurs sur ses ressources.
L’absence de recherche critique
Chesnais termine son livre sur deux thèmes. L’un est une plainte concernant l’absence de recherche marxiste dans les universités, et l’absence de revues où des analyses marxistes peuvent être publiées. Même des revues apparemment critiques comme le Cambridge Journal of Economics sont au fond plutôt conservatrices, dominées par une approche keynésienne convenue qui écarte d’un geste de la main une perspective marxiste lorsque celle-ci dérange son plaidoyer en faveur des politiques « progressistes » que l’État capitaliste doit prendre en considération. S’inscrire dans le consensus progressiste peut être acceptable pour les revues en économie ; par contre, dévoiler les mécanismes impériaux du pouvoir n’est pas recevable. Tel est le climat quasiment universel dans le monde universitaire d’aujourd’hui, malgré les conséquences évidemment destructrices du système qu’il prétend analyser [5]. Ironiquement, c’est pourquoi les critiques les plus incisives et tranchantes du capitalisme – du moins d’un point de vue descriptif – viennent souvent des analystes financiers, qui doivent au moins bien informer leurs clients ! On me dit que la situation des universitaires critiques est encore pire aux États-Unis, ce que je peux bien croire. Pour le développement d’un climat intellectuel plus critique, j’ai plus d’espoir dans le monde non anglo-saxon, où cela me semble réalisable.
Le deuxième thème abordé dans la conclusion est la question de l’émergence d’une nouvelle phase d’accumulation de capital. Pour Chesnais, l’innovation technique a été éclipsée par la dégradation de l’environnement. Il nous laisse avec « la notion de barbarie, associée aux deux Guerres mondiales et à l’Holocauste ». C’est une remarque pessimiste, mais révélatrice du niveau de l’opposition à l’impérialisme actuellement. Dans les grands pays impériaux, la réponse à la question de « socialisme ou barbarie » est biaisée en faveur de ce dernier terme.
Conclusion

Plus généralement, ma préférence personnelle serait d’éviter complètement le terme « capital financier ». Associé à Hilferding et à Lénine, ce terme est trop lié à la thèse du livre éponyme de Hilferding (1910)**, à savoir que les banques dominent et orientent l’industrie***. Ce n’était pas une bonne description de la situation au début du 20e siècle, et elle est encore moins vraie aujourd’hui. Chesnais serait du même avis, car il définit le capital financier comme « la concentration et la centralisation simultanée et entrelacée du capital-argent, du capital industriel, et du capital marchand ou commercial résultant de la concentration nationale et transnationale à travers des fusions et des acquisitions ». Il explique comment les différentes formes du capital financier ont évolué, et fait une distinction importante entre les privilèges des grandes puissances et la position subordonnée des autres. Je suis d’accord, mais je mettrais le capital fictif au centre de l’argument, au lieu du capital financier. Cela démontrerait plus clairement que « la loi de la valeur » (Marx) s’exprime aujourd’hui principalement, ou du moins plus directement dans les marchés des titres financiers, plutôt que dans les marchés des produits de base (commodity markets), bien que les derniers soient importants. La capacité d’une entreprise à avoir accès aux financements dans le marché boursier et dans le marché des obligations, à tel ou tel prix, ou la capacité d’un gouvernement à emprunter et à dépenser, est indiquée par la valeur de leurs titres dans les marchés financiers. Ces marchés font montre aux investisseurs ce qui est bon, mauvais ou acceptable dans l’économie impérialiste mondiale.
Notes du traducteur
*Je traduis surplus value par « plus-value » parce que c’est le terme utilisé par Chesnais lui-même dans ses écrits. Dans sa nouvelle traduction de Capital, Jean-Pierre Lefebvre propose, avec force arguments, le terme « survaleur », qui a été adopté par la nouvelle édition française en cours des œuvres complètes de Marx et Engels (GEME). Le nouveau terme est contesté par certains.
**Le livre classique de Hilferding est en ligne https://www.marxists.org/francais/hilferding/1910/lcp/index.htm/. L’opuscule de Lénine aussi : Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916).
***Cf ce passage dans The City de Tony Norfield : « Hilferding s’est correctement focalisé sur le capital fictif comme une caractéristique majeure du capital financier, mais ce faisant il a élevé les banques, qui sont des négociants en, aussi bien que des propriétaires du capital fictif, à la position où elles exercent un pouvoir complet sur le capital » (p. 93).
Notes
1. Voir mon livre, The City : London and the Global Power of Finance, Verso (London), 2016, p. 111.
2. ibid., p. 144-47.
3. ibid., p. 83-92.
4. https://economicsofimperialism.blogspot.fr/search?q=bank+of+england
5. Voici comment le système fonctionne. Les revues sont classées selon leur valeur supposée, et les universitaires cherchent à se faire publier dans une revue bien évaluée. On peut contester la valeur de telle ou telle revue, mais les classements sont importants dans l’évaluation des contributeurs par leur université, et encore plus dans l’évaluation des universités par le gouvernement pour déterminer leur dotation. Pendant les dernières décennies, un petit nombre de revues orthodoxes et non critiques est devenu le lieu de préférence pour publier des articles savants. Les universitaires ont tendance à orienter leurs travaux vers les sujets que ces revues acceptent. C’est une machine qui produit très peu d’articles de valeur, mais qui assure le maintien d’un statu quo conservateur. Le système est renforcé par des comités de lecture prolongés par des « paires » évaluateurs, qui partagent tous la même perspective. Un mécanisme similaire pousse les universitaires à étendre de manière absurde leurs bibliographies, et à recourir à des citations excessives dans leurs textes. Ce, dans l’espoir d’un retour d’ascenseur, car les citations sont aussi une mesure de la performance.


Tony Norfield a soutenu sa thèse en économie (School of Oriental and African Studies, University of London) en 2014 sur le sujet de l’impérialisme britannique et la finance. Il a publié : The City : London and the Global Power of Finance (Verso, London) en 2016. Dans une autre vie, il a été financier à la City pendant presque 20 ans, y compris une période comme l’un des directeurs de la banque commerciale néerlandaise ABN AMRO.



