La généalogie de la brand culture permet de révéler l’important renouvellement des notions publicitaires. Certaines notions semblent répondre à la crise socio-économique actuelle. Elles permettent de défendre l’industrie publicitaire en difficulté, en la modernisant. Mais la création de ces notions ne semblent pas uniquement corrélées à un contexte de crise puisque la notion de brand image a été élaborée en 1955, période prospère. Dans les deux cas, l’industrie publicitaire doit se justifier par rapport à l’économie et au capitalisme en général. Ces notions sont donc idéologiques, car cette situation peut à tout moment être remise en question.
Articles interdit à la reproduction payante.
Contenu
Introduction
L’objet de recherche qu’est la notion de « brand culture » (« culture des marques ») s’inscrit dans deux types de littérature. La première est une littérature professionnelle en marketing et en publicité, où la notion a été créée et diffusée en France par Daniel Bo, coauteur de Brand Culture (2013). Cette notion y est définie comme une méthode permettant de gérer efficacement les marques, dans une littérature qui cible les professionnels en charge des stratégies de marques, qu’elles soient des stratégies marketing ou des stratégies de communication. Toutefois, cette littérature tente de se rapprocher des recherches en sciences humaines et sociales.
Le fait de venir réunir dans un même terme brand et culture pourrait être considéré comme un simple mot composé. Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, en stage dans une agence de design, j’ai constaté qu’au sein du milieu professionnel, cette notion était tout à fait acceptable, elle était même souhaitée. Pourtant, en tant qu’étudiante en sciences sociales, elle m’apparut tout de suite facilement critiquable. La dimension culturelle des marques m’a alors interrogée : parler de culture dans le domaine des marques a-t-il un sens ?
Cette question était tranchée dans le passé par un non catégorique, car il était évident que le domaine économique dans lequel les marques s’inscrivent était opposé au domaine protégé de la culture, conception typiquement française, héritage de l’exception culturelle en politique, des liens étroits entre culture et État, et d’une segmentation hiérarchique et antagoniste du social. Aujourd’hui encore cette croyance perdure, et pourtant on vient à parler de brand culture sans que cela étonne personne.
Cet objet de recherche s’intègre de manière classique dans la littérature professionnelle du marketing et de la publicité. Mais mon questionnement s’inscrit dans le cadre théorique des analystes universitaires des industries culturelles, qui étudient les relations qui existent entre le domaine industriel et le domaine culturel, et « le phénomène d’enchâssement consubstantiel de la création et de l’industrialisation » (Bouquillon, Miège, Mœglin, 2013, p. 15). Ainsi que celui des sociologues des « industries créatives », comme Scott Lash et Celia Lury, qui considèrent que la superstructure culturelle viendrait dominer l’infrastructure matérielle [1], et qui ont élaboré une analyse sur la marque qui ne « fonctionnerait plus de manière transcendante, mais de manière immanente, dans les artères de la société » (Lash, Lury, 2007, p. 13).
La notion brand culture dans la littérature professionnelle
Marketing Magazine a publié en 2013 une interview avec Daniel Bo, qui insiste sur la différence entre la brand culture et la notion qu’il a précédemment défendue, à savoir le brand content. La brand culture s’y positionne comme le prolongement plus complet de la première notion. Pour son auteur, si la marque produit du contenu par elle-même ce qu’est la définition du brand content, ce contenu est « l’un des canaux d’expression de la brand culture »[2].
La brand culture serait plus large, car elle viendrait rendre compte d’autres manifestations de la marque qui ne sont pas du contenu, comme son identité graphique, sa boutique, ses vendeurs, les gestes et habitudes du consommateur. « Il y a en effet dans l’univers des marques des éléments essentiels qui ne relèvent pas du discours et qu’il faut prendre en compte : la réalité sensorielle, corporelle, physiologique, cognitive, technologique, collective, sociale des marques : le bruit de la machine Nespresso, ou le geste pour se faire un café ou la gestion de la capsule font partie intégrante de la culture Nespresso » (Daniel Bo, cité par Catherine Heurtebise, 2013).
Ce prolongement a été défendu en 2013 par Nicolas Bordas, vice-président de l’agence de publicité TBWA Europe, et enseignant à Sciences Po, sur son site nicolasbordas.fr, dans un post au titre évocateur « Et si on passait utilement du brand content à la brand culture ? ». Un an plus tard, un second article accentue cette idée : « Et si la brand culture tirait la chasse d’eau du brand content ? » Ces titres soulignent la conception de Bordas à ce propos : la notion de brand culture doit remplacer celle de brand content qui est, selon lui, une source de confusion entre le terme américain branded content signifiant un placement de produit dans un contenu extérieur, et le (faux-) anglicisme brand content signifiant en France une création et production de contenu directement par la marque.
Le premier post pointe l’utilité de la notion brand culture qui serait « de nature à faire avancer utilement la réflexion sur la construction et le management des marques » (Bordas, 2013). Changer de notions, de « concepts paradigmatiques » [3], pour réfléchir à la gestion ou au management des marques serait donc utile d’un point de vue professionnel.
On peut se demander pourquoi. Les professionnels en marketing, et plus particulièrement les conseillers en stratégies de marque disent regretter le manque de cohérence entre les différentes manifestations de la marque. Dans son ouvrage, Bo propose des outils afin de construire une communication cohérence en développant une idée culturelle centrale, provenant de l’analyse des sources culturelles de la marque, et qui se décline sur les supports médiatiques eux-mêmes culturels. La brand culture serait clé de succès sur le long terme pour la marque, et serait avant tout une finalité et non un moyen : « Le contenu est un moyen, la culture est une fin » (Bo et al, 2013, p.8).
Cet objectif final de cohérence qui serait rendu possible par la brand culture est soutenu par Nicolas Bordas :
La marque ne se résume pas à des produits et des messages publicitaires, mais englobe toutes ses manifestations, matérielles et immatérielles, la culture de marque étant ce qui permet de créer une cohérence dans un environnement média morcelé (Nicolas Bordas, 2013).
Ce discours découle d’une volonté de l’industrie marketing et publicitaire de lier les manifestations matérielles et immatérielles de la marque, comme constaté dans le Rapport Lévy-Jouyet (Maurice Lévy, Jean-Pierre Jouyet, 2006), remis au Ministère des Finances et de l’Industrie en décembre 2006. Pour le président du groupe Publicis, Maurice Lévy, promouvoir l’ « économie de l’immatériel » est intéressant, puisque les marques sont un actif immatériel de l’entreprise. La notion de brand culture en France s’inscrit dans la continuité des recherches anglo-saxonnes. Bo n’hésite pas à citer ses références dans son ouvrage afin d’asseoir sa légitimité et sa crédibilité : « Depuis des décennies, la thématique de la brand culture s’est fortement développée, à partir des États-Unis. Les ouvrages How Brands Become Icons (2004), Brand Culture (2006) et Cultural Strategy (2010) convergent vers la notion de marque comme émetteur culturel » (Bo et al, 2013, p. 5).
Cette notion proviendrait même de conceptions plus anciennes, déjà présentes en France avec un des premiers spécialistes de la marque Jean-Noël Kapférer, professeur de marketing à HEC et consultant. Bo insiste sur cette continuité et sur le caractère important de la vision culturelle des marques en soulignant : « Dès les années 1990, Kapférer a fait de la facette culturelle un élément important de l’identité de marque dans son livre Marques, capital de l’entreprise. » (Bo et al, 2013, p.5). La brand culture ne se présenterait donc pas uniquement comme un prolongement et une évolution, mais aussi comme la consécration d’une idée déjà présente, mais pas encore nommée. Elle se positionne donc dans une littérature professionnelle du marketing et de la publicité comme une « évolution » du brand content, et finalement comme une « synthèse » de beaucoup d’autres notions récupérées par le marketing comme « l’immatérialité ». C’est pourquoi ce corpus professionnel doit être analysé généalogiquement.
La brand culture est l’évolution actuelle de nombreuses notions marketing et publicitaires l’ayant précédées
La notion de brand content a été créée en 2007 par Bo dans une étude nommée Brand Content : contenu de marque pour Havas Entertainment en tant que PDG de son cabinet d’études QualiQuanti. Pourtant, bien avant que la notion soit créée, le « contenu de marque » existait déjà. Dès 2001, BMW lance une série TV The Hire, tournée par des réalisateurs connus. Bo publia en 2009 l’ouvrage Brand Content, comment les marques deviennent des médias. La notion a connu une grande postérité dès 2010, comme l’indique la création d’une catégorie et d’un prix « Integrated and Brand Content Cristal » au sein du Cristal Festival, qui récompense les meilleures créations publicitaires européennes, suivie en 2012 par la création du « Grand Prix Stratégies du Brand Content » au sein des Grands Prix Stratégies, qui prime depuis 1977 les meilleures publicités internationales. Des agences se sont créées sur ce créneau, venant se spécialiser en création de contenus pour la marque, en 2010 avec l’agence Newcast (devenu Moxi) du groupe Publicis, et en 2012 avec l’agence BETC Content du groupe Havas. Cette notion devint en trois ans le nerf de la guerre des agences de communication. Devenues aux yeux des professionnels un levier d’innovation et donc de profit pour les agences et pour les marques, de nombreuses campagnes se sont érigées sur la base d’une stratégie de contenus.
« Les marques deviennent des médias » titre Les Echos en 2011 [4], car les marques deviennent des chaînes TV, comme c’est le cas avec la RedBullTV, deviennent des magazines, par exemple HappyLife du ClubMed, et deviennent des séries, comme c’est le cas avec la websérie Comme le disent de la Banque Postale, qui cumule 6 millions de vues sur Youtube en septembre 2014 [5]. Si l’engouement est international, la notion brand content demeure propre à la France, les Anglo-Saxons lui préférant la notion content marketing, comme on peut le voir dans un article de Forbes Magazine en 2012 consacré aux success story des marques ayant comme stratégie la création et diffusion de contenus d’entertainment [6]. En effet, la notion phare précédant le brand content fut la notion storytelling.
Le livre à ce propos qui a marqué les esprits aussi bien dans la sphère du marketing et de la publicité que dans la sphère politique fut Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, de Christian Salmon sorti en 2007. Le chercheur français y retrace l’histoire du storytelling qui devint, selon lui, une notion de marketing à partir des années 1990. Sa critique porte sur le fait que le storytelling devint alors une technique de communication, une rhétorique sophistiquée à des fins politiques et économiques, et non plus sociales et culturelles.
Précédemment, l’expérience était envisagée comme le « nouveau paradigme marketing » (Antonnela Carù, Bernard Cova, 2006). Cette notion a été introduite par B. Joseph Pine II et James H. Gilmore dès 1999. L’expérience serait selon ces auteurs la quatrième phase du développement économique au sein de leur modèle de finalisation de l’économie (Marion, 2002). Ils envisagent quatre étapes progressives : les biens sont à l’origine des marchandises, c’est-à-dire des biens banalisés, puis deviennent des biens, des produits standardisés, s’étendent en services intangibles et sur-mesure, pour enfin atteindre leur croissance ultime : ce sont aujourd’hui des expériences personnelles et mémorables (Pine, Gilmore, 1999).
La notion d’ « expérience » venait, quant à elle, remplacer la notion de « relation » (Carù, Cova, 2006). Dans les années 90, il était question de « marketing relationnel » visant à créer une relation personnalisée et interactive (Mercator, 2008). Il s’agissait de démontrer que la marque ou l’entreprise « manifeste un intérêt profond pour son public » insiste Kapférer.
En multipliant les microconnexions avec le public, la marque tisse un lien durable. Il s’agit d’une façon plus ciblée de fidéliser les clients par une politique de relation continue, personnalisée, qui démontre que la marque ne s’intéresse pas uniquement au consommateur, mais à la personne dans sa totalité. (Kapférer, 2005, p.12). Cette dernière idée nous éclaire sur l’objectif recherché par cette notion marketing : communiquer un message à une personne, et non à un consommateur. On constate alors que le processus de finalisation du marketing (Marion, 2002) est une tentative d’humanisation des techniques, des outils et des discours de l’industrie marketing et publicitaire.
Mais la généalogie de brand culture est davantage une généalogie de gestion et de management de marque qu’une généalogie du marketing. C’est à partir du moment où la marque est introduite comme une notion qu’on vient à réfléchir à son application et aux méthodes pour la développer. C’est en 1922 que le terme brand entre dans le lexique du marketing (Barbara Stern, 2006). La question du management des marques débute en 1927 avec Maynard, Weidler et Beckman dans Principles of Marketing, où un chapitre est exclusivement consacré aux politiques des marques (Bastos et Levy, 2010).
C’est en 1955 que B. Burleigh Gardner et son doctorant Sidney J. Levy introduisent la notion « brand image » , qu’ils définissent comme « gouvernant la personnalité du produit et de la marque qui est unifiée, cohérente et significative » [7]. La brand image y est décrite comme « le symbole complexe qu’est l’image de marque, faisant partie de l’investissement à long terme ».

L’essor économique de l’après-guerre a effectivement développé l’industrie publicitaire (Martin, 1992). Cette notion ne répond donc pas à une critique, mais au contraire à un besoin nouveau : le développement de l’industrie du marketing et de la publicité. Bien que ces périodes fussent glorieuses pour la publicité, la notion de brand image crée un nouveau besoin : il ne suffit plus de vendre des produits, mais de vendre une marque qui doit avoir une personnalité pour exister sur le long terme. Cette notion semble donc être idéologique (Rocher, 1995) puisqu’elle vient justifier la bonne situation de l’industrie publicitaire, en proposant de nouvelles valeurs et de nouvelles méthodes à ses acteurs.
La brand culture est l’expression actuelle du renouvellement et du recyclage constant des notions marketing et publicitaires
Cette généalogie de la notion brand culture révèle deux constats : la première est que l’industrie du marketing et de la publicité renouvelle sans cesse ses notions afin de justifier la progression et l’affinement de ses méthodes, « toujours plus » et « toujours mieux ». En effet, cette généalogie montre qu’il est possible de périodiser différents courants théoriques et méthodologiques dans les deux industries. De nombreuses notions se créent et concourent pour devenir le référent d’une période, comme on a pu l’observer avec le brand content face au brand entertainment, ainsi qu’avec la brand culture face au cloud branding. La succession de ces périodes vient justifier le fait que le marketing et la publicité progressent dans leurs analyses et leurs méthodes. Comme le souligne Nicolas Bordas, défenseur de la brand culture, cette notion permettrait de dépasser un schéma de marketing obsolète : « Je suis convaincu, comme Daniel [Bo], qu’il est temps de dépasser le marketing classique qui enferme les marques dans une posture d’émetteur, pour construire un nouveau marketing de l’expérience » (art. cit.).
Le fil rouge du dépassement et du progrès est présent dans tout le livre de Bo et al., où la notion de brand culture viendrait restituer la complexité de la marque ce qui n’était pas le cas avec la notion d’ « ADN de marque » qui produisait « un modèle figé de l’unité de la marque » (Bo et al., 2013, p. 102). Il est aussi nécessaire, nous rappelle l’auteur, d’élargir progressivement le regard sur la marque en passant d’une logique publicitaire à une logique de contenu de marque pour finalement réussir à aboutir à une logique de culture de marque (Bo et al., 2013, p. 42).
Le second constat est que la nouveauté affichée des notions marketing et publicitaires est toute relative puisque ces notions ne viennent généralement pas faire rupture avec les notions précédentes, mais au contraire récupérer ces anciens modèles pour les remodeler, voire les rajeunir sous un autre nom plus actuel et donc plus attractif. La notion qui réussit à s’imposer dans le milieu professionnel du marketing et de la publicité semble être celle qui synthétise les idées précédentes, en feignant de leur donner une nouvelle perspective.
La brand culture permet ainsi de rassembler sous un même nom des notions et des idées plus anciennes précédemment acceptées par l’industrie publicitaire et marketing :
- La notion continue à accorder une grande importance à la création de contenu, que ce soit par les marques elles-mêmes en tant que média, ou généré par les internautes pour la marque.
- Elle conserve aussi la notion de storytelling puisque les sources culturelles de la marque — qui seraient au nombre de sept : l’ingrédient, l’activité, la géographie, l’Histoire, la nature, les mouvements culturels et la science (Bo et al., 2013) — sont autant d’angles possibles pour réaliser du storytelling de marque.
- Enfin, elle reprend la notion d’expérience.
La source culturelle de la marque de sauce tomate Heinz, par exemple, serait donc son ingrédient la tomate. La marque communique effectivement sur la tomate jusqu’à en créer un mythe. Une vidéo De la graine à la récolte en 57 secondes est diffusée sur le compte Youtube de la marque, ce qui est un premier degré de brand content. Un autre exemple marquant le lien entre brand culture et storytelling vient de la marque de luxe Chanel. Sa source culturelle serait sa fondatrice Coco Chanel. Et c’est pourquoi de nombreux contenus de storytelling on été crées à son propos : des publicités certes, mais aussi des livres et des films. Ces contenus sont produits par l’industrie créative qu’est la publicité, mais aussi par les industries culturelles que sont le cinéma et l’édition, le storytelling étant commun à ces industries.
Daniel Bo propose trois critères pour créer une brand culture forte, et la première est de créer une « expérience vécue ». Tout comme le soulignait déjà il y a plus de dix ans la notion de « marketing expérientiel », Bo considère que la marque doit proposer des expériences à ses consommateurs pour former sa culture. Ces expériences peuvent se produire dans les boutiques « devenant des lieux de vies» (Bo, 2013).

- l’expérience, paradigme économique (Pine & Gilmore 1999), déjà présent en marketing avec la notion d’atmosphère proposée par Kotler en 1973 dans l’article « Atmospheric as a marketing tool ».
- l’interaction, paradigme sociologique (Goffman), repris en marketing par Marie-Claire Sicard, qui établit la marque comme un système vivant, et son identité comme un processus en évolution perpétuelle dans Identité de marque (2008), ainsi que par Andréa Semprini, qui voit la marque comme un contrat entre quatre acteurs (l’entreprise, le marché, le contexte des valeurs et les consommateurs), « en interaction permanente, se limitent et s’influencent mutuellement » (La Marque, 1995, p. 56).
- La créativité, paradigme psychologique (Carl Rogers), est devenue un paradigme économique avec la notion d’« économie créative » (Throsby, 2001).
La « créativité » a toujours été l’apanage de l’industrie publicitaire. De nombreux publicitaires ont tenté de la définir afin de fonder la philosophie et la vision de leurs agences. Pour Leo Burnett (1960), fondateur de l’agence portant son nom, la créativité est « l’art d’établir des relations nouvelles et signifiantes entre des éléments initialement indépendants d’une manière pertinente, crédible et esthétique et qui permette de présenter le produit sous une nouvelle lumière » (cité par Maria Mercanti-Guenin (2005)). Pour Jean-Marie Dru (1996), l’un des fondateurs de l’agence BDDP, « une idée créative (est) comme une nouvelle combinaison de pensées. Il suggère que l’idée créative est un lien entre deux concepts qui n’avaient jamais été liés précédemment » (cité par Maria Mercanti-Guenin (2005)).
Cette créativité a donc été centrale dans l’industrie publicitaire, et ce bien avant l’émergence des industries et de l’économie dites « créatives ». Cette perspective est défendue par l’économiste de la culture David Throsby, où les industries créatives viendraient transmettre de la créativité aux autres secteurs de l’économie (Bouquillion, Miège, Mœglin, 2013).
En France, l’industrie publicitaire fait partie des industries créatives, mais est exclue des industries culturelles. Or en Angleterre, l’industrie publicitaire est considérée comme une industrie culturelle. À l’image de la définition anglo-saxonne, l’industrie publicitaire française tenterait de prouver son appartenance aux industries créatives ainsi qu’aux industries culturelles afin de légitimer sa dimension culturelle.
On constate effectivement que la notion de brand culture s’inscrit dans un contexte économique et politique venant promouvoir la culture dans le secteur industriel. La stratégie de l’ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti était de promouvoir la culture comme levier de croissance et de développement économique : « La culture est sous-estimée dans son apport à l’économie globale. C’est pourquoi je mets l’accent sur ce formidable levier de développement », explique-t-elle dans La Tribune en octobre 2013 [8]. Cette vision était partagée par le ministère de l’Économie et des Finances. Un rapport sur l’apport de la culture en France fut réalisé par Serge Kancel, Jérôme Itty, Morgane Weill et Bruno Durieux, signé conjointement par les deux ministères en 2013. Ce rapprochement entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Économie a débuté en France avec la politique culturelle des années 1980. En venant insérer « l’action culturelle de l’État dans la modernité économique », le ministre de la Culture Jack Lang a alors provoqué « une vraie rupture, tant elle est originale par rapport à l’histoire et au reste du monde, où l’action des pouvoirs publics dans le domaine culturel est de façon générique, passéiste, conservatrice, et étrangère aux lois de l’économie », explique Augustin Girard (1996). Ce rapprochement politique-culture-économie n’est donc pas nouveau, mais s’est accentué ces dernières années. Ce contexte politique semble donc pousser l’industrie publicitaire à s’insérer dans un contexte porteur qu’est la culture. Notre généalogie, pour être finalisée, a donc besoin d’analyser les contextes associés à la création des notions publicitaires.
Cette généalogie des notions marketing et publicitaires s’inscrit depuis 1990 dans un contexte d’évolution et de progrès technologique croissants. On constate dans l’ouvrage de Philippe Bouquillion et de Jacob T. Matthews, Le web collaboratif, mutations des industries de la culture et de la communication des similitudes entre la construction et l’avènement du terme Web 2.0 et celui de brand culture. Tous deux ont une paternité précise et localisée dans l’esprit des professionnels de chaque secteur. L’entrepreneur Tim O’Reilly pour le terme Web 2.0, et Daniel Bo en France pour le terme brand culture. Ils ont aussi tous deux fait l’objet d’une campagne de promotion. De plus, la construction de ces termes est similaire. Dans le cas du « Web 2.0 », Tim O’Reilly étudia « les caractéristiques des sociétés qui ont survécu au crash » (Bouquillon, Matthews, 2010, p. 5), c’est-à-dire qui ont survécu à l’éclatement de la bulle spéculative qui a menacé de faillite les sociétés du Web autour des années 2000. Les marques qui sont présentées comme modèles à suivre par Bo, comme Redbull, Apple, Nike, sont celles qui ont le mieux résisté à la crise économique de 2008. Les deux auteurs cherchent dès lors à dévoiler « le secret de leur survie et de leurs succès et de fournir ainsi les clefs de succès dont les sociétés pourront s’inspirer ». Les clefs de succès proposés par Tim O’Reilly à l’industrie du web, à savoir le modèle participatif « où l’usager de simple consommateur se mue en véritable “générateur de contenus” » a été repris à son compte par l’industrie du marketing et de la publicité quelques années plus tard, avec la notion brand content. De même que le « Web 2.0 » s’est construit « dans un très large oubli de l’histoire » (puisque la notion de self-média, c’est-à-dire une « expression hors les grands médias » était déjà présente dès le début des années 1970, donc bien avant l’avènement du « Web 2.0 »), la construction du terme brand culture a cherché à s’établir comme une stratégie nouvelle pour les marques en dépassant les anciens schémas descendants du marketing, et à justifier un usage consommateur beaucoup plus démocratique, libre, car participatif, voire performatif (Bo, 2013). L’industrie marketing et publicitaire a donc repris le paradigme de la « culture participative », comme clé de succès pour leur stratégie de marque se basant ainsi sur le numérique, source de cette culture participative selon Tim O’Reilly ; ainsi que le paradigme de « convergence médiatique ». En effet, la « culture participative » est liée à la « convergence médiatique » annoncée par Henry Jenkins dès 2001 : « La convergence médiatique génère une nouvelle culture populaire participative en offrant aux gens ordinaires les outils pour archiver, annoter, s’approprier et retransmettre les contenus. » (Jenkins, cité par Bouquillion et Matthews, 2010, p. 7).
Lorsque ces auteurs viennent envisager le « Web 2.0 » comme « un discours de légitimation du capitalisme entrepreneurial et comme une tentative de défense d’une industrie en difficulté » (Bouquillon, Matthews, 2010 p. 5), le terme brand culture est lui-même un discours venant légitimer l’industrie du marketing et de la publicité en difficulté, due à la crise économique et sociale actuelle. Les discours sur la brand culture sont donc semblables à ceux sur le « Web 2.0 », car ils produisent tous deux « des représentations vantant les mérites du capitalisme, tant sur le plan socio-économique que sociétal » (id.).
Le « Web 2.0 » fut présenté comme le lieu où la culture était libérée de son insertion industrielle, dans une vision activiste de piratage (Bouquillion, Matthews, 2010). Avec le « Web 2.0 », la culture serait devenue accessible à tous. Avec la brand culture, la culture serait à nouveau davantage accessible à tous grâce aux marques (Bo et al., 2013). Les industries de la culture sont remises en cause par les industries du web (Bouquillion, Matthews, 2010), ainsi que par les industries du marketing et de la publicité, pour qu’ainsi la culture atteigne « un statut et une place dans la société et l’économie dont elle ne disposait pas auparavant ; la culture serait intégrée aux processus de création, de production, de diffusion, de promotion et valorisation d’un grand nombre de produits de l’économie » (Bouquillion, Matthews, 2010, p. 11), dont les marques font partie. De plus, le « Web 2.0 » a permis une représentation sociale mettant au centre « les réseaux et les produits des industries de la culture et de la communication dans la construction des rapports sociaux » (id.). De même l’industrie marketing et publicitaire cherche à faire valoir une représentation sociale de la marque comme lien social ayant une culture à partager et à développer.
Le second contexte qui a engendré la succession de notions marketing et publicitaires est un contexte social de critiques vis-à-vis du capitalisme, et d’intégration de ces critiques par ce capitalisme (Boltanski, Chiapello, 1999). La « critique artiste » vient aujourd’hui déplorer le manque d’authenticité des entreprises capitalistes et le désenchantement qu’elles engendrent : « le capitalisme, source de désenchantement des objets, des personnes, des sentiments, et plus généralement du genre de vie associé » (id. p. 83).
La notion de brand culture est une réponse à cette critique d’inauthenticité et de désenchantement, en cherchant à donner un nouveau sens au rôle mercantile de la publicité et des marques : un rôle culturel. Car si le capitalisme a marchandisé la culture, il peut tout aussi « culturaliser » la marchandise (Lipovetsky, 2010) : « Cette critique met en avant la perte de sens du beau et du grand qui découle de la standardisation et de la marchandisation généralisée, touchant non seulement les objets du quotidien, mais aussi les œuvres d’art (le mercantilisme culturel de la bourgeoisie) et les personnes » (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 84). Si la culture est le lieu d’une résistance face au capitalisme, où l’art culmine pour ses valeurs de désintéressement, valeur esthétique kantienne du beau, elle serait l’un des derniers lieux de l’authenticité, avec la nature. C’est pourquoi on constate un mouvement de légitimation de l’industrie du marketing et de la publicité par la culture. Ce mouvement est externe, vis-à-vis des consommateurs, mais aussi interne, vis-à-vis des professionnels du secteur, en essayant de faire de la culture le nouveau paradigme marketing.
Le troisième contexte est politico-économique. On l’a vu précédemment, la culture est considérée comme un levier de croissance économique (Throsby, 2001), et ce depuis quarante ans. Les sphères habituellement séparées entre culture et industrie deviennent de plus en plus mêlées. Le contexte politique vient favoriser cette perception, en montrant que la culture est une ressource économique importante, comme on peut le constater dans un article de La Tribune titrant « La culture contribue 7 fois plus au PIB que l’industrie automobile » [9]. Le rapport L’apport de la culture à l’économie en France datant de décembre 2013 explore le poids économique de la culture, depuis déjà quarante ans considérée comme une industrie. Cela démontre l’évolution des représentations sur ce qu’est la « culture », autrefois opposée à l’économie et à l’industrie. Aujourd’hui les deux peuvent cohabiter et ce rapprochement est valorisé politiquement.
Cela explique pourquoi lier le terme culture avec le terme marque n’est plus considéré uniquement comme un oxymore. La notion de brand culture prend appui sur ce contexte économique et politique, qui soutient la pertinence et l’efficacité de ce mariage, autrefois impensable. Cette évolution contextuelle est particulièrement forte en France, où la culture a toujours coexisté avec l’État et donc avec le public venant s’opposer à l’industrie et au privé. De plus, la tradition française de la culture vient opposer « culture légitime » et « culture populaire » (Bourdieu, 1979). La culture dite « légitime » comme l’art était donc opposée à une logique triviale, prosaïque et mercantile que sont les produits de consommation.
La notion de brand culture s’inscrit dans l’actuel mouvement de « culturalisation » de la marchandise, de l’industrie et de l’économie
Un objet se présente en tant que marchandise lorsque cet objet possède une valeur d’usage, ainsi qu’une valeur d’échange, d’après l’analyse célèbre de Karl Marx dans Le Capital : « Mais chaque marchandise se présente sous le double aspect de valeur d’usage et de valeur d’échange » (vol. 1, chapitre 1).
La valeur d’usage ne se réalise « que dans le procès de la consommation. La même valeur d’usage peut être utilisée différemment. Toutefois, son mode d’existence d’objet doué de propriétés déterminées embrasse la somme de ses possibilités d’utilisation », tandis que la valeur d’échange est quant à elle « un rapport quantitatif selon lequel des valeurs d’usage sont échangeables entre elles »[10]. Cette valeur d’échange permet aux « produits du travail » d’acquérir « une existence sociale identique et uniforme distincte de leur existence matérielle et multiforme comme objet d’utilité ».
Comme l’expliquent Monique Wahlen et Benoit Héry dans De la marque au branding : vers un nouveau modèle, le cloud branding, la valeur d’échange en marketing désigne le prix, et « la marque est une composante importante du prix de vente, puisque selon sa notoriété et son image, elle peut le faire varier dans des proportions spectaculaires » [11]. Pour eux, le couple valeur d’usage/valeur d’échange entendu par Marx fonctionne économiquement, mais ne fonctionne pas sur le plan symbolique, puisqu’une marque en tant que signe symbolique vient créer une différenciation non plus uniquement dans leur usage, mais aussi dans leur valeur. Deux produits proposant le même usage et le même temps de travail, de production, devraient avoir deux valeurs d’échange équivalentes. Pourtant si ces deux produits ont des marques différentes, leur valeur d’échange est elle-même différente en fonction de la charge symbolique de la marque. C’est pourquoi, les deux auteurs proposent une troisième valeur qui est une valeur de signe, qui « désigne la qualité que s’adjoint, en le possédant, l’individu acquéreur du produit ». Pourtant la valeur symbolique de la marque ne suffit pas toujours à justifier la valeur d’échange qui devient disproportionnée par rapport à sa valeur d’usage. Cela explique pourquoi aujourd’hui l’industrie marketing et publicitaire cherche à « redonner du sens » à la consommation et donc aux marques en leur injectant des signes hautement symboliques issus de la culture.
Ce transfert de signes symboliques au sein de la marchandise, et au sein de signes commerciaux n’est pas nouveau. Dès 1947, Adorno et Horkheimer dans La dialectique de la raison conçoivent l’industrie culturelle comme un « transfert souvent maladroit de l’art dans la sphère de la consommation ». Si aujourd’hui, l’industrie publicitaire cherche à se rapprocher de la « culture » en général, ce mouvement était déjà présent dans le rapprochement de l’art et de la publicité. Arthur Danto dans son livre Après la fin de l’art, identifie trois relations entre art et publicité. La première relation est historique. Les premières réclames publicitaires étaient réalisées par des artistes comme Mucha ou encore Toulouse-Lautrec. La seconde relation vient du marketing. Il y a transfert de signes artistiques, assez iconiques pour être facilement reconnaissables au sein de la communication des marques. L’exemple le plus parlant reste la femme de La Laitière de Vermeer pour la marque laitière du même nom. La troisième relation marque la « fin de l’art » pour Danto, car à partir de l’œuvre de Warhol, Les Boites Brio en 1964, les marques peuvent devenir des œuvres d’art. L’industrie publicitaire a donc toujours cherché à transférer des signes artistiques au sein de la production industrielle. « Ce que la publicité récupère dans la tradition avant-gardiste, c’est un pouvoir d’imagination qui entoure le produit d’un halo subliminal n’ayant rien – ou très peu – à voir avec sa réalité marchande » (Vangelis Athanassopoulos, 2010 [12]). La valeur de signe propre à la marque est effectivement de créer un imaginaire culturel, fait de signes esthétiques et artistiques. Mais ce mouvement était double, puisque la sphère de l’art dès 1912 avec Picasso et sa Bouteille de Suze, et par la suite en 1919 avec Duchamp et le ready-made cherchaient aussi à transférer des signes industriels au sein de leurs créations artistiques. Si l’art a perdu son aura avec la reproductibilité technique (Benjamin), propre de la production industrielle de l’économie capitaliste, cette dernière récupère un halo de technicité.

Si l’expérience du quotidien est remodelée par la consommation marchande, il faut ajouter qu’en même temps, le monde économique, via les marques commerciales, est de plus en plus pénétré de signes culturels. Plus la culture s’impose comme un univers économique à part entière et plus celui-ci tend à se culturaliser : c’est particulièrement manifeste dans l’univers des marques qui ne cessent d’intégrer dans leur offre une dimension culturelle, celle du style, de la mode, de l’art, de la créativité, des « valeurs », de la narration, du sens. L’âge hypermoderne est celui où le culturel se diffuse dans l’univers consumériste des marques : on ne produit plus seulement de la valeur d’usage, mais de la valeur esthétique et culturelle. (Gilles Lipovetsky, Hervé Juvin, L’occident mondialisé, 2010).
L’âge hypermoderne dont parle Lipovetsky et Juvin est une ère mondialisée, capitaliste et technophile. Ce sont ces contextes économiques, politiques et technologiques qui ont fait tomber le mur entre la sphère culturelle et la sphère économique : « Le fait est là, il n’y a plus d’opposition structurelle entre sphère culturelle et sphère économique. L’époque est partout à la domination des logiques financières et commerciales ». Et c’est pourquoi un mouvement bilatéral est devenu possible entre ces deux sphères : « Par quoi le nouvel âge culturel signifie autant marchandisation de la culture que culturalisation de la marchandise ».
Pour Bouquillion, Mœglin et Miege dans leur ouvrage Industrialisation des biens symboliques : les industries créatives en regard des industries culturelles, il y a extension des logiques de fonctionnement des industries culturelles vers d’autres secteurs industriels, qui se traduisent par « l’adoption par les nouvelles activités industrielles de stratégies de prise de risque, d’intégration des comportements des usagers dans la conception d’un produit, de mode de gestion des aléas adaptés à des environnements incertains et dans lesquels joue à plein la surdétermination des valeurs d’usage et d’échange par des valeurs symboliques » (id. p. 13). Leur hypothèse est que la « culturalisation » de l’industrie « dépasserait le simple mouvement d’esthétisation des objets fonctionnels » (id. p. 12), mais est une méthode qui traite et manipule des symboles au nom de leur dimension créative (id. p. 14). Les marchandises industrielles deviennent symboliques lorsqu’elles véhiculent un imaginaire « qui tend à les convertir en médias et moyens de communication et qui en surdétermine la valeur économique » (ibid.), lorsqu’elles procurent un profit symbolique à leurs consommateurs, et lorsque les « les conditions dans lesquelles la mise au point de ces produits, la mobilisation des ressources nécessaires à leur conception, les modalités de leur production et la prévalence de la recherche systématique de la nouveauté visent à aligner – sans d’ailleurs forcément y parvenir toujours – les facteurs matériels et infrastructurels sur les impératifs de la gestion des (et par les) symboles » (ibid.). Ce caractère tridimensionnel existe chez les marques et dans l’industrie publicitaire. Cette valeur symbolique est une condition qui permettrait aux marques d’intégrer des valeurs culturelles, voire de se culturaliser plus facilement et plus rapidement.
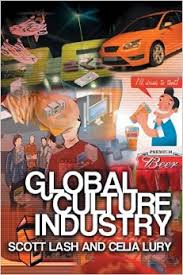
Les marques ont apporté une valeur de signe à leurs produits pour justifier le décalage entre la valeur d’usage et la valeur d’échange. Pour alimenter cette valeur de signe, l’industrie publicitaire a toujours cherché à se rapprocher de domaine hautement symbolique comme l’art et la culture. Il eut tentative d’esthétisation et d’artification de ces marques, signalant l’ère post-moderne, où l’art et l’industrie ne seraient plus opposés. Plus largement, l’industrie publicitaire cherche aujourd’hui à « culturaliser » son secteur. Il serait possible pour les marques de se culturaliser grâce à leur valeur symbolique selon Bouquillion, Miège et Mœglin, et leur valeur virtuelle pour Lash et Lury.
La généalogie de brand culture permet donc de révéler l’important renouvellement des notions publicitaires. Certaines notions semblent répondre à la crise socio-économique actuelle. Tout comme la notion « Web 2.0 », ces notions permettent de défendre l’industrie publicitaire en difficulté, en la modernisant. Mais la création de ces notions ne semblent pas uniquement corrélées à un contexte de crise puisque la notion de brand image a été élaborée en 1955, période prospère. Dans les deux cas, l’industrie publicitaire doit se justifier par rapport à l’économie et au capitalisme en général. Ces notions sont donc idéologiques, car cette situation peut à tout moment être remise en question. Le renouvellement de notions vient alors promouvoir, anticiper ou répondre aux critiques en démontrant les qualités d’adaptabilité de l’industrie. La littérature scientifique permet ainsi de constater que l’origine de la brand culture remonte à l’idée même de « marque », car c’est la dimension immatérielle, symbolique et virtuelle de celle-ci qui permet à l’industrie publicitaire de la redéfinir selon les attentes de son environnement économique, politique et sociale. La « marque » serait elle-même une idéologie.
Adapté du premier chapitre d’un mémoire de recherche en M1 (« La notion marketing et publicitaire : « Brand Culture ». Mise en regard avec les théories critiques des industries culturelles ») présenté à l’université Paris 8 (Saint-Denis) en septembre 2014 sous la direction de Christophe Magis.
Notes
[1] Contrairement à la vision marxienne où l’infrastructure matérielle, économique et technologique détermine la superstructure culturelle et idéologique.
[2] Heurtebise, Catherine, « Daniel Bo : Brand Culture la stratégie de gestion des marques », Emarketing.fr, 02/04/2013.[3] Tout au cours de notre analyse, nous utiliserons le terme « notion » concernant la « Brand Culture », mais les auteurs de cette notion et ceux qui la défendent en parlent comme un « concept ». Le terme « concept » étant dans ce cas un terme professionnel de la publicité, nous cherchons à nous en détacher pour mieux l’analyser dans le cadre des sciences humaines et sociales.
[4] « Les marques deviennent des médias », Les Echos, n°20869, 14 février 2011, page 15. [5] La Banque Postale, « 6 millions de vues, ça cartonne », sept. 26, 2014 [référence mise à jour, NDE].[6] Gutman, Brandon, « 5 big brands confirm that Content marketing is the key to your customer », Forbes, 27/11/2012.
[7] Gardner et Levy, « The product and the brand », Harvard Business Review, 1955.[8] Abrial, Valérie, « Aurélie Filippetti : l’investissement créatif, c’est rentable et ca rapporte ! », La Tribune, 10/10/2013.
[9] Renier, Romain, « La culture contribue 7 fois plus au PIB que l’industrie automobile », La Tribune, 3 jan. 2014. [10] Marx, Karl, Le caractère fétiche de la marchandise et son secret, Allia, 1995.[11] Wahlen, Monique, Héry, Benoit, De la marque au branding : vers un nouveau modèle : le cloud branding, Dunod, 2012.
[12] Athanassopoulos, Vangelis, La publicité dans l’art contemporain : esthétique et post-modernisme, L’Harmattan, 2010, p.72.
Références dans le texte
BASTOS, Wilson, LEVY, Sidney J., « A history of the concept of branding : practice and theory », Journal of Historical Research in Marketing, Vol. 4 : 3, 2012, pp. 347-368.
BO, Daniel, GUEVEL Mathieu, LELLOUCHE Raphale, Brand Culture : développer le potentiel culturel des marques, Dunod, coll. Tendances Marketing, 2013.
BOLTANSKI, Luc, CHIAPELLO, Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Editions Gallimard, coll. Essais, 1996.
BOUQUILLION, Philippe, MATTHEWS, Jacob T., Le web collaboratif : mutations des industries de la culture et de la communication, Presses universitaires de Grenoble, coll. Communication en plus, 2010.
BOUQUILLON, Philippe, MIEGE, Bernard, MOEGLIN, Pierre, L’industrialisation des biens symboliques : les industries créatives en regard des industries culturelles, Presses universitaires de Grenoble, 2013.
BOURDIEU, Pierre, La distinction : critique sociale du jugement, Minuit, coll. Le sens commun, 1979.
CARU, Antonnela, COVA, Bernard, « Expérience de consommation et marketing expérientiel », Revue Française de Gestion, Lavoisier, 2006, n°162, p. 99.
CUCHE, Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, coll. Repères, 2010.
GIRARD, Augustin, Les politiques culturelles d’André Malraux à Jack Lang : ruptures et continuités, histoire d’une modernisation, Hermès, 1996.
KAPFERER, Jean-Noël, Ce qui va changer les marques, Editions de l’Organisation, 2005.
MARTIN, Marc, Trois siècles de publicité en France, Odile Jacob, 1992.
MERCANTI-GUERIN, Maria, La créativité publicitaire perçue. Thèse de doctorat en économie et gestion, Caen, Université de Caen, 2005.
LASH, Scott, LURY, Celia, Global culture economy : the mediation of things, Polity (Cambridge), 2007.
LEVY, Maurice, Jean-Pierre JOUYET, L’économie de l’immatérielle : la croissance de demain, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2006.
LIPOVETSKY, Gilles, JUVIN, Hervé, L’occident mondialisé, Grasset, coll. Nouveau collège de philosophie, 2010.
MARION, Gilles, « Le marketing ‘expérientiel’ : une nouvelle étape ? Non de nouvelles lunettes » , Décisions Marketing, n°30, avril-juin 2003, p. 87.
PINE II, B. Joseph, GILMORE, James H., The experience economy : work is theatre and every business a stage, Editions Harvard Business Press, 1999.
SALMON, Christian, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, coll. Cahiers Libres, 2007.
SEMPRINI, Andréa, La marque, Presses Universitaires de France, collection « Que sais-je », 1995.
SICARD, Marie Claude, Identité de marque, Eyrolles, collection marketing, 2008.
STERN, Barbara, « What does brand mean? Historical analysis, method and construct definition », Journal of the Academy of Marketing Science, n°34, 2006, p. 216-23.
THROSBY, David, Economics and culture, Cambridge University Press, 2001.






















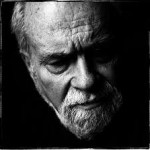
 Adorno vs pop culture
Adorno vs pop culture David Buxton – Jean-Baptiste Favory – Hommage à Pierre Henry
David Buxton – Jean-Baptiste Favory – Hommage à Pierre Henry Comicalités. Études de culture graphique.
Comicalités. Études de culture graphique.