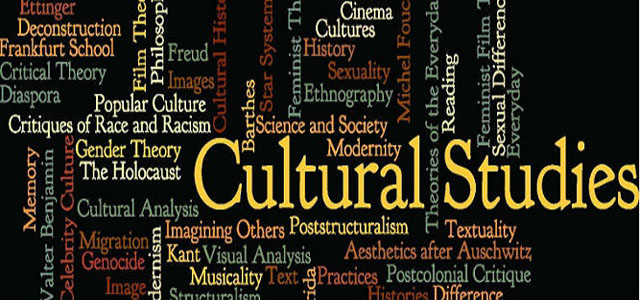Les Cultural Studies – entretien avec Maxime Cervulle et Nelly Quemener
À l’occasion de la sortie de Cultural Studies. Théories et méthodes (Armand Collin, 2015), livre d’introduction clair et équitable signé par deux jeunes universitaires, Maxime Cervulle et Nelly Quemener, la Web-revue a voulu leur poser des questions par écrit dans le but d’un dialogue contradictoire. Cervulle et Quemener représentent la « troisième génération » des Cultural Studies qui s’intéresse tout particulièrement aux « nouveaux sujets de l’émancipation ». Nonobstant quelques excès des deux côtés, la tradition critique de l’École de Francfort et les Cultural Studies ont historiquement existé dans un état de tension créative (mais tension quand même !). Cela est l’approche de la Web-revue, dans un contexte où la recherche critique à l’Université n’est plus encouragée, mais où certaines thématiques travaillées par la tradition des Cultural Studies sont plus que jamais présentes dans les débats politique et social.
Article interdit à la reproduction payante
David Buxton (pour la Web-revue) : Armand Mattelart et Érik Neveu ont publié une Introduction aux Cultural Studies en 2003, devenue un classique. En quoi votre livre se démarque du leur dans son approche ? Qu’est-ce qui a changé dans le domaine des Cultural Studies depuis le début des années 2000 ?
Maxime Cervulle et Nelly Quemener : L’ouvrage de Mattelart et Neveu [1] se concentre tout particulièrement sur l’histoire des Cultural Studies de Birmingham, à travers un exposé très précis des ressorts épistémologiques du Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), entre structuralisme et matérialisme culturel, entre économie politique et approche culturelle. L’ouvrage aborde en outre le « tournant culturel » des années 1970 par le prisme des études en réception et de l’étude des méta-discours, dont il dénonce d’ailleurs les dérives « textualistes ». À force de ramener le social au texte, les Cultural Studies tendraient selon lui à effacer les effets économiques, les rapports de force ou encore les déterminismes sociaux. En dépit de sa grande qualité – le premier chapitre sur la « pré-histoire » des Cultural Studies est admirable –, l’ouvrage donne cependant une vision parfois réductrice des multiples champs d’investigation des Cultural Studies, car il porte trop peu d’attention à leur extension au-delà de la seule question des médias et de la culture. Nous avons fait un choix très différent : notre ouvrage décline différentes thématiques transversales aux Cultural Studies. Il se distingue en cela d’une approche historique et cherche surtout à développer des outils théoriques et méthodologiques de compréhension de la culture et des pratiques qui la constituent. L’idée est par ailleurs de dresser une cartographie des problématiques brassées par les Cultural Studies, et cela à travers deux axes.
D’une part, nous avons souhaité retracer les débats théoriques qui traversent les Cultural Studies et prendre le contre-pied d’une image réductrice déconsidérant aujourd’hui leur dimension critique. Au contraire, il nous a semblé nécessaire de rappeler la dimension structurante du dialogue avec le marxisme au sein de l’école de Birmingham – à ce point structurant, rappelons-le, que les Cultural Studies britanniques ont été un lieu de conflits majeurs entre différents courants marxistes, comme entre l’approche humaniste d’un Edward P. Thompson et celles, structuralistes, importées dans le domaine via la lecture d’Althusser. Ce dialogue ne cesse aujourd’hui de se poursuivre, par exemple dans des travaux portant sur les industries culturelles, à l’instar de ceux développés à la charnière de l’économie politique et des Cultural Studies par David Hesmondhalgh [2] ; il se retrouve dans les critiques formulées à l’égard des politiques de l’identité, comme en témoigne le tournant matérialiste qui s’est opérée au sein des théories queer au début des années 2000 ; il divise à nouveau lorsque sont abordés les phénomènes de convergence culturelle, les travaux d’Henry Jenkins [3] étant souvent accusés par les héritiers de Birmingham de faire le jeu du capitalisme [4]. Bref, l’ambition de l’ouvrage était de déplier les formes diverses que prend la critique au sein des Cultural Studies.
D’autre part, nous avons tenté de proposer une synthèse inédite dans le champ universitaire français du phénomène Cultural Studies. Il ne s’agissait pas d’aspirer à un compte rendu exhaustif de tous les domaines pouvant s’y référer, mais de faire sens avec les multiples ramifications et développements du domaine, en dessinant des lignes de tensions, en identifiant les endroits de conflictualité et les déplacements paradigmatiques qui s’y sont opérés. Cette lecture peut bien entendu prêter à discussion, mais elle nous a paru essentielle pour contrer l’image de fragmentation et de dispersion que peut véhiculer la multiplication des studies à l’échelle internationale. Nous défendons à l’inverse que l’extension du domaine, son renouvellement permanent par les marges est constitutif de la démarche engagée par les figures fondatrices du domaine. Cette démarche consiste à saisir des contextes en mouvement, à rendre compte de nouveaux terrains de lutte politique, autrement dit, à revisiter sans cesse les paradigmes théoriques au contact des pratiques émergentes et des transformations conjoncturelles, sans pour autant se départir d’une attention première aux rapports de pouvoir.
Dans quelle mesure la notion gramscienne de « culture de conflictualité idéologique », élaborée par Stuart Hall pour critiquer l’anhistoricité du courant structuraliste, constitue-t-elle l’essence des Cultural Studies, le sine qua non de son existence ? Alors que cette notion s’imposait comme une évidence dans les décennies mouvementées de ses débuts, qu’en est-il aujourd’hui avec la domination néolibérale écrasante, et l’impitoyable et instantanée récupération de toute culture marginale ? Faut-il conclure que les concepts développés par les Cultural Studies sont eux aussi tributaires des rapports de force historiques, au point d’être emportés par le mouvement de l’histoire ? N’est-il pas étrange que la quasi-discipline arrive si tardivement en France (et sans y être naturalisé linguistiquement depuis 20 ans !), au moment où elle marque le pas ailleurs, surtout en Grande-Bretagne (le Centre de Birmingham a été fermé en 2002) ?
Il est difficile de dire qu’il y aurait – quelle qu’elle soit – une « essence » des Cultural Studies. L’anti-essentialisme a quand même constitué, en leur sein, un mot d’ordre puissant. Le domaine est en outre particulièrement hybride dès ses premières années d’existence. Au sein du Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, la définition gramscienne de la conflictualité a coexisté avec un marxisme structuraliste (en particulier Louis Althusser) – non sans tension bien entendu, mais il est toutefois difficile de dire de quel côté se situerait une version des Cultural Studies qu’on imaginerait « pure » ou « originelle ». Se situe-t-elle du côté du matérialisme culturel (c’est-à-dire du côté des travaux de Raymond Williams, Edward P. Thompson, des chercheurs travaillant sur les subcultures) ? Du côté du marxisme structuraliste (c’est-à-dire du côté de la majeure partie des chercheuses féministes du Centre, des travaux du milieu des années 1970 sur l’idéologie médiatique) ? Voire du côté d’une critique littéraire pré-marxiste bien qu’attentive à la transformation des modes de vie ouvriers (à laquelle renvoie la position de Richard Hoggart, au fondement du Centre) ? Plus que d’une « ligne » constituée, les Cultural Studies émergent plutôt, à Birmingham, des crises successives que provoquent les confrontations entre ces différentes options théoriques. La version des Cultural Studies qui s’est trouvée être la plus institutionnalisée et la plus diffusée à l’international – celle que l’on retrouve dans les écrits de Stuart Hall – vise précisément à élaborer une sorte de synthèse théorique, notamment entre le structuralisme et un matérialisme culturel inspiré de Gramsci [5]. L’insistance de Hall sur la notion de conflictualité a été, en un sens, plus qu’un mot d’ordre scientifique ; au sein du CCCS, c’est quasiment une méthode de travail : organiser la conflictualité entre différents modèles théoriques pour faire émerger l’option la plus pertinente dans la conjoncture. Car cette question de la conjoncture est elle aussi très importante dans les Cultural Studies (Stuart Hall et Lawrence Grossberg sont ceux qui se sont le plus attachés à marquer cette nécessité de saisir le moment historique pour envisager des stratégies politiques possibles)[6]. Donc nécessairement, les Cultural Studies sont très directement tributaires des mouvements de l’histoire. Leurs modèles de conceptualisation ont vocation à être transformés, dépassés au gré des évènements historiques.
Si l’on en vient maintenant à la seconde partie de la question, qui implique un lien entre la montée du néolibéralisme et l’arrivée des Cultural Studies en France, il n’y a évidemment pas de cause à effet entre la première et la seconde. Ce contexte néolibéral va bien au-delà de la simple question des Cultural Studies, et nous interroge sur les missions de l’Université et leurs conditions d’exercice, sur notre capacité à faire de cet espace institutionnel un lieu de possible pour différentes formes de critiques sociales. Dans ce contexte, les Cultural Studies constituent un apport important : Hall, qui a écrit plusieurs textes sur la politique de la recherche ou l’Université, disait d’ailleurs très clairement que « l’Université doit être une institution critique, ou alors elle n’est rien ». Enfin, quant aux raisons pour lesquelles les Cultural Studies ont mis tant de temps à être importées en France, elles sont nombreuses, au regard des multiples causes de dissension et de résistances. On peut d’abord compter le refus de faire rentrer le point de vue des minorités dans la recherche, au nom du sacro-saint universalisme républicain et d’une « neutralité axiologique » transformée en instrument de délégitimation de la pensée critique. Il n’est qu’à voir combien de temps il a fallu, en France, pour que les études de genre et les théories féministes, puissent bénéficier d’une certaine assise institutionnelle. Il y a, ensuite, une sorte de provincialisme français, qui touche aussi bien le monde universitaire que celui de l’édition : peu de traductions et un monolinguisme scientifique affiché fièrement. Enfin, on peut relever la persistance d’une conception légitimiste de la culture et la disqualification de travaux portant sur des objets « sales » ou « indignes » – si les barrières sanitaires autour des objets se déplacent, plus ou moins selon les disciplines d’ailleurs, il n’en reste pas moins qu’elles continuent à exister.
Vous dites (p. 33) que dans les années 1980 s’amorce un large mouvement d’internationalisation des Cultural Studies, en particulier vers les États-Unis. S’agit-il d’un courant endogène des Cultural Studies aux États-Unis, ou plutôt un infléchissement de la conceptualisation marxisante de la première vague britannique vers une politique identitaire (études féministes, queer, postcoloniales, etc.) ? Continuité ou rupture, et dans quelle proportion ?
C’est-là une question récurrente dans le débat français, l’idée que les Cultural Studies auraient pris cette mauvaise manie états-unienne que serait la politique des identités, une fois débarquées là-bas. Mais la politique identitaire était en fait déjà dans leurs bagages lorsqu’elles ont fait la traversée. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs on ne retrouve pas cette question dans l’historiographie des Cultural Studies en langue anglaise. L’émergence d’une politique identitaire au sein des Cultural Studies britanniques s’explique simplement, si l’on considère l’organisation même du travail intellectuel au sein du Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. En 1968, une large mobilisation étudiante émerge au sein de l’université de Birmingham ; les membres du Centre de Birmingham (enseignants comme étudiants) y sont très représentés, voire sont pour certains des têtes de file de la mobilisation. Elle revendique notamment une plus grande participation du corps estudiantin aux instances décisionnaires de l’université. Cette mobilisation va participer d’une radicalisation politique du Centre, d’autant qu’en parallèle, sur le plan scientifique, Marx et Engels y font une percée dans les travaux. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Centre n’est pas, durant les premières années, particulièrement inspiré par le marxisme [7]. Richard Hoggart, qui a fondé le Centre, était loin d’être un marxiste convaincu, et se positionnait plutôt au centre gauche. Stuart Hall, à ce moment-là, tentait quant à lui de ré-élaborer une théorie de la culture, non à partir du marxisme per se, mais à partir de ses points aveugles, de ses failles et de ses non-dits. C’est un point sur lequel il revient souvent d’ailleurs dans ses réflexions rétrospectives, le fait que dans une certaine mesure, avant de se construire avec le marxisme, les Cultural Studies se sont construites contre lui.
Dans les années après 1968, Hoggart se sent de plus en plus mal à l’aise dans le Centre, comme il le raconte dans le troisième volume de son autobiographie [8], alors qu’il est quotidiennement confronté à une hostilité politique cinglante. Il laisse donc les rênes à Stuart Hall, d’abord informellement, puis officiellement à partir de 1971. Dès ce moment, Hall décide – conformément à l’esprit de la mobilisation de 1968 – de permettre aux étudiant•e•s de dicter les orientations et les moyens du Centre, en formant spontanément des groupes de recherche et de pilotage de la recherche (les sub-groups). Se met donc en place, au sein d’une université plutôt conservatrice, une sorte d’enclave expérimentale. Là, sous l’impulsion des doctorant•e•s se dessinent alors d’autres manières, nombreuses, de pratiquer les Cultural Studies. Les premiers sub-groups qui apparaissent sont aujourd’hui les plus connus : le subculture group, le media group, etc. Mais très rapidement, les groupes qui émergent reflètent les engagements des étudiants et les dynamiques politiques alors en cours dans le pays. On voit apparaître tout au long des années 1970 le sexual politics group, le women’s studies group, le women and fascism group, le groupe Race and Politics, puis le groupe non mixte Black Caucus, plus tardivement un groupe de Irish Studies, etc. Le marxisme hétérodoxe du Centre n’a en fait jamais été complètement dissocié de la politique identitaire. Les deux se sont déployés de façon quasiment conjointe. À tel point que certains historiens considèrent le Centre de Birmingham comme un terrain particulièrement fertile pour penser cette reconfiguration de la gauche en Grande-Bretagne. Kieran Connell et Matthew Hilton écrivent par exemple : « L’histoire du Centre dans la conjoncture post-1968 permet de raconter le lien entre la création de la New Left Review (dont Hall fut le premier rédacteur en chef) et l’émergence de la politique identitaire dans la Grande-Bretagne des années 1970 et 1980 »[9].
Il ne s’agit donc pas tant de savoir en quoi, ou à quels moments, marxisme et politique identitaire s’opposent, mais plutôt quel type de marxisme a pu, au sein du Centre, autoriser ce mode politique là. En l’occurrence, la centralité de Gramsci et d’Althusser dans les travaux des années 1970, puis d’Ernesto Laclau (qui lui-même propose une forme de synthèse entre ces deux auteurs) a été extrêmement importante dans ce processus. Pour le dire dans les termes de Laclau et Mouffe [10], une certaine lecture de ces deux auteurs a permis : d’abord, de comprendre la formation sociale comme « indéterminée » ; ensuite, de considérer les antagonismes comme le produit d’un processus politique, donc toujours déjà discursif, et non comme cristallisés autour d’intérêts « objectifs » qu’il suffirait de révéler ; enfin, de refuser le modèle « mécaniste » de la détermination de la superstructure par la base, pour penser des formes de détermination multiples, relâchant ainsi l’emprise du réductionnisme économique. Pour toutes ces raisons, Gramsci et Althusser sont souvent des auteurs de référence dans les théories féministes ou antiracistes anglophones – pensons par exemple à l’importance d’Althusser (en particulier sa notion de « procès sans sujet ») dans la théorisation de Judith Butler [11]. Et au sein même du Centre, leur lecture a été l’une des voies d’hybridation du marxisme par inclusion de la politique identitaire : pensons aux écrits de Hall sur la race [12], qui se déploient à partir d’un cadre d’analyse gramscien, ou à l’ouvrage Women Take Issue où Althusser est extrêmement présent [13]. Il y a donc – dans les premiers temps au moins – non pas rupture, mais continuité entre les cultural studies britanniques et états-uniennes.
D’ailleurs, le chercheur américain Lawrence Grossberg, qui s’est temporairement exilé en Grande-Bretagne et a fait un passage par le Centre à la fin des années 1960 pour échapper à la conscription et donc à la Guerre du Vietnam, a joué un rôle important dans ce processus. Il a été un passeur entre les deux continents, assurant une véritable continuité. Lors du colloque fêtant les 50 ans du CCCS, qui a eu lieu en 2014 à l’Université de Birmingham, Becky Conekin a suscité l’approbation et l’hilarité générale en parlant des deux ouvrages codirigés par Grossberg à la fin des années 1980 au début des années 1990 comme l’Ancien (Marxism and the Interpretation of Culture)[14] et le Nouveau Testament (Cultural Studies)[15]. Et « l’Ancien testament » comportait déjà son lot de textes féministes (Catherine McKinnon, Christine Delphy), postcoloniaux (Gayatri Chakravorty Spivak), antiracistes (Cornell West) ou postmarxistes (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe). Ces deux ouvrages ont joué un rôle majeur, non seulement dans l’importation du domaine aux États-Unis, mais également dans sa redéfinition en Grande-Bretagne, alors que le mouvement d’institutionnalisation s’amplifiait. Si l’on devait toutefois caractériser la spécificité des Cultural Studies états-uniennes, on peut dire que le phénomène de démultiplication des paradigmes – qui accompagne la traduction scientifique de la politique identitaire – a été croissant. C’est une différence quantitative, d’une certaine façon, plus que qualitative, même si, bien sûr, dans l’immense masse de travaux qui ont été conduits sous la bannière des Cultural Studies internationales, il est des travaux non critiques ou politiquement insignifiants.
Une autre façon de comprendre la différence entre les premières et deuxièmes vagues des Cultural Studies est l’abandon progressif du matérialisme culturel des fondateurs (Williams, Hall), influencé par la tradition littéraire, puis par la sémiologie (Dick Hebdige, Judith Williamson) vers l’accent mis sur la réception, et la valorisation de la consommation « active » (Ien Ang, Andrew Ross, John Fiske). Dans le cas du dernier, on a parlé de « populisme culturel », tant la dimension critique semble absente. Que pensez-vous de ce tournant ethnographique, traité de « circulaire et narcissique » par la critique australienne Meaghan Morris ?
On a souvent réduit en France les Cultural Studies aux travaux effectués sur les médias et la réception, oubliant parfois de regarder le large tableau dans lequel ces derniers s’insèrent. Dans les années 1980, l’étude des médias et de la réception occupe une place importante au sein du CCCS. Elle intervient dans un contexte d’arrivée de la télévision dans un grand nombre de foyers et de premier âge d’or des séries télévisées au succès international, à l’instar de Dallas. Le tournant ethnographique de la réception va toutefois bien au-delà du CCCS et des seules Cultural Studies, les travaux fondateurs sur la réception culturelle de Dallas par Elihu Katz et Tamar Liebes ne pouvant pas à proprement parlé être qualifiés de Cultural Studies. Reste que l’on peut voir dans la conception de la culture populaire par Stuart Hall un des points de départ de ce tournant. Les gens ne sont pas des « idiots culturels » défend-il, renvoyant dos à dos l’école empirique de la sociologie américaine, à savoir la sociologie fonctionnaliste de Paul Lazarsfeld, et la théorie de l’industrie culturelle de l’École de Francfort. À la première, il reproche une vision normative de la société et une conception fonctionnaliste des médias. Celle-ci, nous dit-il, confond polysémie et pluralisme, oubliant d’interroger le sens des messages et l’activité de réception au-delà de la seule satisfaction d’un besoin : par leur pluralité intrinsèque, les médias en démocratie viendraient satisfaire la pluralité des points de vue nécessaire au bon fonctionnement de la société [16]. Autrement dit, les médias occuperaient un rôle de garant de l’ordre social, plutôt qu’ils ne seraient un lieu de conflictualité idéologique. À la seconde, Hall reproche une conception de « l’industrie culturelle » en tant qu’« agent de la tromperie de masse » et une approche parfois simplificatrice de l’audience [17]. Pour prendre le contrepied de ces « théories spéculatives », les cultural studies se sont donc attachées à déployer un arsenal empirique visant à saisir la réception comme une activité de production de sens, au travers du développement de méthodes ethnographiques, basées sur l’observation des pratiques de visionnage et d’entretiens approfondis avec les publics.
Toute la question que pose l’approche ethnographique, au-delà des méthodes, est la relation du texte/lecteur et le pouvoir d’imposition du texte. La position de Hall et, à sa suite, de David Morley qui conduit, avec Charlotte Brunsdon, la première grande étude empirique sur la réception de l’émission (d’actualités et de débat politique) Nationwide [18], traduit une sorte de compromis entre le pouvoir structurant du texte et l’autonomie des récepteurs. Hall s’est ouvertement opposé aux approches psychanalytiques et à une interprétation structuraliste de la réception à l’œuvre dans les études cinématographiques, qui consisteraient à voir dans le texte une position déterminée du sujet-lecteur ou spectateur (c’était, en particulier, la position de l’influente revue Screen). À l’inverse, Hall défend une forme d’indétermination du décodage à la réception, sans pour autant négliger les régularités dans les interprétations. Dans le fameux texte « Codage/Décodage » [19], cela se traduit par la dissonance entre le sens premier investi par les producteurs au moment du codage et la « structure de sens 2 » qui émerge lors du décodage par les récepteurs. Le succès d’une telle proposition relève du fait qu’elle permet d’envisager des formes de négociation et de résistance aux lectures hégémoniques des messages médiatiques à la réception. David Morley quant à lui pousse encore plus loin la réflexion, en tentant de spécifier les endroits d’articulation entre le texte et le lecteur, notamment dans les modes lecture négociée et oppositionnelle : il y aurait selon lui une différence entre une opposition à la « problématique idéologique » d’un programme et celle afférente au mode d’adresse [20]. Mais surtout, Morley, dès les travaux sur Nationwide, insiste sur les déterminants sociaux de la réception : chacun réagit à un programme en fonction d’une position située dans l’espace social et politique, et celle est définie aussi bien par les rapports de classe que par les rapports de genre et de race.
Ces travaux initient un large débat autour du pouvoir d’interprétation des publics, de leurs investissements et de leur autonomie. Pourtant, si l’ethnographie porte bien sur les activités et pratiques des publics, elle n’en néglige pas pour autant le rôle des producteurs. Chez Hall, il existe bien un rapport de pouvoir en faveur de producteurs qui opèrent depuis des industries culturelles au fonctionnement complexe, mais qui manient à la perfection le sens commun. Morley défend quant à lui un modèle texte-lecteur dans lequel des « clôtures textuelles » persistent, donnant lieu à autant de « lectures préférentielles ». Les régularités qui apparaissent à la réception sont alors tout à la fois le fait de textes porteurs d’un sens dominant qui agit même s’il ne s’impose pas nécessairement, et celui des rapports sociaux qui organisent la réception. C’est toutefois là une pierre d’achoppement lorsque l’on se tourne vers John Fiske, accusé de réhabiliter une conception très libérale de la réception à travers sa notion de « démocratie sémiotique » [21]. Celle-ci amène à envisager la possibilité pour les récepteurs de construire leurs significations propres, à même de contredire les lectures hégémoniques du texte. Cette approche n’est pas sans avoir suscité de débats au sein même des Cultural Studies, des débats qui ont d’ailleurs souvent amené des interprétations excessives du propos de Fiske. On oublie souvent en effet que Fiske, en s’appuyant sur le modèle de Hall et les mythologies de Barthes, accorde une puissance sémiotique aux images. Les médias encodent des idéologies, manifestent des valeurs et participent de la circulation de significations culturelles. Mais cette puissance sémiotique n’opère pas de façon systématique : tout dépend de l’ouverture sémiotique du texte et de l’activité de lecture des publics.
Là où Fiske s’est sans doute trop emballé, c’est dans sa perception de phénomènes tels que le développement de chaînes comme MTV ou encore des séries télévisées [22]. Sensible aux théories postmodernes, particulièrement prégnantes dans les années 1980-90, il a vu dans la multiplication des images et leur fragmentation une polysémie qui déléguerait aux publics la production du sens, aux moyens d’appropriations situées et de lectures autonomes. Si cet élan fiskéen a eu pour avantage d’insister sur le rôle premier des publics dans la fabrication du sens, il semble bien avoir peu à peu étouffé, dans ses écrits, les formes de détermination par le texte même. Fiske rappelle pourtant à plusieurs endroits les dimensions ambivalentes de cette fragmentation, qui donne une « illusion de liberté » là où en réalité, elle sert la mécanique capitalistique. Enfin, au-delà du cas des travaux de John Fiske, il ne faut pas oublier que le débat que vous soulevez a fait rage au sein même des Cultural Studies : on a même parlé, pour qualifier la volonté de sortir d’un prisme de la réception accordant une importance trop grande à l’activité des publics, d’un tournant « antipopuliste » au sein du domaine [23].
Dans quelle mesure peut-on parler dans le cas des Cultural Studies d’une discipline (ou d’une interdiscipline ou d’une quasi-discipline) ? Dans son célèbre commentaire critique, Fredric Jameson parle d’affinités avec l’historiographie, et davantage avec la sociologie, voire l’anthropologie. Comme dans le cas de ces dernières, le champ est marqué par la tension entre approches théoriques et « textuelles » d’une part, et ethnographiques et empiriques de l’autre. On sait qu’en France la discipline établie des sciences de l’information et de la communication, écartelée et en crise, est désormais de plus en plus réticente à intégrer les Cultural Studies dans son champ, alors que dans les années 1980, cela posait moins de problèmes, d’expérience personnelle. Où situez-vous les Cultural Studies actuellement en termes disciplinaires ? Quelles sont ses potentielles disciplines alliées ?
La caractéristique des Cultural Studies est de refuser les logiques d’enfermement disciplinaire, notamment en défendant une démarche réflexive à l’égard des logiques d’unification et d’uniformisation des savoirs et modes d’élaboration du savoir. Ce refus de la disciplinarité se manifeste dès l’École de Birmingham. Aussi Stuart Hall, retraçant la critique des Cultural Studies à l’égard des disciplines constituées des sciences humaines et sociales, défend-il l’idée d’une interdisciplinarité qui ne serait pas tant « une coalition de collègues venus de différents départements », qu’une opération de déplacement et de décentrement permanent par rapport aux traditions de pensée et paradigmes fondateurs [24]. Cette réflexivité par rapport aux logiques disciplinaires s’est toutefois trouvée mise à mal par le développement à l’échelle internationale. Très vite a émergé une question cruciale : la production d’une « unité » ou d’une cohérence d’approche est-elle nécessaire à l’expansion du domaine ? Face à la montée en force de l’appellation Cultural Studies, certains auteurs à l’instar de Lawrence Grossberg et d’Ien Ang n’ont eu de cesse de rappeler l’opposition constitutive à toute prétention à l’universalité et la voie tracée par l’interdisciplinarité pour contrer les logiques d’unification [25]. L’accent est ici mis sur la nécessité de privilégier des analyses multidimensionnelles, de penser la détermination multiple des phénomènes. Plus encore, ce refus des disciplines est posé comme un fondement épistémologique : s’appuyant sur le primat du contexte et de la conjoncture, la démarche Cultural Studies requiert de mettre les théories et méthodes à l’épreuve des nouvelles pratiques, des nouveaux contextes historiques, de nouveaux rythmes, de nouvelles textures de la vie sociale… Ce qui apparaît comme une invitation permanente à transcender les barrières disciplinaires telles que pratiquées dans les institutions. Bien entendu, une telle démarche n’est pas nécessairement facile à réaliser, étant considérées les logiques institutionnelles à l’œuvre, qui tendent à la constitution et au renforcement de disciplines unifiées.
En France, il semble que les Cultural Studies se soient développées sur les terrains les plus favorables à son a-disciplinarité : elles occupent ainsi depuis une quinzaine d’années l’espace des sciences de l’information et de la communication, elles-mêmes relativement indisciplinées et interdisciplinaires, et s’articulent de façon privilégiée à certains objets – des musiques populaires aux séries télévisées en passant par les fans ou encore les pratiques de réception [26]. Elles traversent également le champ des études cinématographiques, qui ont vu se développer des travaux sur le cinéma populaire, les stars, le cinéma de genre [27]. Au-delà des objets, les approches en Cultural Studies opèrent au sein de ces disciplines des déplacements épistémologiques : il s’agit au travers de l’étude d’objets souvent déconsidérés, d’insister sur les rapports de race, classe, genre, et la façon dont ils organisent l’espace des représentations et des pratiques. Elles ouvrent parfois des espaces de contestation, se construisant en opposition à certaines approches établies, à l’instar des approches esthétiques du cinéma ou de la sociologie bourdieusienne des pratiques culturelles, en même temps qu’elles œuvrent à des rapprochements sur le terrain méthodologique : s’inspirant de la sociologie, de la sémiotique, des approches sémio-discursives, de l’ethnographie… Au sein de ces deux disciplines, plus qu’à une fermeture, les Cultural Studies se trouvent aujourd’hui face à un mouvement contradictoire, fait de backlash et de possibilités d’expansion. Il semble en tout cas en aller ainsi du côté des sciences de l’information et de la communication, section dans laquelle les postes ont déserté le terrain de l’étude des médias, de la musique, de la culture populaire, pour privilégier des intitulés génériques, les humanités numériques ou encore l’info-doc. Et pourtant, on ne saurait ignorer le nombre croissant, depuis une dizaine d’années de doctorant.e.s / docteur.e.s revendiquant une familiarité voire une affiliation aux Cultural Studies, certain.e.s ayant aujourd’hui une position de maître de conférences ou de professeur•e•s. Autrement dit, le renouvellement des équipes, la recomposition générationnelle, accompagnent une présence de plus en plus marquée des Cultural Studies au sein des axes des laboratoires de recherche et des enseignements. Ce déplacement par les pratiques est également sensible dans d’autres disciplines : en études anglophones ou germaniques, en lettres, en philosophie ou encore en science politique, les ramifications et articulations avec les Cultural Studies existent, souvent portées par un petit nombre de personnes qui participent à faire advenir ces dernières, parfois en déplaçant les paradigmes institués des disciplines concernées.
Que pensez-vous de l’affirmation de Jameson que, dans son versant américain où « le matérialisme culturel » cher à Williams tend à disparaître, les Cultural Studies sont devenues un « substitut » pour le marxisme ?
Jameson écrit cela en 1993, et son discours est à situer dans les querelles intellectuelles qui traversent alors le domaine de l’étude de la communication et des phénomènes culturels. Les années 1990 sont en effet marquées par une sorte de conflit entre, d’un côté, l’économie politique de la communication, qui revendique une approche marxiste de la production, et les Cultural Studies, dont le déploiement aux États-Unis marque un moment de refonte épistémologique, avec le tournant linguistique, mais aussi l’appropriation par certains chercheurs des théories du postmodernisme. Ce débat a notamment donné lieu à l’échange qui opposa en 1995 Nicholas Garnham et Lawrence Grossberg dans la revue Critical Studies in Mass Communication [28]. À la suite de ce débat, on a souvent dit, et Garnham le premier, que les Cultural Studies avaient remporté une bataille : au-delà de leur omniprésence institutionnelle, elles ont été le réceptacle privilégié des théories poststructuralistes, notamment à l’œuvre au sein des approches féministes et queer, qui ont clairement dominé la période des années 1990. Il semble par conséquent que le diagnostic de Jameson rend compte de ce moment bien spécifique, lors duquel les tenants de l’économie politique et des approches critiques ont pu se croire dépassés par le développement des Cultural Studies. À cela néanmoins, on peut, avec le recul, objecter qu’il s’agissait sans doute d’une lecture quelque peu simplificatrice de la complexité des déplacements disciplinaires en cours, traduisant davantage une forme d’angoisse face à l’émergence de nouveaux paradigmes. Il n’est pas de notre ressort de retracer le déploiement institutionnel et disciplinaire du marxisme ou des approches critiques, aux États-Unis de surcroît, mais il est possible de douter de la disparition complète de ces dernières au profit des Cultural Studies. Les Cultural Studies n’auraient d’ailleurs aucun intérêt à voir décliner le marxisme, avec lequel elles sont en perpétuel dialogue. Pour nous qui défendons davantage l’existence d’un lien intrinsèque, mais non exclusif, entre le marxisme et les Cultural Studies, il semble difficile de ne voir dans les Cultural Studies qu’un « substitut » au marxisme. S’il est certain que les Cultural Studies ont opéré des déplacements par rapport à une certaine lecture marxiste de la culture, elles sont aussi un lieu de renouvellement des approches critiques. Tout cela invite à ne pas cristalliser les oppositions entre d’un côté les Cultural Studies, de l’autre, l’économie politique de la communication, et à repenser les points de convergence et les liens historiques et épistémologiques. Pour le dire de manière beaucoup plus triviale, les Cultural Studies et l’économie politique semblent bien se nourrir du même jus, même si elles ne le digèrent pas de la même manière. Sans doute donc peuvent-elles également se nourrir mutuellement, et c’est notamment à cela qu’œuvrent des initiatives récentes de publications en France [29].
La première génération des Cultural Studies tendait vers un marxisme hétérodoxe, indépendant, bref, gramscien, d’où la remarque mélancolique de Stuart Hall que « nous étions des intellectuels organiques sans point de référence organique », c’est-à-dire sans relais sociaux. Lors du congrès fondateur des cultural studies « américaines » en 1992, Ian Hunter a parlé de l’absence de relais des Cultural Studies en dehors des facultés d’humanités, les institutions et agences ayant « leurs propres intellectuels ». Quelle serait la portée, actuelle ou à construire, des cultural studies en dehors de l’Université, où l’esprit critique est de moins en moins bienvenu ?
Il n’est pas si certain que les Cultural Studies britanniques n’aient pas bénéficié de relais sociaux – en tout cas, ce n’était pas le cas du Centre for Contemporary Cultural Studies. Le CCCS a beaucoup réfléchi à la manière d’envisager les relations entre les mondes universitaires et militants. De nombreux membres du Centre entretenaient des liens étroits avec diverses organisations militantes : des partis, des syndicats ou des mouvements moins formels tel que Rock against racism. C’est d’ailleurs sans doute cette prolifération de points de référence organiques, plutôt que leur absence, qui a constitué une difficulté pour le Centre [30]. Comment construire une voie théorique critique cohérente – c’est-à-dire porteuse d’un véritable projet hégémonique – face à cette diversité presque baroque des engagements et sensibilités politiques ? Pour répondre à cette interrogation cruciale, le Centre a d’ailleurs tenté plusieurs choses, sous la direction de Stuart Hall. Il a mis en place un groupe de travail nommé « Axis/Praxis », qui devait formaliser les relations du CCCS avec différentes instances de la gauche, tandis que le groupe « Priorities » était, comme son nom l’indique, chargé de définir les priorités du Centre [31]. Ces priorités étaient indissociablement politiques et théoriques, comme par exemple lorsqu’en octobre 1977 le groupe annonce que la priorité du Centre doit être le féminisme marxiste [32], cela en lien avec le bouillonnement scientifique d’alors, mais aussi avec les fractions marxistes du mouvement de masse féministe. Les Cultural Studies telles qu’elles se pratiquaient à Birmingham ne se sont toutefois jamais pleinement stabilisées sur le plan politique, et cette instabilité, cette ouverture à l’émergence constante de nouveaux mouvements et de nouveaux plans de revendication, en est même venu à les caractériser [33]. Et bien sûr, cela n’a pas été sans susciter de fortes tensions au sein même de ce collectif critique qu’était le CCCS. On peut regretter cette absence de focalisation qui, à l’évidence, a pu limiter la portée des Cultural Studies hors les murs de l’Université.
Mais on peut aussi penser que ce refus de clore définitivement le champ d’intervention, voire la définition même des Cultural Studies, est aussi ce qui leur a permis, très tôt, de complexifier l’antagonisme de classe et de se connecter à des mobilisations qu’une large partie de la gauche universitaire tendait alors à ignorer : les mouvements féministes, d’abord, mais aussi les mouvements antifascistes, antiracistes, décoloniaux. Pour le meilleur ou pour le pire, cette tendance à l’indéfinition – ou à la plasticité politique – fait désormais parti de l’ADN des Cultural Studies. D’où le fait que le domaine s’engage, à un rythme effréné dans des « tournants » qui font simultanément émerger de nouveaux objets et de nouveaux clivages politiques : de la politisation du handicap aux revendications antispécistes en passant par la critique queer du binarisme sexué. Peut-être attendons-nous parfois trop des cultural studies, peut-être que leur portée réside précisément dans leur capacité à accompagner l’apparition de perspectives politiques nouvelles et, ainsi, à participer de l’institutionnalisation de points de vue subalternes. Il est donc difficile de répondre à la question des relations à construire entre un domaine de recherche international aussi foisonnant que les cultural studies et le dehors de l’Université. Et effectivement, on peut se demander de quoi les chercheuses et chercheurs en cultural studies seraient les « intellectuel•le•s organiques ». Ce qu’on peut dire, en revanche, à partir du contexte français, c’est que le processus actuellement en cours de traduction et réception des cultural studies participe sans doute d’un mouvement de fond, qui va dans le sens d’une pensée articulée des rapports de classe, de genre, de race et de sexualité ; de renouveau de la critique de l’universalisme républicain (comme aveuglement aux différents fronts de conflictualité sociale) ; et de critique de la disciplinarisation des savoirs [34].
Maxime Cervulle est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et membre du Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (EA 3388 CEMTI). Il est l’auteur de Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias (Éditions Amsterdam, 2013) et le coauteur de Homo exoticus. Race, classe et critique queer (Armand Colin et INA, 2010).
Nelly Quemener est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et membre du laboratoire Communication, Information, Médias (EA 1484 CIM), équipe Médias, Cultures et Pratiques Numériques (MCPN). Elle a notamment publié Le Pouvoir de l’humour. Politique des représentations dans les médias en France (Armand Colin, 2013).
Notes
1. Armand Mattelart, Érik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, 2003.
2. David Hesmondhalgh, « Industries culturelles et cultural studies (anglophones) » [2005], in Hervé Glévarec, Éric Macé, Éric Maigret (dir.), Cultural Studies – Anthologie, Paris, Armand Colin – INA, 2008, p. 275-294.
3. Henry Jenkins, La culture de la convergence. Des médias au transmédia, trad. de C. Jaquet, Armand Colin, 2013 [2006].
4. Voir Matt Hill, « Fiske’s ‘textual productivity’ and digital fandom : Web 2.0 democratization versus fan distinction? », Participations. Journal of Audience and Reception Studies, vol. 10, n°1, 2013, p. 130-153.
5. Stuart Hall, « Cultural Studies : deux paradigmes » [1980], in Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies, éd. établie par Maxime Cervulle, trad. de C. Jaquet, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 81-104.
6. Voir notamment Lawrence Grossberg, Cultural Studies in the Future Tense, Durham, Duke University Press, 2010.
7. Voir ce qu’en dit Colin Sparks, « Stuart Hall : les Cultural Studies et le marxisme » [1992], trad. de A. Blanchard, in Maxime Cervulle, Nelly Quemener et Florian Vörös (dir.), Matérialismes, culture et communication. Tome 2. Cultural Studies, théories féministes et décoloniales, Paris, Presses des Mines, 2016, à paraître.
8. Richard Hoggart, « An Imagined Life », in A Measured Life. The Times and Places of an Orphaned Intellectual, Transaction Publishers, Londres, 1994.
9. Kieran Connell et Matthew Hilton, « The Working Practices of Birmingham’s Centre for Contemporary Cultural Studies », Social History, vol. 40, n° 3, 2015, p. 291.
10. Ernesto Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism, Populism, Londres, NLB, 1977 ; Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une politique démocratique radicale, trad. de J. Abriel, Paris, Les Solitaires Intempestifs, 2009 [1985].
11. Voir Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, trad. de C. Kraus, Paris, La Découverte, 2006 [1990] et La Vie psychique du pouvoir : l’assujettissement en théories, trad. de B. Matthieussent, Paris, Léo Scheer, 2002 [1997].
12. Stuart Hall, « La pertinence de Gramsci pour l’étude de la race et de l’ethnicité » [1986], in Identités et cultures 2. Politiques des différences, éd. établie par Maxime Cervulle, trad. de A. Blanchard et F. Vörös, Paris, Éditions Amsterdam, 2013, p. 179-222.
13. Centre for Contemporary Cultural Studies, Women Take Issue. Aspects of Women Subordination, Londres, Hutchinson, 1978.
14. Lawrence Grossberg et Cary Nelson (dir.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 1988.
15. Lawrence Grossberg, Cary Nelson et Paula Trichler, Cultural Studies, Londres et New York, Routledge, 1992.
16. Stuart Hall, « La redécouverte de l’‘‘idéologie’’ : retour du refoulé dans les Media Studies » [1982], in Identités et Cultures, op. cit., p. 129-168.
17. Stuart Hall, « La déconstruction du ‘‘populaire’’ » [1981], in Identités et Cultures, op. cit., p. 120.
18. Charlotte Brunsdon et David Morley, Everyday Television : « Nationwide », Londres, British Film Institute, 1978. Nationwide fut diffusé tous les jours sur la chaîne BBC1 entre 1969 et 1983.
19. Stuart Hall, « Codage/décodage » [1973], trad. de M. Alberet et M.-C. Gamberini, Réseaux, vol. 12, n°68, 1994, p. 27-39.
20. David Morley, « La réception des travaux sur la réception. Retour sur ‘‘Le Public de Nationwide’’ », trad. de D. Dayan, Hermès, n°11-12, 1992, p. 31-46.
21. John Fiske, « Moments de télévision : ni le texte ni le public » [1989], trad. de C. Jaquet, in Cultural Studies. Anthologie, op. cit., p. 190-210.
22. John Fiske, « MTV : Post-Structural, post-Modern », Journal of Commmunication Inquiry, vol. 10, n°1, 1986, p. 74-79.
23. Voir par exemple Imre Szeman, « The Limits of Culture : The Frankfurt School and/for Cultural Studies », in Jeffrey T. Nealon et Caren Irr (dir.), Rethinking the Frankfurt School. Alternative Legacies of Cultural Critique, New York, State University of New York Press, 2002, p. 59-80.
24. Stuart Hall, « L’émergence des Cultural Studies et la crise des humanités » [1990], in Identités et Cultures, op. cit., p. 111.
25. Voir notamment Ien Ang, « Cultural Studies », in Tony Bennett, John Frow (dir.), The Sage Handbook of Cultural Analysis, Los Angeles, Londres, New Dehli, Singapour, Sage Publications, 2008, p. 227-248 ; Lawrence Grossberg, « The circulation of Cultural Studies », Critical Studies in Mass Communication, vol. 6, n°4, 1989, p. 413-421.
26. On peut citer les travaux de Gérôme Guibert, Florian Vörös, Sarah Lécossais, Marion Dalibert, Anne-Sophie Béliard, Marion Coville, etc.
27. Voir notamment les travaux de Geneviève Sellier, Raphaëlle Moine et Gwenaëlle Legras.
28. Voir Nicholas Garnham, « Political Economy and Cultural Studies : Reconciliation or Divorce ? », Critical Studies in Mass Communication, vol. 12, n°1, 1995, p. 62-71 ; Lawrence Grossberg, « Cultural Studies vs. Political Economy : Is Anybody Else Bored with this Debate ? », Critical Studies in Mass Communication, vol. 12, n°1, 1995, p. 72-81.
29. Voir notamment Éric Maigret, Franck Rebillard (dir.), « Cultural studies et économie politique de la communication », Réseaux, vol. 33, n° 192, 2015, ainsi que la série de trois volumes, intitulée Matérialismes, culture & communication, publiée aux Presses des Mines à l’initiative de Fabien Granjon, dont l’un des tomes porte sur les Cultural Studies.
30. Voir Kieran Connell et Matthew Hilton, « The Working Practices of Birmingham’s Centre for Contemporary Cultural Studies », Social History, vol. 40, n° 3, 2015, p. 287-311.
31. Voir Maxime Cervulle, « Le Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham : une pratique critique collective entre crises et contradictions », in Malek Bouyahia, Franck Freitas et Karima Ramdani (dir.), Encoder le réel, décoder le culturel : l’actualité de Stuart Hall, La Dispute, Paris, à paraître 2016.
32. Priorities Group, « Priorities for the Year », octobre 1977, cité dans Stuart Hall, Michael Green, Richard Johnson et Paul Willis, « On Contradictions », document polycopié, janvier 1979 (Archives du CCCS, Cadbury Research Library, University of Birmingham, Papers of Hazel Chowcat (née Downing)).
33. Stuart Hall, « Les Cultural Studies et leurs fondements théoriques » [1992], in Identités et cultures, op. cit., p. 17-32
34. Voir sur la façon dont les Cultural Studies troublent les disciplines établies, voir par exemple les articles du dossier de la revue SociologieS, consacré au thème « Sociétés en mouvement, sociologie en changement » (sous la direction de Jean-Louis Genard et Marta Roca i Escoda, 2016). Pour nombre d’auteur•e•s, elles occupent, au côté d’autres studies avec lesquelles elles partagent des fondements épistémologiques commun, une place de choix dans la redéfinition en cours de la sociologie, de ses objets et de ses paradigmes.


Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)