Les « cultural studies » : un entretien avec Toby MILLER
Toby Miller (né en 1958) est un universitaire britanno-australien très influent dans le champ anglo-saxon des cultural studies et des media studies. Il est l’auteur d’environ quarante livres, seul ou collectivement (traduits en plusieurs langues : le chinois, le japonais, l’espagnol, l’allemand, le portugais etc., mais non le français), notamment Global Hollywood et Global Hollywood 2, devenus des classiques de l’économie politique du cinéma*. On lui doit aussi plusieurs livres d’anthologie et d’introduction, comme A Companion to Cultural Studies (Blackwell, 2e édition, 2006) et Television Studies : The Basics (Routledge, 2010). Depuis sa thèse de doctorat à Murdoch University (Perth, Australie) en 1991, il a occupé des postes universitaires (parfois simultanément) à New South Wales University (Sydney), à Griffith University (Brisbane), à Murdoch University (Perth), à New York University, à l’Université de Californie à Riverdale, à l’Université de Cardiff, et à l’Universidad del Norte (Barranquilla, Colombie, comme professeur invité). Il est actuellement professeur en graduate studies à Loughborough University (antenne à Londres).
Cet entretien avec le philosophe Nigel Warburton vient d’une série de podcasts Social Science Bites (accès libre), et date du 3 décembre 2012 ; la transcription est disponible en ligne ici. Le texte a été traduit par moi et validé par Toby Miller (David Buxton).
*Ces deux livres (fortement recommandés) sont consultables à la Bibliothèque François Truffaut (Forum des Halles, Paris). Site de Toby Miller : https://www.tobymiller.org/cv-spanish/
Nigel Warburton : Pourriez-vous expliquer ce que vous faites et en quoi cela relève des « cultural studies » ?
Toby Miller : Je pense que la définition des cultural studies n’est jamais fixe, et dépend de l’époque et du lieu où on pose la question. On pourrait dire la même chose à propos d’autres disciplines alors qu’elles interagissent et fusionnent à travers le temps, s’enchaînent et se trament. J’essaie d’analyser deux aspects particuliers de la vie culturelle de tous les jours. D’abord, la subjectivité : par cela, je ne me réfère pas simplement aux opinions personnelles, mais plutôt à la fabrication du sujet, à la construction de la personne, à la génération des points de vue, etc. C’est quelque chose que, par exemple, un recensement, une mère, ou une affiliation religieuse dit d’un individu. Ensuite, le pouvoir : comment les sujets sont-ils construits en termes de diverses dynamiques de pouvoir, de hiérarchies, et de possibilités de différence et de contestation.
NW : Pour moi, l’idée d’une relation entre le soi et la société ressemble à la sociologie.
TM : Il est vrai que je suis un sociologue manqué ! Ma carrière s’est déroulée entre l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Amérique latine, et par conséquent je suis ouvert à des genres différents de sociologie. Celui qui me sied le plus, c’est la forme qualitative, culturaliste et ouvertement politique qu’on trouve en Amérique latine, et moins la forme quantitative, statistique qui domine aux États-Unis.

NW : Pourriez-vous donner un exemple de quelque chose qui relève des cultural studies ? En quoi est-ce « culturel » ?
TM : Par « culture », la plupart de gens dans le champ veulent dire deux choses. D’abord, ce qui est souvent pensé en termes d’un legs esthétique ou d’un patrimoine, à savoir le monde des arts, le monde de la signification, le monde de la textualité, le monde des contenus. La façon dont les artistes, les auteurs, les producteurs génèrent des objets de beauté, de vérité, si vous voulez [1] – c’est ce que l’on comprend par « les Arts » ou « les Humanités ».
Ensuite, il existe une autre façon de comprendre la culture qui est plus ethnographique, peut-être même anthropologique. Cela touche à des manières de vivre coutumières : l’idée que la société est créée non seulement à travers des règles et des conventions formelles, mais aussi informelles : comment les routines quotidiennes sont organisées, et en ce moment, la façon dont vous et moi respectons – très poliment – les phrases de l’autre. Dans les cultural studies, tout cela interagit. Pour comprendre comment fonctionne l’art, il faut comprendre la vie quotidienne, et pour comprendre la vie quotidienne, il faut comprendre comment fonctionne l’art. Cela est spécialement vrai dans des sociétés post-industrialisées, ou en voie de désindustrialisation, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. De plus en plus dans ces pays, ce sont plutôt la culture, les idées, les significations, les assurances, les droits et les médias qui font l’objet de transactions économiques, et moins l’agriculture, l’industrie ou les mines.

Dans les livres Global Hollywood (2001) et Global Hollywood 2 (2005) que j’ai écrits avec des collaboratrices et collaborateurs provenant de la Chine, de l’Inde, de l’Espagne et des États-Unis, nous avons cherché à comprendre le succès de Hollywood comme industrie mondiale, dans des contextes très divers. Nous avons pris en compte trois aspects.
Premièrement, l’économie politique à la base de cela – autrement dit, qui en tire les bénéfices ? Comment l’argent y circule-t-il ? Le succès de Hollywood s’explique-t-il non seulement par la supposée qualité de ses produits, mais également par sa capacité d’accéder à des subventions ? Je ne parle pas du crédit et des actions boursières, mais des gouvernements fous qui lui jettent de l’argent en pensant qu’il généra du glamour, du tourisme, ou du je ne sais quoi. À cet égard, on pourrait citer le Royaume-Uni, l’Australie et la Hongrie entre autres.
Deuxièmement, la signification de ces produits. Comment le succès de Hollywood se réalise-t-il à travers d’images, de sons, de récits et d’arcs dramatiques ? Quel est le sens créé par des effets spéciaux, alors que ceux-ci définissent la référence à Hollywood ?
Troisièmement, comment ces produits sont-ils interprétés ? Que savons-nous de la création du sens par les audiences ?
Autrement dit, ma façon d’intervenir dans les cultural studies essaie de combiner ces trois aspects : les questions de propriété, de contrôle et de régulation, etc. ; la génération du sens ; l’expérience de ces significations par des audiences.
NW : Il me semble que cela implique deux choses distinctes. Vous amassez des données empiriques sur Hollywood, ce qui est probablement assez objectif, mais en même temps vous racontez une histoire qui contient assurément un élément subjectif. Comment savez-vous que l’histoire que vous racontez sur Hollywood est plausible ?
TM : C’est une bonne question, car Hollywood en particulier est un lieu où énormément d’informations sont rendues publiques. On pourrait choisir de les accepter telles quelles. Mais franchement, on y trouve beaucoup de bullshit. Quand on lit la presse professionnelle, ou quand on visite les studios, on entend des histoires sur le grand succès d’un film comme, disons, Skyfall [dans la série des James Bond] – il a coûté tant, il a amassé tant au box-office, il généra tant dans ses futures fenêtres de distribution. Ces histoires sont souvent fabriquées de bout en bout. La seule façon d’avoir accès aux vrais chiffres, c’est lors d’une action en justice quand les livres sont ouverts devant le tribunal. Alors j’essaie d’exploiter autant que faire se peut les données « dures » concernant la circulation de l’argent. Mais certaines données sont fiables, et d’autres non.
Pour revenir à votre question, votre réserve se comprend. Je suis un écrivain polémique, et j’essaie de raconter des histoires qui attirent d’abord d’autres universitaires, et qui atteignent le niveau de rigueur attendu dans les disciplines concernées. Ensuite, je veux m’adresser aux professionnels impliqués dans le champ, et finalement aux citoyens intéressés par le sujet. Certains, quand ils lisent mes publications, disent « données empiriques très intéressantes, dommage que l’auteur soit si tendancieux ».
NW : Mais vous ne pensez pas que votre travail soit tendancieux ?
TM : Non. Mes engagements personnels, qu’ils soient politiques ou intellectuels, sont très importants pour mon travail, mais ils ne le structurent ni ne l’influencent d’une manière totalisante. Mon engagement global est d’essayer de découvrir la nature des choses et comment celles-ci opèrent. Cela implique souvent de dévoiler certains faits qui soient inconfortables pour ceux qui sont de l’autre bord. Par exemple, la plupart des gens pensent que Hollywood est une entreprise privée qui exemplifie la grandeur du capitalisme à l’américaine, à savoir laisser faire les entrepreneurs sans intervention étatique. Cela n’est simplement pas vrai. Comme d’autres chercheurs, j’ai infirmé cela maintes fois. Il reste beaucoup de gens qui disent « vous êtes socialiste, vous trouvez ce que vous cherchez ». Mais mes opinions politiques n’interfèrent pas avec le matériel empirique que je découvre.
NW : Comment pouvez-vous en être sûr ?
TM : Je me fais lire par d’autres qui ne partagent pas forcément mes opinions. Et comme en général j’écris rapidement en devançant bien la date de soumission, je peux revenir critiquement sur ce que je fais. À propos de mes travaux sur Hollywood, je connais des producteurs, des directeurs de studio et des avocats spécialisés qui ont lu mon livre et qui me présentent à leurs collègues ainsi : « Voici Toby Miller, il est professeur à l’université de Californie [à l’époque], il est de gauche, mais il comprend bien ce que nous faisons ».
Quand j’insiste sur les subventions cachées qui caractérisent des pans entiers du capitalisme aux États-Unis, c’est influencé par ce que je pense que je vais trouver, comme conséquence de ma formation en sciences sociales et de mes engagements politiques. Quand je trouve des données qui vont dans ce sens, je suis en mesure de faire un diagnostic qui est à mon avis parfaitement légitime. Mais on n’a pas besoin d’accepter ce diagnostic pour reconnaître que les données empiriques présentées sont vraies.
NW : Vous est-il arrivé à présenter vos interprétations et intuitions à des professionnels qui rétorquent que ce que vous écrivez n’est pas vrai, qu’ils ne s’y reconnaissent pas ?
TM : Oui. Et c’est une leçon intéressante en elle-même. Alors que beaucoup de professionnels à Hollywood trouvent mes analyses très convaincantes, d’autres refusent de les reconnaître, car la réalité de l’intervention publique dans cette industrie apparemment capitaliste est inaudible pour eux. Cela ne veut pas dire que leur version des faits est sans valeur. Il est important pour moi que les points de vue de ceux qui ne sont pas d’accord avec moi soient bien représentés dans ce que j’écris.
NW : Quand j’ai interviewé le psychologue Jonathan Haidt, il m’a dit qu’il était passé de la gauche vers la droite comme une conséquence de sa recherche. Est-ce qu’un tel scénario est possible dans votre cas ?
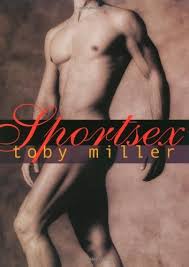
Que faire ? Que fallait-il comprendre à cela ? Mettons de côté les questions éthiques et juridiques. J’ai appris que mon livre, qui voulait parler de la beauté du corps masculin en tant que nouvelle marchandise dans les médias, dans les sports et dans l’image publique du corps, n’excluait pas une interprétation érotico-pornographique. Dans ce cas, je trouvais mes mots accompagnés, sans mon accord, par des images offensantes pour beaucoup, alors que d’autres y trouvaient une signification positive. Voilà ce qui peut se passer quand on met le pied dans l’eau, et qu’on se retrouve devant des réactions non anticipées.
NW : Vous m’avez intrigué quand vous avez dit que votre rôle est de dévoiler « la nature des choses ». Selon la caricature, les praticiens des cultural studies ne pensent pas qu’il existe une nature des choses, mais que tout soit socialement construit, et qu’il y ait toujours une autre perspective. Vous semblez embrasser la tradition des Lumières s’agissant de notre rapport au monde externe.
TM : Touché ! En guise de réponse je me tournerai vers Bruno Latour – l’un des plus grands ethnologues/philosophes/sociologues de la science. Quand on lui demande quelle est la nature de la science, la nature des choses, et la nature du sens, Latour dit qu’il faut maintenir tous les trois dans une interaction dynamique.
Il y a différentes natures des choses : celles-ci évoluent, ainsi que les luttes sur comment il faut les traiter. La lutte concernant leur représentation évolue aussi. Il faut comprendre les trois facteurs si on veut saisir la nature des choses.

Latour donne un exemple : celui d’un scientifique écrivant un papier sur un phénomène qui existe dans le monde naturel, disons le vent. Personne en cultural studies ne nierait qu’un drapeau, objet forcément idéologique, a besoin du vent pour flotter. Cela dit, la décision d’écrire sur la signification d’un drapeau implique des forces sociales, des relations de pouvoir, des mesures gouvernementales, des investissements financiers, etc. Et pour le scientifique, le fait d’écrire sur ce phénomène du monde naturel qu’est le vent sera contraint par les règlements propres à un papier scientifique : un résumé, des mots clés, une méthodologie, une revue de la littérature, et une hypothèse. Tout cela n’a rien à voir avec le vent ; c’est à voir avec un ensemble de forces sociales et avec des textes. Alors pour comprendre la nature des choses, il faut saisir l’interaction de tous ces facteurs.
NW : Mais quand il s’agit de l’interprétation de la signification des choses, il y a beaucoup plus de marge pour du débat que pour l’interprétation de données empiriques « dures ».
TM : Oui, mais que compter et comment le faire ? L’universitaire britannique Justin Lewis a écrit en 2001 un livre magnifique sur l’opinion publique dans lequel il affirme que dans beaucoup de travaux en sociologie statistique, l’objet est décrit d’abord avec des mots. On discute, par exemple, le jour d’une élection présidentielle, de qui va gagner. Ce sera décidé empiriquement par des chiffres, mais la question se pose verbalement. Une fois énoncé le problème en mots, il faut transformer celui-ci en catégories chiffrées : tant de personnes font ceci, tant de personnes font cela. Et quand vous aurez effectué les manipulations exigées par une sociologie à base mathématique, il faudra ensuite les retransformer en mots, afin qu’on puisse les interpréter. En fait, donc, la sémiotique de la collection des données, de l’administration, du traitement des données est criblée de questions de représentation. Chaque fois qu’on décide de compter quelque chose, la « chose » est aussi un mot, donc sujet à contestation par sa définition, par sa pertinence, par son usage. Et chaque fois qu’on aboutit à un niveau de compréhension à travers des méthodes quantitatives, il faut l’expliquer de nouveau en langage naturel : on retourne donc à des problèmes de définition, d’interprétation et de contestation.
NW : Les cultural studies ont mauvaise presse en Grande-Bretagne et peut-être aussi ailleurs. Comment l’expliquez-vous ?
TM : En Grande-Bretagne, c’est perçu comme une matière Mickey Mouse (incompétente, pas sérieuse) – c’est le terme employé. Pas mal de gens dans les universités d’élite comme Oxford ou Cambridge, ou dans des institutions médiatiques comme la BBC et The Guardian décrivent les cultural studies ainsi. Pareillement chez les gens qui s’inquiètent du soi-disant déclin du niveau de l’éducation supérieure.
Les cultural studies traversent la même crise de croissance, et font face aux mêmes attaques que la sociologie après la Seconde Guerre mondiale, la littérature à la fin du 19e siècle, et les sciences naturelles au début du 20e siècle. En d’autres termes, quand un pays subit des transformations politiques et économiques massives, le savoir créé dans les universités en réponse à ces changements ne trouve pas sa place. Il y a un peu plus d’un siècle, les hellénistes et les latinistes dénonçaient les analyses de la littérature moderne – risibles, pas sérieuses – d’une manière étonnamment similaire.
Aux États-Unis, les cultural studies se situent beaucoup plus sur le terrain des études littéraires. La mission historique de la haute culture était d’élever spirituellement les citoyens. Cette mission est supposément en train d’être jetée aux loups par les professeurs de lettres qui tournent le dos à leur vocation en faveur de la paralittérature bas de gamme. On prétend que l’obsession avec le politically correct et avec la culture populaire diminue la capacité à faire valoir cette mission historique de la littérature, qui offrait soi-disant une vision désintéressée du monde social, des quintessences mythiques plutôt que des questions de conflit, de classe ou de genre.
NW : Il ne s’ensuit pas que ce qui est méprisé actuellement aura de la valeur dans le futur.
TM : Vous avez tout à fait raison. Bien entendu, on vit dans une époque où l’édition universitaire se transforme très rapidement, ainsi que la marchandisation du savoir, et la relation entre les médias et l’université. Et à moins que les cultural studies ne réussissent, d’une part à satisfaire certaines de ces exigences et à s’adapter à la société existante, et d’autre part à trouver des méthodes et des normes lisibles par d’autres disciplines, comme l’a fait la littérature, elles auront du mal à survivre.

Revenons en 1959, à C. P. Snow, le grand physicien et romancier, et à son pamphlet sur « les deux cultures ». Snow se plaignait que, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, quand il parlait à des professeurs de lettres, ceux-ci ne comprenaient rien de la loi de la thermodynamique, alors que des professeurs de physique savaient au moins quelque chose sur le poète T. S. Eliot. Il pensait qu’il y avait là deux cultures qui fatalement ne se communiquaient pas. L’un des bénéfices potentiels des cultural studies, c’est leur capacité à créer des liens avec à la fois les sciences dures et les sciences sociales, avec à la clé l’interaction entre les deux.
Je vous donne un exemple organique et très actuel. Dans le domaine des jeux vidéo, il y a des gens en cultural studies qui savent coder, et comprendre comment les logiciels et la technologie interagissent ; en informatique, il y a gens qui s’intéressent aux techniques de narration et de la mise en images. Ceux-ci consomment les mêmes drogues, portent le même style de vêtements, se couchent entre eux, et fréquentent les mêmes soirées ; ils ne se trouvent plus physiquement ou symboliquement aux coins opposés du campus. Alors si les cultural studies peuvent profiter de cela, sans perdre leur engagement par rapport à la subjectivité et au pouvoir, elles pourraient avoir un avenir.
NW : Diriez-vous que le but des cultural studies est de comprendre le monde, ou de le changer ?
TM : C’est le marxiste tapi en vous qui s’exprime ! Si vous regardez les gens qui enseignent l’administration publique, le tourisme, la construction des bateaux, l’architecture ou l’histoire, qu’allez-vous découvrir ? Qu’ils ne recherchent pas la vérité juste pour la forme. Ils sont en fait profondément complices avec, et impliqués dans la nature de l’économie, dans la formation de ceux qui y participent, dans le fonctionnement de l’État, et dans la connaissance qui aide à forger les futurs citoyens. Alors, il n’existe pas de savoir pur qui n’essaie pas de changer le monde.
Note du traducteur
1. Allusion aux lignes célèbres du poète John Keats (1795-1821) : « La beauté est vérité, la vérité beauté/C’est tout ce que vous savez sur terre, et c’est tout ce qu’il faut savoir » (Beauty is truth, truth beauty/ It is all ye know on earth, and all ye need to know).


Toby Miller est l’auteur ou coauteur d’environ 40 livres dans le domaine des cultural studies et des media studies. Il est actuellement professeur à la graduate school de l’université de Loughborough (Royaume-Uni).



