Actualités des industries culturelles et numériques #36, novembre 2015
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et numériques du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante.
Contenu
CSI (Les Experts) tire sa révérence
La chaîne américaine CBS a annoncé l’arrêt de la CSI : Crime Scene Investigation, après 15 saisons et 337 épisodes. La série a pris fin avec la diffusion d’un téléfilm de deux heures le 27 septembre intitulé Immortality, qui voit le retour de trois acteurs ayant quitté la série : William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows) et Paul Guilfoyle (le capitaine Jim Brass). Il se termine – spoiler faible – avec la reprise de l’idylle entre Grissom, devenu écologiste de mer, et Sarah Sidle, qui décline une promotion pour partir en bateau avec lui. Lancée en octobre 2000, CSI a été pendant quelques années (2002-04) la série la plus regardée aux États-Unis avec 26 millions de téléspectateurs réguliers par épisode, et la plus regardée au monde avec 73,8 millions de téléspectateurs dans environ 150 pays en 2009. Elle a commencé son lent déclin aux États-Unis en 2007 (20,34 millions), tombant à 11,2 millions en 2015. En France, TF1 l’a retransmise depuis novembre 2001 (d’abord le dimanche après-midi, et depuis 2005, en prime time) : à son apogée, elle a drainé 11,1 millions de téléspectateurs et n’est jamais tombée en dessous de 4 millions.
« Quand on a présenté la série à CBS, expliquait William Petersen, acteur principal et l’un des producteurs exécutifs, dans une interview en 2009 lors de son départ, elle était un peu sceptique : « vous voulez faire une série mettant en scène des gens qui analysent des empreintes digitales ? ». Mais l’intérêt était de montrer à l’image ce qu’ils voyaient à travers les microscopes, leurs diverses expériences de laboratoire, et de vulgariser la science médico-légale. Les gens aiment résoudre les énigmes. On savait qu’il y aurait de l’audience, mais personne ne s’attendait à un tel succès. » Dans un documentaire consacré à la série en 2007, le producteur Anthony Zuiker prétendait : « On a commencé en 2000, et ce fut un succès, mais le taux d’audimat a vraiment décollé après les attaques du 11 septembre [2001]. Les gens se sont précipités vers nous pour leur nourriture de confort. Dans CSI, il y avait un sens de justice ; c’était bien de savoir qu’il y avait des gens comme nos personnages qui aidaient à résoudre des crimes. Et bien sûr, 9/11 était la plus importante scène de crime au monde ».
CSI a donné naissance à trois séries dérivées : CSI : Miami (2002-10, 232 épisodes), CSI : NY (2004-13, 197 épisodes) et CSI : Cyber (2015, 13 épisodes pour l’instant) qui a été renouvelée pour une deuxième saison. Cette dernière série se focalise sur des enquêtes dans le monde virtuel plutôt que de la science médico-légale.
Sources : Le Monde, 27-28 septembre 2015, p. 24 ; entrées Wikipedia « CSI », « CSI franchise » (anglais).
Les mots de Petersen, et de Zuicker, complaisamment relayés par l’article du Monde, relèvent plutôt de l’autopromotion (qui s’appelle plus familièrement « la com »). Il ne faut pas s’attendre à autre chose de la part de personnes aussi impliquées, mais les analyses universitaires et journalistiques peuvent être lénifiantes à leur manière. Les discours d’escorte de la série ont toujours insisté sur sa dimension scientifique, voire pédagogique et humaniste, alors que la science en question comporte des scènes d’autopsie macabres, qui n’épargnent aucunement le téléspectateur quant à la réalité biochimique de la décomposition des cadavres. Clairement, la série renvoie plus à une forme de pornographie morbide qu’à un engouement pour la méthode scientifique, qui n’influe pas ici sur la société des vivants. Nul meilleur monde en devenir. Quant au producteur Zuiker, enclin à des justificatifs pseudo-philosophiques, le lien (mystérieux) qu’il avance entre les attaques terroristes du « 9/11 » (le 11 septembre 2001), et le « décollage » de CSI ne résiste pas à un regard un tant soit peu critique. La première saison de CSI (2000-01), diffusée intégralement avant « 9/11 », a attiré 20,8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode ; la deuxième saison, qui a débuté quelques semaines après les attaques, 23,7 millions. L’audience de la série a donc été largement réalisée dès sa première saison.
Cela dit, la série a fait preuve d’une longévité exceptionnelle, cinquième de tous les temps aux États-Unis (si l’on exclut quelques dessins animés), après Gunsmoke (635 épisodes, 1955-75), Law and Order (New York District en français) (456, 1990-2010), Lassie (pour enfants, le personnage principal étant un chien, 591, 1954-73), Law and Order : Special Victims Unit (New York Unité spéciale) (368, série en cours, depuis 1999). Ce que ces séries ont en commun, c’est une formule exceptionnellement stable et prévisible. Si Gunsmoke et Lassie relèvent de la série classique avec un minimum de personnages récurrents, les autres font partie de la série moderne avec de multiples personnages, et des éléments feuilletonnants, ici relativement faibles. Les arrivées et les disparitions de personnages récurrents ne déstabilisent pas l’assemblage de base. Dans CSI, l’expression (minime) de la personnalité est limitée sauf exception à la sphère professionnelle, ce qui va de pair avec des intrigues squelettiques (au moins deux enquêtes par épisode de 42 minutes), sans intensité émotionnelle.
Le précurseur des séries médico-légales fut la britannique Silent Witness (Autopsie en vf), diffusée depuis 1996 sur la BBC, et toujours en production à un rythme de 4 à 6 épisodes de deux heures par an. Comme sa longueur l’indique, elle est plus conséquente d’un point de vue dramatique. Diffusée aux États-Unis sur BBC America, elle a dû influencer CSI, notamment dans sa conception du cadavre comme un témoin privilégié (« qui ne ment pas »), même si Zuiker attribue son inspiration à un documentaire sur la chaîne Discovery. En dehors de ses propres franchises, CSI a mené à la création d’autres séries comportant des autopsies, notamment Bones (212 épisodes depuis 2005), Rizzoli & Isles (86 épisodes depuis 2010), Body of Proof (42 épisodes, 2011-13), et dans une certaine mesure NCIS (285 épisodes depuis 2003). Il est probable que le cycle de séries médico-légales touche à sa fin, en même temps que celui des émissions de télé-réalité.
Pour une analyse critique de CSI, voir mon livre Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan, 2010), pp. 103-19.
James Bond pousse à boire
Le James Bond interprété par Daniel Craig boit 20 verres d’alcool par film, par rapport à 11 verres pour le James Bond interprété par Sean Connery dans les années 1960. Il faut y voir le poids croissant des sponsors, et des placements de produits. À partir de 2006, la consommation de gin a explosé au Royaume-Uni après que Craig s’est mis au Vesper Martini (gin, vodka, vermouth) dans le film Casino Royale. Entre 2014-15, le chiffre d’affaires britannique du gin, devenu l’alcool le plus fashionable, a encore augmenté de 24,1 millions £ (+ 9,1%). Le Vesper Martini a été inventé et nommé par l’auteur Ian Fleming dans le roman du même nom publié en 1953. Le cocktail de prédilection du Bond joué par Sean Connery était une vodka martini, « au shaker, pas à la cuillère ».
Le placement de produits a toujours été fortement présent depuis le début de la franchise, qui se prête bien à cela, transformant le personnage Bond (du moins en partie) en panneau publicitaire sur pattes. Dans les années 1960, c’étaient les voitures de sport Aston Martin, et la compagnie d’avion américaine, disparue depuis, PanAm. Depuis la fin des années 1990, les placements tournent autour de 100 millions de dollars par film (Coke Zero, Proctor & Gamble, Ford (35 millions $ pour Die another day, 2002), Sony, Avon, Virgin Atlantic, BMW, Avis, l’Oréal. Dans Casino Royale, Bond précise qu’il porte une montre Omega, pas une Rolex. Dans Skyfall, contre toute attente (car le personnage est snob), il daigne boire une Heineken, moyennant 35 millions $, soit près d’un cinquième du budget du film ; une campagne publicitaire avec Daniel Craig a suivi dans la foulée. D’après les documents dévoilés au public à la suite du piratage des boîtes mail de Sony Pictures en novembre 2014 (Actualités #29, mars 2015), le Mexique a payé 15 millions de dollars pour pouvoir modifier le scénario du dernier Bond Spectre, afin d’adoucir l’image du pays.
Sources : Les Échos, 23 sept. 2015, p. 23 ; The Grocer, 21 sept. 2015 ; bbc.com, 1 oct. 2015 ; Les Échos, 26 oct. 2015.
Les personnages récurrents dans l’édition (suite)
Le mois dernier, j’ai parlé de la polémique suscitée par le tome 4 de Millenium, écrit par un écrivain à commandes onze ans après la mort de l’auteur original. Dans le même temps, on a vu la publication de deux reprises de personnages de BD, sans controverse aucune : Sous le soleil de minuit, une nouvelle aventure de Corto Maltese (la 13e) par les Espagnols Ruben Pellejero et Juan Diaz Canales, et un nouvel album d’Astérix, Le Papyrus de César, de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.
Le créateur de Corto Maltese en 1967, Hugo Pratt (1927-95), avait déclaré avant sa mort qu’il n’était pas hostile à ce que son héros lui survive. Le nouvel album sort donc avec l’accord de son amie et ayant droit. Pour l’éditeur Casterman, propriété de Gallimard, l’enjeu est d’importance ; le premier tirage de 300 000 est son deuxième plus gros lancement. Sans nouveau titre depuis vingt ans, le fonds Corto Maltese s’étiolait fatalement : ces dernières années, il tournait à 30 000 albums en moyenne par an, alors que du vivant de Pratt il s’écoulait entre 8 et 9 millions par an en France. Pour le nouvel album, Casterman a ressorti toute la collection, numérotée et avec une nouvelle charte graphique. Quant au 36e album d’Astérix (aux éditions Albert-René, propriété du groupe Hachette), c’est le dessinateur original Albert Uderzo (87 ans) qui a décidé de passer la main. L’avant-dernier titre, Astérix chez les Pictes s’est vendu à 1,9 million d’exemplaires en 2013, et le dernier devrait terminer également en tête des ventes en France.

Certains éditeurs veulent croire que ce modèle établi par la BD, ainsi que celui qu’implique l’opération Millenium, peuvent se généraliser. « Les années 1950 à 1980 ont été extrêmement créatives, et l’on est à une époque où l’on recycle énormément », dit Patrice Hoffmann, éditeur chez Flammarion. Lui-même a participé à une des seules réussites en la matière en ce qui concerne la littérature : la relance de James Bond en 2008 avec un roman de Sebastien Faulks, choisi par les héritiers, Le Diable l’emporte. La famille de l’auteur original Ian Fleming, qui ne détient que les droits littéraires sur le personnage (les droits filmiques ayant été vendus au début des années 1960 au producteur Alberto Broccoli, à l’exception de Casino Royale), confie tous les cinq ans l’usage du personnage à un auteur célèbre ; après Faulks, c’était le tour de William Boyd, dont le « traitement » Solo, paru en 2014, s’est déjà vendu en France à 59 000 exemplaires (dont 18 000 en poche depuis cette année). Parmi les auteurs ayant écrit des James Bond originaux, on compte Robert Markham, pseudonyme de Kingsley Amis (1 titre, 1968), John Gardner (14 titres, 1981-96), et Raymond Benson (6 titres, 1996-2002).
Le succès au cinéma des licences comme celle des superhéros Marvel fait saliver certains éditeurs, qui reconnaissent, cependant, que rééditer le succès de Millenium n’est pas toujours possible. Depuis la mort de Gérard de Villiers en 2013, la série SAS et son héros Son Altesse Sérénissime le prince Malko Linge, agent du CIA, sont orphelins. « Difficile de lui trouver un successeur, dit l’avocat Éric Morain, son exécuteur testamentaire. C’est la qualité des informations, plus que celle du style, qui maintenait l’intérêt de la série. » En effet, les intrigues puériles, comportant des scènes de violence sadique et d’érotisme viril, pourraient être continuées par d’autres, s’agissant d’une formule. Mais de Villiers, assez facho sur les bords, et qui avait vraisemblablement ses entrées aux services de renseignements, était crédible au point d’être lu par de nombreux diplomates, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères socialiste Hubert Védrine ; derrière ceux-ci, une armée de lecteurs masculins qui tenaient à être bien informés en se divertissant. On estime que 120 à 150 millions d’exemplaires ont été vendus d’une série de 200 titres entre 1965 et 2013, paraissant à un rythme de quatre, puis cinq par an, chacun avec un tirage de 200 000, rapidement épuisé.
Source : Le Monde, 1 oct. 2015, (Alain Beuve-Méry), supplément Économie et Entreprise, p. 2 ; entrées Wikipédia « Gérard de Villiers », « SAS (série) ».
Netflix (vidéo à la demande) s’installe en France, lentement mais sûrement
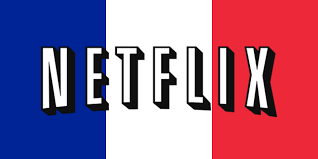
Canalplay, le service de vidéo à la demande de Canal+ lancé en 2011, a revendiqué 700 000 abonnés en juin 2015, contre 500 000 en juin 2014. Quoique toujours leader sur le marché français, Canalplay a des soucis à se faire ; cette dernière année, il a recruté 200 000 abonnés, contre 500 000 pour Netflix. Comme l’affirme Alexandre Piquard dans Le Monde, Canalplay tient un discours ambigu, offensif et défensif en même temps. Explique Manuel Alduy, son responsable, déjà cité le mois dernier (Actualités #35) : « [L’arrivée de Netflix] n’est pas le tsunami annoncé et la vertu de l’année écoulée est d’avoir sorti le secteur des fantasmes. Certains comparaient trop vite le marché américain à celui de la France, qui est très différent ». Avant d’ajouter, « pour autant, on a bien affaire à une multinationale de taille mondiale qui investit massivement en publicité sur notre marché local ».
Les deux devront améliorer leurs catalogues pour l’instant un peu décevants (films et séries vieillis) pour espérer progresser. Depuis son lancement, Netflix a plus que doublé son offre en France pour atteindre 10 800 titres, contre 9136 pour Canalplay, qui revendique une part d’œuvres françaises (40%) beaucoup plus importante. Netflix compte jouer aussi la carte de séries françaises originales comme Marseille (avec Gérard Depardieu), mais en visant le marché mondial.
NPA Conseil prévoit entre 1 et 2,7 millions d’abonnés français à Netflix en 2018 ; Future Source Consulting avance le chiffre de 3 millions d’abonnés en 2019, sur un marché français comptant 5 millions. Ce sont des prévisions fragiles, mais indicatives du taux de croissance nécessaire pour que le modèle d’abonnement devienne rentable, compte tenu des investissements qu’il faudra faire dans la production de films et de séries originaux pour être attractif. Selon une étude du cabinet d’études Deloitte Digital, le chiffre d’affaires des services de vidéo à la demande par abonnement (SVoD) en Europe a généré 833 millions d’euros en 2014, une progression de 23% par rapport à 2013. Il devrait atteindre 1,75 milliard d’euros en 2018 (13,7 milliards dans le monde).
Source : Le Monde, 15 sept. 2015 (Alexandre Piquard), supplément Économie et Entreprise, p. 7.
Également sur Netflix dans la web-revue : Actualités #30 ; #28 ; et surtout pour l’historique #25.
Mea culpa de l’industrie publicitaire : « on s’est plantés »
Dans un communiqué publié le 15 octobre, l’Interactive Advertising Bureau (IAB) se livre à une confession étonnante. Après l’explosion de la bulle Internet en 2001, qui a vu la faillite de nombreuses start-up, est venue la « Renaissance » : « La publicité en ligne est devenue la base d’un moteur économique qui, aujourd’hui encore, fait tourner le Web gratuit et démocratique ». Mais ensuite, « on s’est plantés » : trop de publicités invasives, trop de ciblage des utilisateurs, trop de course au profit. Un militant anticapitaliste ne dirait pas autre chose.
« Dans notre recherche d’une plus grande automatisation et de maximisation de profits […], nous avons construit des technologies pour optimiser les revenus durant la baisse des marchés publicitaires. Avec le recul, nous avons perdu l’équivalent de beaucoup d’euros en termes de confiance des consommateurs pour faire la chasse aux centimes. Les systèmes de ciblage, rapides, simples d’utilisation et rapportant gros, ont ralenti l’Internet grand public et vidé bien des batteries de téléphones. Nous étions tellement bons à ce jeu que nous sommes allés au-delà des capacités des tuyaux que nous avions créés. Cela a dépassé les utilisateurs, vidé leurs terminaux, et mis leur patience à bout ».
De l’aveu même de l’IAB, en désarroi depuis des années, il a fallu le déploiement généralisé des bloqueurs de publicité pour que l’industrie publicitaire prenne conscience de son extrême faiblesse sur supports numériques. Deux branches du capital ont radicalement des intérêts opposés : l’industrie publicitaire, et l’industrie des logiciels et des applications. En désespoir de cause, l’IAB a opté pour une stratégie « vertueuse » avec le lancement d’une nouvelle certification pour les annonces en ligne baptisée « Lean » (maigre), réservée aux formats « légers, chiffrés, qui donnent le choix à l’utilisateur et qui ne sont pas invasifs ».
L’enjeu, c’est d’être classé parmi les « publicités acceptables » par certaines applications bloqueuses, dont la plus connue, Adblock Plus (ABP), qui utilise une « liste blanche » de publicités non bloquées par défaut. Pour y figurer, les annonces ne doivent pas perturber la lecture, mais il faut aussi payer d’importants « frais techniques », pratique dénoncée comme un racket par de nombreux éditeurs. Plusieurs procès ont été intentés, pour l’instant toujours remportés par Adblock Plus.
Source : Le Monde (Damien Leloup), supplément Économie et Entreprise, 18-19 oct. 2015, p. 8.
Le site de critique rock Pitchfork racheté par le géant du luxe Condé Nast
Tout fan du rock indé qui se respecte connait le site Pitchfork (« fourche à foin »), qui s’est taillé une réputation d’indépendance vis-à-vis de l’industrie musicale. Son rachat récent par le conglomérat de la presse de luxe Condé Nast est symptomatique d’un processus de concentration, qui sévit désormais sur les sites en ligne. En ce sens, la trajectoire de Pitchfork est un bon exemple de la fusion tendancielle des capitaux « établi » et « alternatif ».
Condé Nast fut fondé en 1909 par un éditeur new-yorkais, Condé Montrose Nast, après avoir acheté le magazine de mode, Vogue. Historiquement, le groupe s’est spécialisé dans des publications pour l’élite (class publications) plutôt que pour la masse. Actuellement, il possède 20 titres de journaux presse et web (Vogue, Wired, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Glamour…) avec une circulation totale de 164 millions ; une filiale Condé Nast Entertainment pour développer des projets cinéma, télévision et web ; et Fairchild Fashion Media qui possède plusieurs journaux de mode. Condé Nast est aussi le propriétaire des sites Reddit (forum de discussion) et Ars (actualités des nouvelles technologies).
À peine sorti du lycée à Minneapolis en 1995, le jeune Ryan Schreiber a eu l’intuition que l’Internet naissant était le média du futur et qu’il perdait son temps avec les fanzines photocopiés distribués artisanalement. Le site Pitchfork, mélange d’érudition maniaque et de critiques volontairement subjectives (à l’image de Rolling Stone pour la génération précédente), a vu le jour gratuitement en ligne, financé par la publicité. On s’enflammait à l’époque pour le groupe britannique Radiohead. Depuis le mitan des années 2000, Pitchfork a influé sur la carrière de quelques groupes indé, notamment Arcade Fire, et organise deux festivals annuels à Chicago (depuis 2005) et à Paris (depuis 2011). Il a lancé une web-TV en 2008, et un support-papier trimestriel Pitchfork Review en 2013. Un autre site dédié au cinéma, The Dissolve a dû fermer en juillet 2015 après deux ans d’existence. La société emploie 50 personnes réparties sur New York (rédaction web et vidéo) et Chicago (régie publicitaire). L’audience mensuelle déclarée est de 6 millions de visiteurs uniques et de 4 millions de followers sur les réseaux sociaux.
Quel est l’intérêt de ce rachat pour Condé Nast, à part le développement de sa propre audience sur Internet ? (Celle-ci est passée de 17,2 millions de visiteurs mensuels en 2010 à 87,3 millions en 2015). Bob Sauerberg, son PDG, s’est félicité : « Pitchfork est un site remarquable avec une ligne éditoriale forte, un public jeune et enthousiaste, une plateforme vidéo en développement et un business d’événements florissant ». Voilà pour la com. Condé Nast s’est plutôt concentré jusqu’ici sur des magazines de mode destinés aux femmes. Or, selon les statistiques de Quantcast, 84% des visiteurs au site Pitchfork sont des hommes entre 18 et 34 ans, cible décisive courtisée par les annonceurs, car réputée difficile. Qui plus est, les fans du rock indé sont majoritairement issus de la classe moyenne, et destinés à intégrer les professions après leurs études. Bref, de (bons) futurs consommateurs, monnayables comme tels.

Sources : Libération, 14 oct. 2015 (Elvire von Bardeleben et Guillaume Gendron) ; entrée Wikipédia « Condé Nast ».
Lire les autres articles de la rubrique.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)



