Actualités des industries culturelles et numériques #32, juin 2015
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante.
Contenu
De plus en plus de films en langue anglaise à Cannes
Certes, le palme d’or est revenu au réalisateur français Jacques Audiard (Dheepan), mais 14 des 19 films présentés en compétition à la 68e édition du Festival de Cannes étaient en langue anglaise, alors que seuls trois cinéastes étaient d’origine anglo-saxonne (un Australien et deux Américains). Même pour le cinéma d’auteur (à Cannes, la nationalité d’un film tient au passeport de son réalisateur), le choix de l’anglais s’impose, dès lors qu’on veut infiltrer le marché américain, où les films ne sont jamais doublés, et où les versions sous-titrées ne circulent pas en dehors de quelques campus. « Tout cela se fonde principalement sur un ensemble que nous appelons le « package » : un réalisateur, plus un casting, plus un budget, plus un script… L’idée d’un [remake en anglais du film primé du réalisateur italien] Sorrentino avec [de grands acteurs anglo-saxons] se révèle beaucoup plus facile à vendre qu’un nouveau film du même avec un acteur italien en langue italienne », dit Muriel Sauzay, responsable des acquisitions et ventes internationales chez Pathé. La renaissance du cinéma italien passe par des coproductions européennes en langue anglaise, les films tournés en italien étant presque devenus un banc d’essai pour les réalisateurs italiens montants, présents dans les sélections parallèles du festival (Un certain regard, la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique). La remarque vaut pour tous les cinéastes non anglophones.

Olivier Père, patron d’Arte Cinéma, qui coproduit une vingtaine de films français et étrangers par an, estime qu’ « on traverse une période de plus grande hybridation des coproductions, et donc des projets. Ce qu’on constate ces dernières années est tout de même loin de « l’euro-pudding », ces productions des années 80 et 90 où l’on imposait l’anglais comme vecteur d’export sans aucun respect du sujet… Aujourd’hui, il faut bien distinguer deux choses. Évidemment, il nous arrive de recevoir des projets un peu bizarres, dont l’anglophonie traduit une tentative de faire du cinéma dont le genre serait « européen » ou une absence de respect pour le fond du film. […] Mais d’autre part, il y a de plus en plus de projets où l’anglais prend son sens de par le contexte narratif et le désir initial du réalisateur… Des films qui traduisent un effacement des frontières du cinéma d’auteur, avec une volonté des cinéastes de s’affranchir des limites de leur propre pays pour aller vers un ailleurs, des codes différents, des tournages lointains, des rencontres avec des acteurs d’horizons plus variés. Cela part d’une curiosité intellectuelle et, à mon niveau, j’y vois plus de possibilités supplémentaires qu’un diktat d’exportation ». C’est le ressenti peut-être d’Olivier Père, mais il est difficile de ne pas voir en ces propos la rationalisation d’une internationalisation accélérée en matière de financement ; la bougeotte créative évoquée des réalisateurs argentins, chinois, danois, etc. converge dans tous les cas vers la langue anglaise. Pour sa part, Vincent Maraval (du distributeur Wild Bunch) estime que les films présentés à Cannes ne sont pas calibrés pour les multiplexes, et que le choix de langue ne modifie pas la donne.


Désormais, sur douze films produits par EuropaCorp par an, neuf seront tournés en anglais. Les trois films en anglais (sur 12) de 2014 ont apporté 55% des recettes et 80% du résultat. Ancien publicitaire, proche de Nicolas Sarkozy, Christophe Lambert peste contre le système français du crédit d’impôt (voir rubrique ci-dessous), qui interdit toute aide aux films tournés en anglais par des producteurs français. Selon lui : « Confondre la défense du cinéma français et celle de la langue française, c’est une énorme erreur. Même tournés en anglais, nos films sont français, car tournés en France avec des techniciens français. Ils sont simplement en anglais pour accéder au marché international ».
Sources : « Cannes : la promenade de l’anglais » (Julien Gester, Didier Péron), Libération, 13 mai, 2015, p. 2-4 ; « Avec Valérian, EuropaCorp pense avoir trouvé son « Star Wars » » (Julien Dupont-Calbo), Les Échos, 13-14 mai, 2015, p. 23.
Investissements record dans les start-up de la Silicon Valley
Jamais depuis quinze ans aux États-Unis les start-up n’ont levé autant d’argent qu’au premier trimestre 2015, surtout à la Silicon Valley. Espèce excessivement rare au point où on les appelait les « licornes » d’après le nom des animaux imaginaires du monde des contes, les start-up valorisées à plus d’un milliard $ se multiplient ; on en compte aujourd’hui un peu plus que 80. Quatre d’entre elles valent plus de 10 milliards $ : Uber (41,2), Snapchat (19), Airb’n’b (13), Space-X (12). Selon une étude publiée en avril par la National Venture Capital Association, 13,4 milliards $ ont été investis dans la période janvier-mars 2015 dans les start-up, en 1020 tours de table, le meilleur résultat depuis l’explosion de la bulle Internet en 2000, qui avait provoqué l’effondrement des marchés et la faillite de milliers d’entreprises.

En conséquence, beaucoup de start-up retardent le plus possible leur entrée en Bourse, avec les contraintes de transparence financière qui vont avec. Le site suédois de streaming musical, Spotify, a finalement renoncé à être coté sur la place de New York en septembre 2014. Car aucune de ces entreprises n’est rentable, et certaines n’ont ni modèle économique, ni rentrée d’argent, ce qui n’a pas empêche Snapshot (application d’échanges de photos et de vidéos), fondée en 2011 par un étudiant de Stanford, Evan Spiegel, d’être valorisée à 19 milliards $, après avoir refusé une offre de rachat en novembre 2013 de Facebook pour 3 milliards $. Joe Horowitz, gérant du fonds Icon Ventures spécialisé dans les nouvelles technologies, prétend : « quand on commence à valoriser à tort et à travers tout ce qui passe un milliard de dollars, c’est le signe que nous sommes en train de perdre le sens commun ».

En ces temps de politique monétaire de très faibles taux d’intérêt, le capital spéculatif ne manque pas dans la Silicon Valley. « Les taux bas font qu’il y a énormément d’argent dans les caisses des fonds de capital investissement, et quel meilleur endroit pour investir aujourd’hui que les nouvelles technologies ? […] Le succès phénoménal et les rendements qu’ont apportés des entreprises comme Facebook ont attiré plein de nouveaux sur le secteur. Aujourd’hui, j’ai moins peur d’acheter du Uber que des bonds allemands », explique Gregori Volokhine, gérant de la société de gestion Meeschaert Capital Markets.

Aucun autre secteur de l’économie n’est aussi potentiellement rentable que la Silicon Valley, ce qui pousse des investisseurs traditionnels comme Calpers, un gros fonds de pension californien connu pour son approche conservatrice, à tenter sa chance, dans le sillage de Google et d’Alibaba (Chine). Pour certains, ces exemples prouvent qu’il n’y a pas de bulle. « Ces fonds investissent dans des entreprises qui révolutionnent les usages et prennent des places dominantes qu’il sera difficile de remettre en place par un concurrent. Si les modèles économiques ne sont pas encore trouvés, on considère qu’ils ne vont pas tarder à l’être », explique Greg Revenu, cofondateur français de la banque d’investissement Bryan Garnier & Co. Point de vue tempéré par Gregori Volokhine, pour qui l’introduction en bourse des « licornes » sera l’épreuve décisive : « il faut bien que les investisseurs sortent et récupèrent leur argent, c’est à ce moment-là qu’on saura s’il y a bulle ou pas ».
Source : « Les start-up de la Silicon Valley flambent » (Sarah Belouezzane), Le Monde, supplément « Éco & Entreprise », 19-20 avril 2015, p. 3.
À regarder : la sitcom Silicon Valley (actuellement diffusée sur OCS City).
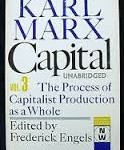
Le poids moyen du capital fictif dans les onze pays les plus riches est passé de 145% du PIB en 1980 à 340% en 2012, ce qui montre que l’accumulation financière n’a cessé de progresser par rapport à l’accumulation réelle (les richesses effectivement produites). Actuellement, 98% des transactions monétaires dans le monde relèvent de la spéculation, seulement 2% concernent des valeurs « réelles ». À priori, cette fantasmagorie ne peut continuer en l’état indéfiniment, en dépit des outils financiers de plus en plus sophistiqués.

Le crédit et la spéculation ont toujours existé, mais jamais à ce point-là ; il s’agit d’une évolution structurelle du capitalisme dans un stade qu’on peut qualifier de « financier » ou de « tardif ». La valeur du dollar est totalement flottante, et n’est plus indexée sur les réserves de l’or depuis 1971. Comme le montre le géographe social David Harvey, le capitalisme, qui est un processus continu de création de plus-value, dépend non pas de la croissance simple, mais de la croissance composée, avec une norme historique de 3%. En termes concrets, cela veut dire qu’alors que l’économie mondiale devait trouver le moyen de réinvestir 6 milliards $ en 1970 pour se reproduire, il en faudra 2 billions $ (2 millions de millions) actuellement, et 3 billions $ en 2030, avant de devenir exponentiel et au-delà de l’entendement. Voilà qui n’implique pas en soi la fin du capitalisme, mais qui pose la question des conditions sociales, politiques et environnementales de sa survie, et le prix éventuel à payer (inégalités extrêmes, régions inhabitables, régimes autoritaires, classe rentière, déchirement du tissu social, populations « superflues »). Quelques individus ont déjà les moyens de décider l’avenir de l’humanité (voir Actualités #28), et les aspects d’un monde dystopique à venir sont présents sur les plans réel (la surveillance massive par la NSA) et imaginaire (la franchise Hunger Games, où la question de survie est déplacée sur l’individu).
C’est dans ce contexte, où la part des investissements en capital fixe (productif) n’a cessé à se réduire, qu’on peut mieux comprendre comment on en arrive « rationnellement » à éponger le surplus de capital fictif dans des start-up sans modèle d’affaires viable, sans rentrée d’argent, sans valeur d’usage affirmée, et parfois même sans produit…
À lire : Cédric Durand, Le capital fictif, Les Prairies ordinaires, 2014 ; David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism, Profile Books (London), 2014, surtout p. 222-45.
http://clementsenechal.com/2014/11/24/lessor-du-capital-fictif-comment-la-finance-sapproprie-notre-avenir-collectif/, blog de Clément Sénéchal.
Âpre bataille entre pays pour attirer les tournages de films et de séries américains

Tournée aux quatre coins de l’Europe, la série Game of Thrones, dont la cinquième saison a redémarré le 12 avril dans 170 pays, résume bien la guerre que se livrent les pays du monde pour attirer de grosses productions américaines. Une partie des quatrième et cinquième saisons a été tournée au parc naturel de Thingvellir en Islande, situé pile entre les plaques tectoniques américaine et eurasienne (la Porte sanglante dans la série). (Islande a aussi servi de décor pour les planètes de glace et d’océan dans le film Interstellar). Pour créer le monde médiévo-antiquo-fantastique de Game of Thrones, les producteurs ont choisi des lieux en Irlande du Nord (beaucoup), en Écosse, à Dubrovnik (Croatie), en Espagne, au Maroc, et à Malte.

Dès les années 1970, le Canada et le Royaume-Uni se sont proposés comme lieux de tournage pour les productions américaines. En quelques décennies, profitant d’une main-d’œuvre moins syndiquée et donc moins chère, le Canada a réussi à drainer un quart des productions américaines, cinéma et télévision compris (notamment X-Files dans les années 1990). En Europe, c’est le Royaume-Uni qui domine, avec 60% des dépenses de tournages américains hors d’Amérique du Nord, soit plus d’un milliard d’euros par an, selon le British Film Institute ; en 2014, le septième volet de Star Wars fut tourné dans les célèbres studios de Pinewood, 32 kilomètres à l’ouest de Londres. Cet avantage britannique s’explique en grande partie par sa politique fiscale vis-à-vis des producteurs américains : 25% des dépenses que ces derniers font sur le sol britannique sont remboursées par un crédit d’impôt, y compris les salaires des stars. Ces vingt dernières années, une trentaine de pays ont adopté ce modèle, sans pour autant contester la domination des systèmes canadien et britannique : Allemagne, Nouvelle-Zélande, Islande, Lituanie, Afrique du Sud, France.
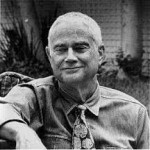

La France n’est vraiment rentrée dans la course qu’en 2009 avec l’instauration d’un crédit d’impôt de 20% des dépenses réalisées en France, dans la limite de 20 millions d’euros, ce qui sera porté à 30% et 30 millions d’euros début 2016, mais sans comprendre les salaires des stars. Elle a réussi à attirer entre autres les tournages de Hunger Games 4 et du pilote de The Cosmopolitans (Amazon). « Studios et producteurs vont toujours là où les avantages financiers sont les meilleurs, à condition que la qualité artistique ne soit pas compromise », dit le producteur chevronné Lawrence Turman. Pour les studios américains, l’argument décisif reste la certitude de trouver sur place une main-d’œuvre qualifiée : techniciens, régisseurs, chefs opérateurs, accessoiristes, figurants, et surtout monteurs, étalonneurs et autres spécialistes de la postproduction. La France semble bien placée avec son industrie du cinéma établie, et ses 110 000 intermittents du spectacle rien qu’en région parisienne, mais son droit de travail est jugé beaucoup moins flexible que celui en Grande-Bretagne, surtout quand il est question de tourner quelques scènes seulement. Les pays d’Europe centrale affichent des coûts de main-d’œuvre 30% à 40% moins cher, mais ils ne disposent pas de toute la gamme des métiers de la production. Explique Joseph Chianese, vice-président d’Entertainment Partners, une société californienne spécialiste des montages financiers dans l’industrie audiovisuelle : « Pour arrêter leur choix, les producteurs dressent le bilan des atouts et faiblesses de chaque pays en fonction des besoins du film : la sélection est implacable ».

C’est là où le choix des décors entre en compte. Chaque pays affine ses arguments en la matière. Islande (Batman Begins, Mémoire de nos pères, Interstellar) met en avant la diversité et l’étrangeté de ses paysages, le tout à quelques kilomètres. La Nouvelle-Zélande propose ses paysages spectaculaires, variés et sauvages qui conviennent à l’univers tolkienien (les sagas Le Seigneur des Anneaux, et Le Hobbit). Le Canada mise sur ses forêts, et ses agglomérations identiques à celles des États-Unis à moindre coût, la France sur son patrimoine historique (le Louvre, Versailles, Notre-Dame de Paris, les châteaux de la Loire), et les pays baltes ou d’Europe centrale sur les centres historiques de leurs capitales. La Lituanie rappelle que ses tristes quartiers sont parfaits pour recréer l’ère soviétique. Les retombées économiques sont importantes ; les grosses productions américaines peuvent dépenser jusqu’à 450 000 euros par jour. Le tournage de quelques séquences d’Interstellar a injecté plus de 5 millions d’euros dans l’économie islandaise, une manne pour ses 320 000 habitants. Au Canada, l’industrie audiovisuelle a créé, dit-on, 400 000 emplois en dix ans.

Le succès planétaire de la saga Le Seigneur des Anneaux a profité à l’industrie du tourisme en Nouvelle-Zélande, qui a vu croître le nombre de visiteurs de 1,7 million en 2000 à 2,4 millions en 2006, une augmentation de 40%. De même, en Irlande du Nord et en Islande, le succès du Game of Thrones a mené à la création de circuits touristiques dédiés pour les pèlerins d’un nouveau type. Selon la Northern Ireland Screen Agency, le tourisme associé à la série a déjà rapporté près de 77 millions d’euros au pays. Depuis 2013, Iceland Travel, une agence de voyages qui jusque-là limitait ses activités en été, organise des circuits en hiver sur les lieux de tournage de la série.
Source : « Les États se bousculent au générique » (Marie Charrel), Le Monde, 12-13 avril 2015, supplément « Éco & Entreprise », p. 2.


En dehors de cela, on ne peut construire durablement une industrie du tourisme sur la base d’un film ou d’une série. Que deviendront les circuits dédiés à Game of Thrones dans dix ou quinze ans, quand la série sera oubliée ? Les retombées pour l’industrie du tourisme sont souvent de court terme, et au détriment des autres secteurs. Pour obtenir le tournage du Hobbit en 2011, à la demande de Warner, la Nouvelle-Zélande a honteusement modifié son droit de travail pour écarter les syndicats, et augmenté les subventions à la production (selon les sources, le chiffre varie entre 25 millions $ et 109 millions $), ce qui fut jugé « exorbitant » par le New Zealand Herald (29 oct. 2010). Les subventions pour Le Seigneur des Anneaux ont atteint 150 millions $, selon le New York Times (23 nov. 2012).
Entrée Wikipédia « Tolkien Tourism » ; « Le Monde », art. cit.
YouTube Poops (des vidéos caca)

Dernièrement, le système de reconnaissance de contenus (Content ID) permet à Viacom, Disney et autres propriétaires d’images de retrouver automatiquement sur YouTube des extraits de leur catalogue. Face aux plaintes reçues, YouTube (Google) supprime sans ménagement les vidéos incriminées, et bannit les poopers responsables. On pourrait à la limite plaider le droit de courte citation à des fins de parodie et de critique (une exception au droit d’auteur), mais les poopers préfèrent réagir en repostant leurs contenus sur de nouveaux comptes dans une guerre sans fin, et en retournant horizontalement les images empruntées pour échapper aux contrôles.
Le genre a vu le développement de figures et de codes propres. Mentionnons le stutter loop (extrait souligné en boucle), l’ear rape (où l’on « viole » les oreilles avec un son très laid, distordu et fort), le sentence mix (séparation au mixage de syllabes de phrases pour en récréer une autre, technique prisée pour des discours politiques ou médiatiques), et le glitch, art numérique plus élaboré qui célèbre l’esthétique des accidents, des bugs.
La réaction de Viacom, Disney et d’autres propriétaires des droits peut être jugée mesquine à l’extrême, vu que les poops ne sont pas source de gains monétaires, sauf dérisoirement à la marge (YouTube rémunère l’auteur d’une vidéo 2,20 $ (2 €) pour 1000 vues). Comme son cousin professionnel, le clip musical, produit culturel condamné au statut de support publicitaire, la vidéo postée sur YouTube n’est pas une marchandise, et n’a aucune chance de la devenir. La dialectique créative entre les industries culturelles et les sous-cultures « rebelles » des jeunes, si forte jadis (on pense au rock et au punk, partie prenante de l’industrie du disque), ne semble plus opérer.
Source : « YouTube Poops, pépites caca » (Camille Gévaudan), Libération, 24 avril 2015, p. 28.
Lire les autres articles de la revue.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)



