Actualités des industries culturelles et numériques #31, mai 2015
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante
Contenu
Le métier de compositeur se paupérise en France
Jusqu’à récemment, la musique à l’image (le film, et par extension, la musique destinée aux jeux vidéo, à la publicité, à la télévision, et aux séries) a été relativement épargnée par la crise du marché du disque.

Certains musiciens venus de la musique pop (Jonny Greenwood notamment) y ont apporté un soufflé nouveau, mais la concurrence exacerbée entre les compositeurs maîtrisant à moindre coût les home studios numériques accentuent leur faiblesse auprès des producteurs et des diffuseurs, qui ne cessent depuis cinq ans de diminuer les budgets alloués à ce poste. Le prix du ticket d’entrée pour devenir compositeur s’est sensiblement réduit ; plus besoin de longues études en harmonie et en contrepoint dans un conservatoire ! Alors que la musique revient en moyenne à 2 % du budget d’un film américain (par rapport à une fourchette de 3 à 6 % dans les années 1960 [1]), en France, selon Patrick Sigwalt, secrétaire général de l’Union des compositeurs de musique de film (UCMF) : « on est plus près de 0,3% ou 0,4% du budget du film, pour environ vingt à trente-cinq minutes de musique. À la télévision, la situation est encore plus difficile. Pour une fiction de 90 minutes, les dernières études font état d’un budget moyen de 15 000 €. Pour les séries, 9000 €, les miniséries, 3000 €, et pour les documentaires, l’effondrement est total, puisque l’on est tombé autour de 2000 € ».

Ces sommes ne représentent même pas les revenus des compositeurs, mais le budget global qui leur est alloué par la production ; aux compositeurs eux-mêmes d’assumer les coûts d’enregistrement, et les salaires des musiciens et des techniciens. Plusieurs fois primé, le compositeur François-Eudes Chanfrault témoigne : « Dans mon travail, je dois souvent répondre aux demandes de réalisateurs consciencieux et exigeants, tout en étant doté de budgets absurdes. Il faut savoir qu’une journée d’enregistrement ou de mixage en studio professionnel coûte environ 1500 euros, ingénieur du son compris. Cinq jours de studio sont la plupart du temps nécessaires pour un long métrage. Au final, comme je suis consciencieux et que je n’ai pas envie de faire de la merde, je me paye mal, et je paye mal les gens avec lesquels je travaille. Les producteurs n’ont aucun souci pour dépenser des sommes conséquentes pour de la location du matériel ou de studio de postproduction, pour des reports numériques, pour les comédiens ou même pour l’achat de musiques préexistantes, mais ils font peu de cas de la création musicale ». Cette situation pousse à la désertification des studios français, les compositeurs étant souvent obligés d’enregistrer à Londres (où les charges sociales sont faibles), ou même en Macédoine, en Bulgarie ou en République tchèque.

Certains professionnels évoquent le dédain historique en France vis-à-vis du caractère artistique de la musique du film. « Par tradition, le réalisateur français est plutôt littéraire, il n’attache qu’une importance secondaire à la musique, même s’il existe bien sûr quelques glorieuses exceptions », prétend Jean-Claude Petit, compositeur et nouveau président de l’UCMF. Quant à lui, Patrick Sigwalt renchérit : « il faut réussir à changer le rapport entre réalisateur et compositeur. La musique étant un art antérieur au cinéma, on ressent trop souvent une forme de crainte de la part du réalisateur à l’encontre de la musique, une peur qu’elle vienne phagocyter l’image ou le discours cinématographique de l’auteur ». Cette antienne, qui contient peut-être une petite part de vérité, est sujette à caution : ce n’est pas le réalisateur qui alloue le budget, et une bonne culture littéraire – les littérateurs (existent-ils encore ?) ont bon dos – n’implique pas en elle-même un moindre égard pour la musique. Qui plus est, l’effondrement de l’industrie musicale est un phénomène mondial, et c’est Hollywood qui a généralisé la pratique de l’underscoring, où la bande originale est intégrée aux dialogues et aux bruitages, et placée au second plan.

De façon plus profonde, Jean-Claude Petit parle « d’une perte de valeur générale de la musique, de toutes les musiques ». Pour le compositeur Jean-Philippe Verdin, « on sent même à la fois une dépréciation du son, de la qualité d’écoute, mais aussi le sentiment que certains considèrent aujourd’hui la musique comme une denrée gratuite, à l’image des titres et des albums que peuvent offrir les opérateurs téléphoniques avec l’achat d’un mobile ou d’un abonnement ».
Quoi qu’il en soit, il faut insister, en fin de compte, sur les rapports de force entre producteurs et compositeurs. Ceux-ci n’ont jamais été très favorables aux derniers (même aux États-Unis où ils sont en principe mieux représentés), mais la situation se dégrade. Normalement, le compositeur touche de la part de la production une première somme au titre de la commande. Ensuite, il touchera via la Sacem une redevance calculée sur les diffusions du film en salles et à la télévision. Théoriquement, la moitié de ces sommes (droits d’auteur) est versée au compositeur, et l’autre moitié (droits d’édition) à son éditeur, censé par coutume lui renverser la plus grande partie de cette redevance (environ 75 %), et assurer la diffusion et l’exploitation de l’œuvre. Mais dorénavant, les droits d’édition tendent à être raflés par les producteurs et les diffuseurs, sans contrepartie. D’autres abus, plus courants dans les domaines de la publicité, de la télévision, et de l’illustration musicale, incluent le non-paiement à la commande (avec la promesse de futurs droits d’auteur comme rémunération), et le partage forcé des droits avec un auteur fictif (le commanditaire). Dans le cas d’une fiction télévisée, les compositeurs doivent la plupart du temps céder 100 % de leurs droits éditoriaux. Jean-Claude Petit de l’UCMF s’indigne : « Pour la télévision, la production ne fait finalement qu’avancer au compositeur l’argent qu’elle va récupérer auprès de la Sacem à travers les droits éditoriaux. Au final, ces producteurs ou ces diffuseurs n’investissent rien dans la musique ! […] Au fond, les compositeurs rencontrent les mêmes problèmes que les ouvriers et les employés : paupérisation, pressions sur les conditions du travail et sur les salaires (les droits d’auteur pouvant être considérés comme leur salaire ».
Le nombre de sociétaires de la Sacem augmente chaque année de 15 à 20 %, mais seulement 4500 d’entre eux (sur 160 000) parviennent à gagner plus de 3000 euros par mois en droits d’auteur. L’avenir de la musique à l’image en France (mais pas seulement) paraît donc sombre.
[1] Robert R. Faulkner, Hollywood Studio Musicians. Their Work and Careers in the Recording Industry, University Press of America, Lanham (Maryland), 1985 (1971), p. 41.
Source : « La débandade originale » (Jean-Yves Leloup), Libération, 1 avril 2015, supplément « Cinéma », pp. VI-VII.
Voir aussi dans la Web-revue David Buxton, « La musique des séries télévisées : de l’underscore au sound design » ; Jean-Baptiste Favory, « Composer avec les stations audionumériques (DAW)« .
Selon Advertising Age, c’est le consommateur qui est responsable du taux de mortalité élevé des séries télévisées
Malgré le ton ironique, le sens est clair : pour les publicitaires, quand on annule une série aux États-Unis, c’est en grande partie la faute du téléspectateur. Non pas en raison du téléchargement illégal (crime inqualifiable), mais du visionnage légal en dehors des clous, autrement dit, en dehors des procédures de mesure. Seule la consommation dite « C3 » (consommation en première diffusion, ou en rediffusion (hertzienne, VOD) dans les trois jours qui suivent) est prise en compte par les indices Nielsen (ratings), qui sont à la base d’un marché publicitaire qui s’élève à 14 milliards $ annuellement.

Le visionnage d’une série sur un appareil mobile n’est pas pris en compte non plus par les indices, ce qui est doublement fâcheux, car il s’agit là d’un public jeune convoité qui regarde de moins en moins la télévision « en linéaire » (baisse annuelle de -14% le dimanche soir pour la démographique 18-34 ans depuis quelques années). « Une grande part du déclin des indices en prime time peut s’expliquer par l’incapacité de Nielsen de mesurer les nouveaux modes de consommation des contenus. […] À mon avis, entre 15% et 40% de l’audience de certains programmes selon le genre n’est pas mesurée », dit Alan Wurtzel, président de recherche et de développement chez NBC Universal.
Pour les quatre saisons 2011, 2012, 2013, 2014, 42 % des séries (scripted shows) ont été annulés (119, soit quasiment 30 par saison). 69 % des nouvelles séries ont été annulés (contre 65 % pour la période 2009-12*). En général, sauf exception, passe à la trappe toute série avec un indice de moins de 1,5 (soit une audience d’environ 2 millions, un point Nielsen représentant 1% des 127 millions d’Américains entre 18-49 ans).
Source : « Your favorite show is going to be cancelled and it’s all your fault » (Anthony Crupi), Advertising Age, avril 3, 2015.
Le taux de mortalité des séries américaines augmente graduellement chaque année, alors que l’audience se fragmente entre diffuseurs et entre supports. Il s’agit d’une contradiction forte entre deux branches du capital, entre l’industrie de produits électroniques, et l’industrie publicitaire, doublée d’une opposition entre sociétés asiatiques (Japon, Corée, Chine) et américaines. L’émergence d’un autre modèle de financement, celui de l’abonnement (HBO, et maintenant Netflix), est un facteur aggravant. Il est grand temps de parler de l’immense gâchis en temps et en ressources créatives qu’est devenu le modèle économique financé uniquement par la publicité, de toute façon en perte de vitesse, surtout chez les jeunes. L’article en question, qui parle officieusement au nom de l’industrie publicitaire, a quelque chose au fond de désespéré.
Il est difficile, compte tenu du nombre sensiblement inférieur de séries diffusées, de faire une comparaison avec les années 1960, mais à titre indicatif, en 1967, 5 sur 13 des séries westerns en prime time furent annulées, soit 38,5 %*. En 1964, quand le système d’indices était encore purement quantitatif, quand il n’y avait que trois networks (donc un choix entre trois programmes commerciaux en prime time), et quand il n’y avait qu’un téléviseur par ménage, une série diffusée le soir devait atteindre un indice de 20 (20% de tous les ménages équipés), et une part de 30 (30% de l’audience) pour survivre, soit au moins 10 millions des 52,8 millions de ménages équipés (92%)**. Autant dire qu’une série à succès de nos jours est beaucoup moins « massifiée » sur le marché américain, et plus dépendante du marché international.
*http://www.tvparty.com/fall67.html ; ** Jon Heitland, The Man from U.N.C.L.E. Book (St Martin’s Press, New York, 1987, p. 43.
Voir dans la web-revue l’analyse de l’écosystème télévisuel américain par Jérôme David, « La logique de spécialisation des chaînes américaines« .
Et si chaque internaute devenait chaîne de télévision ?

Ces dernières années, plusieurs start-up ont essayé de réaliser ce vieux fantasme, de Justin.tv à Livestream en passant par Twitch, spin-off de Justin.tv spécialisant dans la retransmission en direct de jeux vidéo, et qui a été rachetée par Amazon pour 1 milliard de dollars. La généralisation des smartphones et la toute-puissance des réseaux sociaux ont fait émerger d’autres start-up dans ce créneau : l’israélo-américaine Meerkat qui compte déjà 500 000 utilisateurs ; Periscope (rachetée par Twitter pour 100 millions de dollars, dit-on, avant même que le produit n’existe) ; et InfiniteTakes (de Charleston, Caroline du sud), qui a lancé une version profondément remaniée de son application Stre.am en janvier 2015.
Le principe est de permettre à n’importe qui de filmer une scène avec son smartphone, et de la diffuser en direct via les réseaux sociaux. L’application est simple au possible : il suffit d’appuyer sur un bouton pour filmer et diffuser en ligne en même temps, alors que les contacts Facebook et Twitter sont alertés automatiquement. « Nous voulions créer quelque chose le plus proche possible de la téléportation. […] Imaginez si vous pouvez voir à travers les yeux d’un manifestant en Ukraine », ont annoncé les fondateurs de Periscope lors du lancement de l’application en mars, ce qui témoigne de l’influence pérenne de la série Star Trek dans la culture des informaticiens. Pour Dan Pfeiffer, ancien conseiller de Barack Obama, Meerkat et Periscope pourraient « changer l’élection présidentielle américaine de 2016 comme Facebook a changé celle de 2008, et Twitter celle de 2012. […] Ces applis pourraient faire à la télévision ce que les blogs ont fait aux journaux, en faisant tomber leurs avantages financiers et structurels ».

Les plateformes vidéo traditionnelles comme YouTube et Daily Motion ont toujours été prudentes avec le direct, en raison de l’impossibilité de contrôler le contenu des flux, d’autant que les autorités leur demandent déjà davantage de coopération pour écarter, par exemple, la propagande terroriste. À cet égard, la réponse de Ben Rubin, ancien directeur de Yevvo (application abandonnée au début 2015), et cofondateur de Meerkat, n’est pas très convaincante, même si la diffusion de vidéos sur ce dernier se limite en principe aux « amis » : « Nous faisons confiance à notre communauté pour signaler les contenus inappropriés. En matière de sécurité, nous avons une politique de tolérance zéro ».
Meerkat est devenu l’une des applications les plus téléchargées sur les App Stores, et a réussi à lever 14 millions de dollars en mars, mais l’arrivée de Periscope, qui bénéficie du poids logistique de Twitter (et sans parler d’autres acteurs potentiels comme Facebook, et même YouTube), pourrait freiner sérieusement son expansion. La stratégie de Rubin face aux concurrents est de construire son propre réseau social et d’offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités.
Source : « La guerre fait rage pour la diffusion de vidéos en direct sur le Net » (Nicolas Rauline), Les Échos, 31 mars 2015, p. 20.

Les prolongements de Twitter que sont Meerkat (qui ne donne pas la possibilité de sauvegarder les flux vidéo), Stre.am (qui peut être sauvegardé sur son smartphone, mais pas sur un serveur) et Periscope (qui offre un replay des livestreams pendant 24 heures) inaugurent peut-être un nouveau marché de masse. On se souvient, cependant, de l’engouement initial pour les blogs, vite retombé faute de lecteurs. Vivre par procuration à travers les yeux de l’autre, fût-ce un(e) « ami(e) », devrait contenir ses limites propres, ne serait-ce que par narcissismes qui s’annulent. Par contre, la possibilité de prendre une douche avec une célébrité par vidéo interposée pourrait générer des dizaines de millions de vues, logique de la surenchère oblige.

En dehors de ces considérations politiques et éthiques, j’aimerais insister sur le montant des capitaux disponibles pour les start-up en question, dont l’utilité sociale est à débattre (1 milliard de dollars par-ci, 100 millions de dollars par-là, sans produit…). Je reviendrai sur le rôle du capital-risque (venture capital) à la Silicon Valley le mois prochain.
Les investissements dans le cinéma en France sont en net repli
L’année dernière, la production de films majoritairement français est restée supérieure à 200 pour la cinquième année d’affilée. Avec 203 films, le repli n’est que de six par rapport à 2013, mais les investissements ont baissé de 800 millions d’euros, soit 22% en moins, le plus bas niveau depuis le début des années 2000. Par rapport à 2011 (1,028 milliards d’euros, le recul atteint presque 30%. Effet de la crise, le devis moyen d’un film français est passé sous la barre de 4 millions d’euros l’an dernier, contre 6 millions d’euros en 2008.
Le nombre de films affichant un devis supérieur à 15 millions d’euros est passé de 12 à 3, alors que celui de films à plus de 7 millions d’euros a diminué de 25%. Les distributeurs privés historiques comme Canal +, qui avaient les moyens de financer les grosses productions, y mettent désormais moins d’argent, alors que les chaînes publiques, qui financent les films à budget moyen, ont augmenté leurs investissements de 10%. Mais ce sont essentiellement les financements internationaux qui ont chuté l’année dernière : 81 millions d’euros en moins, soit une baisse de presque 60%.
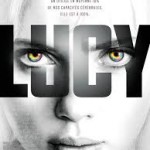
Source, « Cinéma : autant de films et moins d’argent en 2014 » (Grégoire Poussielgue), Les Échos, 26 mars 2015, p. 23.
Lire les autres articles de la rubrique

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)



