Actualités des industries culturelles et numériques #27, janvier 2015
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante
Contenu
Contestation grandissante des sites de streaming musicaux

Le Conseil international des créateurs de musique (Ciam) et la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Clisac) travaillent sur l’établissement d’un label de commerce équitable pour les plateformes d’achat et d’écoute de musique en ligne, après en avoir approuvé le principe lors de leur congrès à Costa Rica en 2013. Cette année, à leur congrès annuel à Nashville, les deux associations ont publié une étude de travail. « Reste à obtenir la transparence sur la répartition des revenus de la musique en ligne, puis à contacter les organisations d’utilisateurs, puis à s’adresser aux Spotify de la planète, et enfin à créer un comité indépendant qui pourra décerner un label « Fair Trade » aux plateformes internet de musique en ligne », dit Lorenzo Ferrero, compositeur italien et président du Ciam. Vaste programme qui prendra trois ans à mettre en œuvre.
L’étude publiée par le Ciam montre que si les sites de streaming reversent 60 à 70 % de leurs revenus aux ayant droits (le Ciam milite pour 80 %), ce sont les maisons de disques, également actionnaires de certaines plateformes dont Spotify, qui raflent la plus grosse part. En effet, les labels, avec les interprètes, touchent 96 % de ces revenus, laissant 4 % aux compositeurs et aux éditeurs. D’après un éditeur anonyme cité dans une enquête du New Yorker, « les majors ont sacrifié leurs divisions publishing pour sauver leurs labels. Les artistes se sont donc fait avoir ». Spotify, par exemple, verse de l’argent aux labels en fonction du pourcentage d’écoutes en ligne, mais ceux-ci sont ensuite libres de redistribuer cet argent comme ils entendent. Le patron de Sony-ATV, Marty Bandier, qui juge la situation « inacceptable », a révélé que l’un des plus gros tubes aux États-Unis, All of me (John Legend), a été écouté 55 millions de fois sur Pandora, le leader américain du streaming, mais n’a rapporté que 3400 $ à l’artiste et à sa maison de disques, soit 60 $ par million d’écoutes. Pas grand-chose donc à redistribuer…

En novembre, la chanteuse Taylor Swift, mécontente de cette rémunération en cacahuètes, a retiré tous ses titres des sites Spotify et Deezer, où elle avait atteint 16 millions d’écoutes lors du mois précédent. Sans prendre une action aussi drastique, car craignant de disparaître sous le radar promotionnel, de nombreux artistes d’envergure ont retardé la mise à disposition en streaming de leurs nouveaux albums, afin de ne pas perdre des ventes. Déjà en 2013, Scott Borchetta, responsable de Big Machine Records (la maison de Taylor Swift), avait accusé les services de streaming de participer à « une course continuelle vers le bas ». Pour sa part, Spotify rétorque vertueusement : « Nous estimons que les fans devraient être capables d’écouter de la musique où et quand ils le souhaitent, et que les artistes ont absolument le droit d’être payés pour leur travail, et protégés du piratage ».
Dans un développement séparé, la société Global Music Rights (GMR), qui gère les droits d’auteur de plusieurs dizaines d’artistes importants (Pharrell Williams, Christine Aguilera, The Eagles, John Lennon, Fleetwood Mac), réclame un milliard de dollars en dommages à YouTube si la filiale de Google ne retire pas de sa plateforme les quelques 20 000 chansons des artistes représentés par GMR, mises en ligne sans autorisation. La menace d’intenter une action en justice a été déclenchée par l’annonce, en novembre, que YouTube allait lancer son propre service de streaming, Music Key. Pour le moment, YouTube se retranche derrière le Digital Millennium Copyright Act de 1998 qui oblige les ayants droits de répertorier l’URL de chaque titre, tâche titanesque qui reviendrait pour GMR à lister mois après mois des centaines de milliers de vidéos. GMR rétorque que YouTube en aurait déjà les moyens d’identifier les morceaux, grâce à ContentID, une technologie que le site a lui-même développée. Les lawyers des deux côtés aiguisent leurs couteaux…
Sources : « Les Échos », 1 déc. 2014 (Nicolas Madelaine) ; « Huffington Post », 3 déc. 2014 ; « Le Monde », 28-29 déc. 2014 (Stéphane Lauer), p. 10.
L’industrie culturelle est le troisième employeur européen
Le Groupement européen des sociétés d’auteurs et de compositeurs (GESAC) a commandité une étude au cabinet EY (ex-Ernst & Young) afin d’évaluer le poids économique du secteur culturel en Europe. D’après le rapport, publié en décembre, les industries culturelles et créatives au sens large, allant du livre à la publicité en passant par les arts visuels et le spectacle vivant, pèseraient 536 milliards €, soit 4,2 % du PIB européen. Elles emploient 7,1 millions de personnes, ce qui en fait d’elles le troisième employeur de l’UE (hors secteur public), derrière la construction (15,3 millions) et la restauration (7,3 millions).
Selon Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem (France), qui a joué un rôle influent dans la publication du rapport : « Le secteur de la culture est souvent accusé de peser sur l’activité. Toutes les conclusions de cette étude démontrent exactement l’inverse, comme l’avait une étude similaire publiée l’an dernier à propos des industries culturelles en France… Beaucoup de ces emplois émanent de PME très flexibles et réactives, parfois mêmes constituées d’une seule personne : c’est ce que les économistes présentent comme la catégorie d’emplois la mieux placée pour résister à la mondialisation ». Il note que 90 % de la création de valeur dans le secteur provient du secteur privé, et que le nombre de ses emplois a continué à croître de 0,7 % pendant les années de crise (2008-12), alors que l’UE dans son ensemble a perdu des emplois au même rythme.

Les emplois de la culture, soutient le rapport, sont difficiles à délocaliser, et sont occupés par des jeunes, garants de dynamisme économique. Les deux grands pôles des industries culturelles en Europe, Londres et Paris, ont le mieux résisté aux effets de la crise de 2008. Le document déplore que les crédits publics alloués à la culture (qui ne représentent que 1 % des budgets de 28 pays membres) aient baissé de 1 % en moyenne entre 2008 et 2012. Selon Jean-Noël Tronc, « les efforts faits pour abattre les frontières, de type marché européen des droits d’auteur, sont un ânerie suicidaire : il faut comprendre qu’on doit vivre avec la fragmentation culturelle, et que c’est un atout ». Pour lui, il faut renforcer à l’échelle européen certains dispositifs « efficaces », en l’occurrence français : la TVA réduite sur le livre, et la subvention des films via le Centre national du cinéma (CNC).
Commentaire : le rapport ne semble pas aborder la question de la qualité des emplois dans la culture (précarité, etc.). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un document de contre-attaque, à forte influence française, qui veut s’assurer d’abord de la reconduite des subventions européennes. En période d’austérité impulsée par l’Allemagne et la Banque centrale européenne, il y aura du pain sur la planche. En arrière plan, les négociations commerciales redoutables à venir entre l’Union européenne et les États-Unis (TTIP) sur, entre autres choses, l’avenir des subventions, et la généralisation d’une conception anglo-saxonne des droits d’auteur (copyright), nettement à l’avantage des grandes entreprises.
Source : « Les Échos », 1 déc. 2014 (Nicolas Madelaine).
Netflix réserve la mini-série Marco Polo pour ses abonnés

Source : « Huffington Post », 7 déc. 2014.
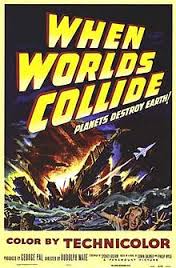
[1] http://youtu.be/H1Wu-zAdbc4 (entretien très intéressant, en anglais).
Les « web-apps » concurrencent les « applications natives » (iOS et Android)


Tout n’est pas perdu cependant pour la navigation sur Internet. Le standard HTML5 permet de développer un site ou une application pour toutes les plateformes (iOS, Android, PC, mobiles, tablettes). On parle alors d’application web (web-app) par opposition à l’application native développée spécialement pour iOS ou Android. En termes de performance, les applications web sont encore nettement en deçà des applications natives, même si elles s’améliorent à grande vitesse. Pour certains usages nécessitant la communication avec un téléphone, l’application native reste obligatoire : la géolocalisation, le mode hors ligne et les services de photo. Pour Marie-Caroline Lanfranchi, associée et directrice adjointe de l’agence d’innovation Fabernovel :
Applications natives et web peuvent être complémentaires, beaucoup de clients font les deux. Si vous êtes un musée par exemple, vous aurez intérêt à développer un site web en « responsive design » [qui s’adapte automatiquement à la taille de l’écran grâce au HTML5] pour y mettre toutes les informations pratiques, les horaires d’ouverture… Mais si vous voulez mettre en valeur une exposition, mieux vaut développer une application native, où vous aurez de meilleures photos, des vidéos, etc.

Il est aujourd’hui possible de développer une application avec une « base Web », puis d’ajouter des couches pour l’adapter à chaque plateforme. Explique Alexis Godais, fondateur de l’agence Buzzaka :
Le niveau de performance ne sera certes pas le même qu’une appli traditionnelle, mais on peut arriver à des coûts quatre fois moindres. Cela permet de développer pour toute plateforme alors qu’aujourd’hui, beaucoup de clients doivent choisir entre iOS et Android pour des raisons budgétaires et se coupent d’une partie de leur cible… Difficile de faire des projections mais, à long terme, [passer au 100 % Web] sera sans doute possible.

Mozilla fait la promotion des technologies ouvertes pour les développeurs d’applications. « Les choses sont en train de changer et c’est le sens de l’Histoire. Développer une fois pour toutes, sur toutes les plate-formes, c’est plus simple », affirme Tristan Nitot, président de Mozilla Europe. Les avantages des applications web sont nombreux : coûts de développement moindres, conservation de 100 % des revenus générés (sans verser les 30% de commission à Apple ou Google), contrôle des contenus, mises à jour automatiques. Le site du Financial Times (dès 2011) et Quartz (site lancé par The Atlantic en 2012) ont opté pour une application web sans application native. En France, peu de médias osent pour le moment se passer d’Apple ou de Google. Graham Hinchly, jeune directeur de l’ingénierie au FT Labs :
Je ne m’attends pas à voir beaucoup d’éditeurs se passer de leurs applications natives dans un futur proche, mais je pense qu’ils vont investir de plus en plus dans des applications web, afin d’éviter d’être trop lié à un seul acteur. Cela réduit aussi les risques de changement dans ces boutiques, économiques ou juridiques, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses en termes de business.
Sources : « Les Échos », 24 nov. 2014, p. 24 (« Internet : ces nouveaux outils qui sapent l’hégémonie des applis » et « Plusieurs médias anglo-saxons ont déjà choisi de s’affranchir d’Apple » – Nicolas Rauline).
Ruée sur les contenus audiovisuels en Chine, retour de la censure

En Chine, les productions télévisuelles et cinématographiques sont de plus en plus convoitées par des grands groupes très divers, mais à leur manière liés incestueusement. Dalian Wanda Group (immobilier), Alibaba (commerce en ligne), et Tencent (jeux vidéo, réseaux sociaux) multiplient les initiatives dans ce secteur avec en ligne de mire l’accès au savoir-faire américain. Après avoir mis la main sur AMC, le deuxième réseau de salles de cinéma aux États-Unis, Dalian Wanda Group cherche à prendre une part majoritaire dans les studios Lions Gate (Hunger Games), lesquels intéressent aussi Alibaba, dont le patron Jack Ma s’est rendu à Los Angeles en novembre pour explorer des pistes de partenariat. Quant à Tencent, il vient de signer avec HBO un contrat de distribution exclusive sur l’Internet chinois. Baidu, le grand moteur de recherche, et Xiaomi, un nouvel entrant sur le marché des smartphones, ont pris des parts dans iQiyi, le principal portail vidéo en Chine, tandis que Xiaomi a annoncé des projets de coproduction avec Youku Tudou, l’autre grand portail chinois. Alibaba a racheté 60% des studios de production China Media Group, et a entré au capital des studios Huayai Brothers Media Corporation, aux côtés de Tencent Holdings !
Comment expliquer une telle frénésie ? D’abord, il y a une dimension politique : le gouvernement a clairement fait savoir qu’il compte sur le cinéma pour faire rayonner la Chine à l’international (« soft power ») et à cette fin, il octroie des aides fiscales et des subventions à la filière. Ensuite, une dimension économique : le cinéma, avec une croissance de son chiffre d’affaires de 30% en moyenne depuis dix ans, se présente comme un investissement de choix pour des grands groupes chinois, qui ont atteint des positions dominantes dans leurs industries respectives, et qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Pour les groupes issus du monde des technologies, les investissements dans les contenus audiovisuels vont de soi. Xiaomi (smartphones) a besoin de contenus à diffuser sur ses terminaux, alors que Tencent (réseaux sociaux) entend monétiser les clients de ses plateformes en leur proposant des films et des séries.
Quant à Alibaba, qui a raflé 80% du marché du commerce en ligne, il est condamné à se diversifier. Dans le cinéma, note Huang Guofeng, analyste chez Analysys International, il existe « la possibilité de vendre, sur son réseau de distribution, tous les produits dérivés, qui jusqu’à présent lui échappent totalement ». Voilà énoncée la principale faiblesse de l’industrie du cinéma chinoise. La billetterie représente près de 80% de son chiffre d’affaires, un chiffre anormalement élevé, qui indique que beaucoup reste à faire dans l’exploitation des produits dérivés.

Disney a proposé une version spéciale d’Iron Man 3 (voir « Actualités #9 », mai 2013) avec acteurs et placements de produits chinois ; pour le remake du film anticommuniste primaire Red Dawn (2012, première version 1984), MGM a transformé dans la postproduction les envahisseurs chinois en Nord-Coréens (que même les Chinois ne veulent pas défendre) ; Warner Bros a coupé une quarantaine de minutes de Cloud Atlas (2013) afin de ne pas incommoder la censure chinoise. Cela dit, les entreprises américaines, proactives et pas seulement réactives, investissent de plus en plus sur place. Dreamworks a formé une joint-venture avec plusieurs sociétés chinoises (Oriental DreamWorks) qui ont produit Kung Fu Panda 3 (sortie prévue en 2016). Disney va ouvrir un parc à thème à Shanghai l’année prochaine (5,5 milliards $), et Universal a un projet similaire pour Pékin. Pour Charles Rivdin, chargé de la diplomatie économique au département d’État, ce qui compte par-dessus tout, c’est « la certitude et la sécurité qu’apportent une application rigoureuse des droits de propriété intellectuelle et une protection des intérêts des investisseurs ».

Ces derniers temps, la tolérance relative des productions étrangères s’amenuise sensiblement. Depuis septembre, il faut faire valider par le bureau de censure toute série télévisée produite à l’étranger, avant diffusion sur Internet. Le 2 décembre, en écho lointain de la « révolution culturelle » maoïste des années 1960, le pouvoir a annoncé un projet pour emmener régulièrement les producteurs de télévision et de cinéma à la campagne auprès des « masses », afin qu’ils acquièrent une vision « correcte » de la culture. Les discours officiels volontiers anti-occidentaux, et les interdictions récentes (notamment à Wenzhou, grande ville commerçante à 20 % chrétienne) de fêter Noël, raillée pour son caractère réactionnaire, témoignent de la volonté des autorités de réimposer « les valeurs socialistes fondamentales ». Petite différence tout de même : celles-ci mobilisent désormais le vieux sage Confucius, conspué sous Mao, afin de combler « le vide des valeurs morales », dû essentiellement aux yeux des autorités à la surexposition aux produits culturels américains. Entre ouverture au monde et repli sur des valeurs traditionnelles, la situation du cinéma en Chine est contradictoire au possible.
Sources : « Les Échos », 5-6 déc, 2014, p. 27 (« L’audiovisuel, nouvel eldorado chinois » et « Le cinéma chinois entre doute et euphorie » – Gabriel Grésillon ; « Hollywood prêt à modifier ses productions pour plaire aux Chinois » – Karl De Meyer). « Le Monde », 28-29 déc. 2014 (« Pékin appelle à résister à Noël » (Brice Pedroletti)).
Lire l’article de Chen Yuzhe dans la web-revue sur les plateformes de streaming de films et de séries en Chine.
Lire les autres articles de la rubrique

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)



