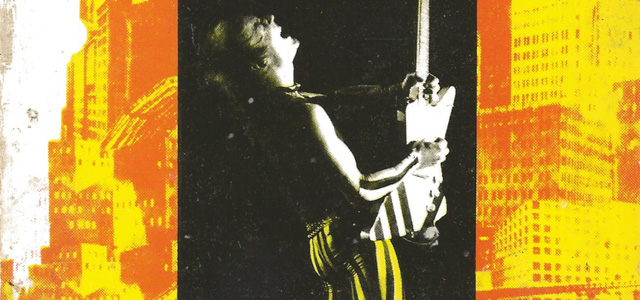Le rock – Chapitre 1 : La montée du star-system dans la musique populaire – David BUXTON
Le rock, star-system et société de consommation, livre de David Buxton adapté d’une thèse de doctorat soutenue en 1983, fut publié par La Pensée sauvage, petit éditeur grenoblois, en 1985 ; il est devenu introuvable, sauf dans quelques bibliothèques universitaires et encore. À l’initiative du webmaster, la Web-revue a décidé d’en assurer une nouvelle édition numérique au rythme d’un chapitre par mois. Ce livre se voulait une approche conceptuelle et critique de l’impact idéologique du rock. Des débuts de l’industrie du disque microsillon aux punks et aux vidéo-clips, en passant par l’invention du teenager et l’impact capital de la contre-culture et des nouveaux médias de l’époque, le rock sert de point d’entrée dans la société afin de mieux comprendre d’autres phénomènes sociaux comme la consommation de biens culturels et la technologie.
Interdit à la publication payante
Contenu
Le centre d’une nouvelle culture ?
Au milieu des années 1960, la musique rock a pris une importance qui dépassait de loin le champ de la musique. La consommation massive de rock, devenu soi-disant une forme folk aux valeurs radicales et « alternatives », a été considérée comme la preuve d’un changement politique chez les jeunes. On suivait des idéologues de gauche aux États-Unis comme Tom Hayden et Eldridge Cleaver pour penser que la « libération » des jeunes Blancs pouvait trouver ses racines dans le rock. Dès lors, il ne restait plus qu’un petit pas à franchir pour en arriver aux idées de « révolution culturelle » ou de « libération de l’esprit » (à l’aide des moyens psychédéliques ou autres) qui pouvaient servir d’alternative à la révolution politique, voire la réaliser. Comme le critique Robert Christgau le déclarait :
Le rock and roll, comme nous le savons tous, a été l’instrument qui a creusé le fossé entre les générations et qui a fertilisé l’énergie essentiellement sexuelle qui a circulé parmi la jeunesse dont le style de vie, comme nous le savons tous, va révolutionner le monde. [1]

Suivant Paul Kanter, guitariste de Jefferson Airplane : « La révolution est déjà là, mec. Tous ces kids qui laissent tomber, qui fument de la dope, qui se branchent. C’est important » [2]. L’importance du rock comme vecteur d’un style de vie, d’une mentalité sociale cohérente peut se voir dans le manifeste qui suit, publié dans un journal underground de San Francisco :
Les principes du rock ne se limitent pas à la musique : le futur se dessine en grande partie dans ses aspirations aujourd’hui (à savoir la liberté totale, l’expérience totale, l’amour total, la paix et l’affection). Le rock est une façon de vivre internationale, en train de devenir universelle ; il ne peut être arrêté, ralenti, supprimé, assourdi, modifié ou contrôlé. Le rock est un phénomène tribal, à l’abri de la définition… et constitue ce que l’on pourrait appeler une forme de magie au xxème siècle. Le rock est un agent vital dans l’effondrement des distinctions absolues et arbitraires. Les desiderata du rock sont la participation en groupe et l’expérience totale. Le rock est en train de créer les rituels sociaux de l’avenir. Le rock présente une esthétique de la découverte. Le rock est en train de faire évoluer les configurations de l’homo gestalt. [3]
Cette vision du rôle du rock, aussi délirante qu’elle soit rétrospectivement, a été partagée par les maisons de disques. Jac Holzman, président des disques Elektra, affirmait :
Elektra n’est pas l’outil de la révolution de qui que ce soit. Nous pensons que la révolution sera gagnée par la poésie et non par la politique… que la poésie changera la structure du monde. Elle a déjà atteint les jeunes et elles les atteint au meilleur niveau possible. [4]
En dépit de son désir apparent de véhiculer la révolution, la musique rock est d’une certaine façon devenue le vecteur de la solidarité avec les grandes sociétés. Une publicité pour la firme Columbia proclamait en 1967 :
Les autorités ne peuvent pas arrêter notre musique… Sachez qui sont vos amis. Regardez, touchez, restez tous ensemble, puis écoutez. Nous faisons la même chose (je souligne). [5]
Les maisons de disques contribuaient au financement de la presse alternative ou underground. En 1967, le magazine alternatif Rolling Stone sollicitait ainsi des abonnements dans le New York Times :
Vous savez que le rock and roll c’est plus que de la musique, c’est le centre énergétique de la nouvelle culture et de la révolution de la jeunesse. [6]
On se trouve devant une énigme. Premièrement, comment et pourquoi le rock a-t-il pu devenir « le centre énergétique de la nouvelle culture » et deuxièmement, comment en était-on arrivé à cette situation où la nouvelle gauche et les multinationales du disque proclamaient ensemble l’importance centrale du rock en tant que force culturelle révolutionnaire ?
La valeur d’usage du disque
Il faut souligner qu’il n’y avait rien d’acquis dans l’apparition puis dans la domination de la marchandise-disque dans la musique populaire. Bien que la tradition folk locale, anonyme et communautaire ait largement décliné en Angleterre et aux États-Unis au début du siècle en raison de l’éclatement des communautés rurales par l’industrialisation rapide, la musique populaire continuait à exister en dehors ou en marge des circuits commerciaux. Le chant dans les bars, le chant amateur, les music-halls et les troupes itinérantes prédominaient. La musique populaire était, en fait, à cette époque, surtout pas au point de devenir un bien quasi obligatoire pour les jeunes de la fin des années 1960 et de remplacer les concerts en importance. Il aurait été concevable que le disque reste un bien de consommation marginal pour les collectionneurs ou les amateurs de musique. Les explications économiques qui se fondent sur le fait qu’il y avait plus d’argent à dépenser présupposent également un concept anhistorique de besoin et ne nous disent pas pourquoi les consommateurs dépensent leur argent en achetant des disques plutôt qu’autre chose. L’apparition du disque en tant que bien de consommation de masse dépendait de la création d’une nouvelle valeur d’usage sociale de la musique populaire sous la forme commerciale de disque. C’est cette utilité sociale spécifique du disque que nous devons à présent expliquer.

Selon Marx, le bien de consommation a une valeur d’usage parce qu’il satisfait un désir humain d’une sorte ou d’une autre ; l’utilité d’une chose lui donne une valeur d’usage [7]. Mais pour Jean Baudrillard, la conception de valeur d’usage utilisée par Marx est d’ordre naturaliste, car la valeur d’usage n’est pas impliquée dans la logique de la valeur d’échange, mais a sa finalité propre qui se fonde sur le besoin, certes historique. Chez Marx, la fétichisation de la marchandise — le processus par lequel les choses deviennent vivantes et les gens vivants deviennent des choses — ne joue pas sur la valeur d’usage, car ce dernier n’est pas un rapport social, ni donc un lieu de fétichisation. Baudrillard, au contraire, affirme que la valeur d’usage est aussi un rapport social fétichisé ; sur les besoins ou mieux le système des besoins…
… se fonde le système de la valeur d’usage, comme sur le travail social abstrait se fonde le système de la valeur d’échange. L’hypothèse implique aussi, pour qu’il y ait système qu’une même logique abstraite de l’équivalence règle la valeur d’usage et la valeur d’échange, un même code. Le code d’utilité est aussi un code d’équivalence abstraite des objets et des sujets (de chacun d’eux et des deux ensembles dans leur rapport)… c’est en tant que système, et non pas, bien sûr, en tant qu’opération pratique que la valeur d’usage peut être “fétichisée”. Ce sont les deux fétichisations, celle de la valeur d’usage et celle de la valeur d’échange, elles seules réunies, qui constituent le fétichisme de la marchandise. [8]
Il y a plusieurs raisons pour adopter l’hypothèse de Baudrillard. Premièrement, Marx écrivait avant l’arrivée des mécanismes de la publicité et des médias de masse que connait la société moderne. La création des besoins est bien plus avancée qu’à l’époque où Marx a pu écrire que le capitaliste « cherche les moyens de pousser les travailleurs à la consommation, de donner à ses marchandises de nouveaux charmes, de créer de nouveaux besoins avec des bruits qui courent, un constant bavardage, etc. » [9] Deuxièmement, aborder la musique populaire par le biais de la valeur d’échange, non seulement n’échappe pas à la tendance à réduire les phénomènes culturels aux seuls aspects économiques, mais ne nous permet pas d’expliquer pourquoi le disque a prédominé sur d’autres formes de la commercialisation de la musique, et pourquoi la musique rock a pu être investie par autant de discours idéologiques dans les années 1960. Si l’on prend la valeur d’usage du disque comme quelque chose d’évident, on se limite à remarquer le passage de la musique populaire à sa forme marchande, supposant, implicitement, que la commercialisation soit la seule chose qui s’est passée. En effet, on voit la musique comme quelque chose qui attendait, sous sa forme pure, d’être commercialisée. Dès lors, il ne restait plus qu’un petit pas à franchir pour en arriver aux jugements d’un ordre moraliste quant à la musique commercialisée par rapport à un passé où la musique a pu exister sous sa forme « naturelle ». La commercialisation de la musique populaire et l’apparition du disque furent un processus social complexe : pourquoi alors le disque est-il apparu en tant que médium de masse pour certaines formes populaires aux États-Unis et non en Europe ? Pourquoi ces formes musicales américaines ont pu conquérir le monde à un tel point ? Qu’est-ce qui explique l’essor du disque dans les années 1950 et 1960 ?
Il ne faut pas oublier que le disque a commencé sa vie en tant qu’enregistreur des conversations téléphoniques. Edison, l’inventeur, a envisagé un usage éventuel dans la politique et dans les affaires. Cela nous permet de voir qu’une valeur d’usage pour le disque a été créée et non acquise, le lien entre le disque et la musique n’avait rien d’automatique.
Une fois acquise, la valeur d’usage n’est pas constante comme nous allons le voir dans le cas du disque. Elle ne devrait pas être comprise comme quelque chose de « naturel », ni même comme largement déterminée par les facteurs historiques et sociaux, mais comme un facteur fluctuant et variable de la marchandise elle-même, dépendant des transformations ou des déplacements dans le code abstrait des signes qui règlent en général la valeur d’usage sociale. Ce code va au-delà d’une simple valeur d’usage fonctionnelle — quoiqu’il n’existe pas un degré zéro isolable du fonctionnel — et cela d’autant plus dans le cas de produits culturels comme le disque, auquel cas la capacité de la marchandise à absorber les signifiants est d’autant plus potentiellement infinie. Nous appellerons cette absorption une valeur d’usage accrue de la marchandise.
Ce processus d’absorption, une des stratégies majeures du capitalisme du vingtième siècle à travers la publicité et les médias, tente de faire advenir la marchandise à un public de masse en la surdéterminant de valeur symbolique. Cela prend une importance capitale avec l’avènement de la production de masse et l’expansion des biens de consommation. Les arguments de Baudrillard, bien qu’ils soient d’une abstraction imposante à première vue, nous permettent de comprendre comment les jeans, par exemple, originellement un produit spécialisé pour les cowboys, sont devenus, à la fin des années 1960, un produit presque universel, identifié avec la jeunesse détendue, énergétique et « libérée » des contraintes puritaines. Dans la mesure où cette transformation du code des signes attachés à l’usage des jeans a permis au produit de devenir un symbole-clé de tout un style de vie, nous pourrons parler d’un accroissement de leur valeur d’usage, manifesté par son statut de marchandise de masse. Cet argument suppose que l’accession du disque au statut de produit de masse soit due davantage aux stratégies symboliques investies en lui qu’aux qualités inhérentes à la musique ou au « besoin naturel » de musique. Nous allons explorer l’histoire de la valeur d’usage du disque en analysant les transformations du code des signes qui règlent « l’utilité » du disque.
La montée de la star
Les partitions constituaient antérieurement la principale forme de marchandise de la musique populaire. Au début du siècle, la représentation n’était guère organisée à l’échelle de masse.
La culture folk appartenait à une vie communautaire — arts ruraux, ballades, chansons de travail, danses, jeux et artisanat. Ces arts et ces artisanats étaient proches de la vie et des gens et parlaient d’un monde concret familier à tous, ils célébraient rituellement la communauté. Le matériel était familier et se transmettait de génération en génération ; il y avait peu de différence entre public et musicien, car la pratique rudimentaire d’un instrument était courante. Le musicien n’était pas un créateur des chansons, mais le véhicule de l’expression de la culture. « Mon nom n’a rien d’extraordinaire, aussi ne le dirai-je pas », disaient les chanteurs du folk.

Le music-hall, par exemple, ressemblait cependant à l’ancienne musique folk en ce qu’il traitait de la vie et de la culture de la classe ouvrière au moyen du spectacle, chanson et comédie, encadré par des références et des attitudes communes. Il y avait encore un rapport partagé entre le musicien et le public, un sens de communauté. Pourtant il y avait une différence importante. Le music-hall (ou bien les spectacles de vaudeville, etc.) c’était l’art du chanteur plutôt que la culture folk de la communauté. Dans ce confinement de la musique populaire dans un lieu, le chanteur avait été individualisé. Il s’agissait ainsi d’un stade transitoire entre l’art folk et la musique populaire dans le sens moderne. Il y eut toute une liste de musiciens et de chanteurs de qualité qui établirent une réputation régionale grâce à la force de leur style personnel.
Pour les musiciens du music-hall, le lien avec le public était une condition de l’art qu’ils pratiquaient. En tant que tel, le music-hall était la confirmation d’expériences connues. Trop implantés dans les traditions régionales, les chanteurs de music-hall n’étaient pas des stars au sens moderne, mais plutôt des personnalités locales. Comme toutes les formes traditionnellement folkloriques, leur musique était trop étroitement régionale pour l’exploitation rentable par disques. La célébrité de chanteurs d’opéra comme Enrico Caruso (qui fut le premier à vendre un million de disques en 1903) dépendait de ce que leur talent soit largement remarqué afin de transcender les publics locaux.
La musique country

L’entrée de la musique country dans le circuit commercial est plus ou moins établie au milieu du XIXe siècle dans les villes, dans lesquelles la musique est circonscrite dans des lieux spécifiques que sont les minstrel shows et les théâtres de vaudeville, sans oublier les saloons et les bordels. Dans les régions rurales des Etats-Unis, pourtant, la tradition folk persiste. Cependant une commercialisation existe déjà sous la forme des medicine shows ou physick wagons, qui se déplacent de ville en ville, vendant des « médecines » pour le moins suspectes, et qui emploient presque toujours un ou plusieurs amuseurs ou musiciens. De plus, il y a des travelling circuses ou des spectacles de vaudeville qui voyagent même jusque dans les plus petits villages dans le Sud, y restant jusqu’au jour où tous les villageois assistent au spectacle. Finalement, il y a des barn dances : traditionnellement, ils sont animés gratuitement par des musiciens amateurs, mais peu à peu, les musiciens connus pour leur expérience et pour leur expertise demandèrent à être payés.
La musique country fut enregistrée pour la première fois en 1922, qui vit aussi le début d’une certaine reconnaissance du genre hillbilly ou country. Les premiers artistes enregistrés — des musiciens amateurs locaux — ne font pas de la musique leur gagne-pain. On annonce dans les journaux locaux que des unités d’enregistrement passeront dans telle ou telle ville, tel ou tel jour et que tous ceux désirant une audition seront bienvenus. La plupart des artistes enregistrés — récompensés seulement par un paiement très modeste, sans droits d’auteur — continuent leur travail de tous les jours. Même un artiste connu comme Dock Boggs reste mineur de charbon jusqu’à sa retraite en 1952. Pour d’autres artistes, la vie de professionnel est précaire ; Kelly Harnell, qui connaîtra un petit succès à partir de 1924, finit ses jours en tant que travailleur dans une usine de serviettes. Jimmie Rogers, avant son succès, fut cheminot avant d’aborder une carrière de chanteur professionnel dans un medicine show, puis détective privé avant de redevenir chanteur professionnel en 1927. Au fur et à mesure que l’industrie avance, les artistes amateurs quittent le droit chemin lorsque les maisons de disques commencent à savoir quels sont les chanteurs qui vendent.
Dès que s’établit un marché régional pour la musique country, les maisons de disques eurent tendance à chercher des artistes déjà connus. Lors de leurs premiers enregistrements entre 1923-25, Fiddlin’ John Carson a 55 ans, Uncle Dave Macon, 54 ans, Uncle ‘Am Stuart 73 ans, Charlie Oaks au moins 55 ans, Bascom Lamos Lunstard 42 ans et Sanyanlua Bumgamer au moins 44 ans [10]. L’idée de faire enregistrer des artistes jeunes ne devait venir que plus tard.
Ces artistes imprégnés de tradition folklorique avaient un public qui en était également imprégné. Chaque région du Sud des États-Unis avait son style de chant particulier, reconnu comme tel par les habitants des régions limitrophes. Le développement de la technologie de la radio, qui servit aussi à faire connaître les disques à une échelle de masse, correspondait au début du déclin lent des cultures régionales. Les différents styles régionaux, une fois enregistrés, étaient attribués au style personnel du chanteur. De plus, les chansons traditionnelles furent vite épuisées : il fallait alors chercher du nouveau matériel dans le même style. Le chanteur est devenu ainsi la source des chansons plutôt qu’un simple véhicule.
La croissance de l’industrie de la country music est due au nombre de disques vendus plutôt qu’au nombre de disques enregistrés. En 1925, il y avait 225 disques country enregistrés, en 1929, 1250 (l’apogée) et dans les années 1970, une moyenne de 500-600. Alors qu’aujourd’hui la plupart des ventes se font dans les trois mois après la sortie du disque, dans les années 1920 et 1930, plus de 50 % des ventes se faisaient un an après la sortie [11].
La grande Dépression a complètement transformé une industrie conservatrice et traditionnelle. En effet, pendant la Dépression, les ventes de disques furent si faibles que la plupart des artistes ont tout laissé tomber. Le chiffre de ventes des disques pour 1933 est tombé à 7 % du chiffre pour 1929. L’industrie a recommencé à croître à partir de 1943. Alors que pendant les années 1920, la radio, qui employait des musiciens pour diffuser des concerts en direct, était en concurrence avec le disque, pendant les années 1930, une série de rachats des maisons de disques par les grandes sociétés de radio et de cinéma (par exemple, Victor Talking Machine Company par Radio Corporation of America), a provoqué le remplacement des musiciens par des disques à la radio, renforçant ainsi l’industrie du disque et la naissance d’un véritable marché de masse. D’autre part, Decca a introduit le disque à bas prix (35 cents) suivi par RCA Bluebird et American Record Company avec des prix de 25 cents et 35 cents.
Dans cette industrie rationalisée, les artistes sont devenus de vrais professionnels, et petit à petit on note une différence de technique et de compétence entre les artistes enregistrés et les musiciens amateurs. De plus, la musique country s’est ouverte aux autres influences (la musique cowboy, le swing, la musique mexicaine, l’utilisation des cuivres, la musique Cajun et le blues) créant ainsi des nouvelles formes sans tradition folkloriques. Graduellement, un star-system s’est établi, surtout après la Deuxième Guerre mondiale lorsque l’industrie de la musique country a commencé à « emballer » ses chanteurs en fonction de leur jeunesse et de leur sex-appeal. À partir des années 30, d’autres formes folk comme le blues ont également permis le développement d’une tradition de « grands chanteurs », une fois enregistrées.
Le blues existait dans plusieurs traditions différentes : le country blues, joué par des solistes, l’urban blues (ou le jazz blues), plus sophistiqué, joué en groupe et instrumental plutôt que vocal, et
Ce n’est pas notre propos d’entrer dans les détails en ce qui concerne l’histoire des musiques populaires américaines. Ce qu’il faut retenir, pour la construction de l’argument, c’est que l’enregistrement des formes folk a complètement changé non seulement leurs conditions d’existence, mais leur forme même : le rhythm and blues et le country and western furent des évolutions au sein des traditions originelles. Authentiquement populaires néanmoins, ces nouveaux mélanges n’existaient pas avant l’apparition du disque. Surtout, le disque a véhiculé, pour un certain nombre de raisons contingentes, un star-system.
La suite du chapitre est en PDF.
Lire le chapitre en entier au format PDF :
[himage]
Notes
1. Robert Christgau, Any old way you choose it, Penguin, 1973, p. 95.
2. Michael Lydon, « Rock for Sale » in Jon Eisen (ed.) The Age of Rock 2, Random House, New York, 1970.
3. « Notes for the new theology », Oracle (San Francisco), 1 : 6, fév. 1967, p. 1.
4. Lydon, art. cit., p. 60.
5. Lydon, art. cit., p. 61. (En anglais : « The Man can’t bust our music… ».)
6. Ibid., p. 61.
7. Karl Marx, Le Capital, 1, 1, IV et 1, VI, Editions Sociales.
8. Jean Baudrillard (1972), Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, pp. 155-6.
9. Karl Marx, Grundnsse : Introduction to the Critique of Political Economy, Penguin, 1973, p. 287 (en français: Editions Sociales).
10. Bill Malone et Judith McCulloh (eds.), Stars of Country Music, University of Illinois Press, Chicago, 1975, p. 6.
11. Ibid., p. 5.


Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)