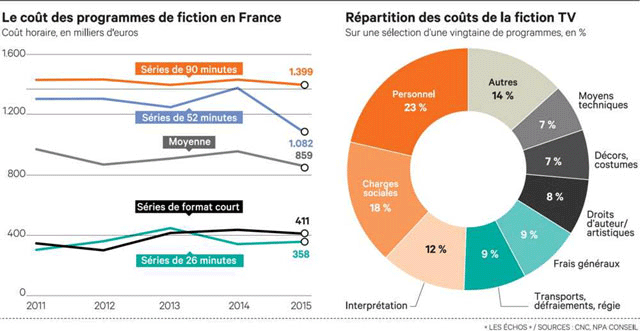Actualités des industries culturelles et numériques #43, juin 2016
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et numériques du côté des acteurs professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante.
Contenu
Le rap français devient une musique de patrimoine
En avril, une réédition de Première consultation (Warner France) est sortie en CD et en vinyle pour fêter les vingt ans du premier opus de Doc Gynéco, album qui s’est vendu à 1 million d’exemplaires. En décembre 2015, Warner avait aussi commercialisé une réédition vinyle de L’École du micro d’argent d’IAM (1997), album le plus vendu du rap français à 1,5 million d’exemplaires. La major a hérité les droits de ces albums grâce au rachat à Universal de Parlophone (partie des actifs d’EMI) pour 742 millions de dollars en juillet 2013. « Il faut avoir en tête que les ventes [de ces deux albums phares] sont au niveau des très gros chanteurs pop de l’époque, que ce soit Goldman, Cabrel ou Bruel », rappelle Thierry Chassagne, patron de Warner Music France.
Doc Gynéco en profite pour orchestrer son retour sur le devant de la scène, huit ans après son dernier album Peace Maker (produit par DJ Mosey, aka* Pierre Sarkozy), échec cinglant qui ne s’est écoulé qu’à 2000 exemplaires. Cette année, le rappeur va donner une trentaine de concerts en France, où il ne jouera que les titres de son premier album. Les places se sont arrachées au point qu’en trois heures, l’Olympia (2000 places) était rempli ; en 26 heures, idem pour une deuxième date. Le public est « essentiellement des trentenaires et des quadragénaires », dit Oriana Convelbo (Arachnée Productions), qui produit la tournée. Dans la foulée, Doc Gynéco est en discussion avancée, dit-on, pour signer avec une major. De son côté, IAM donnera un concert reprenant son premier album à l’AccorHotels Arena (Bercy) en novembre 2017, pour fêter les 20 ans de sa sortie. Les 15 000 places sont parties en moins de quatre mois. Déjà en 2015, Akhenaton, le leader d’IAM fut commissaire d’une exposition sur l’histoire du rap à l’Institut du monde arabe. IAM va sortir son 8e album studio l’année prochaine.
« Ce qui est primordial, c’est que ces artistes reviennent sur scène pour jouer tout un album et pas simplement un tube. Ce qui n’est pas lié qu’au rap puisque d’autres formations cultes se reforment pour jouer leur premier album en concert, comme les Jesus and Mary Chain [« Psychocandy » date de 1985], dont la tournée a fait un carton », affirme Benjamin Chulvanij, patron du label Def Jam France.
Un album de reprises des tubes du rap français des années 1990 (Affaire de famille) doit sortir en octobre. Les nouveaux – Soprano, Nekfeu, Youssoupha, Orelsan – reprennent (et non pas remixent) les chansons de Secteur Ä (collectif sarcellois regroupant Doc Gynéco, Passi, Stomy Bugsy, Arsenik). « Ces classiques ont vocation à être découverts par les plus jeunes, et redécouverts par ceux qui les ont écoutés il y a vingt ans », explique Marley Salem, directeur d’Empirisme Music, le producteur. Sébastien Duclos, directeur du label Play On, distributeur du disque, abonde de son côté : « Musicalement, les morceaux ont bien vieilli et les textes sont toujours d’actualité ».
Le budget pour l’ensemble du projet intégrant les sessions d’enregistrement, les cachets des artistes, et le marketing (dont la production d’un clip) monte à 400 000 euros. Les auteurs des originaux percevront des droits d’édition et de reproduction. On vise au moins à un disque d’or (50 000 exemplaires vendus), un concert au Zenith et quelques dates de tournée. À titre de comparaison, le premier disque de Doc Gynéco a coûté 1 million de francs (198 750 euros constants), somme importante à l’époque, et celui de Passi (Virgin 2, 1997), 600 000 francs (117 800 euros constants). Le producteur Empirisme Music a signé un contrat de licence avec Play On, la plus grosse structure indépendante en France, qui génère 20 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Dans ce type de contrat, devenu la norme, le producteur livre un produit fini au distributeur qui récupère entre 16% et 30% sur les ventes.
* aka = also known as (également connu sous le nom de).
Sources : « Quand le rap français valorise son patrimoine » (Nicolas Richaud), Les Échos, 15-16 avril 2016, p. 22 ; « »Affaire de famille », le premier album de reprise » (Nicolas Richaud), ibid.
N’étant ni spécialiste, ni même spécialement amateur du rap français, je laisserai à d’autres la charge d’évaluer l’intérêt artistique de ces rééditions. Je retiens cependant que les stratégies de marketing sont fondées sur le constat, justifié ou non, d’une certaine inertie musicale (« les morceaux ont bien vieilli »), et d’une certaine inertie sociale (« les textes sont toujours d’actualité »). On remarque aussi que, depuis les années 1990, les coûts constants de production ont sensiblement augmenté pour un rendement très sensiblement inférieur. Même la visée d’un disque d’or (50 000 exemplaires) est ambitieuse ; en 2010, par exemple, seul Dei des Prêtres a atteint ce statut (89 600), alors que L’école des points vitaux de Sexion d’Assaut (48 600) et On trace la route de Christophe Maé (46 200) l’ont frôlé [1]. On est très loin des ventes des classiques de Doc Gynéco et d’IAM en 1996-7.
Le centre de gravité de l’industrie musicale s’est déplacé depuis, et le concert constitue désormais de très loin le secteur le plus lucratif de l’industrie, suivi par les droits annexes (publicité, marketing, bandes sonores, etc.). Dans ce contexte, le disque tend de plus en plus vers une sorte de carte de visite, un tremplin vers d’autres sources de revenus (voir sur ce point Jacob T. Matthews [2]). Explorant les liens entre musique et merchandising, Christophe Magis [3] fait remarquer que la stratégie des éditeurs musicaux suit le mouvement plus général dans les industries culturelles et d’information décelé par Philippe Bouquillion, qui affirme : « beaucoup de contenus ne sont désormais plus produits seulement pour être consommés et valorisés auprès de consommateurs finaux, mais ils entrent dans les processus de diffusion, promotion et valorisation de différents produits de consommation » [4].
[1] Vincent Rouzé, « L’expérience au cœur des stratégies », in Jacob T. Matthews et Lucien Percitoz (dir.), L’Industrie musicale à l’aube du XXIe siècle. Approches critiques, L’Harmattan, 2012, p. 50.
[2] Jacob T. Matthews, « Introduction. Prendre au sérieux l’industrie musicale », ibid.
[3] Christophe Magis, « La musique comme valeur ajouté : lorsque les éditeurs deviennent « marque de service »», ibid.
[4] Philippe Bouquillion, « Incidences des mutations des industries de la culture et de la communication, et contenus informationnels », Les cahiers du journalisme, 20, automne 2009.
La presse : vers un nouveau modèle économique
Depuis la réorganisation du groupe, Numericable-SFR est devenu la maison-mère de 17 journaux (dont Libération et L’Express), deux chaînes de télévision (dont BFMTV), et une radio (RMC). La stratégie du directeur, l’homme d’affaires Patrick Drahi, est de racheter à grand renfort de crédit des contenants et des contenus dans un but de convergence. Ainsi les abonnés à Numericable-SFR auront un accès gratuit à toutes les publications du groupe sur leurs écrans.
« Nous allons augmenter considérablement le nombre de lecteurs de ces journaux, qui passera de quelques dizaines de milliers actuellement à potentiellement 18 millions, le nombre total de nos abonnés. Ce changement d’échelle va nous donner des possibilités accrues de recettes publicitaires […] Il était temps de rentabiliser notre investissement dans la presse », explique un conseiller de Drahi, qui prétend que 100 000 personnes ont téléchargé l’application le jour de l’annonce.
Les journaux intégrés à SFR Presse ont, selon le groupe, accumulé quelque 150 millions d’euros de pertes, qui peuvent être fiscalement déduites des futurs bénéfices de SFR. Celui-ci va donc voir sa facture d’impôt diminuer de 50 millions d’euros. En outre, la partie presse, qui sera désormais incluse d’office dans l’abonnement des clients, bénéficie d’un taux de TVA réduit (2,1% au lieu de 10% ou 20% pour la télévision, l’Internet et le téléphone). SFR va donc régler moins de TVA : en moyenne 1,36 euros par abonné et par mois selon ses calculs, soit une jolie ristourne de 200 millions d’euros par an. Cela, grâce aux journaux qui ont coûté à Drahi moins de 40 millions d’euros (Libération) et environ 60 millions (L’Express). Bref, pour les magnats contemporains, la presse n’est plus une danseuse, ni même un moyen d’influencer les milieux politiques, mais un simple outil de défiscalisation, et accessoirement un produit d’appel. Autrefois, on donnait un portable en cadeau à tout nouvel abonné à un titre de presse. Désormais, c’est l’inverse.
Source : Le Canard enchaîné (Hervé Martin), 4 mai 2016, p. 4.
Voilà ce qui confirme l’argument de Philippe Bouquillion avancé ci-dessus. On peut s’offusquer du cynisme de Drahi, mais il ne fait que profiter – en en détournant l’esprit – des dérogations fiscales accordées à la presse après la Libération en 1944 dans l’intérêt de la libre expression, et du pluralisme. Les grands groupes financiers n’ont plus que faire de ces considérations politiques.
Il faudra resituer l’évolution de la presse dite d’opinion, son déclin historique étant désormais manifeste, dans un contexte socioéconomique plus large. Indépendamment des questions de support, la question se pose, de manière lancinante : à quoi bon prétendre être le vecteur médiatique d’un courant politique, si celui-ci est exsangue (que ce soit d’une gauche sociale-libérale jadis « contestataire » (Libération), ou d’une centre-droite libérale jadis « moderne et progressiste » (L’Express)), et si le jeu même de la politique n’a plus aucune prise sur l’économique ?
De nouveaux médias présents uniquement sur les réseaux sociaux
Plusieurs médias américains n’ont plus de site web, et postent des contenus directement sur Facebook ou sur Snapchat. Sur la page web d’Obsessee, par exemple, lancé en mars, on ne trouve qu’un fond jaune, un dessin de cactus, et dix petites icônes représentant Instagram, Snapchat, Facebook, Tumblr, YouTube, Pinterest, Twitter, etc. Obsessee, qui parle « de mode, de beauté, et de culture », appartient au Clique Media Group, qui a créé plusieurs sites de mode (WhoWhatWear, MyDomaine, Byrdie). L’entreprise s’explique sur sa page YouTube : « Les magazines sont passés de l’impression papier aux sites Web. Nous passons désormais de la « com » aux médias sociaux ». C’est pour atteindre les 14-24 ans, principalement des filles, qui s’informent principalement sur leurs smartphones, que de plus en plus de médias se lancent sur les réseaux sociaux : Popular, The Shade Room (potins sur des célébrités), Insider (affaires) et NowThis (Buzzfeed), AJ+ (reportages vidéo).
Avec la généralisation des bloqueurs de publicité, la page d’accueil d’un site web ne génère pratiquement plus de revenus. Selon Brian Nowak, un analyste de Morgan Stanley, sur chaque dollar dépensé dans la publicité en ligne au premier trimestre 2016, 85 cents sont allés à Facebook et à Google.
Le modèle économique de ces nouveaux médias est encore tâtonnant. Facebook multiplie les initiatives pour que la consommation de contenus se déroule entièrement au sein de sa plateforme ; reste à trouver des formes de monétisation. En 2015, la société de Zuckerberg a lancé Instant Articles, une offre permettant de lire les articles postés par les médias sans quitter la plateforme, en leur proposant de conserver 100% des recettes publicitaires. Le réseau social envisage la possibilité d’abriter des contenus sponsorisés. Buzzfeed pratique déjà le placement de produits avec Tasty, composé de vidéos de recettes de cuisine publiées sur une page Facebook dédiée. Neuf mois après son lancement en 2015, la page a été likée 52 millions de fois, et elle est devenue le premier producteur de contenus sur Facebook en mars. Dans la foulée, Buzzfeed vient de lancer Nifty, une page de vidéos do it yourself (bricolage, cosmétiques « maison », etc.). Là aussi, les possibilités du placement de produits semblent très prometteuses.

Source : « Ces nouveaux médias présents uniquement sur les réseaux sociaux » (Anaïs Moutot), Les Échos, 1 mai 2016.
France Télévisions va lancer un service de vidéos à la demande par abonnement
« Nous allons lancer le 31 mars 2017 une offre de vidéo à la demande par abonnement qui sera généraliste, avec des séries, du documentaire, des programmes jeunesse et du cinéma », indique Laetitia Recayte, directrice du développement commercial de France Télévision, chargée de la publicité, de la distribution, et de la production (tout un programme). Le service public sera alors en concurrence directe avec Netflix et Canal+ sur le marché de la vidéo par abonnement. Le marché aiguise les appétits : Vivendi (Vincent Bolloré), propriétaire de Canalplay, a récemment annoncé une alliance avec l’Italien Mediaset (Berlusconi) pour créer un « Netflix latin » ; SFR va agrandir sa plateforme Zive avec des contenus originaux.
Laetitia Recayte estime qu’il y a place pour une offre de service public qui dépassera les contenus de France Télévisions : « La plupart des groupes audiovisuels publics dans le monde ont développé des offres payantes ». La future offre devrait permettre à France Télévisions de développer et de diversifier ses sources de revenus. À quoi tient encore la notion de service public ? La justification du nouveau service est étrangement défensive, et semble liée au ressentiment provoqué par le manque à gagner des recettes publicitaires. Selon Recayte : « France Télévisions ne peut pas diffuser de publicité en soirée. C’est une question sur laquelle, à mon sens, il faudra un jour revenir, pour nous donner des marges de développement – le potentiel est de 100 millions d’euros. Plutôt que des restrictions, je préférais un système où nous puissions nous auto-réguler, à l’image de ce que nous faisons pour les programmes jeunesse. J’ai l’impression qu’il n’y a eu aucun enseignement tiré de ce qui s’est passé en 2009, quand nous avons perdu la publicité en soirée et les deux tiers de notre budget [par décision du Président Sarkozy]. Cela a-t-il profité aux chaînes privées ? Non : la moitié de notre perte a migré vers le numérique, un marché qui échappe aux télés et ne finance pas la création ».
La question de la viabilité de tous ces SVOD* concurrents se pose, ne serait-ce qu’en raison de l’offre lacunaire des uns par rapport aux autres, la clé de la réussite passant assurément par des productions originales. Envisage-t-on sérieusement que le consommateur s’abonnera à de multiples SVOD ? Est-ce la fin à terme de la télévision programmée ? Y a-t-il réellement une demande pour un « Netflix latin » en dehors de l’ambition de deux grands fauves ? Quoi qu’il en soit, il y aura forcement de la casse, et la distinction entre régimes public et privé, déjà floue, le devient de plus en plus. Mais dire, comme Laetitia Recayte, que la plupart des services publics dans le monde ont déjà « développé » des offres payantes n’est pas tout à fait exact. S’agissant de la BBC, service public indépendant de référence, la question est toujours à l’étude. Dans un livre blanc publié en mai, le ministre (conservateur) de la Culture a estimé – de manière purement indicative – que la BBC devait « tester différents types d’abonnement ». La BBC aurait pris des contacts avec NBC Universal (États-Unis) et la chaîne privée britannique ITV afin de discuter les possibilités d’une offre payante commune (Le Monde, 19 mai).
*SVOD = service de vidéo on demand (à la demande par abonnement).
Sources : Les Échos avec AFP, 3 mai 2016 ; Le Monde, « Netflix et Amazon devront financer la création » (Cécile Ducourtieux et Alain Beuve-Méry), 19 mai 2016, supplément Éco & Entreprise, p. 8.
Pic de production du cinéma français en 2015 (2) : revers de la médaille
On a produit 234 films d’initiative française en 2015, soit 31 de plus qu’en 2014, un record depuis le début de la collecte des données du CNC en 1952 (Actualités #42). Mais les entrées des films français ne suivent plus. À 72,9 millions l’an dernier, elles sont loin de leur pic de 1957 (205,9 millions). Leur part du marché se situe à 34%, contre 45% dans les années 1980, avec deux fois moins de films.
Se pose alors le problème de l’engorgement des salles disponibles et, dans la foulée, de la viabilité perenne du système de financement par avances sur recettes. En l’absence de données fiables sur toute la chaîne de valeur, il est difficile d’évaluer précisément la rentabilité du cinéma français en intégrant ce qu’il rapporte aux chaînes de télévision, et par rapport à ce que celles-ci investissent (entre le tiers et la moitié des budgets totaux). En 2008, Olivier Bomsel, directeur de la chaire d’économie des médias à Mines Paris Tech, a calculé que les recettes des 162 films français produits en 2005 étaient d’au moins 309 millions d’euros inférieures à leurs coûts (872 millions), soit un déficit de 36%. « Il faudrait refaire le calcul, dit-il aujourd’hui. […] Il y a tout lieu de croire que la situation s’est aggravée. L’audience TV du cinéma est en baisse. Celle-ci explique en partie la désaffection de Canal+, à la fois financeur (sic) et diffuseur du cinéma français. Et c’est la même chose pour les chaînes gratuites ».
Pour Olivier Bomsel, alors qu’il est légitime de soutenir la création comme une forme de recherche-développement, on pourrait commencer à se demander s’il faut consacrer autant de ressources au cinéma. « Aujourd’hui, le format fictionnel qui a le vent en poupe est la série télévisée. […] Le film de cinéma est menacé par des coûts d’édition (marketing et distribution) qui imposent de faire connaître un nouveau prototype à chaque sortie. Il n’est pas certain qu’il restera le phénomène massif et inventif qu’il a été. La preuve, on entre dans une période d’exploitation des marques « renommées », comme on peut le voir avec des suites et les « spin-offs » de franchises. […] Du coup, quelle que soit la qualité des [films] produits en France, on perd de la compétitivité en orientant à ce point les obligations de financement de la télévision vers le cinéma. D’ailleurs, de plus en plus de producteurs de cinéma produisent aussi des fictions TV ».
Sources : « Les questions que se pose la surproduction de films français » (Nicolas Madelaine), Les Échos, 9 mai 2016, p. 22 ; « Les séries TV mériteraient d’être plus aidées » (entretien avec Bomsel) (propos recueillis avec Nicolas Madelaine), ibid.
Les sociétés de production audiovisuelles contraintes à baisser les coûts
L’industrie audiovisuelle en France n’est pas épargnée par la chasse aux économies. En raison du recul des recettes publicitaires, et de la fragmentation des audiences, les chaînes ont dû revoir à la baisse leurs coûts de grille, ce qui se répercute sur les boîtes de production. Dans la fiction, malgré quelques exceptions de prestige qui faussent la moyenne (Versailles), le coût horaire moyen a reculé de 10% entre 2014-2015, à environ 859 000 euros, selon le CNC. Même constat pour les émissions à flux (jeux, émissions de plateaux), où les prix varient entre 350 000 euros à 1 million en prime time. « Les producteurs ont fait beaucoup d’efforts pour diminuer les coûts, si bien que les marges ont fondu d’un tiers, voire de moitié, en dix ans. On parle désormais de marges de 10% à 15% dans l’industrie. Difficile d’aller vraiment plus loin, au risque de ne plus pouvoir faire de R&D », affirme Thomas Anargyros, coprésident d’EuropaCorp TV, et président de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA).
La plupart des professionnels s’accordent à dire qu’il existe encore des marges pour rationaliser les coûts, mais sans pouvoir procéder à de grosses coupes. Plus qu’à la moitié des dépenses dans la fiction sont liées aux frais salariaux, protégés pour l’instant en France (mais pour combien de temps encore ?) par des conventions collectives. Pour les émissions à flux, la France a déjà des coûts de production inférieurs d’un peu moins de 30% par rapport au Royaume-Uni et à l’Allemagne (mais de 10% plus chers que la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas).
Aliette de Villeneuve et Maxime Pannetier, coauteurs d’une étude sur le sujet pour NPA Conseil, préconisent de mieux penser dès le départ le choix des décors ou les cachets des acteurs, autrement dit de privilégier les arbitrages budgétaires avant d’évaluer l’intérêt de tel ou tel projet. Le poids de l’interprétation représente entre 8% et 18% d’un budget de fiction. Pour Aliette de Villeneuve, « c’est donc un levier non négligeable. Alors qu’en France, le recours à des stars de cinéma s’est généralisé, dans plusieurs pays, au contraire […], les comédiens ne sont pas connus et les contrats peuvent être verrouillés sur plusieurs saisons ».
Enfin, on pourrait réaliser des économies d’échelle en commandant de plus gros volumes, en s’appuyant sur une meilleure exploitation offerte par des possibilités technologiques. L’étude NPA constate que le temps de production est plus lent en France que dans d’autres pays : une dizaine de jours pour un épisode de série, contre sept aux États-Unis. En dehors des paramètres juridiques et logistiques comme la modification de la durée du travail, et la réorganisation des tâches, le décor virtuel pourrait être davantage utilisé en France, où il reste rare : « En prenant de simples photos, on peut reproduire des décors, évitant ainsi des coûts de location, des déplacements, etc. », dit Maxime Pannetier.
D’autres possibilités d’économies : des décors pour les émissions de plateau fabriqués au Portugal, 50% moins chers que chez les fabricants français, et déjà utilisés pour Dialogues citoyens avec le président François Hollande en avril ; le recours aux maisons privées plutôt qu’aux studios (Fais pas ci, fais pas ça) ; la présence d’un showrunner (Le Bureau des Légendes), non pas en auteur surdoué, mais en gestionnaire des coûts, et preneur de décisions rapides (selon le producteur Alex Berger, « lorsqu’on produit 10 épisodes en environ cinq mois, chaque minute compte »).
Source : « Audiovisuel : les sociétés de production face au défi de la baisse des coûts » (Marina Alcaraz), Les Échos, 13-14 mai 2016, p. 23.
Lire les autres articles de la rubrique.

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)