Actualités des industries culturelles et numériques #15, décembre 2013
Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels de la publicité et du marketing, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation technologique constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de cette web-revue.
Article interdit à la reproduction payante
Contenu
Netflix semble avoir réussi son pari pour le moment
Le 21 octobr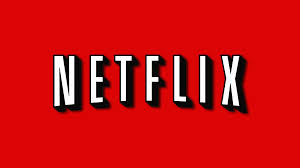
Le chiffre d’affaires de Netflix a atteint 1,1 milliard $, soit 22% de plus en un an. Ses bénéfices nets ont quadruplé dans la même période à 32 millions $, et sa valeur boursière a quintuplé à 20 milliards $. Sur le marché américain, Netflix a dépassé la chaîne câblée HBO en nombre d’abonnés. Elle vise désormais le marché international, où la barre des 10 millions d’abonnés a déjà été franchie. Actuellement, elle est en négociations avec les opérateurs de chaînes câblées afin de pouvoir intégrer son application aux décodeurs, permettant aux téléspectateurs de rechercher des films et des séries sur l’internet en même temps que les programmes du câble. En position de faiblesse relative, les opérateurs du câble voit de plus en plus le service Netflix comme un moyen d’attirer, et de retenir leurs clients, plutôt qu’un concurrent ; à moyen terme, ils pourraient profiter de l’application pour promouvoir leur propre offre de contenus à la demande. On attend l’annonce d’un accord prochainement.
Le pari n’est pas totalement gagné pour l’instant. Par rapport au chiffre d’affaires, les bénéfices sont anormalement faibles (2,9%), et surtout très loin de sa valeur boursière qui, du coup, paraît fragile. La réussite durable de Netflix représente un enjeu considérable pour l’industrie. En cas d’échec, selon le journaliste du Monde Jean-Baptiste Jacquin, il n’y aura plus aucune concurrence « vertueuse » au piratage, avec en ligne d’horizon l’absence de tout modèle économique viable pour la production de contenus audiovisuels.
Sources : « Le Monde », 23 oct. 2013 (supplément Éco et Entreprise), article de Jean-Baptiste Jacquin ; « Advertising Age », oct. 14, 2013.
Les défis de Twitter après son introduction réussie en Bourse
Lancé en juillet 2006, Twitter a levé 1,82 milliard $ lors de son introduction en Bourse le 6 novembre 2013, vendant 70 millions d’actions à 26 $ (44,9 $ à la fermeture, prix excessive selon les analystes) et dépassant sensiblement sa valorisation projetée de 14 milliards $. Sa valeur a atteint 24,9 milliards $, soit 22 fois son chiffre d’affaires estimé pour 2014 (cf. Facebook 11,2 fois, et LinkedIn, 11,7 fois). À titre de comparaison, la valeur boursière de Facebook a atteint 125 milliards $ le 8 novembre (+ 91% depuis janvier), légèrement supérieure à sa valorisation initiale « excessive » en 2012. Actuellement, Twitter a 232 millions d’abonnés, alors que Facebook en a 1020 millions. D’évidence, les investisseurs en Twitter comptent sur une croissance exponentielle du chiffre d’affaires (les revenus ont doublé chaque année, atteignant 534,5 millions $ pour la période septembre 2012 à septembre 2013), mais la société californienne n’a jamais été rentable, alors que Facebook et LinkedIn l’étaient au moment de leur introduction en Bourse. Contrairement aux revenus, la croissance du nombre d’abonnés de Twitter s’est ralentie : + 39% entre septembre 2012 et septembre 2013, contre +65% pour l’année précédente. Certains analystes estiment que Twitter est très loin d’avoir réalisé son potentiel et sera rentable en 2015, mais la menace d’un krach 2.0 plane toujours pour d’autres.

4) La télévision. Grâce au rachat de Bluefin Labs en début d’année, Twitter bénéficie désormais d’un outil de mesure et d’analyse précis sur la « télévision sociale ». Selon Olivier Gonzalez, directeur de Twitter France, une étude de Nielsen aux États-Unis montrait que 95% des discussions publiques autour de la télévision avaient lieu sur Twitter et que 29% des programmes télévisés voyaient leur audience augmentée par Twitter. Celui-ci devrait s’en servir pour se positionner sur le marché de la publicité télévisée et proposer des opérations couplées Twitter et spot sur certaines émissions. Mais ceux qui « s’engagent » avec les spots tweetés ne dépassent pas les dizaines de milliers pour l’instant, alors qu’une série télévisée à succès (ou à la mode) peut atteindre dans les 10-20 millions par diffusion. La question de la valeur publicitaire du support, même à long terme, reste posée. 5) La diversification. À terme, Twitter pourrait proposer aux annonceurs un produit publicitaire dédié, car le marché en ligne constitue l’essentiel de la croissance du secteur. Mais toute diversification doit conserver un équilibre avec le service de base (les fameux 140 signes), celui d’une plateforme mobile de communication collective en temps réel.
Sources : »Les Echos », 6 novembre 2013 (article de Nicolas Rauline) ; « Advertising Age », 6 nov. 2013 ; www.businessinsider.com/what-is-twitter-worth-2013-11 ; « Les Echos » (entretien avec Olivier Gonzalez), oct. 30, 2013, p. 21.

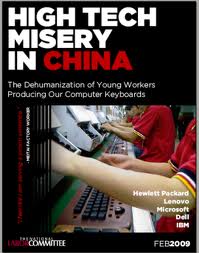
Les conseils financiers sont plutôt d’accord avec cette analyse néo-marxiste. Comme le dit le site « business insider » cité ci-dessus : « À la différence des sociétés de médias traditionnels, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google et d’autres sociétés de médias fonctionnant à la technologie [numérique] n’ont pas de coûts de contenu. Elles fournissent une plateforme à des centaines de millions d’utilisateurs, qui créent des contenus gratuitement. D’un point de vue financier, c’est un avantage massif. […] Avec des coûts de contenu égalant zéro, Twitter devrait être en mesure à terme de réussir une marge (avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement) d’au moins 50%. Facebook a déjà réalisé une marge opératoire de 50%. Pourquoi pas Twitter? Les investisseurs institutionnels en Twitter ne se soucient pas des pertes actuelles. Ils envisagent une éventuelle marge de bénéfices de 50%+ dans l’avenir.»

Depuis l’émergence de Twitter (et à un degré moindre, LinkedIn, Viadeo etc.), Facebook ne peut plus profiter dans la même mesure de sa rareté artificielle, son quasi-monopole. Un réseau social pourrait disparaître brutalement au profit d’un autre, quelle que soit sa situation acquise, comme en témoignent les exemples de MSN (Windows) Spaces (120 millions d’utilisateurs) et de Bebo entre autres. Quant à Myspace, en rapide déclin après avoir atteint 230 millions d’utilisateurs en 2008, il a été vendu par le groupe Murdoch à Specific Media en 2011 pour 35 millions $, soit 16 fois moins que le prix d’acquisition de 2005. Il est vain de vouloir faire des projections économiques sur le devenir des sociétés particulières érigées en modèle sans tenir compte de la logique du capitalisme tardif (qui, devenu mondial, tourne « normalement » avec des bulles spéculatives hypothéquées sur une très improbable réalisation future dans « l’économie réelle », du chômage de masse structurel, de la précarité et des inégalités croissantes, du démantèlement des systèmes de protection sociale là où ils existent). Les conséquences sociales et politiques de cela – assez imprévisibles – sont aussi à prendre en compte dans l’évolution des réseaux sociaux : replis communautaires, montée du racisme et de la xénophobie, délitement du lien social « réel ». Cette dimension politique ne figure jamais dans les prévisions des conseils financiers qu’on peut lire dans la presse spécialisée, aussi « experts » soient-ils.
*Pour bien saisir le sens du terme « capitalisme tardif », et le poids du « capital financier », considérons les chiffres suivants. Alors que les produits financiers dérivés étaient quasiment inconnus dans les années 1970, en 2012, la somme total de ce seul outil financier arriverait à 600 mille milliards $, soit environ 15 fois la somme de tous les PIB (produits intérieurs bruts) du monde. En 2011, le volume quotidien des transactions financières était de 4,7 mille milliards $. Moins d’1% de cette somme provenait des transactions des marchandises. On le voit, « l’économie réelle » est devenu un (très petit) accessoire de l’industrie financière. (Estimations fournies par la Banque des Règlements Internationaux, 2012) [2].
[1] « The Value of Marx : Free Labour, Rent and « Primitive Accumulation » in Facebook« , papier de travail, University of Essex, mai 2012.
[2] Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, « Sur l’immense décharge du capital fictif. Les limites de l’ajournement de la crise par le capital financier et le délire des programmes d’austérité« , article en ligne sur le site palim-psao (l’École critique de la valeur, influencée par Adorno entre autres), posté 31 août 2012.
BuzzFeed débarque en version française

Le site en ligne BuzzFeed, c’est l’avenir du journalisme, selon certains. Il ne s’agit pas de l’actualité politique, culturelle, ou sociale, mais des histoires drôles, incroyables et souvent trash. « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… sur la vie d’une stripteaseuse qui a dansé pour Justin Bieber », par exemple. Des vidéos comme « Être saoul vs. être défoncé » (3,1 millions de vues). Des listes, vraie marque de fabrique du site, comme « 16 chevaux qui ressemblent à Miley Cyrus » ; « 21 raisons pour lesquelles c’est complètement génial d’avoir sa sœur pour meilleure amie » ou « 30 signes que vous avez presque 30 ans » (7,9 millions de vues). Ce genre de liste, fantaisiste, triviale ou mi-sérieuse, sévit désormais sur le Web. On peut citer à cet égard Koreus, Neatorama, Laughing Squid, The Daily What, et la référence française, Topito (5 millions de visites par mois).
Créé à New York en 2006 par Jonah Peretti, venu du journal en ligne Huffington Post, BuzzFeed revendique actuellement 85 millions de visiteurs uniques, et 80 millions de visites par jour, trois fois plus qu’en 2012. Les instituts de mesure d’audience le créditent de 20-40 millions de visiteurs uniques aux États-Unis. 75% du lectorat consultent le site via les réseaux sociaux. Sans surprise, la grande majorité de ces visiteurs ont entre 18-34 ans, le bon créneau pour les publicitaires. Selon le site AllThingsD, le chiffre d’affaires de BuzzFeed approcherait 60 millions $ cette année, dépassant largement ses prévisions. Depuis sa création, BuzzFeed a levé 46 millions $ auprès des fonds comme SoftBank Capital, Hearst Ventures, RRE Ventures.

Ce média était pensé comme un laboratoire de contenus dédiés aux réseaux sociaux, pour créer des « mèmes » (memes) dans le jargon d’internet. Dans ses bureaux à New York, Chicago, Los Angeles, Washington, Londres et Sydney, BuzzFeed emploie 350 personnes, dont seulement 140 journalistes et éditeurs, avec pour objectif de produire des informations partageables. « Ils écoutent les foules, identifient les mots-clés et produisent ce pour quoi elles ont de l’appétit. C’est une manière très efficace de fabriquer de l’information : ne pas donner aux gens ce dont ils auraient éventuellement besoin, mais ce qu’ils veulent. […] Les lecteurs ne viennent pas chercher le contenu sur le site BuzzFeed, ils tombent dessus sur Facebook, Twitter ou Pinterest », dit Gabriel Kahn, professeur de l’économie des médias à l’Annenberg School of Communication (Californie). D’après Ben Smith, rédacteur en chef du site, « nous sommes attentifs aux statistiques, aux sujets qui seront lus, mais ce n’est pas non plus notre obsession ». Bel exemple de dénégation…
Les revenus sont générés grâce au modèle publicitaire dit du « native advertising » (voir « Actualités #3»). La publicité est intégrée directement dans l’article, et elle est souvent conçue par le site. La liste des dix lieux aux États-Unis à voir absolument, par exemple, a été compilée en partenariat avec une compagnie aérienne. Mais le média veut aussi s’ouvrir aux contenus plus sérieux. Selon Jon Steinberg, le président de Buzzfeed (et ancien de chez Google) : « Les jeunes n’ont pas de média qui leur est propre. […] Ce qui leur appartient, c’est la culture web, la culture des mèmes (sic). Nous avons pensé que nous pouvions être l’endroit où ils viennent aussi chercher des informations sérieuses et du reportage« . Fin octobre, BuzzFeed a annoncé le recrutement de Mark Schoofs, venu du site journalistique ProPublica, pour diriger une petite équipe spécialisée dans l’enquête. L’objectif, dit-il, est de mêler « l’énergie et la popularité de BuzzFeed sur les réseaux sociaux au journalisme d’enquête américain traditionnel« . Mais ce service est destiné à rester minoritaire dans un modèle fondé sur des contenus dépolitisés, d’un intérêt très anecdotique ; il permet, cependant, de couvrir toutes les bases dans l’éventualité d’un regain d’intérêt pour le politique chez les jeunes. Reste que les débats politiques traversent moins bien les frontières. « Certains contenus sont transposables d’un pays à un autre car il existe une culture Internet universelle », prétend Ben Smith.

Dans une stratégie de croissance et d’internationalisation, BuzzFeed se lance en espagnol, en portugais, et en français. La version française a démarré le 4 novembre (10-30 articles par jour). Elle consiste en une traduction de la version américaine, sous-traitée au start-up Duolingo, qui fait travailler des internautes gratuitement d’après un modèle original. Son fondateur, Luis von Ahn, inventeur du système antispam Captcha, a expliqué au journal Libération : « Des francophones apprennent l’anglais en ligne sur Duolingo, en traduisant des mots et des phrases piochés sur Internet. Après une leçon centrée sur le vocabulaire lié à la nourriture, l’étudiant va pouvoir pratiquer en traduisant un texte parlant de nourriture. Désormais, s’il le souhaite, il pourra aussi traduire un article anglais de BuzzFeed, également sur ce thème. Ils seront plusieurs à faire de même à travers le monde. Cette communauté d’étudiants internautes relira et validera la version finale de l’article en français. […] Financièrement, ça n’aurait aucun sens de faire appel à des traducteurs de métier. Et nous ne détruisons pas d’emplois, ce travail n’était fait par personne« . Il s’agit du conceptde « surplus cognitif » élaboré par le consultant Clay Shirky (vidéo sous-titrée en français ici), selon lequel le temps passé sur le Web, seul ou en « communauté », peut être mieux utilisé, mieux rentabilisé. Si les résultats en France sont bons, annonce Ben Smith, BuzzFeed pourrait ouvrir des bureaux en France et embaucher des éditeurs, comme à Londres où il y a désormais 15 éditeurs (contre 3 au départ).
Dans la nébuleuse de « pure players » (médias qui n’existent que sur support numérique), il existe plusieurs modèles. Certains sont en concurrence avec la presse traditionnelle (Huffington Post, Slate ou en France, Rue 89). D’autres explorent de nouvelles pistes. Inspiré de BuzzFeed, Upworthy (crée en 2012, déjà 30 millions de visiteurs uniques) n’a pas de rédaction, mais des « éditeurs » qui travaillent chez eux à la recherche de contenus sur le Web susceptibles d’être partagés sur les réseaux sociaux, sans travail éditorial, et pratiquement sans référencement. Plus sérieux, Medium (crée par l’un des cofondateurs de Twitter) propose une plateforme de publication pour des contenus longs, et Beacon (fondé par un ancien de Facebook) fait appel au financement participatif pour des projets de journalistes free-lance. Sera lancé prochainement NewCo News, financé par le fondateur d’eBay Pierre Omidyar, et avec le concours de l’initiateur du journalisme citoyen Jay Rosen (voir « Actualités #7« ). Ce nouveau média consacré à l’enquête sera dirigé par Glenn Greenwald, journaliste britannique qui a quitté The Guardian, où il a publié les grandes révélations sur les programmes de surveillance de la NSA américaine fournies par Edward Snowden, actuellement réfugié en Russie.
Sources : « Libération », 4 nov. 2013, pp. 28-9 (articles d’Iris Derœux sur BuzzFeed, et sur Duolingo ; d’Erwan Cario sur Topito) ; « Les Echos », 5 nov. 2013, p. 23 (articles (2) de Nicolas Rauline); Libération, 19 nov. 2013, p. 32.
Lire les autres articles de la rubrique

Professeur des universités – Paris Nanterre – Département information-communication
Dernier livre : « Les séries télévisées – forme, idéologie et mode de production », L’Harmattan, collection « Champs visuels » (2010)




