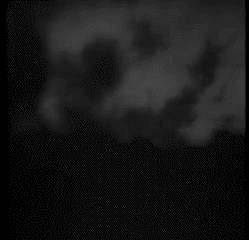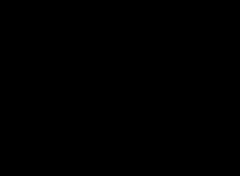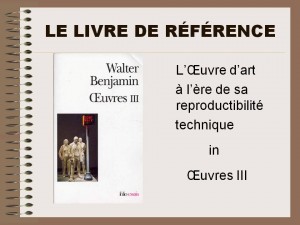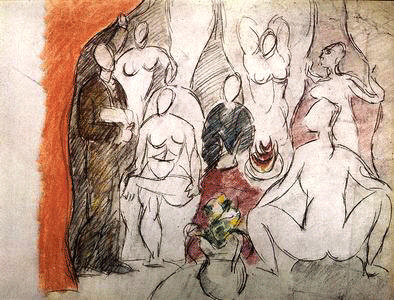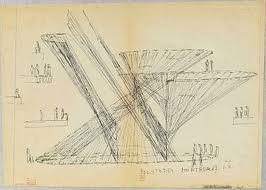Avant propos
L’article « Le lieu du fantasme : le commentaire sur images dans les magazines de reportage à la télévision française 1960-92 » fut originellement publié comme chapitre dans l’ouvrage collectif Télévisions : la vérité à construire (David Buxton, Jean-Pierre Esquenazi, Frédéric Lambert, Kamel Regaya et Pierre Sorlin) chez L’Harmattan en 1995, résultat de deux années de discussions communes, et depuis longtemps oublié. Il s’agissait pour moi de l’étape intermédiaire d’un travail en vue d’une thèse d’habilitation à diriger des recherches. La thèse fut soutenue en 1999 à l’université de Paris 3, et publiée en 2000, aussi chez L’Harmattan, sous le titre Le reportage de télévision en France depuis 1959. Ma première motivation pour ressusciter ce texte, c’était de mettre en ligne un soutien pour un cours sur le journalisme de télévision que je continue de faire en licence. Sans attente particulière, je le remets en circulation tel quel, à part un toilettage par-ci, par-là (notamment en remplaçant « inconscient historique », concept erroné, par « imaginaire historique »). Quelques phrases rajoutées en 2017 sont placées entre parenthèses carrées.
Relecture faite, force est de reconnaitre que ce texte est daté. Cela peut impliquer qu’il est obsolète, périmé, dépassé (mais par quoi ?), ou simplement qu’il a besoin d’être réactualisé pour tenir compte de l’évolution historique. Dans les sciences sociales, ce genre de jugement a toujours été plus politique que strictement scientifique, et les conditions de réception pour un texte de ce type ne sont guère favorables dans l’université d’aujourd’hui, marquée par la soumission croissante aux exigences du marché. On peut tout de même avoir l’impression que la tradition critique est elle-même figée dans le temps, en partie pour des raisons politiques, en partie à cause de ses propres impasses théoriques. Le cocktail théorique qui mélange la notion de régime de vérité chez Foucault, la conception d’idéologie chez Althusser, la psychanalyse appliquée, et la critique des médias de Bourdieu (pas mentionné ici, mais implicite) est détonnant, et était déjà problématique à l’époque. Certains concepts appartiennent à des espaces théoriques très différents (événement discursif, idéologie, le fantasme freudien), et le texte court assurément trop de lièvres à la fois. La mobilisation de théories diverses est légitime en principe, si on veut éviter un positivisme docile et lénifiant, mais il faudrait que tout cela soit repris sur des bases plus solides. La synthèse de Marx et de Foucault est d’autant plus difficile qu’il est nécessaire théoriquement et politiquement*; quant à un mariage (de raison) convaincant des traditions marxistes et freudiennes, c’est la grande arlésienne des sciences humaines et sociales, qui perdurera tant que celles-ci continuent d’exister sous une forme critique.
Le texte est également daté en ce qui concerne son objet. À l’époque, le magazine de reportages avait le vent en poupe, et se multipliait sur les chaînes hertziennes, publiques et privées (le câble était à ses débuts). Internet commençait tout juste à pénétrer l’espace domestique, et était loin de dominer la diffusion et la circulation de l’information comme il le fait aujourd’hui. La reality show, déjà esquissée dans des magazines comme 52 sur la une, attendait encore son heure. Alors qu’Envoyé spécial est toujours à l’antenne en 2017, les magazines de reportage généralistes touchent probablement à leur fin. Entre-temps, la profession journalistique dans tous les formats s’est fortement précarisée. Mais l’analyse présentée ici vaut pour la forme du commentaire sur images en général, qui continue d’exister en format court dans les journaux télévisés, et qui n’est plus limitée au support télévisé. La découverte que le discours néolibéral dominant, qui imprègne le journalisme à des degrés divers, est sous-tendu de pulsions masochistes refoulées, tendant vers l’acceptation passive d’une hypothétique « fin du monde », s’avère plus actuelle que jamais.
*Voir cependant le livre extrêmement rigoureux, remarquable de Jacques Bidet, Foucault avec Marx, La Fabrique, 2014.
Introduction : le reportage télévisé.

Marc Ferro (1924-)
Ce texte cherche un moyen d’interpréter le reportage télévisé qui respecte la spécificité de la forme ; il est guidé en même temps par l’idée formulée par l’historien Marc Ferro que l’image (en l’occurrence du cinéma) peut être appréhendée comme une archive, une source primaire à exploiter par l’historien. Si le reportage est un ensemble de choses dites et de choses montrées, une analyse de celui-ci doit partir de la relation entre ces deux éléments. Dans l’impossibilité d’être exhaustive, l’analyse doit se focaliser sur des incidents, des fissures dans cette relation qui saisissent les contradictions internes du document audiovisuel. J’avance ici le concept d’image-symptôme qui décrit une incongruité patente entre commentaire et image, qui s’assimile à un lapsus ou acte manqué. De là émerge l’intérêt de ce type d’analyse : trouver des traces visibles de ce qu’on peut appeler l’imaginaire historique.

Hervé Brusini
Comment traiter alors le contenu des magazines de reportages à la télévision d’une manière qui ne tende pas à réduire cette dernière au rôle de simple support ? Comment saisir la spécificité d’une forme qui marie paroles et images ? Poser ces questions d’emblée, c’est prendre conscience à quel point forme et contenu sont indissociables dans le magazine télévisuel ; celui-ci ne saurait être réductible à un communiqué politique ou à une annonce publicitaire, sa crédibilité en dépend. Une influence extérieure, si puissante soit-elle, agit sur des pratiques autonomes déjà en place avec leurs propres critères de validité, leur propre rapport à la vérité. Ce qui suit part d’une relecture critique d’un livre publié en 1982, après une décennie qui a vu la transformation en profondeur de la télévision française. Voir la vérité : le journalisme de télévision de Hervé Brusini et Francis James reste à ce jour l’un des seuls ouvrages sur l’information télévisée en France qui aborde son objet du côté des pratiques professionnelles [1]. Souvent cité, mais peu repris depuis sa sortie, ce livre mérite mieux que d’être consigné à un passé révolu de l’histoire de l’audiovisuel en France. Car la question qu’il pose est à tous égards fondamentale : comment faire une histoire de l’information télévisée qui ne soit pas la simple projection d’une autre histoire, technique ou politique selon les cas ?
Journalisme d’enquête et journalisme d’examen

Pierre Desgraupes (1918-93), producteur de « Cinq Colonnes ».
Brusini et James distinguent deux champs discursifs : le journalisme d’enquête, qui tire sa légitimité de la présence sur le terrain d’un témoin professionnel qui donne à voir les traces visibles de l’événement ; et le journalisme d’examen, plus analytique, qui met en avant le spécialiste sachant expliquer le réel affranchi « de la servitude de l’événement » (Pierre Desgraupes, 1969). Dans le journalisme d’enquête, qui caractérise la première période de la télévision française jusqu’au milieu des années 1960, le commentaire n’ajoute peu ou rien à l’évidence primaire que constitue l’image : « la volonté de voir et montrer tout en même temps fait de la description l’acte de parole majeur porté sur l’événement ». Le reportage de télévision, c’est l’expérience vécue du journaliste en situation ; il s’agit donc d’un mode de savoir résolument empiriste, la compétence professionnelle venant d’une sensibilité supérieure, d’un « œil irradié » qui voit mieux que le commun des mortels.
Vers la fin des années 1960, la nécessité d’un niveau d’explication plus abstrait de l’actualité s’affirme dans la plupart des discours professionnels. Peu à peu, une actualité invisible émerge, perçue en termes de « problèmes » ou de « phénomènes de société ». Actualité dépendante donc de la construction préalable d’un objet journalistique ; le terrain perd sa prépondérance au profit du studio, lieu d’explications et de débats, où les éléments d’un dossier (témoignages, interviews, interventions savantes) sont examinés de façon contradictoire. Le résultat de cette évolution, où l’unité de base du journalisme à la télévision n’est plus l’événement, mais le thème, c’est un décalage croissant entre image et texte, le commentaire se détache de l’image pour dire ce que celle-ci ne parvient pas à montrer. Accéder à l’abstraction afin de rendre compte d’un phénomène qui n’a ni lieu, ni durée fixes passe par l’utilisation de ce qu’on pourrait qualifier des images-prétextes, qui n’apportent rien en termes strictement informationnels, images « banales » de bâtiments et de promeneurs métonymiquement ou métaphoriquement liées au discours qui les surplombe. S’impose alors une forme bâtarde, le mélange de deux formes, le commentaire abstrait sur fond d’image-prétexte (forme « examen »), et l’interview du témoin en situation (« forme enquête »). Ce modèle fut généralisé pendant les années 1970 dans les journaux télévisés, en même temps que les magazines de reportage tendaient à disparaître en faveur d’émissions thématiques et de débats sur plateau. Ce n’est qu’au début des années 1990 que les magazines généralistes de reportage se sont imposés de nouveau.
Quel que soit le jugement que l’on veuille finalement porter sur ses arguments, reconnaissons que le grand mérite de Voir la Vérité, c’est d’avoir construit un objet théorique spécifique ; l’information télévisée est une configuration de discours et de techniques, plus ou moins avoués, qui vise jour après jour à dire et montrer la vérité. Sous l’influence de Michel Foucault, les auteurs conçoivent cet objet théorique comme un savoir appliqué, relativement autonome ; à cet égard, le journalisme, qui tire sa légitimité d’une prétendue objectivité garantie par un système de règles et de contrôles établis par une communauté de professionnels, n’est pas si éloigné des sciences humaines (sociologie, histoire, ethnologie) en ce que son discours, pour idéologique qu’il soit, n’est pas entièrement réductible à des intérêts sectoriels ni à une quelconque subjectivité. L’historicité du journalisme audiovisuel est aussi et surtout celle de la production de ses concepts, et pas seulement celle de ses contraintes extérieures politiques et sociologiques. Construire ainsi son objet théorique, c’est éviter une vision par trop réductrice qui voit dans l’information télévisée l’expression directe des influences politiques ou mercantiles.
De prime abord, il faut s’interroger sur le statut épistémologique de la coupure faite entre journalisme d’enquête et journalisme d’examen, et située autour des années 1964-1967. Perçue comme une théorie descriptive susceptible d’être confirmée ou infirmée de façon empirique, une telle coupure ne résisterait pas longtemps à l’épreuve des faits. À maints égards, le journalisme de télévision des années 1990 est très loin de celui analysé par Brusini et James ; grande est alors la tentation d’y ajouter d’autres coupures qui prennent en compte l’évolution de techniques et de pratiques et, fait marquant, le changement de statut juridique de la première chaîne. Tentation à laquelle il faut résister dans la mesure où multiplier les discontinuités tend vers une histoire composée de stades successifs, identifiés empiriquement. Comme les auteurs le précisent (p. 19), il s’agit d’une distinction entre deux « régimes de vérité », concept qu’emploie Foucault pour désigner « l’économie de pouvoir » (relation circulaire entre institutions et discours) gouvernant les procédures et les techniques qui distinguent entre le « vrai » et le « faux ». La discontinuité entre deux régimes de vérité doit se justifier en termes autres qu’empiriques, ce qui nous oblige à rejeter, par exemple, une définition par trop descriptive du journalisme d’examen qui le limiterait à la prépondérance du studio par rapport au terrain, ou à la dominance du commentaire sur l’image. Composé d’aprioris fondamentaux régissant les pratiques et leurs discours d’escorte, le régime de vérité a sa propre temporalité : comme le disent les auteurs, « l’histoire de la vérité à la télévision n’est pas scandée par les mêmes événements que son histoire juridique, politique ou technologique. La nomination d’un ministre de l’information, l’élaboration d’un statut inédit ou l’emploi d’une nouvelle caméra ne détournent en rien son cours. Elle n’a pas non plus la même vitesse »[2].
L’analyse d’un régime de vérité porte donc sur la configuration abstraite qui relie les éléments isolés et disparates (image-prétexte, commentaire sur images, commentaire sur plateau, témoignage, débat, terrain, studio, reporter, spécialiste, animateur, etc.) et qui les rend intelligibles. Ainsi défini, le concept de régime de vérité se mesure à d’autres formulations théoriques ; bien évidemment, les mêmes formes empiriques (type d’émission, statut du journaliste, techniques professionnelles) existent avant comme après la ligne de coupure dessinée. Au sein d’une autre configuration, cependant, elles n’ont ni le même sens, ni la même fonction. La coupure est un « évènement discursif » (Foucault), qui marque un réaménagement interne de la configuration de discours et de pratiques, un déplacement d’emphase qui se manifeste dans l’émergence de nouveaux objets autrefois inconcevables, de nouvelles fêlures.

Michel Foucault (1926-84)
Il faut préciser toutefois que les concepts d’« enquête » et d’« examen », appliqués au journalisme audiovisuel, sont des emprunts métaphoriques de ce qui, chez Foucault dans Surveiller et Punir, réfère au passage au 19ème siècle d’une justice « inquisitoire » à une justice « disciplinaire », marquée entre autres choses par l’observation minutieuse de plus en plus analytique, l’établissement d’un dossier jamais clos [3]. Emprunts qui sont également partiaux en ce qu’ils négligent un des thèmes principaux de Surveiller et Punir : le lien étroit entre le développement des sciences humaines et celui d’une « société disciplinaire ». Établir le lien entre le passage évoqué ci-dessus et la naissance du journalisme moderne demandera un travail en amont qui fonde ce dernier dans le projet des Lumières, projeter justement une lumière à visée réformatrice sur les zones d’ombre de la société : en ce sens, l’information en images serait le point culminant d’une certaine conception historique du journalisme. Une telle approche, qui fonderait les techniques journalistiques dans les procédures juridiques visant à établir la vérité [4], donne une autre résonance au terme usuel « dossier », consacré dans le titre de l’émission à débats thématiques Les Dossiers de l’Écran. Jamais fermé, ouvert et rouvert selon le jugement d’un professionnel affranchi des péripéties événementielles, le dossier journalistique permet d’élaborer des discours « normalisés » s’appliquant aux secteurs de la vie quotidienne jusqu’alors à l’écart du regard journalistique.
Il est clair que pour Foucault, les formes d’enquête et d’examen sous-tendent toutes les disciplines scientifiques, et se détachent d’une technologie ou d’une méthode précise. Dans le domaine du journalisme, elles existent bien avant l’arrivée de la télévision. Dans son histoire de la presse écrite aux États-Unis, Michael Schudson montre l’irruption vers la fin du 19e siècle d’un journalisme de synthèse et d’interprétation, étroitement lié aux sciences sociales naissantes, qui rompait avec la forme dominante orientée autour de la collecte (présence sur le terrain) et le compte rendu des faits (qualités narratrices) [5]. Le journalisme en tant que langage spécialisé est donc constitué dans la rupture avec une approche purement descriptive des événements, rupture qui permet l’émergence d’un discours professionnel autonome et l’extension du champ journalistique à une réalité non événementielle.
La méthode généalogique de Foucault n’est pas une recherche des origines, de formes embryonnaires en attente d’un aboutissement historique ; plutôt, elle tourne le dos à la tentation évolutionniste afin de voir sous quelle forme, et dans quel contexte discursif, un savoir a fait son entrée dans le champ du discours [6]. La coupure épistémologique entre deux régimes est constitutive d’une pratique proprement journalistique à la télévision : les formes enquête et examen font partie de la configuration qui préside au début de la télévision (dans une histoire de longue durée, vingt ans sont un instantané dans le temps). Pour imposer une manière de faire de l’information spécifique à la télévision, il a fallu franchir un obstacle épistémologique primitif : l’incapacité de l’image à figurer un discours abstrait, autrement dit à rendre visible l’invisible, condition sine qua non d’un traitement proprement journalistique de l’information à la télévision. La coupure entre les formes enquête et examen doit être pensée non seulement comme un événement fondateur, donc irréversible, mais aussi comme une tentative continue de surmonter cet obstacle, où rien n’est gagné d’avance.

Francis James (1952-)
À première vue, le livre de Brusini et James, qui se préoccupe plutôt de changements dans les pratiques et dans le statut des professionnels de l’audiovisuel, ne semble pas pertinent pour une analyse du contenu des magazines d’information. Mais prendre ce livre comme point de départ me permet de saisir pleinement l’autonomie formelle des magazines télévisés, à laquelle tout contenu se doit de s’adapter, sous peine d’être récusé par les normes journalistiques dominantes. On ne peut pas traiter une émission à la télévision en recourant, de façon bâtarde, aux techniques d’analyse de cinéma ou de textes écrits, encore moins en passant par des typologies d’images ou de linguistique appliquée. Ce qui est fondamental pour les journalistes de l’audiovisuel l’est également pour qui veut analyser le contenu de celui-ci : un certain rapport historique établi entre commentaire et image.
Dans une reprise ultérieure, Francis James se sert d’une belle abstraction empruntée à René Char, celle d’un « partage formel » : « partage » en exprime la redistribution des rôles et des responsabilités ; « formel », « …un rapport neuf entre opération et objet » [7]. Portant sur la naissance d’un nouvel ordre des gens et des choses dans l’information télévisée, la formule gagnerait à être appliquée également au rapport établi entre commentaire et image, rapport à jamais tendu qui reflète la tentative plus ou moins réussie pour réconcilier deux éléments discursifs, chacun avec sa logique propre.
Dans le journalisme d’enquête, l’image se conçoit comme un indice de vérité qui dérive du lien pur, non contaminé entre réalité et image. Il importe que le commentaire reste subordonné, qu’il s’efface devant l’image, n’apportant que deux éléments supplémentaires d’information que celle-ci ne peut fournir, le nom et le moment. Mais comme le dit Derrida dans un autre contexte, le « supplément » est dangereusement ambigu, comme en témoigne le sens contradictoire de « suppléer », compléter et remplacer. D’une part, il s’ajoute à quelque chose de déjà complet ; d’autre part, il constitue une addition qui compense un manque, une carence [8]. Dans une logique qui tend à concevoir l’image filmée d’un événement comme une « plaque photographique » du réel, le commentaire qui s’y ajoute risque toujours de détourner cette vérité à d’autres fins. Il est intéressant à cet égard de noter que les principaux reproches faits aux journalistes de télévision des années 1950-60 concernaient l’incapacité de voir « correctement » ; ainsi, Claude Darget se montre « incompétent » parce que son commentaire, à contresens, « cache le visible et coupe la parole aux images » [9]. Conception qui n’est pas dénuée d’arrière-pensées politiques. Inaugurant à l’antenne (en présence du présentateur Léon Zitrone) la nouvelle formule du journal télévisé en avril 1963, le ministre de l’Information Alain Peyrefitte s’intéresse, lui aussi, au rapport entre commentaire et image :

Peyrefitte (1925-99) à l’antenne (1963)
« Il suffit qu’on mette (le journaliste) en mesure de s’informer et de traduire son information en langage télévisé, c’est-à-dire en images parlantes. Le génie de la télévision, c’est l’image…Ce qui compte, ce qu’il faut remplacer les propos par l’image photographique de l’événement… Transformer le présentateur en un simple meneur de jeu qui donne la parole, le plus possible, aux images » (c’est moi qui souligne) [10].
En réalité, ce que souhaite Alain Peyrefitte, sans le dire explicitement, c’est une pure visibilité du pouvoir qui peut se passer de propos supplémentaires, trop indépendants, qui peut se passer donc de la médiation journalistique. Ses vains propos rejoignent indirectement le naturalisme défendu par une première génération de journalistes-reporters, orientation renversée dans le journalisme d’examen qui consacre le droit des journalistes spécialistes de parler, et à la place de l’image, et à la place du pouvoir politique. Schématiquement, on pourrait dire que le problème ne se pose plus en termes d’ajouts à l’image, mais à l’inverse, il importe désormais que l’image ne contredise pas l’analyse, qu’elle soit prétexte à la parole. Priorité qui a contribué logiquement à la quasi-disparition des magazines généralistes de reportages entre 1969 et 1990.
L’image symptôme
Loin d’une complémentarité harmonieuse, naturelle, le partage formel entre commentaire et image trahit non seulement un rapport de forces entre catégories professionnelles, mais aussi une tension constante entre deux logiques discursives où l’image ne se suffit jamais à elle-même. L’analyse critique s’intéresse à ces instants où l’artifice de la complémentarité entre paroles et images s’effondre momentanément ; le reportage existe autant par ce qu’il ne peut pas dire, par les contradictions refoulées qui produisent en son sein des microfissures. L’image-symptôme marque une incongruité patente dans le rapport entre commentaire et image, un décalage (comprenant des silences « assourdissants ») qui révèle les limites réelles du projet idéologique défendu par le reportage (largement conscient, plus ou moins cohérent, un projet idéologique – [concept que j’emprunte au philosophe Pierre Macherey parlant d’un roman de Jules Verne] [11] – permet au reportage de faire sens dans le contexte historique donné). Sous la forme de symptômes « pathologiques », le mariage forcé entre image et commentaire nous fournit des traces visibles de ce que nous appellerons l’imaginaire historique.
Dans la théorie psychanalytique, le symptôme représente le compromis entre l’agence du refoulement (instance du surmoi) et les pulsions inconscientes (instance du ça). Comme l’image du rêve, le lapsus ou l’acte manqué, l’image-symptôme peut être appréhendée comme une formation symbolique provenant du conflit intrapsychique, du clivage de la personnalité que suppose l’existence d’une instance de répression. Formellement, le commentaire off sur images ressemble à ce que Freud appelle « le délire d’observation », forme de psychose dans laquelle le sujet entend une voix extérieure qui l’observe, et qui commente ses faits et ses gestes [12]. Le délire d’observation manifeste de façon nette le clivage du moi ; l’instance observante, qui semble être logée dans la réalité extérieure, fait partie du moi (la conscience morale) et cependant peut en être séparée (le surmoi « tyrannique » qui punit des fautes imaginaires). Selon ses différentes modalités historiques, la voix off remplit plusieurs fonctions à géométrie variable : décrire le regard, l’encadrer (dire la vérité) et censurer le plaisir scopique que procurent les images de corps et de visages (allant jusqu’à la (dé)négation « autodestructrice »). En d’autres termes, la voix off est toujours potentiellement psychotique dans la mesure où elle s’écarte de l’image. Dans cette optique, la forme « normale » que prend le commentaire sur images nous laisse un aperçu aplani de « la structure psychique » (Michel de Certeau) de ceux qui sont mandatés pour dire et montrer la vérité au nom des autres [13]. Équilibre historiquement « idéal » entre les trois instances de la deuxième topique freudienne, cette structure psychique, pour peu que la forme soit relativement crédible, est celle qui devrait permettre de voir (et d’entendre) la vérité de façon non pathologique. Sous sa forme audiovisuelle, le partage est donc doublement normalisateur, non seulement sur le plan idéologique (discours « convaincant »), mais aussi dans sa présentation implicite d’une rupture psychique normalisée.
Dans L’information en uniforme, essai d’historien sur la couverture télévisuelle de la Guerre du Golfe, Marc Ferro formule le souhait que soit exploitée par l’historien et par le journaliste la masse d’images produite par la télévision, une sorte de « contre-analyse de la société » [14]. Projet que je fais mien ici : une contre-analyse des images, ou pour emprunter un autre langage, une « lecture symptômale » (Althusser), demande un travail d’interprétation, et permet de situer la dimension idéologique du journalisme télévisé à un niveau plus profond que celui des débats politiques courants. À titre de démonstration, j’analyse deux reportages thématiquement comparables, l’un datant de décembre 1960 sur la ville nouvelle de Sarcelles (Cinq Colonnes à la Une : « 40000 voisins »), l’autre datant de juin 1992 sur Los Angeles deux mois après les émeutes (Envoyé spécial : « LA, Western Avenue »), tout en présupposant qu’ils sont tous les deux formellement représentatifs des reportages de leur époque.
Au petit matin, Sarcelles se vide (2 décembre, 1960)

Pierre Tchernia (1928-2016) à l’époque de « Cinq Colonnes »
« 40000 voisins » (Pierre Tchernia) commence par un plan pris depuis un hélicoptère, qui donne à voir la topographie d’un grand ensemble. Prouesse technique, le regard de la télévision s’aligne sur les bienfaits du progrès : « dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c’est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci ». L’avenir, c’est une ville nouvelle comme Sarcelles, appelée à remplacer les grandes villes traditionnelles, de même que l’hélicoptère remplacera la voiture et les trains. Visiblement, on n’arrête pas le progrès.
Mais dans le présent il y a un accroc : « on les appelle aussi les villes dortoirs…les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès ». Que disent-ils ? Là n’est pas le propos ; dans le code journalistique en vigueur, la référence aux sociologues suffit à indiquer que les villes nouvelles posent problème. Du haut de son hélicoptère, le journaliste Pierre Tchernia se donne pour mission de juger Sarcelles (comme il le dit plus loin, « il ne faut pas trop vite la juger »). Sa stratégie, c’est de suspendre tout jugement immédiat, d’attendre que la réalité permette un avis plus favorable, que les lignes de progrès technique et sociale se rejoignent. La difficulté que pointe ici un journalisme qui privilégie le terrain, le visible, c’est d’assurer le lien entre un présent problématique, et un avenir prometteur n’existant pour l’instant que dans le regard du journaliste. Autrement dit, entre le jugement (situé là-haut) et le réel (en bas).

« C’est en hélicoptère que vous irez » (ombre de celui-ci visible comme tache à droite).
Descente sur terre. Des arbres s’interposent entre la caméra et la façade d’un bloc d’appartements, et l’image nous prend à témoin : « les arbres, voyez-vous, sont très jeunes ». La métaphore organique (la ville comme forme de vie) renforce celle d’un passage de générations ; surplombant des images d’une vieille dame et d’une charcuterie à l’ancienne, le commentaire nous informe, « à quelques centaines de mètres de là, Sarcelles le vieux, un village traditionnel plutôt fatigué qui a vu naître une ville nouvelle dont il ne sera bientôt qu’une dépendance ». Mort anticipée du village qui n’attend que d’être remplacé par « une ville toute neuve en train de naître ».

Pierre Tchernia (droite) et le bistrotier triste.
Également vestige d’un monde en train de mourir, un petit îlot de pavillons où se trouve un bistrot, « le seul qui existe dans le coin », désespérément vide. Installé en 1937, quand les rares pavillons étaient « noyés dans la plaine, c’était de la grosse culture maraîchère, il y avait toujours des betteraves rouges », le bistrotier triste (et visiblement alcoolique) ne manque pas d’infléchir la métaphore organique dont il est le porteur : « [les gens de Sarcelles] ne sont pas bien riches, les loyers, ils sont très chers. Et, en plus, quand les gens arrivent ici, ils n’ont pas de meubles… »
Meubles, loyers, c’est le mode de vie d’une classe qui se profile : « le prix des loyers, c’est le principal souci des habitants » ; « le problème dépasse le cadre de Sarcelles, c’est un problème général, les classes les moins favorisées de notre société ont le plus grand besoin de logements, et c’est justement les appartements neufs qui coûtent le plus cher, d’autant que le Français, par rapport à d’autres peuples, est habitué à consacrer un budget moins important à son logement ». Phrase contradictoire qui, d’une main, souligne l’injustice d’une société divisée en classes, et qui, de l’autre, implique que le Français, cette créature hors classe, ne dépense pas assez sur son logement (et trop peut-être dans les cafés). Le problème dépasse le cadre de Sarcelles, il dépasse le cadre des classes sociales ; le Français de condition modeste doit faire des efforts pour accéder à la propriété, et à la modernité. C’est aux Français de se mettre en règle avec la marche de l’histoire. Sur fond d’un plan de la rue principale de Sarcelles, déserte, on nous informe : « ce sont les jeunes ménages qui ont besoin de venir ici, cependant que les beaux quartiers voient s’éteindre les vieillards ». Les différences de classe se dissolvent en différences de génération : la classe ouvrière se transforme en « jeunes ménages », alors que la bourgeoisie s’assimile à des vieillards moribonds. C’est la mort d’une classe devant la montée d’une génération dont la mission historique est le dépassement des clivages de classe.

Intérieur « moderne » avec poste de télévision
Dans le processus d’embourgeoisement qui va main ans la main avec la modernisation du pays, Sarcelles accuse quelques défauts : « il y a aussi l’absence de persiennes aux fenêtres, on s’en plaint souvent ». Mais les progrès réalisés sont sensibles : « le fait d’être enfin au chaud, à l’aise, à l’abri, ici la plupart des habitants viennent de logis insalubres, trop sombres, trop humides ». Image-symptôme, le plan incongru d’une cuvette de w.c. (alors que le commentaire parle de « l’allocation logement qui est souvent importante ») trahit la conception hygiéniste du progrès qui fonde inconsciemment le reportage. Le décalage momentané entre image et commentaire témoigne de la difficulté qu’éprouve le reportage à figurer son projet, l’assemblage du progrès technique et de la nouvelle donne sociale dans une vision consensuelle de la modernité, les deux éléments étant ici réunis trop brutalement dans l’image d’une cuvette. Mais le sens politique est clair : expulsées en dehors de la ville, de leurs logis « insalubres », les classes populaires se voient récompensées par des sanitaires en dedans. Surplombant des images fixes de pavillons de banlieue en pierre, Pierre Tchernia en conclusion nous assure : « mais de là à regretter les bicoques lugubres et malsaines de la banlieue parisienne, il y a un pas que je refuse de franchir ».

Image-symptôme 1 : « Mais il faut déduire de cela l’allocation logement qui est souvent importante »
Cependant, les témoignages des Sarcelloises (manifestement préoccupées par le coût des loyers, le manque d’intimité, la sonorité, la monotonie, les catégories sociales trop mêlées, l’architecture inesthétique) n’appuient pas une conclusion qui force le sens des images, et qui remplace les paroles des intéressés. Un témoignage retient l’attention : au moment où une femme se plaint des populations « trop mêlées », le journaliste corrige le tir : « trop les uns sur les autres », refusant d’entendre l’intolérance populaire (racisme ?) que ne peut manquer de découvrir l’enquête sur le terrain. Deuxième image-symptôme : un commentaire « les adolescents et les enfants forment la majorité de la population de Sarcelles » s’attache à une image d’un adulte basané (portugais, espagnol ?) en compagnie d’une femme (française ?), image doublement indue en ce que le monsieur est sensiblement plus petit que la femme. Remonte donc à la surface le temps d’une image « mal choisie », ce dont le reportage essaye de refouler : la fracture dans la population de Sarcelles entre immigrés et Français de souche.

Image-symptôme 2 : « Les adolescents et les enfants forment la majorité de la population »
Fracture déplacée sur un autre problème. La moyenne d’âge de Sarcelles est de douze ans, soit trois fois moins que la moyenne nationale. Cette jeunesse, appelée à vivre plus bourgeoisement, de façon plus moderne, « est à la fois le slogan et le problème de Sarcelles ». Ce sont nos amis les sociologues qui « vous diront que les grands ensembles favorisent la délinquance juvénile ». Sur fond d’image deux pongistes dans une Maison des Jeunes, le problème évoqué est aussitôt réglé : « pour l’instant à Sarcelles, il n’y a guère de voyous et la Maison des Jeunes y est pour beaucoup ». Solution technique aux problèmes de société qui s’aligne sur l’espace « neutre » du journalisme, la Maison des Jeunes (« ni politique, ni confessionnelle ») participe d’une même conception « hygiéniste » du progrès social qui passe par l’organisation d’activités (poterie, tennis de table, photo, baby-foot) encadrées à l’intérieur. « Sans Maison des Jeunes, dit un jeune homme en gilet de cuir noir, les trois quarts d’entre nous seraient en prison », autre forme d’encadrement pour ce qui constituait les classes dangereuses.

Le jeune « sauvé » par la Maison des Jeunes
Dans la logique du journalisme d’enquête, l’image apportée du terrain constitue « la preuve » du discours tenu. Au couple thèse et démonstration, correspond le couple commentaire et image. Éparpillées à travers le reportage, se trouvent autant d’injonctions à se laisser convaincre par la vérité de l’image : « les arbres, voyez-vous, sont très jeunes » ; « un petit îlot que vous allez découvrir » ; « la gare, voyez-vous, n’est qu’une halte » ; « tenez, retrouvez la façade que vous avez regardée tout à l’heure » ; « la vie extérieure, la voilà ». Le malaise vient du fait que l’image n’est pas toujours à la hauteur de sa mission : le maire « aventurier » ne fait que réciter des chiffres d’une voix monocorde ; le jeune en gilet, « sauvé » par la Maison des Jeunes, est visiblement (trop) gentil ; les « bicoques insalubres » ne sont que des pavillons en pierre ; la ville nouvelle « en train de naître » sur fond off de musique d’accordéon s’illustre par quelques joueurs de pétanque et des adolescents qui se promènent, écrasés par les grands ensembles au milieu du « Sahara » (pour reprendre l’image du jeune en gilet). Le commentaire compatissant passe outre les témoignages et les images rapportés de Sarcelles, ce qui touche le journalisme d’enquête à son cœur même : « sauver » Sarcelles exige que l’on suspende son jugement jusqu’à un avenir pour l’instant invisible. Parfois sous la tension, la réalité du visible oblige le texte à rattraper le décalage, à se contredire ; à peine a-t-on déclaré que « les promeneurs et les amoureux ont pris le pli », que l’on enchaîne, « les enfants s’ennuient le dimanche ». Sur le terrain, « on prend conscience de ce que c’est une ville dortoir », mais on voit mal comment le temps pourrait transformer « un principe qui restera le même : des centres commerciaux, sportifs, administratifs éloignés des groupes d’immeubles ». Le journalisme d’examen n’a pas encore trouvé sa forme, l’image-prétexte qui permet au journaliste de dire la vérité, de tenir un discours autonome par rapport à l’image. Pour l’instant, l’abstraction n’a droit de cité qu’en passant par de lourdes mises en scène : le maire qui récite les chiffres de la croissance démographique ; le curé qui fournit le nombre de baptêmes et d’enterrements ; le bistrotier triste qui « représente » les loyers trop chers ; la vue depuis l’hélicoptère qui donne à voir le futur.
Force est de constater que le cadre idéologique de la modernisation de la France, discours naturel du journalisme d’alors, se trouve malmené sur le terrain. La relation « naturelle » de complémentarité descriptive trébuche dès lors qu’il s’agit de monter des images n’obéissant plus à une structure chronologique. L’enquête sur le terrain entre en contradiction avec le hors-champ, cet espace supplémentaire, surmoïque, qui impose un discours (paternaliste) au nom des autres. On ne juge pas un enfant « qui vient de naître », mais on s’occupe bien de lui, d’autant plus qu’il s’agit d’un enfant difficile : afin que sa socialisation soit réussie, il faut qu’on lui apprenne la propreté et la discipline sociale. D’où l’obsession hygiéniste du reportage : « au petit matin, Sarcelles se vide » [dans des toilettes privatives]. La gare en construction (« une halte ») figure la promesse d’une vie réglée, rythmée par le départ au travail le matin et le retour au domicile le soir, fantasme d’une société « propre », sans classes dangereuses, où chacun retrouve sa dignité naturelle. On mesure ici l’importance stratégique pour le journalisme audiovisuel d’alors d’un discours d’inspiration personnaliste (Emmanuel Mounier) et sociale-chrétienne. C’est bien le curé qui nous annonce le nombre annuel de baptêmes, et non pas le maire qui annonce le nombre de naissances. Dans tous les sens du mot, on veut « sauver » Sarcelle, c’est une question de foi.
Saisie par l’idéologie, la ville nouvelle se prête mal à un discours naïvement empirique. L’enquête s’efforce d’aboutir à son point de départ : « les grands ensembles sont-ils un mal nécessaire, ou un nouvel aspect du plaisir vivre ? Ce sera si vous voulez à ces enfants de répondre dans plusieurs années ». Question partiellement fermée dans la mesure où les villes nouvelles sont par-dessus tout « nécessaires ». Y a-t-il de la lumière au bout du tunnel ? On peut en douter ; la dernière image montre deux enfants qui sortent de la lumière et entrent dans un tunnel.

Image-symptôme 3 : « Ce sera … à ces enfants de répondre dans plusieurs années »
Nulle image ne saurait répondre à leur place ; rendez-vous donc dans un studio de télévision, où seront invoqués non seulement « ces enfants » devenus adultes, mais aussi des représentants politiques, des urbanistes, des sociologues, pour débattre du mal-vivre — constat acquis d’avance — des habitants des villes nouvelles. Aux journalistes de veiller au dossier, de retenir les témoins, de poser les bonnes questions.
La jeune fille sur la colline (25 juin 1992)

Eric Lemasson en plateau
Trente-deux ans plus tard, il est de nouveau question de délinquance dans le magazine généraliste d’information Envoyé Spécial (France 2), crée en janvier 1990, qui renoue avec le format de Cinq Colonnes. Dans « Western Avenue », le jeune reporter Éric Lemasson et son équipe débarquent à Los Angeles après les émeutes dévastatrices de mai 1992. Lors de son lancement, le présentateur Paul Nahon explique l’origine des événements (« l’injustice, le racisme, le ghetto, la misère »), et formule la question suivante : « comment un pays aussi riche peut-il engendrer autant d’inégalité, de pauvreté ? » Un problème majeur apparaît ; le reportage doit à la fois illustrer les éléments d’explication, tout en hissant ceux-ci à un niveau encore plus abstrait. L’injustice est à l’origine des émeutes, mais qu’est-ce qui est à l’origine de l’injustice ? De par sa forme, un reportage ne saurait répondre à une telle question.

Bernard Benyamin et Paul Nahon, présentateurs d' »Envoyé spécial », 1990-2001.
La problématique d’enquête ne se réduit pas au reportage, bien que celui-ci, avec ses notions de « terrain » et de « témoignage », soit la forme qui exprime mieux sa démarche. Ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas de montrer si oui ou non le reportage moderne correspond aux catégories conceptuelles établies, mais de voir dans quelle mesure une forme issue du journalisme d’enquête est influencée par la prédominance à la télévision du journalisme d’examen (émissions en plateau, talk-shows, etc.).
Commençons par la fin, inversant la logique de la « postface » en plateau, où le journaliste explique sa démarche après coup. En conversation avec Nahon en plateau, Lemasson s’explique :
« Les gens, lorsqu’on est arrivé dans ce quartier noir de South Central, dès qu’on descendait de la voiture, nous ont intimé l’ordre – gentiment ou pas – de déguerpir au plus vite. Alors, ce qu’on a essayé de faire, c’était de prendre une photographie de ces populations qui ne se mélangent pas, de ces populations qui se détestent, un peu à la manière des géologues qui prennent une carotte et qui vont faire une coupe dans le sol, et nous avons décidé d’appréhender la ville à travers une coupe, à travers une avenue, et on a constaté que des populations ne se mélangeaient pas » (j’ai souligné).
L’angle choisi (la « coupe ») n’est pas le résultat d’une construction préalable, mais vient après (« alors ») les mésaventures de l’équipe, devant l’impossibilité de poursuivre le réflexe initial d’enquêter sur place. Issu du journalisme d’enquête, un tel réflexe prolonge les implications idéologiques d’un certain style de sociologie empirique : les pauvres détiennent en eux l’origine de leur pauvreté. La contradiction entre illustration et explication (et entre les formes enquête et examen) se trahit dans la tautologie des propos : « les populations qui ne se mélangent pas » sont à la fois le point de départ et la conclusion du reportage. Contradiction également apparente dans les deux métaphores employées : l’une, la photographie, saisit la surface, le visible, alors que l’autre, la coupe ou la carotte, vise la profondeur, le caché, invisible. « Cinq Colonnes n’est pas une plaque photographique du monde, mais veut être une réflexion sur monde », avait déclaré Pierre Desgraupes en 1968. Plus de vingt ans après, le problème fondamental de « partage formel » reste le même : comment réconcilier le visible et l’invisible, l’image de la surface et l’analyse en profondeur ? Le reportage en question résout ce problème en mettant à plat la profondeur, transformant la dimension verticale en plan horizontal. Le point de départ et le point d’arrivée étant identiques, le reportage doit trouver le moyen de faire du surplace, de marquer le temps pendant sa durée. Que faire ? Tout simplement en transformant le terrain en plateau, où interviennent, à tour de rôle, une succession de personnages exotiques et jeunes : des membres de gang noirs, des miliciens coréens et de très jeunes gangsters mexicains (entre 12 et 16 ans), qui vivent en bas des collines, et qui s’expriment en situation, dans leur habitat. Autour de vingt-cinq minutes, alors que l’on évoque le danger des balles perdues pour les enfants (avec image d’un panneau d’avertissement), le gros plan d’une jeune fille blanche d’environ douze ou treize ans introduit la dernière séquence qui se passe sur les collines de Hollywood. Faux raccord : la fille (« qui n’a jamais vu un membre de gang ») n’est plus tout à fait une enfant.

« If you shoot bullets into the sky, when they come down, we might die » (Si vous tirez en l’air, les balles peuvent nous tuer).

La fille du publicitaire (plan sans commentaire)
C’est la fin du voyage. Dans son jardin, Dale Richards, publicitaire, la quarantaine, taille ses rosiers. Toute responsabilité envers la violence et la misère que nous venons de voir lui est étrangère : « c’est comme une île ici, comme la campagne… Je ne suis pas riche, je ne suis pas chanceux, j’ai dû travailler dur pour ce que je possède. Les Noirs veulent quelque chose pour rien. C’est très dommage. C’est pour ça qu’ils pillent. L’idée de s’améliorer, d’aller à l’école n’entre jamais dans leur tête. Ça fait partie de leur culture ». Propos intercalés de plans silencieux de « Lolita » (désignation certes subjective), sa fille, en short, vue de dos se penchant sur la balustrade. Les préjugés racistes du « fils de pub » risquent de lui coûter cher, voilà ce que nous dit cette série de prises de vue « superflues » qui figurent son absence de conscience politique. « Dale et ses voisins ont préféré oublier les pillards, oubliés qui peut-être un jour monteront sur la colline ». Ce sont les derniers mots du reportage. Et cette fois, l’objet de la convoitise des pillards noirs ne sera plus les fringues, les téléviseurs et les paquets de cigarettes que nous avons vus dans une séquence précédente, mais la fille du publicitaire, sexualisée dans des images qui anticipent et épousent le regard subjectif de l’acteur virtuel d’un événement futur, le violeur de la fille. L’oubli de Dale Richards se donne à voir dans un plan pris depuis les collines où l’on ne voit qu’un brouillard noir, « jugement simple d’un habitant de Hollywood pour qui le ruban gris de l’avenue se perd là-bas dans les brumes ». Voilà faute de mieux l’explication retenue par le reportage : l’injustice résulte d’une incapacité de voir de la part de Dale Richards et de ses semblables.

« Oubliés qui un jour peut-être monteront sur la colline » (dernier plan, et renversement du regard)
C’est dans cette « scène fantasmatique » que l’on découvre l’imaginaire historique du reportage. La fille est d’abord filmée de face, prise d’en bas ; ensuite, par-derrière ; entre-temps, en plans intercalés, Dale taille ses rosiers, aveugle à l’idée que d’autres, dans un futur proche, risquent de violer sa fille, de « tailler sa rose ». Les laissés pour compte d’en bas monteront sur les collines, de même que les masses misérables et sans espoir de l’Afrique, et des pays de l’Est « monteront » sur l’Europe de l’Ouest. [Inconsciemment, le reportage anticipe ici par déplacement l’attentat contre les Twin Towers à New York du 11 septembre 2001]. En ce sens, la séquence met en scène un fantasme sadomasochiste : sadique en ce qu’elle épouse le regard du futur violeur ; masochiste, en ce que la fille, par le jeu de permutation de rôle entre sujet et objet mis en évidence par Freud, c’est nous-mêmes. On est très proche ici (« une jeune fille sera violée ») de l’analyse célèbre de Freud : Un enfant est battu (résumé ici) [15].

Image-symptôme : plan « subjectif » sans commentaire
D’une certaine façon, le déplacement sur le terrain de Los Angeles et les 29 minutes d’images qui en résultent ne sont qu’un prétexte pour faire passer ce plan par trop silencieux, véritable image-symptôme. La voix off arrive à point nommé, c’est-à-dire trop tard pour gâcher le plaisir scopique ; ainsi, les derniers mots du reportage (« peut-être un jour ils monteront sur la colline ») restaurent le sérieux moral après coup. En termes freudiens, l’abord du réel tend à bifurquer entre l’expression visuelle de pulsions sadiques, et la (piètre) justification de celles-ci dans le commentaire, déséquilibre qui témoigne d’un surmoi affaibli.

John Bryant, financier, « en situation »
Si le publicitaire raciste a le (mauvais) dernier mot, le héros du reportage (rencontré à mi-parcours) est un jeune financier, John Bryant, « noir, riche et influent », qui a « décidé d’user de ses relations dans les milieux financiers » pour créer « opération Espoir », libérale (place aux entrepreneurs) et moralisatrice en diable. Une assimilation rapide s’effectue entre John et la conscience collective, réifiée : « L.A. n’a qu’une seule idée en tête, reconstruire ». Deux membres des gangs rivaux, les Bloods et les Crips, font irruption dans l’image au moment où John explique son projet, pour livrer un message : désormais, tous les Noirs sont ensemble. Que la scène soit manifestement scénarisée (la voiture arrive à point nommé dans le contrechamp ; les membres du gang s’adressent à la caméra et non pas à John comme son salut de la main à la voiture qui part essaye de nous le faire croire) importe moins que le fait que l’image « confirme » non pas la thèse du journaliste, mais le point de vue d’un acteur-témoin. La mise en situation scénarisée de John se met au service de sa propre vérité, à savoir une rédemption miraculeuse. Sur des images de John en voiture, le commentaire reprend :
« Les célèbres Bloods et Crips s’entre-tuent depuis des années. Ils essayent maintenant de fraterniser, la preuve est là, selon John, que les émeutes ont provoqué un électrochoc dans la communauté noire. La preuve aussi que son engagement pour reconstruire le quartier sur de nouvelles bases n’est pas une utopie. John y croit, exemples à l’appui, juste derrière Western Avenue ».

Solidarité scénarisée : un Blood (en rouge) et un Crip (en bleu) qui arrivent à point nommé dans le contre-champ où la caméra les attend.
Ces exemples ? En sortant de Western Avenue, on est loin du ghetto, et John nous prend à témoins : « la fierté passe par la propriété, il faut que les Noirs deviennent propriétaires de leur commerce ». Commence alors une longue séquence qui se passe dans la First Emmy Church, où « John ne manque pas un seul office », et qui nous offre, en récompense, de fort belles images de chansons gospel et de danse. Mais quel est le rapport avec les émeutes et la misère du ghetto ?
« À deux pas de Western, on célèbre ici chaque dimanche 200 ans de lutte pour l’égalité. Les sermons sont emplis de politique, les cantiques emplis de larmes et de joie. Le rêve américain de la terre promise, de l’égalité des chances, la plupart des fidèles de la First Emmy Church en rêvent encore, et Western aussi voudrait y croire. Mais en traversant le quartier coréen, l’avenue, la ville montraient leur vrai visage, celui de la peur ».
Le commentaire comporte des éléments métaphoriques (« les cantiques emplis de larmes et de joie » ; « la ville a un visage, la peur ») et explicatifs (« emplis de politique »). Mais en regardant de près, l’explication n’en est pas une : la dimension politique des sermons n’est nullement précisée. Le lien avec Western Avenue ne tient qu’à un fil rhétorique (« le rêve américain, la plupart des fidèles de la First Emmy Church en rêvent, et Western aussi voudrait y croire ») qui sert à raccorder deux séquences du voyage ; c’est en ce sens que l’on peut parler d’un commentaire-prétexte dont le rôle principal est de démarquer le reportage (dont les images, esthétisées, empruntent à l’écriture cinématographique) d’une fiction, et d’atténuer la transition brutale entre séquences.
Défait de ses illusions pédagogiques, saisi par la concurrence commerciale, le journalisme d’examen dévoile ses conséquences inattendues : non pas la maîtrise de l’image par la parole, mais la dissociation radicale entre les deux. Dans le cas de « Western Avenue », il y a presque autant de paroles prononcées par le journaliste dans les quelques minutes qui suivent la diffusion que pendant les 29 minutes du reportage. Se dégagent les deux cas de figure, les deux pôles de ce qu’on pourrait qualifier de journalisme d’examen en crise : les images sans paroles (par exemple, le clip qui ouvre le reportage, montage cut et musique rap), et les paroles sans « images » (commentaires en plateau). Dans l’association de commentaires-prétextes et d’images-prétextes, ce qui entre en crise, c’est l’existence même du reportage en tant que forme journalistique.
La soumission de l’image au texte dans le journalisme l’examen libérait un espace afin que le journaliste puisse passer au-delà d’une plate description de l’image, pour analyser un thème préalablement construit, pour dire autre chose. La légitimité de cet espace venait de la force du projet idéologique qu’il véhiculait : la convergence de deux lignes de progrès, technique et social, qui rendait caduque la lutte des classes, et qui permettait un traitement « neutre » de la marche de l’Histoire [une émission de débats animée par Jean-Marie Cavada entre 1987-2001 fut intitulée La marche du siècle]. Le reportage s’organise autour du progrès et de ces accrocs, les problèmes que le processus de modernisation se doit d’affronter et de surmonter. Dans cette interpellation implicite, il existe un interlocuteur de taille qui permet au journalisme audiovisuel de jouer pleinement son rôle de médiateur, d’opposant loyal : c’est l’État. Ainsi dans le reportage sur Sarcelles, le journaliste identifie les problèmes (la délinquance) provoqués par la modernisation et propose des solutions techniques au bon entendeur : « il faut » faire construire davantage de Maisons de Jeunes, de centres commerciaux.
Au fur et à mesure que s’installe la crise comme horizon indépassable de l’époque, le problème pour les journalistes de télévision devient autre. Dans un monde toujours déjà conceptualisé en termes de crise globale, il s’agit de moraliser (à défaut d’expliquer) des images fortes (esthétisation qu’impose une concurrence commerciale croissante) d’un monde à la dérive. Le reportage s’organise désormais autour de l’opposition entre volontarisme (du côté du commentaire) et fatalisme jouissif (du côté des images). Comme John, comme Western, « il faut y croire », car « l’engagement [de John] pour reconstruire le quartier sur de nouvelles bases n’est pas une utopie ». Volontarisme nécessairement moralisateur ; le journaliste, témoignage à l’appui, veut y croire et nous y faire croire aussi. Reconstruire le monde sur de nouvelles bases, sortir de la crise, surmonter les conséquences d’un ultralibéralisme qui accentue les inégalités sociales, ce n’est pas une utopie, c’est tout simplement une question d’engagement : par défaut, la crise s’explique par le manque de volonté, de croyance. Absence d’engagement qui vient en premier lieu de l’État, de plus en plus en retrait de la vie sociale, sous l’influence, justement, du libéralisme classique (« il faut que les Noirs deviennent propriétaires de leur propre commerce ») que préconise le banquier John Bryant, et que le reportage reprend à son compte. [En fait, vu rétrospectivement, on assiste ici à l’origine « en direct » de la future crise des subprimes en 2008]. À ce titre, « Western Avenue » est parfaitement contradictoire : d’une main, il dresse le portrait des conséquences pathologiques d’un « système » bâti sur l’exclusion ; de l’autre, il place sa confiance en la doctrine libérale responsable de la situation. Finalement, en plateau, la persistance des inégalités s’explique par des facteurs psychologiques et culturalistes qui empêchent les Américains de voir :
« …quand on discute à froid avec ces gens [les pauvres], c’est très frappant de constater qu’ils ne remettent pas en cause du tout le système américain dans lequel ils vivent. C’est-à-dire que même s’ils se sentent exclus un tout petit peu de cette société, ils rêvent encore de la terre promise américaine, et ils pensent qu’un jour peut-être, ils pourraient profiter de ce système américain, ils savent pertinemment que tout le monde n’a pas sa place dans l’Amérique riche, dans l’Amérique qui gagne, qui réussit, mais là où on retrouve justement l’individualisme forcené des Américains, c’est-à-dire que le chacun pour soi domine à la fin et ils pensent qu’ils réussiront un jour à avoir une part du gâteau pour eux ou pour leurs enfants ».
Fatalisme qui s’avère finalement plus fort que les efforts volontaristes mis en valeur auparavant. Aussi impuissant que ses personnages, le journaliste ne peut que constater que « tout le monde n’a pas sa place dans Amérique riche », que « le chacun pour soi domine à la fin ». À défaut d’un discours politique et social cohérent, l’objet ultime du reportage télévisuel devient le fantasme, ce point privilégié où pourrait être saisi le passage entre les différentes instances psychiques (selon Freud, « les fantasmes approchent tout près de la conscience »). Comprise en termes de capture d’émotion, la compétence du journaliste-reporter (armé de sa caméra, sa foreuse et son couteau), c’est de pouvoir trouver ce lieu et ces personnages à travers lesquels le fantasme eût être mis en scène. Le retour du refoulé est « acceptablement » déformé par les processus défensifs primitifs (renversement, dénégation, projection) que fournit la forme même du reportage, à savoir le commentaire sur images.
Conclusion
Quel est le statut du reportage dans la configuration « examen » qui s’étend maintenant jusque dans le domaine des variétés ? Il est rare que ces images prises sur le terrain ne soient pas encadrées (dans tous les sens du mot) par des débats ou des commentaires en plateau. Après trente ans de reportages à la télévision, on ne part plus à la recherche de la vérité comme en voyage de découverte. On peut même aller jusqu’à dire que le terrain est désormais un plateau grandeur réelle, éminemment décoratif, où les acteurs sociaux peuvent s’exprimer comme acteurs tout court, sur fond d’activité naturelle, leurs interventions étant « améliorées » dans la postproduction. De fait, le commentaire-(prétexte) se réduit au rôle de modérateur, introduisant les personnages, assurant les transitions entre intervenants et accouchant une (non-) conclusion qui respecte la diversité des propos.

Pierre Moeglin (1951-)
La forme examen se voit rattrapée par une contradiction de fond ; si l’image-prétexte est une manifestation en creux du journalisme d’examen, l’habillage de l’image en est une autre. Pierre Mœglin a parlé de « l’incontestable montée de nouvelles catégories de professionnels, graphistes, ensembliers, designers, informaticiens, metteurs en image… Autant de techniciens de l’assemblage…qui pourraient bien être rapidement tentés de chercher à disputer aux journalistes et aux réalisateurs un peu de la maîtrise sur la confection du JT que ceux-ci se sont, non sans mal, partagés au cours des ans » [16]. On peut également parler ici d’une nouvelle forme de « partage formel » au sein de la postproduction, entre les journalistes spécialistes, et ce que Mœglin appelle les « techniciens de l’assemblage » qui visent à dynamiser l’image (et accessoirement à chasser l’image-prétexte, jugée trop peu accrocheuse). Dans ce nouveau partage de rôles, qui voit l’émergence en force d’autres fêlures, la fonction de commentaire (lui-même minimisé au profit de la voix in) est souvent remplie par les témoins eux-mêmes, qui parlent en voix off sur fond d’images où ils jouent leur propre vie. Le rôle du journaliste se trouve ainsi doublement minimisé.
Force est de constater que la présentation dynamique de témoins en situation laisse peu de place à la démonstration en images d’une thèse, d’un point de vue synthétique. Là où le reportage s’avère bien rentable, c’est lorsqu’on compare son coût à celui d’un téléfilm. Certains reportages (notamment ceux de 52 sur la une qui innovent en la matière) recréent la vie des témoins qui jouent leur propre rôle dans des situations scénarisées [17]. L’enquête sur le terrain consiste essentiellement en un travail de casting et de repérage. Nul besoin de scénario serré, de cohérence dramatique, les microhistoires et situations se dispersent dans le montage juxtaposé de personnages, comme autant de points de vue dans un débat imaginaire. Avec du recul, on peut dire que s’affranchir des contraintes de l’événement constitue l’une des conditions formelles pour l’émergence du talk show, ou de « l’infotainment » où on « examine » une thématique hors temps à des fins promotionnelles ou du pur divertissement. S’affranchir de l’événement peut aller jusqu’à examiner, avec force techniques journalistiques, le surnaturel (ce monument d’obscurantisme qu’est le magazine Mystères sur TF1).
Le reportage « Western Avenue » est disponible ici sur le site de l’INA (1,99 euro), les trois premières minutes gratuites.
Le reportage « 40 000 voisins » est disponible ici sur le site de l’INA (gratuit).
Je remercie Jean-Baptiste Favory pour les captures d’écran de ces deux émissions.
[Annexe : extrait de l’émission Histoire parallèle (Marc Ferro, Arte, mai 1993)]
Voix off sur images de foule assistant à l’inauguration d’un monument aux États-Unis (sous-titrée), extrait d’un reportage soviétique datant de mai 1943 : « Tel était le village de Lidice en Tchécoslovaquie avant que les Allemands ne le rasent et ne massacrent ses habitants. Ce bourg américain a été rebaptisé Lidice en mémoire de ceux qui y sont morts pour la liberté. L’inauguration du monument aux martyrs de Lidice a rassemblé le bourg et les alentours qui comptent de nombreux Tchécoslovaques. Lidice vit ! ».
Marc Ferro (en plateau) : « Les Soviétiques nous montrent maintenant cette cérémonie américaine de la reconstruction de la ville de Lidice pour un massacre qui a eu lieu il y a plus d’un an. Ce document datant de juin 1942, et qu’on a d’ailleurs déjà vu à Histoire parallèle n’est pas innocent. C’est pour effacer [le massacre de] Katyn dont on commençait à parler partout ; il montre le massacre par les Allemands d’une ville tchèque. Mais c’est à nous justement de révéler pourquoi on nous montre ça maintenant, et ce dont les Russes bien sûr ne pouvaient pas se douter ».
Si ce document n’est pas innocent, c’est parce qu’il constitue un aveu, indirect certes, mais aveu quand même. En reportant sur d’autres, on reporte la culpabilité sur d’autres ; en ce sens, le document éponge par massacre allemand interposé la culpabilité ressentie par les autorités soviétiques. Ferro insiste sur l’incongruité temporelle du reportage, tourné en juin 1942, rediffusé sans explication en mai 1943 comme s’il s’agissait d’une actualité récente. On reconnait facilement ici le concept freudien de dénégation (Verneinung), où on manifeste indirectement un désir en affirmant (vivement) le contraire, alors qu’autrui n’a rien demandé. Plus le reportage se libère des impératifs temporels de l’actualité, plus il s’expose à laisser exprimer des désirs inconscients. Et du même coup, plus il se libère des impératifs d’un lieu d’actualité, plus il s’expose à devenir le lieu de projection de ses désirs : on est à Lidice, États-Unis, pour parler du massacre à Lidice, Tchécoslovaquie, pour refouler (mais il y a retour du refoulé par ce double déplacement) le massacre des officiers polonais à Katyn, en URSS. Si on peut partir des images des actualités à des fins de contre-histoire, c’est parce que celles-ci permettent, de manière privilégiée, de dégager dans des symptômes analysés le discours de l’Autre (Lacan) qui se niche dans ce qui se présente comme un discours de vérité.
Extrait de David Buxton, Le reportage de télévision en France depuis 1959, L’Harmattan, 2000, pp. 88-9.
Notes
1. Hervé Brusini et Francis James, Voir la Vérité : le journalisme de télévision, PUF, 1982. Il s’agit d’un ouvrage tiré d’une thèse de doctorat présenté en commun avec, chose rare, un document audiovisuel en soutien (archivé à l’INA). [Par la suite, Brusini a été journaliste, puis directeur de l’information à la télévision publique, et James enseignant-chercheur en information-communication à l’université de Paris Nanterre].
2. ibid, p. 22-23.
3. Michel Foucault, Surveiller et Punir, Gallimard, 1975, pp. 226-229.
4. A ce propos, voir le livre de Gérard Leblanc sur les journaux télévisés, Treize heures/Vingt heures, le monde en suspens, Hitzeroth, Marburg (R.F.A.), 1987, surtout les pages 13-30. « Ce sont les pratiques juridiques qui ont donné naissance au mot « information ». Aujourd’hui encore, ouvrir une information fait partie de l’instruction d’une affaire. » (p. 13). « Toute information-infraction est virtuellement une information-événement » (p. 26).
5. Michael Schudson, Discovering the News. A social history of American newspapers, Basic Books, New York, 1978. Pour une histoire synthétique en français, voir l’essai de Michael Palmer, « Les héritiers de Théophraste », in J.-F. Lacan, M. Palmer et D. Ruellan, Les journalistes, Syros, 1994.
6. Voir Pierre Sorlin, Esthétiques de l’audiovisuel, Nathan, 1992, p. 48 et sq.
7. Francis James, « Le problème de l’évolution du statut de l’image dans l’information télévisée », in Histoire et médias : journalisme et journalistes français 1950-1990 (sous la direction de Marc Martin), Albin Michel, 1991, p. 113.
8. Jacques Derrida, De la grammatologie, Minuit, 1967, p. 203 et sq.
9. Brusini et James, op cit., p. 83.
10. Cité in ibid, p. 85-6. Pour la petite histoire, cette formule, mal reçue, fut abandonnée après quelques mois seulement. L’émergence du commentaire sur images s’écartant de la simple description, et impliquant explications et points de vue correspond à une conquête professionnelle, face à la conception de Peyrefitte fondée sur la séparation entre images d’actualité et commentaires en studio prononcés par des journalistes « sûrs ».
11. Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Maspero, 1966 (réédité 2014 aux Éditions ENS, Lyon).
12. Freud, Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, 1984, p. 83. Voir aussi Patrick Lacoste, L’étrange cas du Professeur M : psychanalyse à l’écran, Gallimard, 1990, p. 80 ; Paul-Laurent Assoun, Freud et les sciences sociales, Armand Collin, 1993 ; Roland Chemama (dir.), Dictionnaire de la psychanalyse, Larousse, 1993, p. 275 (entrée sur « surmoi ») ; Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, 1967, pp. 152-6 (définition du fantasme).
13. Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, 1987, pp. 97-117. De Certeau nous rappelle que Freud invalide la coupure entre psychologie individuelle et psychologie collective, et considère le « pathologique » comme une région où les fonctionnements structuraux de l’expression humaine se dévoilent.
14. Marc Ferro, L’information en uniforme, Ramsay, 1991, p. 84. [Dans une note en bas de cette page, Ferro cite mon livre sur les séries télévisées (De Bonanza à Miami Vice, Espace européen, 1991)]. Voir du même auteur Cinéma et Histoire, Gallimard, 1993, surtout les chapitres « Le film, contre-analyse de la société » (article qui date de 1971), et « Critique des actualités ».
15. Freud, « Un enfant est battu », Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973, pp. 219-243.
16. Pierre Mœglin, « Paillettes électroniques », Dossiers de l’audiovisuel, 11, 1987, p.29. Voir également du même auteur : « Journaux télévisés : enjeux scénographiques des nouveaux traitements de l’image », Quaderni, 4, 1988 ; « Une scénographie en quête de modernité : de nouveaux traitements de l’image au journal télévisé », Réseaux, 4 : 21, 1986, pp. 31-69.
17. Dans une interview donnée à Télérama, Patrick Le Lay, le PDG de TF1 à l’époque, a pris la défense du magazine 52 sur la Une, critiqué pour avoir trop insisté sur les fesses des jeunes femmes thaïlandaises : « Cette émission n’est pas de l’information. C’est du reportage-documentaire ». Cité dans Le Canard Enchaîné, 23/02/94, p. 6.
 BUXTON David, « Le lieu du fantasme : le commentaire sur images dans les magazines de reportages à la télévision française 1960-92 – David BUXTON», [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2017, mis en ligne le 1er avril 2017. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/fantasme-commentaire-images-reportage-television-david-buxton/
BUXTON David, « Le lieu du fantasme : le commentaire sur images dans les magazines de reportages à la télévision française 1960-92 – David BUXTON», [en ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2017, mis en ligne le 1er avril 2017. URL : http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/fantasme-commentaire-images-reportage-television-david-buxton/


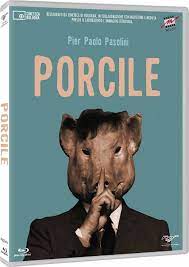
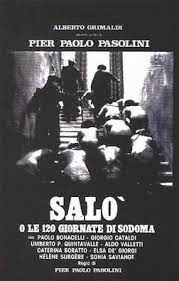
 SCHALK Owen, «Disney, « Salò » et l’art non consommable de Pasolini – Owen SCHALK», Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2022, mis en ligne le 1er mai 2022. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/disney-salo-et-lart-non-consommable-de-pasolini-owen-schalk/
SCHALK Owen, «Disney, « Salò » et l’art non consommable de Pasolini – Owen SCHALK», Articles [En ligne], Web-revue des industries culturelles et numériques, 2022, mis en ligne le 1er mai 2022. URL : https://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle/disney-salo-et-lart-non-consommable-de-pasolini-owen-schalk/


























 En contrepartie de l’obésité, il y a quelque chose de mortifère qui se dégage constamment du ventre dans Les Soprano, comme si cette partie du corps était constamment asphyxiée par un monde par trop vénéneux. Lorsque Christopher et Tony ont sombré dans le coma après avoir été blessés par balle, c’est leur ventre qui en pâtit gravement. Christopher subit une opération de la rate, tandis que Tony, le pancréas perforé par une balle, exhibe une plaie béante assez spectaculaire, rappelant le gore existentiel d’un David Cronenberg. Au cinquième épisode de la sixième saison, Tony, en convalescence après que les médecins ont recousu la plaie béante de son ventre, veut imposer son leadership à ses hommes, qui ont commencé à discerner sa faiblesse à la suite à son coma. Sentant que ses hommes le voient d’un autre œil après son hospitalisation, il se rue sur l’un d’entre eux et le tabasse gratuitement, puis s’empresse de se réfugier dans les toilettes, où il vomira du sang en abondance. Le circuit mental qui l’avait conduit à ouvrir la porte de cette démesure arrogante contre l’un de ses hommes en le rossant n’a pu être parcouru sans que son ventre en pâtisse.
En contrepartie de l’obésité, il y a quelque chose de mortifère qui se dégage constamment du ventre dans Les Soprano, comme si cette partie du corps était constamment asphyxiée par un monde par trop vénéneux. Lorsque Christopher et Tony ont sombré dans le coma après avoir été blessés par balle, c’est leur ventre qui en pâtit gravement. Christopher subit une opération de la rate, tandis que Tony, le pancréas perforé par une balle, exhibe une plaie béante assez spectaculaire, rappelant le gore existentiel d’un David Cronenberg. Au cinquième épisode de la sixième saison, Tony, en convalescence après que les médecins ont recousu la plaie béante de son ventre, veut imposer son leadership à ses hommes, qui ont commencé à discerner sa faiblesse à la suite à son coma. Sentant que ses hommes le voient d’un autre œil après son hospitalisation, il se rue sur l’un d’entre eux et le tabasse gratuitement, puis s’empresse de se réfugier dans les toilettes, où il vomira du sang en abondance. Le circuit mental qui l’avait conduit à ouvrir la porte de cette démesure arrogante contre l’un de ses hommes en le rossant n’a pu être parcouru sans que son ventre en pâtisse. Tout cela est probablement la meilleure façon d’approcher, ou du moins d’historiciser
Tout cela est probablement la meilleure façon d’approcher, ou du moins d’historiciser


















 Le rapport à la photographie participe chez Cimino d’une perception « feuilletée » de l’histoire. L’objet photographique est fréquemment utilisé pour jeter des ponts entre les différents fragments de l’œuvre. Ainsi la procession funèbre de Year of the Dragon (1985), avec les grands portraits en noir et blanc du parrain assassiné est un motif fort, évoquant irrésistiblement les photographies des trois futurs soldats déployées sur un des murs de la grande salle Lemko dans The Deer Hunter ; le film de 1985 a bien été pensé comme la conclusion de la « trilogie américaine ». Mais surtout, l’usage profondément mélancolique de la photographie est mis au service d’une réflexion sur l’histoire qui contribue à la difficulté d’interprétation du propos cinématographique. Ainsi, au cours de la même scène, il est frappant de constater que la place accordée au cours de cette séquence longue d’une vingtaine de minutes aux trois portraits, eux-mêmes d’une taille démesurée, relève d’une forme de sous-texte. Est ici convoqué un autre temps que celui objectivement mis en scène (les photographies représentent les trois appelés Mike, Steven et Nick à la fin de l’adolescence, soit une période quasi contemporaine du récit filmique) ; les trois soldats, offerts en sacrifice par la communauté, sont déjà morts. La mise en scène et l’esthétique construites par ce mur de l’histoire sur lequel prennent place les trois portraits, entre vitraux, couronnes de fleurs et bannières étoilées, s’inscrivent dans une représentation très identifiable du souvenir de la perte et de la mort à l’ère de la guerre industrielle ; c’est moins ici le Vietnam à venir que l’anéantissement de communautés entières qui est convoqué (la population de Clairton est présentée comme homogène, d’extraction russe).
Le rapport à la photographie participe chez Cimino d’une perception « feuilletée » de l’histoire. L’objet photographique est fréquemment utilisé pour jeter des ponts entre les différents fragments de l’œuvre. Ainsi la procession funèbre de Year of the Dragon (1985), avec les grands portraits en noir et blanc du parrain assassiné est un motif fort, évoquant irrésistiblement les photographies des trois futurs soldats déployées sur un des murs de la grande salle Lemko dans The Deer Hunter ; le film de 1985 a bien été pensé comme la conclusion de la « trilogie américaine ». Mais surtout, l’usage profondément mélancolique de la photographie est mis au service d’une réflexion sur l’histoire qui contribue à la difficulté d’interprétation du propos cinématographique. Ainsi, au cours de la même scène, il est frappant de constater que la place accordée au cours de cette séquence longue d’une vingtaine de minutes aux trois portraits, eux-mêmes d’une taille démesurée, relève d’une forme de sous-texte. Est ici convoqué un autre temps que celui objectivement mis en scène (les photographies représentent les trois appelés Mike, Steven et Nick à la fin de l’adolescence, soit une période quasi contemporaine du récit filmique) ; les trois soldats, offerts en sacrifice par la communauté, sont déjà morts. La mise en scène et l’esthétique construites par ce mur de l’histoire sur lequel prennent place les trois portraits, entre vitraux, couronnes de fleurs et bannières étoilées, s’inscrivent dans une représentation très identifiable du souvenir de la perte et de la mort à l’ère de la guerre industrielle ; c’est moins ici le Vietnam à venir que l’anéantissement de communautés entières qui est convoqué (la population de Clairton est présentée comme homogène, d’extraction russe).