Actualités des industries culturelles et numériques #26, décembre 2014
La Web-revue : de la Kulturindustrie d’hier aux industries culturelles, créatives et numériques d’aujourd’hui, s’est ouvert un champ interdisciplinaire pour tous ceux dont les recherches interrogent la culture populaire industrialisée et les médias. Cette rubrique propose de suivre les actualités des industries culturelles et créatives du côté des professionnels, qui sont souvent divisés quant à la bonne stratégie à adopter face à l’innovation constante, d’où des débats « internes » dont doit tenir compte l’approche critique de la Web-revue.
Interdit à la reproduction payante
Les zombies postapocalyptiques « mangent » la télévision
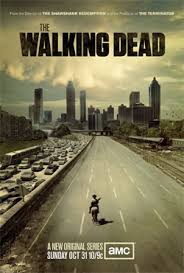 Dans l’attente de regarder les zombies de The Walking Dead, 17,3 millions de téléspectateurs américains se sont rassemblés devant la chaîne câblée AMC le 12 octobre pour le début de la cinquième saison. À titre de comparaison, le premier épisode de la saison 4 a drainé 16,3 millions. Trois autres séries traitant des revenants sont actuellement programmées aux États-Unis. Depuis septembre, la chaîne Syfy diffuse Z Nation, dont l’intrigue démarre trois ans après qu’un virus a transformé quasiment tout le monde en morts-vivants. Un groupe de survivants doit transporter la seule personne immunisée connue au seul laboratoire capable de fabriquer un vaccin. Pour reprendre les mots de Pauline Croquet du Monde : « [L]’esthétique générale de Z Nation ressemble à celle de The Walking Dead : une atmosphère de plomb, des armes, une combinaison éclectique de survivants poussiéreux et méfiants qui tentent de se rappeler que l’union peut faire la force ».
Dans l’attente de regarder les zombies de The Walking Dead, 17,3 millions de téléspectateurs américains se sont rassemblés devant la chaîne câblée AMC le 12 octobre pour le début de la cinquième saison. À titre de comparaison, le premier épisode de la saison 4 a drainé 16,3 millions. Trois autres séries traitant des revenants sont actuellement programmées aux États-Unis. Depuis septembre, la chaîne Syfy diffuse Z Nation, dont l’intrigue démarre trois ans après qu’un virus a transformé quasiment tout le monde en morts-vivants. Un groupe de survivants doit transporter la seule personne immunisée connue au seul laboratoire capable de fabriquer un vaccin. Pour reprendre les mots de Pauline Croquet du Monde : « [L]’esthétique générale de Z Nation ressemble à celle de The Walking Dead : une atmosphère de plomb, des armes, une combinaison éclectique de survivants poussiéreux et méfiants qui tentent de se rappeler que l’union peut faire la force ».
 Encouragée par le triomphe de The Walking Dead, AMC vient de commander un épisode pilote pour une série dérivée qui devrait se dérouler dans d’autres parties du monde. Le président de la chaîne, Charlie Collier, a assuré que la nouvelle série sera « une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages », mais les ressorts psychologiques devraient être identiques. Pour travailler sur le pilote, Robert Kirkman, le père de la bande dessinée originale (avec Frank Darabont) et producteur de la série phare, sera épaulé par Dave Erickson, le producteur de Sons of Anarchy.
Encouragée par le triomphe de The Walking Dead, AMC vient de commander un épisode pilote pour une série dérivée qui devrait se dérouler dans d’autres parties du monde. Le président de la chaîne, Charlie Collier, a assuré que la nouvelle série sera « une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages », mais les ressorts psychologiques devraient être identiques. Pour travailler sur le pilote, Robert Kirkman, le père de la bande dessinée originale (avec Frank Darabont) et producteur de la série phare, sera épaulé par Dave Erickson, le producteur de Sons of Anarchy.
CW, une (petite) chaîne network qui vise les 18-34 ans, prépare pour 2015 une adaptation de la bande dessinée iZOMBIE (DC-Vertigo), mélange de Veronica Mars (dont le créateur Rob Thomas est aussi producteur de la nouvelle série), Ghost Whisperer et Vampire Diaries. Lors d’une soirée qui tourne mal, une étudiante (Gwen dans la bande dessinée, Liv dans la série) se transforme en morte-vivante. Afin d’épargner les humains, elle travaille dans une morgue pour se nourrir des morts. En mangeant leur cervelle, elle accède à leurs (mauvais) souvenirs, et par respect envers eux, se consacre à résoudre les crimes à l’origine de leurs morts violentes. La bande dessinée originale contient même des éléments « philosophiques » : la « surâme » (pensées, souvenirs) située dans le cerveau (oversoul, dérivée du concept éponyme de Ralph Waldo Emerson, fondateur du transcendantalisme), et la « sous-âme » (émotions, désirs) située dans le cœur (undersoul). Par jeu de combinaisons, les fantômes sont des surâmes sans corps, les esprits frappeurs des sous-âmes sans corps, les vampires des corps sans sous-âme, les zombies des corps sans surâme, et les morts-vivants la synthèse de la surâme et de la sous-âme. Comme les vivants ? Il reste à voir dans quelle mesure ces éléments seront intégrés dans la série télévisée.
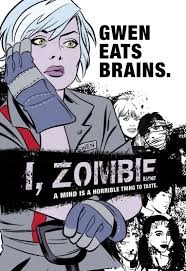 Après les retransmissions de matchs de football américain, The Walking Dead (série) et The Big Bang Theory (sitcom) sont les programmes de télévision les plus rentables. Selon Advertising Age, les trente secondes d’un spot publicitaire pendant les coupures de The Walking Dead peuvent monter à plus de 400 000 $ (313 330 €), alors que pour The Big Bang Theory, un spot est facturé en moyenne 344 827 $. Dans le cas de The Walking Dead, même un spot acheté bien en avance coûte entre 200 et 260 000 $. En 2013, le bimensuel new-yorkais Complex a calculé qu’à raison de 18 minutes de publicité et d’un coût moyen de 2,75 millions $ (relativement bon marché), chaque épisode pourrait rapporter 11 millions $ de bénéfices sur le seul marché américain. Ce niveau de rentabilité est en grande partie dû aux salaires « modestes » des acteurs. Andrew Lincoln (Rick), qui incarne le personnage central de The Walking Dead, n’a touché « que » 90 000 $ par épisode en 2013 (en comparaison, les trois acteurs principaux de The Big Bang Theory ont gagné chacun un million $ par épisode, ce qui en fait d’eux les mieux payés à la télévision américaine).
Après les retransmissions de matchs de football américain, The Walking Dead (série) et The Big Bang Theory (sitcom) sont les programmes de télévision les plus rentables. Selon Advertising Age, les trente secondes d’un spot publicitaire pendant les coupures de The Walking Dead peuvent monter à plus de 400 000 $ (313 330 €), alors que pour The Big Bang Theory, un spot est facturé en moyenne 344 827 $. Dans le cas de The Walking Dead, même un spot acheté bien en avance coûte entre 200 et 260 000 $. En 2013, le bimensuel new-yorkais Complex a calculé qu’à raison de 18 minutes de publicité et d’un coût moyen de 2,75 millions $ (relativement bon marché), chaque épisode pourrait rapporter 11 millions $ de bénéfices sur le seul marché américain. Ce niveau de rentabilité est en grande partie dû aux salaires « modestes » des acteurs. Andrew Lincoln (Rick), qui incarne le personnage central de The Walking Dead, n’a touché « que » 90 000 $ par épisode en 2013 (en comparaison, les trois acteurs principaux de The Big Bang Theory ont gagné chacun un million $ par épisode, ce qui en fait d’eux les mieux payés à la télévision américaine).
Les nouvelles séries de zombies cherchent à se démarquer entre elles en intégrant à des dosages divers des éléments de science-fiction, d’horreur, de policier et de teen culture. Si le cœur de cible reste les 18-34 ans, il est jugé important de grignoter sur la catégorie 12-17 ans. Pour ce faire, les producteurs d’iZombie (notez l’orthographe différente) ont choisi d’adoucir les éléments pure gore de la bande dessinée en faveur d’un style plus romantique qui correspond mieux aux goûts des adolescents. Une autre tactique, qui profite de l’armée de geeks érudits qui sévissent sur la web, consiste à multiplier les références « intertextuelles » à d’autres séries (Lost, Heroes, Vampire Diaries, etc.) en faisant appel à des acteurs issus de celles-ci.
 Pour les publicitaires, The Walking Dead a modifié le paysage de la télévision américaine à plusieurs égards. D’abord, elle a déclenché la tendance générale vers la « série limitée » (en épisodes) inspirée par le câble. Avec seulement 16 épisodes par saison, les tarifs publicitaires profitent de l’effet de rareté ainsi créé. Un exemple d’une « série limitée » hertzienne à succès : Sleepy Hollow (Fox), l’histoire d’un revenant adaptée du film éponyme de Tim Burton, dont la première saison n’a pas dépassé 13 épisodes (et la 2ème saison, 15). Deuxièmement, certaines grandes marques sont désormais plus enclines à s’associer avec des séries peu respectables, pourvues qu’elles drainent une audience massive de jeunes. La plupart de marques, cependant, renâclent encore. The Walking Dead a été jugée incompatible par les fabricants du poudre de lavage, de la dentifrice, et de la vinaigrette ; Kentucky Fried Chicken a dû se ressaisir en catastrophe après un placement « malheureux ». Mais d’autres s’y retrouvent. Le fabricant de voitures 4 x 4 Hyundai a une étroite association avec la série depuis la saison 2, au point où son modèle Tucson est devenu un quasi-personnage. Récemment, Hyundai a lancé un concours pour la meilleure machine de survie aux zombies via son application « Walking Dead Chop Shop ». D’après son président, Steve Shannon, « The Walking Dead contient les ingrédients clés qu’on recherche dans une série aujourd’hui : non seulement un bon audimat, mais du bavardage sur les réseaux sociaux, une base loyale de fans, et une série dérivée réussie, Talking Dead ». Cette dernière a quand même drainé 5,2 millions de téléspectateurs pour l’épisode final de la première saison, chiffre non négligeable pour une série dérivée. Selon Jason Croddy, publicitaire chez Initiative qui a collaboré avec Hyundai : « Nous sommes toujours à la recherche de biens (properties, on parle des séries !) avec une base loyale de fans qui sont passionnés et enthousiastes ».
Pour les publicitaires, The Walking Dead a modifié le paysage de la télévision américaine à plusieurs égards. D’abord, elle a déclenché la tendance générale vers la « série limitée » (en épisodes) inspirée par le câble. Avec seulement 16 épisodes par saison, les tarifs publicitaires profitent de l’effet de rareté ainsi créé. Un exemple d’une « série limitée » hertzienne à succès : Sleepy Hollow (Fox), l’histoire d’un revenant adaptée du film éponyme de Tim Burton, dont la première saison n’a pas dépassé 13 épisodes (et la 2ème saison, 15). Deuxièmement, certaines grandes marques sont désormais plus enclines à s’associer avec des séries peu respectables, pourvues qu’elles drainent une audience massive de jeunes. La plupart de marques, cependant, renâclent encore. The Walking Dead a été jugée incompatible par les fabricants du poudre de lavage, de la dentifrice, et de la vinaigrette ; Kentucky Fried Chicken a dû se ressaisir en catastrophe après un placement « malheureux ». Mais d’autres s’y retrouvent. Le fabricant de voitures 4 x 4 Hyundai a une étroite association avec la série depuis la saison 2, au point où son modèle Tucson est devenu un quasi-personnage. Récemment, Hyundai a lancé un concours pour la meilleure machine de survie aux zombies via son application « Walking Dead Chop Shop ». D’après son président, Steve Shannon, « The Walking Dead contient les ingrédients clés qu’on recherche dans une série aujourd’hui : non seulement un bon audimat, mais du bavardage sur les réseaux sociaux, une base loyale de fans, et une série dérivée réussie, Talking Dead ». Cette dernière a quand même drainé 5,2 millions de téléspectateurs pour l’épisode final de la première saison, chiffre non négligeable pour une série dérivée. Selon Jason Croddy, publicitaire chez Initiative qui a collaboré avec Hyundai : « Nous sommes toujours à la recherche de biens (properties, on parle des séries !) avec une base loyale de fans qui sont passionnés et enthousiastes ».
Brian Steinberg, responsable de la rubrique télévision à Advertising Age, pense que les autres chaînes seront condamnées à terme à s’inspirer des séries comme The Walking Dead, même si la trame de celle-ci, déprimante et pessimiste, va radicalement à l’encontre de l’ambiance positive et vivifiante réclamée par les annonceurs depuis toujours. En cela, la série marque, selon lui, un déplacement de ton à la télévision américaine. Une série comme Revolution (NBC, 2012-14), qui est partie d’un groupe de survivants vivant dans un monde postapocalyptique sans électricité, a été une tentative d’adapter cette trame pour une audience plus mainstream. Steinberg a demandé déjà en 2012 : « Si The Walking Dead peut avoir cet effet en 2012, qui pourrait dire quel type de programme fera fureur en 2020 ? ».
Sources : « Le Monde », 19-20 oct. 2014 (Pauline Croquet, « Les zombies contaminent les écrans de télévision ») ; entrée wikipédia (en anglais) « iZOMBIE » ; « Advertising Age », déc 5, 2012 (Brian Steinberg, « Have AMC’s Zombies already eaten TV ? ») ; « Advertising Age », oct. 11, 2013 (Jeanine Poggi, « How AMC’s Walking Dead Zombies reinvented TV »).
On peut suivre Brian Steinberg sur Twitter @bristei.
 De quoi les zombies sont-ils le nom ? Poser cette question, c’est déjà pointer les limites d’une approche des produits culturels uniquement en termes d’économie politique. Si les contenus ne peuvent pas être directement reliés à la logique du capital, ils ne sont pas complètement arbitraires par rapport à l’évolution de celle-ci. Précisons d’emblée que la question est difficile, d’autant qu’une analyse vraiment satisfaisante des ressorts idéologiques du fantastique devrait tenir compte des montées et des reflux de ses figures diverses : les fantômes, les extraterrestres, les loups-garous, les vampires, et les zombies, figures pour la plupart fort anciennes et préscientifiques, dont la signification est loin d’être fixe. Mais avant d’entrer dans de telles nuances, une analyse convaincante doit aussi expliquer ce que ces figures du fantastique ont en commun. Pendant les vingt dernières années, les extraterrestres, les vampires et les morts-vivants se sont succédé sur les écrans américains ; de façon décisive, les nouvelles séries fantastiques font coexister (et même collaborer !) vivants, morts-vivants et fantômes dans le même assemblage.
De quoi les zombies sont-ils le nom ? Poser cette question, c’est déjà pointer les limites d’une approche des produits culturels uniquement en termes d’économie politique. Si les contenus ne peuvent pas être directement reliés à la logique du capital, ils ne sont pas complètement arbitraires par rapport à l’évolution de celle-ci. Précisons d’emblée que la question est difficile, d’autant qu’une analyse vraiment satisfaisante des ressorts idéologiques du fantastique devrait tenir compte des montées et des reflux de ses figures diverses : les fantômes, les extraterrestres, les loups-garous, les vampires, et les zombies, figures pour la plupart fort anciennes et préscientifiques, dont la signification est loin d’être fixe. Mais avant d’entrer dans de telles nuances, une analyse convaincante doit aussi expliquer ce que ces figures du fantastique ont en commun. Pendant les vingt dernières années, les extraterrestres, les vampires et les morts-vivants se sont succédé sur les écrans américains ; de façon décisive, les nouvelles séries fantastiques font coexister (et même collaborer !) vivants, morts-vivants et fantômes dans le même assemblage.
 La célébration actuelle des zombies résulte à un niveau très général de la rencontre de plusieurs tendances historiques. D’abord, l’influence de la pop culture des années 1960 (mariage d’une culture issue des classes populaires avec une nouvelle culture commerciale) a eu pour effet la progressive revalorisation de formes jadis méprisées en avant-garde d’une modernité essentiellement organisée autour de la consommation de masse. Ce mouvement, qui a vu des figures mal vues, aux marges de la culture populaire devenir de plus en plus mainstream, n’a pas cessé de gagner en force depuis. La deuxième influence vient à ce que j’ai appelé l’avatarisation des personnages (le gommage de toute profondeur psychologique) qui accompagne l’ouverture des fictions audiovisuelles au marché international à partir des années 1960 [1]. Un des aboutissements de ce processus, c’est l’engouement du public chinois pour les super-héros issus de la bande dessinée américaine des années 1960. La troisième influence, qui remonte aux débuts de la crise dans les années 1970, et les premières attaques contre les acquis sociaux, touche à ce que j’ai caractérisé comme la quasi-impossibilité pour les protagonistes d’incarner un projet social positif [2], d’où une passivité de fait, une posture essentiellement défensive vis à vis un monde hostile dans lequel la méfiance extrême devient la seule manière sensée de se comporter avec les autres, y compris ses amis. « Ne faites confiance à personne », disait Fox Mulder (The X-Files) déjà dans les années 1990. Sous l’effet d’une crise structurelle profonde et chronique, c’est le lien social qui se fragilise. Or, aucune société (et aucun échange marchand) ne peut fonctionner sans un minimum de confiance.
La célébration actuelle des zombies résulte à un niveau très général de la rencontre de plusieurs tendances historiques. D’abord, l’influence de la pop culture des années 1960 (mariage d’une culture issue des classes populaires avec une nouvelle culture commerciale) a eu pour effet la progressive revalorisation de formes jadis méprisées en avant-garde d’une modernité essentiellement organisée autour de la consommation de masse. Ce mouvement, qui a vu des figures mal vues, aux marges de la culture populaire devenir de plus en plus mainstream, n’a pas cessé de gagner en force depuis. La deuxième influence vient à ce que j’ai appelé l’avatarisation des personnages (le gommage de toute profondeur psychologique) qui accompagne l’ouverture des fictions audiovisuelles au marché international à partir des années 1960 [1]. Un des aboutissements de ce processus, c’est l’engouement du public chinois pour les super-héros issus de la bande dessinée américaine des années 1960. La troisième influence, qui remonte aux débuts de la crise dans les années 1970, et les premières attaques contre les acquis sociaux, touche à ce que j’ai caractérisé comme la quasi-impossibilité pour les protagonistes d’incarner un projet social positif [2], d’où une passivité de fait, une posture essentiellement défensive vis à vis un monde hostile dans lequel la méfiance extrême devient la seule manière sensée de se comporter avec les autres, y compris ses amis. « Ne faites confiance à personne », disait Fox Mulder (The X-Files) déjà dans les années 1990. Sous l’effet d’une crise structurelle profonde et chronique, c’est le lien social qui se fragilise. Or, aucune société (et aucun échange marchand) ne peut fonctionner sans un minimum de confiance.
Qu’il s’agisse d’un monde préapocalyptique (The X-Files dans les années 1990), ou postapocalyptique (The Walking Dead), les ressorts sont similaires : le plus-de-jouir (concept du psychanalyste Jacques Lacan calqué sur celui de la plus-value chez Marx) apporté par l’idée même d’apocalypse, le désir de celle-ci. « La manière la plus facile de dégager le plus-de-jouir idéologique dans une formation idéologique, écrit le philosophe slovène Slavoj Zizek, c’est de lire celle-ci comme un rêve afin d’analyser le déplacement qui y travaille » [3]. Zizek en cite deux exemples : un patient de Freud qui, dans un rêve, rencontre avec bonheur une ancienne amante à l’enterrement de son père ; un film de science-fiction des années 1950, similaire aux séries traitées ici, dans lequel un virus à fait disparaître la population de la Californie, ce qui offre la possibilité aux quelques survivants de redécouvrir le bonheur d’une vie simple fondée sur la solidarité organique. Dans les deux cas, la mort ou la catastrophe, c’est le prix à payer pour la réalisation d’un désir qui est en même temps sadique (survivant) et masochiste (victime).
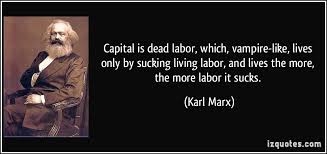 La figure du vampire ou du mort-vivant dans ces séries est donc surdéterminée : métaphore du capitalisme, et expression d’un au-delà de celui-ci, certes sous une forme « survivaliste », et profondément pessimiste. Plus encore que le fantôme ou le vampire, le zombie représente le degré zéro du lien social, le point limite du rapport avec l’autre dans une société qui se dévore. Nul échange possible avec lui ! Le Capital contient plusieurs passages mémorables où Marx fait référence aux vampires pour caractériser les capitalistes, et le processus du capitalisme lui-même [4]. Pour le critique littéraire italien Franco Moretti, le désir du sang de Dracula est une métaphore pour le désir d’accumulation du capital, désir qui n’a pas honte de lui-même : « comme le capital, Dracula est poussé vers une croissance perpétuelle, une expansion illimitée de son domaine ; l’accumulation est inhérente dans sa nature » [5]. La figure du vampire se renforce singulièrement aujourd’hui, qui voit la domination outrancière du capitalisme financier, du « capital mort » qui ne cesse de demander son tribut sacrificiel aux vivants.
La figure du vampire ou du mort-vivant dans ces séries est donc surdéterminée : métaphore du capitalisme, et expression d’un au-delà de celui-ci, certes sous une forme « survivaliste », et profondément pessimiste. Plus encore que le fantôme ou le vampire, le zombie représente le degré zéro du lien social, le point limite du rapport avec l’autre dans une société qui se dévore. Nul échange possible avec lui ! Le Capital contient plusieurs passages mémorables où Marx fait référence aux vampires pour caractériser les capitalistes, et le processus du capitalisme lui-même [4]. Pour le critique littéraire italien Franco Moretti, le désir du sang de Dracula est une métaphore pour le désir d’accumulation du capital, désir qui n’a pas honte de lui-même : « comme le capital, Dracula est poussé vers une croissance perpétuelle, une expansion illimitée de son domaine ; l’accumulation est inhérente dans sa nature » [5]. La figure du vampire se renforce singulièrement aujourd’hui, qui voit la domination outrancière du capitalisme financier, du « capital mort » qui ne cesse de demander son tribut sacrificiel aux vivants.
 Faisant preuve de perspicacité, le journaliste Brian Steinberg se demande si « les morts qui marchent » sont les morts-vivants, ou les pauvres survivants qui doivent coexister avec eux [6]. Il est possible de lire la figure du zombie dans ce sens comme une métaphore – mi-parodique, mi-protestataire – de la vie elle-même sous le capitalisme tardif. Anecdotiquement, un ordinateur contrôlé à distance par un prédateur informatique s’appelle un « ordinateur zombie ». On a vu ces dernières années des marches des zombies (zombie walks) partout dans le monde, y compris en France. Le responsable des effets spéciaux de The Walking Dead, Greg Nicotero, a donné des conseils pour bien se ressembler à un zombie [7] : marcher comme un ivrogne, ne pas cligner les yeux, manger comme un animal, ce qui reste largement dans les cordes de n’importe quel adolescent.
Faisant preuve de perspicacité, le journaliste Brian Steinberg se demande si « les morts qui marchent » sont les morts-vivants, ou les pauvres survivants qui doivent coexister avec eux [6]. Il est possible de lire la figure du zombie dans ce sens comme une métaphore – mi-parodique, mi-protestataire – de la vie elle-même sous le capitalisme tardif. Anecdotiquement, un ordinateur contrôlé à distance par un prédateur informatique s’appelle un « ordinateur zombie ». On a vu ces dernières années des marches des zombies (zombie walks) partout dans le monde, y compris en France. Le responsable des effets spéciaux de The Walking Dead, Greg Nicotero, a donné des conseils pour bien se ressembler à un zombie [7] : marcher comme un ivrogne, ne pas cligner les yeux, manger comme un animal, ce qui reste largement dans les cordes de n’importe quel adolescent.
[1] David Buxton, Les séries télévisées : forme, idéologie et mode de production, L’Harmattan, 2010, pp. 67-8.
[2] ibid., pp. 5, 90-2, 96, 145-9.
[3] Slavoj Zizek, « Repeating Lenin » [1997], pp. 11-12 (je traduis). Jacques Lacan, « De la plus-value au plus-de-jouir », séminaire du 13 nov. 1968, in Cités, 16, 2003, pp. 129-44.
[4] Marx, Le Capital, tome 1, passim [1867]. Voir l’article de Mark Neocleous, « The Political Economy of the Dead : Marx’s vampires », 2003.
[5] Franco Moretti, Signs taken for wonders : essays in the sociology of literary forms, Verso (London), 1983, p. 91.
[6] Brian Steinberg, « Have AMC’s zombies already eaten TV ? », Advertising Age, oct 11, 2014 (lien ci-dessus).
[7] Anne-Christine Diaz, « 6 Tips for being a good zombie », Advertising Age, oct. 11, 2013.
L’overdose de super-héros ? (2)
Le modèle économique actuel du cinéma, qui tourne de plus en plus autour des franchises inspirées par la bande dessinée « alternative » des années 1960, n’est pas près de se modifier (voir « Actualités #21 », juin 2014). Une quarantaine de projets sont en production dans une offensive convergente de studios concurrents, ce qui nous mène au moins jusqu’à 2020 : mentionnons entre autres Avengers : Age of Ultron (Marvel, 2015), Ant-Man (Marvel, 2015), Captain America 3 (Marvel, 2016), Batman vs Superman (Warner Bros, 2016), Spider-Man, 2 et 3 (Sony Columbia, 2016, 2019), Wolverine 3 (Fox, 2017), Wonder Woman (Warner Bros, 2017), Les Gardiens de la Galaxie (Marvel, 2017), Spider-Woman (Sony Columbia, 2018), X-Men (Fox, 2018), La Ligue des justiciers 1 et 2 (Warner Bros, 2017, 2019), Green Lantern (Warner Bros, 2020).
 Le catalogue Marvel (racheté par Disney en 2009) contient plus de 8000 personnages, de quoi alimenter le filon pour quelques années encore. Mais avec une telle frénésie de productions, il y a risque à terme d’une saturation du marché. Dans son blog du Washington Post, la journaliste Stephanie Merry prédit un éclatement de la bulle des super-héros, comme il y a eu par le passé un effondrement de l’intérêt pour le western ou le film d’espionnage. Jusqu’ici, les échecs commerciaux cuisants ont été rares : Catwoman (2004), Jonah Hex (2010) et Green Lantern (2011). En fait, le genre a réussi à s’internationaliser et à se féminiser. L’adaptation cinématographique d’un obscur comic book pioché dans le catalogue Marvel, Les Gardiens de la Galaxie, a fait un carton planétaire ; actuellement à l’affiche en Chine, le film a déjà rapporté 70 millions $ après seulement dix jours d’exploitation. Force est de constater que la créativité de l’industrie est entièrement réorganisée autour de la fabrication de franchises avec suites, préquels et réinitialisations.
Le catalogue Marvel (racheté par Disney en 2009) contient plus de 8000 personnages, de quoi alimenter le filon pour quelques années encore. Mais avec une telle frénésie de productions, il y a risque à terme d’une saturation du marché. Dans son blog du Washington Post, la journaliste Stephanie Merry prédit un éclatement de la bulle des super-héros, comme il y a eu par le passé un effondrement de l’intérêt pour le western ou le film d’espionnage. Jusqu’ici, les échecs commerciaux cuisants ont été rares : Catwoman (2004), Jonah Hex (2010) et Green Lantern (2011). En fait, le genre a réussi à s’internationaliser et à se féminiser. L’adaptation cinématographique d’un obscur comic book pioché dans le catalogue Marvel, Les Gardiens de la Galaxie, a fait un carton planétaire ; actuellement à l’affiche en Chine, le film a déjà rapporté 70 millions $ après seulement dix jours d’exploitation. Force est de constater que la créativité de l’industrie est entièrement réorganisée autour de la fabrication de franchises avec suites, préquels et réinitialisations.
Laissons la conclusion forte à Philippe Guedj, journaliste et coréalisateur du documentaire Marvel Renaissance (diffusé sur Canal + le 7 mars 2014) :
Les grands studios ne font plus confiance qu’à des univers préexistants, ils vont piocher dans les catalogues des comics et refusent désormais de créer de nouveaux mythes comme à l’époque où surgissaient « Rocky », « Mad Max », « Star Wars »… On est dans une gigantesque matrice à consolider de la marque, de la licence afin d’inonder le marché de lucratifs produits dérivés (figurines, jouets, jeux vidéo…). Il faut bien comprendre que la raison d’être des films est avant tout d’entretenir le capital de notoriété des héros qui sont pensés comme des marques infiniment déclinables. On est parti de la bande dessinée, phénomène contre-culturel dans les années 60, pour aboutir aujourd’hui à une exploitation froide, tayloriste, industrialisée qui, même pour un fan du genre comme moi, devient franchement effrayante.
Source : « Libération », 29 oct. 2014 (« Le trop plein de Super-héros », Didier Péron).
Interview avec Philippe Guedj et Philippe Roure, réalisateurs de « Marvel Renaissance », dans Cinechronicle.com (mars 2014).
Canal + nomme un showrunner à l’américaine pour la saison 5 d’Engrenages
Pour la saison 5 de la série française acclamée, Engrenages, lancée par Canal + en 2005, la scénariste Anne Landois a été nommé « productrice artistique », équivalent français du showrunner américain, et prépare déjà la saison 6. Elle commente :
Ce rôle de « showrunner » nous manquait jusqu’ici. Nous gagnons ainsi en efficacité et en rapidité avec un seul interlocuteur, bien identifié, auprès de la chaîne, des producteurs, des auteurs, des réalisateurs, des comédiens… En tant que « showrunner », on est là pour prendre les décisions à toutes les étapes : écriture, casting, décor, costumes, montage etc.
… Cette fois-ci, nous voulions que tous les personnages ou presque travaillent sur la même affaire criminelle : ils vont faire tout le voyage ensemble. Et puis cette saison va être celle des mises à l’épreuve de chacun d’entre eux, aucun ne maîtrisant grand-chose de sa vie personnelle. Auparavant, nous partions des histoires policières que nous apportaient nos consultants dans ce domaine. Pour cette saison, nous avons pris le problème à l’envers, en partant des personnages et en nous demandant d’abord comment ils allaient évoluer.
 L’inspiration pour Landois est venue de la lecture de Homicide spécial, une enquête du journaliste Miles Corwin qui a suivi pendant quelques mois la brigade des homicides de Los Angeles, avec son lot d’erreurs, de temps morts et de fausses pistes. « Une de ces histoires m’a frappée parce qu’elle concernait une mère et son enfant. Ça a fait image pour moi, alors que Laure est enceinte ». Cette recherche de véracité est la marque de fabrique de la série, qui a fait appel à plusieurs consultants professionnels. Selon le producteur Vassili Clert : « Nous sommes partis de témoignages réels… Je pense qu’Engrenages… travaille des temps morts. On ne travaille pas la course-poursuite du flic avec son flingue, mais ce que l’on a l’habitude de couper parce que c’est chiant ».
L’inspiration pour Landois est venue de la lecture de Homicide spécial, une enquête du journaliste Miles Corwin qui a suivi pendant quelques mois la brigade des homicides de Los Angeles, avec son lot d’erreurs, de temps morts et de fausses pistes. « Une de ces histoires m’a frappée parce qu’elle concernait une mère et son enfant. Ça a fait image pour moi, alors que Laure est enceinte ». Cette recherche de véracité est la marque de fabrique de la série, qui a fait appel à plusieurs consultants professionnels. Selon le producteur Vassili Clert : « Nous sommes partis de témoignages réels… Je pense qu’Engrenages… travaille des temps morts. On ne travaille pas la course-poursuite du flic avec son flingue, mais ce que l’on a l’habitude de couper parce que c’est chiant ».
Déjà en 2012, pour la saison 4, Anne Landois a fait état des changements intervenus depuis la saison 3, où le tournage a commencé après le bouclage du scénario de six épisodes, soit à mi-saison : « En France, nous avons un peu comme défaut de commencer à tourner une fois toute la saison est écrite. C’est une folie… On ajuste les rôles au fil de la saison, en décidant, après visionnage, de donner de l’importance à un personnage qui n’avait pas autant de place dans nos premières versions… L’auteur commence à devenir un interlocuteur crédible alors que le réalisateur était souvent roi sur de nombreux unitaires. Les séries américaines et le rapport Chevalier – en 2011, il a remis à plat le statut du scénariste pour relancer la fiction française – ont fait beaucoup de bien aux auteurs ». Chaque épisode de la saison 4 a été financé à hauteur de 900 000 €, ce qui est dans la norme des productions françaises de prestige, mais quand même moins que le 1,3 million € par épisode dépensé par TF1 pendant sa politique de calques de séries américaines entre 2007-10.
La série est diffusée dans près de 70 pays, y compris en version sous-titrée (Spiral) sur BBC4 en Grande-Bretagne, une première. Aux États-Unis, Netflix en propose quatre saisons. Endemol Studios a acheté le concept afin de développer une adaptation américaine pour la chaîne câblée Showtime, sous la houlette du producteur Tom Fontana (Oz, Borgia).
Source : « Le Monde », 9-10 nov. 2014, « Les personnages, rouages d’«Engrenages » », (Martine Delahaye), p. 20. « Fluctuat.premiere.fr », 24/08/2012, « Produire une série française addictive : la méthode « Engrenages »« . series-tv.premiere.fr, « Engrenages, saison 5 : ce qu’en pense la presse« , 10/11/2014.
Sans préjuger la qualité qu’on prétend supérieure de la nouvelle saison, il faut tenir compte ici de l’effet d’annonce (ou de « com »), Anne Landois étant déjà créditée comme scénariste pour les 12 épisodes (contre 8 jusque-là) des saisons 3 et 4 (avec Eric de Barahir, policier de son état). La presse de télévision populaire est par trop unanime : « dans cette saison, les personnages sont plus fouillés », et « les dialogues remarquables évitent toute vulgarité ou facilité » (Télécâblesat) ; « l’intrigue, réaliste et sans concession, captive » (Télé Loisirs) ; « scénario de haut voltige, réalisation rigoureuse et comédiens parfaits » (Télé 7 Jours) ; « ne déroge pas à la règle d’excellence » (Télé Z).
Dans Télérama, le jugement positif (mais curieusement tentative) d’Isabelle Poitte est plus idéologique : « Pour cette cinquième saison, les auteurs ont choisi de laisser un peu de côté la vocation sociétale de la série pour se concentrer sur ses personnages… Sur qui compter quand rien ne va plus ? À cette question, la série, portée par une vision assez désespérée de la justice, répond avec un peu moins de noirceur qu’à l’accoutumée. Et aussi minuscule soit-elle, cette lueur d’espoir est la bienvenue ». Lueur d’espoir, vraiment ? Il se peut – à vérifier – que la nouvelle saison marque la transition vers un modèle plus américain (avec une orientation plus « féministe ») au lieu du modèle britannique original. Le journaliste spécialiste des séries Pierre Sérisier, tout en reconnaissant que cela reste « de la très belle ouvrage », regrette que « cette cinquième saison ne se distingue pas plus des précédentes », qu’elle « manque de souffle propre et qu’elle donne le sentiment d’un fort déjà-vu ». Bref, « un manque d’évolution des personnages » (voir son blog sur le site du « Monde »).












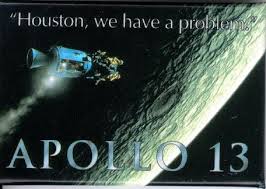


 l’original n’aurait aucun sens. Selon Philippe Manœuvre, rédacteur en chef de Rock & Folk : « Nous sommes, en ce moment, dans le creux de la vague en matière de rock, et des artistes comme Queen, Pink Floyd ou Led Zeppelin ont laissé un répertoire formidable. Il est normal qu’il y ait des musiciens qui l’interprètent. Pour moi, le rock est la musique classique d’aujourd’hui. Quand on joue du Bach ou du Chopin, on ne s’attend pas que ces derniers soient présents au concert, en train de diriger l’orchestre… ». Moins
l’original n’aurait aucun sens. Selon Philippe Manœuvre, rédacteur en chef de Rock & Folk : « Nous sommes, en ce moment, dans le creux de la vague en matière de rock, et des artistes comme Queen, Pink Floyd ou Led Zeppelin ont laissé un répertoire formidable. Il est normal qu’il y ait des musiciens qui l’interprètent. Pour moi, le rock est la musique classique d’aujourd’hui. Quand on joue du Bach ou du Chopin, on ne s’attend pas que ces derniers soient présents au concert, en train de diriger l’orchestre… ». Moins 